The Project Gutenberg EBook of Oeuvres complčtes de Alfred de Musset -
Tome 5, by Alfred De Musset
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Oeuvres complčtes de Alfred de Musset - Tome 5
Author: Alfred De Musset
Release Date: November 20, 2007 [EBook #23567]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ALFRED DE MUSSET ***
Produced by Pierre Lacaze, Suzanne Lybarger and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothčque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
OEUVRES COMPLČTES DE ALFRED DE MUSSET
ÉDITION ORNÉE DE 28 GRAVURES D'APRČS LES DESSINS DE BIDA D'UN PORTRAIT
GRAVÉ PAR FLAMENG D'APRČS L'ORIGINAL DE LANDELLE ET ACCOMPAGNÉE D'UNE
NOTICE SUR ALFRED DE MUSSET PAR SON FRČRE
* * * * *
TOME CINQUIČME
COMÉDIES
III
PARIS
EDITION CHARPENTIER
L. HÉBERT, LIBRAIRE
7, RUE PERRONET, 7
1888
UN CAPRICE
COMÉDIE EN UN ACTE
PUBLIÉE EN 1837, REPRÉSENTÉE EN 1847.
PERSONNAGES. ACTEURS QUI ONT CRÉÉ LES RÔLES.
M. DE CHAVIGNY M. BRINDEAU.
MATHILDE. Mmes JUDITH.
MADAME DE LÉRY. ALLAN-DESPRÉAUX.
_La scčne se passe dans la chambre ŕ coucher de Mathilde._
[Illustration: Un caprice]
SCČNE PREMIČRE
MATHILDE, _seule, travaillant au filet._
Encore un point, et j'ai fini.
_Elle sonne; un domestique entre._
Est-on venu de chez Janisset?
LE DOMESTIQUE.
Non, madame, pas encore.
MATHILDE.
C'est insupportable; qu'on y retourne; dépęchez-vous.
_Le domestique sort._
J'aurais dű prendre les premiers glands venus; il est huit heures; il
est ŕ sa toilette; je suis sűre qu'il va venir ici avant que tout soit
pręt. Ce sera encore un jour de retard.
_Elle se lčve._
Faire une bourse en cachette ŕ son mari, cela passerait aux yeux de
bien des gens pour un peu plus que romanesque. Aprčs un an de mariage!
Qu'est-ce que madame de Léry, par exemple, en dirait si elle le
savait? Et lui-męme, qu'en penserait-il? Bon! il rira peut-ętre du
mystčre, mais il ne rira pas du cadeau. Pourquoi ce mystčre, en effet?
Je ne sais; il me semble que je n'aurais pas travaillé de si bon
coeur devant lui; cela aurait eu l'air de lui dire: Voyez comme
je pense ŕ vous; cela ressemblerait ŕ un reproche; tandis qu'en lui
montrant mon petit travail fini, ce sera lui qui se dira que j'ai
pensé ŕ lui.
LE DOMESTIQUE, _rentrant_.
On apporte cela ŕ madame de chez le bijoutier.
_Il donne un petit paquet ŕ Mathilde._
MATHILDE.
Enfin!
_Elle se rassoit._
Quand M. de Chavigny viendra, prévenez-moi.
_Le domestique sort._
Nous allons donc, ma chčre petite bourse, vous faire votre derničre
toilette. Voyons si vous serez coquette avec ces glands-lŕ? Pas mal.
Comment serez-vous reçue maintenant? Direz-vous tout le plaisir qu'on
a eu ŕ vous faire, tout le soin qu'on a pris de votre petite personne?
On ne s'attend pas ŕ vous, mademoiselle. On n'a voulu vous montrer que
dans tous vos atours. Aurez-vous un baiser pour votre peine?
_Elle baise sa bourse et s'arręte._
Pauvre petite! tu ne vaux pas grand'chose; on ne te vendrait pas deux
louis. Comment se fait-il qu'il me semble triste de me séparer de toi?
N'as-tu pas été commencée pour ętre finie le plus vite possible?
Ah! tu as été commencée plus gaiement que je ne t'achčve. Il n'y a
pourtant que quinze jours de cela; que quinze jours, est-ce possible?
Non, pas davantage; et que de choses en quinze jours! Arrivons-nous
trop tard, petite?... Pourquoi de telles idées? On vient, je crois;
c'est lui; il m'aime encore.
UN DOMESTIQUE, _entrant_.
Voilŕ monsieur le comte, madame.
MATHILDE.
Ah, mon Dieu! je n'ai mis qu'un gland et j'ai oublié l'autre. Sotte
que je suis! Je ne pourrai pas encore lui donner aujourd'hui! Qu'il
attende un instant, une minute, au salon; vite, avant qu'il entre...
LE DOMESTIQUE.
Le voilŕ, madame.
_Il sort. Mathilde cache sa bourse._
SCČNE II
MATHILDE, CHAVIGNY.
CHAVIGNY.
Bonsoir, ma chčre, est-ce que je vous dérange?
_Il s'assoit._
MATHILDE.
Moi, Henri? quelle question!
CHAVIGNY.
Vous avez l'air troublé, préoccupé. J'oublie toujours, quand j'entre
chez vous, que je suis votre mari, et je pousse la porte trop vite.
MATHILDE.
Il y a lŕ un peu de méchanceté; mais comme il y a aussi un peu
d'amour, je ne vous en embrasserai pas moins.
_Elle l'embrasse._
Qu'est-ce que vous croyez donc ętre, monsieur, quand vous oubliez que
vous ętes mon mari?
CHAVIGNY.
Ton amant, ma belle; est-ce que je me trompe?
MATHILDE.
Amant et ami, tu ne te trompes pas.
_Ŕ part._
J'ai envie de lui donner la bourse comme elle est.
CHAVIGNY.
Quelle robe as-tu donc? Tu ne sors pas?
MATHILDE.
Non, je voulais... j'espérais que peut-ętre?...
CHAVIGNY.
Vous espériez?... Qu'est-ce que c'est donc?
MATHILDE.
Tu vas au bal? tu es superbe.
CHAVIGNY.
Pas trop; je ne sais si c'est ma faute ou celle du tailleur, mais je
n'ai plus ma tournure du régiment.
MATHILDE.
Inconstant! vous ne pensez pas ŕ moi en vous mirant dans cette glace.
CHAVIGNY.
Bah! ŕ qui donc? Est-ce que je vais au bal pour danser? Je vous jure
bien que c'est une corvée, et que je m'y traîne sans savoir pourquoi.
MATHILDE.
Eh bien! restez, je vous en supplie. Nous serons seuls, et je vous
dirai...
CHAVIGNY.
Il me semble que ta pendule avance; il ne peut pas ętre si tard.
MATHILDE.
On ne va pas au bal ŕ cette heure-ci, quoi que puisse dire la pendule.
Nous sortons de table il y a un instant.
CHAVIGNY.
J'ai dit d'atteler; j'ai une visite ŕ faire.
MATHILDE.
Ah! c'est différent. Je... je ne savais pas,... j'avais cru...
CHAVIGNY.
Eh bien?
MATHILDE.
J'avais supposé,... d'aprčs ce que tu disais... Mais la pendule va
bien; il n'est que huit heures. Accordez-moi un petit moment. J'ai une
petite surprise ŕ vous faire.
CHAVIGNY, _se levant_.
Vous savez, ma chčre, que je vous laisse libre et que vous sortez
quand il vous plaît. Vous trouverez juste que ce soit réciproque.
Quelle surprise me destinez-vous?
MATHILDE.
Rien; je n'ai pas dit ce mot-lŕ, je crois.
CHAVIGNY.
Je me trompe donc, j'avais cru l'entendre. Avez-vous lŕ ces valses de
Strauss? Prętez-les-moi, si vous n'en faites rien.
MATHILDE.
Les voilŕ; les voulez-vous maintenant?
CHAVIGNY.
Mais, oui, si cela ne vous gęne pas. On me les a demandées pour un ou
deux jours. Je ne vous en priverai pas longtemps.
MATHILDE.
Est-ce pour madame de Blainville?
CHAVIGNY, _prenant les valses_.
Plaît-il? Ne parlez-vous pas de madame de Blainville?
MATHILDE.
Moi! non. Je n'ai pas parlé d'elle.
CHAVIGNY.
Pour cette fois j'ai bien entendu.
_Il se rassoit._
Qu'est-ce que vous dites de madame de Blainville?
MATHILDE.
Je pensais que mes valses étaient pour elle.
CHAVIGNY.
Et pourquoi pensiez-vous cela?
MATHILDE.
Mais parce que... parce qu'elle les aime.
CHAVIGNY.
Oui, et moi aussi; et vous aussi, je crois? Il y en a une surtout;
comment est-ce donc? Je l'ai oubliée... Comment dit-elle donc?
MATHILDE.
Je ne sais pas si je m'en souviendrai.
_Elle se met au piano et joue._
CHAVIGNY.
C'est cela męme! C'est charmant, divin, et vous la jouez comme un
ange, ou, pour mieux dire, comme une vraie valseuse.
MATHILDE.
Est-ce aussi bien qu'elle, Henri?
CHAVIGNY.
Qui, elle? madame de Blainville? Vous y tenez, ŕ ce qu'il paraît.
MATHILDE.
Oh! pas beaucoup. Si j'étais homme, ce n'est pas elle qui me
tournerait la tęte.
CHAVIGNY.
Et vous auriez raison, madame, il ne faut jamais qu'un homme se laisse
tourner la tęte, ni par une femme ni par une valse.
MATHILDE.
Comptez-vous jouer ce soir, mon ami?
CHAVIGNY.
Eh! ma chčre, quelle idée avez-vous? On joue, mais on ne compte pas
jouer.
MATHILDE.
Avez-vous de l'or dans vos poches?
CHAVIGNY.
Peut-ętre bien. Est-ce que vous en voulez?
MATHILDE.
Moi, grand Dieu! que voulez-vous que j'en fasse?
CHAVIGNY.
Pourquoi pas? Si j'ouvre votre porte trop vite, je n'ouvre pas du
moins vos tiroirs, et c'est peut-ętre un double tort que j'ai.
MATHILDE.
Vous mentez, monsieur; il n'y a pas longtemps que je me suis aperçue
que vous les aviez ouverts, et vous me laissez beaucoup trop riche.
CHAVIGNY.
Non pas, ma chčre, tant qu'il y aura des pauvres. Je sais quel usage
vous faites de votre fortune, et je vous demande de me permettre de
faire la charité par vos mains.
MATHILDE.
Cher Henri! que tu es noble et bon! Dis-moi un peu: te souviens-tu
d'un jour oů tu avais une petite dette ŕ payer, et oů tu te plaignais
de n'avoir pas de bourse?
CHAVIGNY.
Quand donc? Ah! c'est juste. Le fait est que, quand on sort, c'est une
chose insupportable de se fier ŕ des poches qui ne tiennent ŕ rien...
MATHILDE.
Aimerais-tu une bourse rouge avec un filet noir?
CHAVIGNY.
Non, je n'aime pas le rouge. Parbleu! tu me fais penser que j'ai
justement lŕ une bourse toute neuve d'hier; c'est un cadeau. Qu'en
pensez vous?
_Il tire une bourse de sa poche._
Est-ce de bon goűt?
MATHILDE.
Voyons; voulez-vous me la montrer?
CHAVIGNY.
Tenez.
_Il la lui donne; elle la regarde, puis la lui rend._
MATHILDE.
C'est trčs joli. De quelle couleur est-elle?
CHAVIGNY, _riant_.
De quelle couleur? La question est excellente.
MATHILDE.
Je me trompe... Je veux dire... Qui est-ce qui vous l'a donnée?
CHAVIGNY.
Ah! c'est trop plaisant! sur mon honneur! vos distractions sont
adorables.
UN DOMESTIQUE, _annonçant_.
Madame de Léry!
MATHILDE.
J'ai défendu ma porte en bas.
CHAVIGNY.
Non, non, qu'elle entre. Pourquoi ne pas la recevoir?
MATHILDE.
Eh bien! enfin, monsieur, cette bourse, peut-on savoir le nom de
l'auteur?
SCČNE III
MATHILDE, CHAVIGNY, MADAME DE LÉRY, _en toilette de bal._
CHAVIGNY.
Venez, madame, venez, je vous en prie; on n'arrive pas plus ŕ propos.
Mathilde vient de me faire une étourderie qui, en vérité, vaut son
pesant d'or. Figurez-vous que je lui montre cette bourse...
MADAME DE LÉRY.
Tiens! c'est assez gentil. Voyons donc.
CHAVIGNY.
Je lui montre cette bourse; elle la regarde, la tâte, la retourne,
et, en me la rendant, savez-vous ce qu'elle me dit? Elle me demande de
quelle couleur elle est!
MADAME DE LÉRY.
Eh bien! elle est bleue.
CHAVIGNY.
Eh oui! elle est bleue... C'est bien certain,... et c'est précisément
le plaisant de l'affaire... Imaginez-vous qu'on le demande?
MADAME DE LÉRY.
C'est parfait. Bonsoir, chčre Mathilde; venez-vous ce soir ŕ
l'ambassade?
MATHILDE.
Non, je compte rester.
CHAVIGNY.
Mais vous ne riez pas de mon histoire?
MADAME DE LÉRY.
Mais si. Et qui est-ce qui a fait cette bourse? Ah! je la reconnais,
c'est madame de Blainville. Comment! vraiment vous ne bougez pas?
CHAVIGNY, _brusquement_.
Ŕ quoi la reconnaissez-vous, s'il vous plaît?
MADAME DE LÉRY.
Ŕ ce qu'elle est bleue justement. Je l'ai vue traîner pendant des
sičcles; on a mis sept ans ŕ la faire, et vous jugez si pendant ce
temps-lŕ elle a changé de destination. Elle a appartenu en idée ŕ
trois personnes de ma connaissance. C'est un trésor que vous avez lŕ,
monsieur de Chavigny; c'est un vrai héritage que vous avez fait.
CHAVIGNY.
On dirait qu'il n'y a qu'une bourse au monde.
MADAME DE LÉRY.
Non, mais il n'y a qu'une bourse bleue. D'abord, moi, le bleu m'est
odieux; ça ne veut rien dire, c'est une couleur bęte. Je ne peux pas
me tromper sur une chose pareille; il suffit que je l'aie vue une
fois. Autant j'adore le lilas, autant je déteste le bleu.
MATHILDE.
C'est la couleur de la constance.
MADAME DE LÉRY.
Bah! c'est la couleur des perruquiers. Je ne viens qu'en passant, vous
voyez, je suis en grand uniforme; il faut arriver de bonne heure dans
ce pays-lŕ; c'est une cohue ŕ se casser le cou. Pourquoi donc n'y
venez-vous pas? Je n'y manquerais pas pour un monde.
MATHILDE.
Je n'y ai pas pensé, et il est trop tard ŕ présent.
MADAME DE LÉRY.
Laissez donc, vous avez tout le temps. Tenez, chčre, je vais sonner.
Demandez une robe. Nous mettrons M. de Chavigny ŕ la porte avec son
petit meuble. Je vous coiffe, je vous pose deux brins de fleurettes,
et je vous enlčve dans ma voiture. Allons, voilŕ une affaire bâclée.
MATHILDE.
Pas pour ce soir; je reste décidément.
MADAME DE LÉRY.
Décidément! est-ce un parti pris? Monsieur de Chavigny, amenez donc
Mathilde.
CHAVIGNY, _sčchement_.
Je ne me męle des affaires de personne.
MADAME DE LÉRY.
Oh! oh! vous aimez le bleu, ŕ ce qu'il paraît. Eh bien! écoutez,
savez-vous ce que je vais faire? Donnez-moi du thé, je vais rester
ici.
MATHILDE.
Que vous ętes gentille, chčre Ernestine! Non, je ne veux pas priver
ce bal de sa reine. Allez me faire un tour de valse, et revenez ŕ
onze heures, si vous y pensez; nous causerons seules au coin du feu,
puisque M. de Chavigny nous abandonne.
CHAVIGNY.
Moi? pas du tout: je ne sais si je sortirai.
MADAME DE LÉRY.
Eh bien! c'est convenu, je vous quitte. Ŕ propos, vous savez mes
malheurs; j'ai été volée comme dans un bois.
MATHILDE.
Volée! qu'est-ce que vous voulez dire?
MADAME DE LÉRY.
Quatre robes, ma chčre, quatre amours de robes qui me venaient de
Londres, perdues ŕ la douane. Si vous les aviez vues, c'est ŕ en
pleurer; il y en avait une perse et une puce; on ne fera jamais rien
de pareil.
MATHILDE.
Je vous plains bien sincčrement. On vous les a donc confisquées?
MADAME DE LÉRY.
Pas du tout. Si ce n'était que cela, je crierais tant qu'on me les
rendrait, car c'est un meurtre. Me voilŕ nue pour cet été. Imaginez
qu'ils m'ont lardé mes robes; ils ont fourré leur sonde je ne sais par
oů dans ma caisse; ils m'ont fait des trous ŕ y mettre un doigt. Voilŕ
ce qu'on m'apporte hier ŕ déjeuner.
CHAVIGNY.
Il n'y en avait pas de bleue, par hasard?
MADAME DE LÉRY.
Non, monsieur, pas la moindre. Adieu, belle; je ne fais qu'une
apparition. J'en suis, je crois, ŕ ma douzičme grippe de l'hiver; je
vais attraper ma treizičme. Aussitôt fait, j'accours, et me plonge
dans vos fauteuils. Nous causerons douane, chiffons, pas vrai? Non,
je suis toute triste, nous ferons du sentiment. Enfin, n'importe!
Bonsoir, monsieur de l'azur... Si vous me reconduisez, je ne reviens
pas.
_Elle sort._
SCČNE IV
CHAVIGNY, MATHILDE.
CHAVIGNY.
Quel cerveau fęlé que cette femme! Vous choisissez bien vos amies!
MATHILDE.
C'est vous qui avez voulu qu'elle montât.
CHAVIGNY.
Je parierais que vous croyez que c'est madame de Blainville qui a fait
ma bourse.
MATHILDE.
Non, puisque vous me dites le contraire.
CHAVIGNY.
Je suis sűr que vous le croyez.
MATHILDE.
Et pourquoi en ętes-vous sűr?
CHAVIGNY.
Parce que je connais votre caractčre: madame de Léry est votre oracle;
c'est une idée qui n'a pas le sens commun.
MATHILDE.
Voilŕ un beau compliment que je ne mérite gučre.
CHAVIGNY.
Oh! mon Dieu, si; et j'aimerais tout autant vous voir franche
lŕ-dessus que dissimulée.
MATHILDE.
Mais, si je ne crois pas, je ne puis feindre de le croire pour vous
paraître sincčre.
CHAVIGNY.
Je vous dis que vous le croyez; c'est écrit sur votre visage.
MATHILDE.
S'il faut le dire pour vous satisfaire, eh bien! j'y consens; je le
crois.
CHAVIGNY.
Vous le croyez? et quand cela serait vrai, quel mal y aurait-il?
MATHILDE.
Aucun, et par cette raison je ne vois pas pourquoi vous le nieriez.
CHAVIGNY.
Je ne le nie pas; c'est elle qui l'a faite.
_Il se lčve._
Bonsoir; je reviendrai peut-ętre tout ŕ l'heure prendre le thé avec
votre amie.
MATHILDE.
Henri, ne me quittez pas ainsi!
CHAVIGNY.
Qu'appelez-vous _ainsi_? Sommes-nous fâchés? Je ne vois lŕ rien que de
trčs simple: on me fait une bourse, et je la porte; vous demandez qui,
et je vous le dis. Rien ne ressemble moins ŕ une querelle.
MATHILDE.
Et si je vous demandais cette bourse, m'en feriez-vous le sacrifice?
CHAVIGNY.
Peut-ętre; ŕ quoi vous servirait-elle?
MATHILDE.
Il n'importe; je vous la demande.
CHAVIGNY.
Ce n'est pas pour la porter, je suppose? Je veux savoir ce que vous en
feriez.
MATHILDE.
C'est pour la porter.
CHAVIGNY.
Quelle plaisanterie! Vous porteriez une bourse faite par madame de
Blainville?
MATHILDE.
Pourquoi non? Vous la portez bien.
CHAVIGNY.
La belle raison! Je ne suis pas femme.
MATHILDE.
Eh bien! si je ne m'en sers pas, je la jetterai au feu.
CHAVIGNY.
Ah! ah! vous voilŕ donc enfin sincčre. Eh bien! trčs sincčrement
aussi, je la garderai, si vous le permettez.
MATHILDE.
Vous en ętes libre, assurément; mais je vous avoue qu'il m'est cruel
de penser que tout le monde sait qui vous l'a faite, et que vous allez
la montrer partout.
CHAVIGNY.
La montrer! Ne dirait-on pas que c'est un trophée!
MATHILDE.
Écoutez-moi, je vous en prie, et laissez-moi votre main dans les
miennes.
_Elle l'embrasse._
M'aimez-vous, Henri? Répondez.
CHAVIGNY.
Je vous aime, et je vous écoute.
MATHILDE.
Je vous jure que je ne suis pas jalouse; mais si vous me donnez cette
bourse de bonne amitié, je vous remercierai de tout mon coeur. C'est
un petit échange que je vous propose, et je crois, j'espčre du moins,
que vous ne trouverez pas que vous y perdez.
CHAVIGNY.
Voyons votre échange; qu'est-ce que c'est?
MATHILDE.
Je vais vous le dire, si vous y tenez; mais si vous me donniez la
bourse auparavant, sur parole, vous me rendriez bien heureuse.
CHAVIGNY.
Je ne donne rien sur parole.
MATHILDE.
Voyons, Henri, je vous en prie.
CHAVIGNY.
Non.
MATHILDE.
Eh bien! je t'en supplie ŕ genoux.
CHAVIGNY.
Levez-vous, Mathilde, je vous en conjure ŕ mon tour; vous savez que je
n'aime pas ces maničres-lŕ. Je ne peux pas souffrir qu'on s'abaisse,
et je te comprends moins ici que jamais. C'est trop insister sur un
enfantillage; si vous l'exigez sérieusement, je jetterais cette bourse
au feu moi-męme, et je n'aurais que faire d'échange pour cela. Allons,
levez-vous, et n'en parlons plus. Adieu; ŕ ce soir; je reviendrai.
_Il sort._
SCČNE V
MATHILDE, _seule_.
Puisque ce n'est pas celle-lŕ, ce sera donc l'autre que je brűlerai.
_Elle va ŕ son secrétaire et en tire la bourse qu'elle a faite._
Pauvre petite, je te baisais tout ŕ l'heure; et te souviens-tu de ce
que je te disais? Nous arrivons trop tard, tu le vois. Il ne veut pas
de toi, et ne veut plus de moi.
_Elle s'approche de la cheminée._
Qu'on est folle de faire des ręves! ils ne se réalisent jamais.
Pourquoi cet attrait, ce charme invincible qui nous fait caresser une
idée? Pourquoi tant de plaisir ŕ la suivre, ŕ l'exécuter en secret? Ŕ
quoi bon tout cela? Ŕ pleurer ensuite. Que demande donc l'impitoyable
hasard? Quelles précautions, quelles pričres faut-il donc pour mener
ŕ bien le souhait le plus simple, la plus chétive espérance? Vous avez
bien dit, monsieur le comte, j'insiste sur un enfantillage, mais il
m'était doux d'y insister; et vous, si fier ou si infidčle, il ne vous
eűt pas coűté beaucoup de vous pręter ŕ cet enfantillage. Ah! il ne
m'aime plus, il ne m'aime plus. Il vous aime, madame de Blainville!
_Elle pleure._
Allons! il n'y faut plus penser. Jetons au feu ce hochet d'enfant qui
n'a pas su arriver assez vite; si je le lui avais donné ce soir, il
l'aurait peut-ętre perdu demain. Ah! sans nul doute, il l'aurait fait;
il laisserait ma bourse traîner sur sa table, je ne sais oů, dans ses
rebuts, tandis que l'autre le suivra partout, tandis qu'en jouant, ŕ
l'heure qu'il est, il la tire avec orgueil; je le vois l'étaler sur le
tapis, et faire résonner l'or qu'elle renferme. Malheureuse! je suis
jalouse; il me manquait cela pour me faire haďr!
_Elle va jeter sa bourse au feu, et s'arręte._
Mais qu'as-tu fait? Pourquoi te détruire, triste ouvrage de mes
mains? Il n'y a pas de ta faute; tu attendais, tu espérais aussi! Tes
fraîches couleurs n'ont point pâli durant cet entretien cruel; tu me
plais, je sens que je t'aime; dans ce petit réseau fragile, il y a
quinze jours de ma vie; ah! non, non, la main qui t'a faite ne te
tuera pas; je veux te conserver, je veux t'achever; tu seras pour moi
une relique, et je te porterai sur mon coeur; tu m'y feras en męme
temps du bien et du mal; tu me rappelleras mon amour pour lui, son
oubli, ses caprices; et qui sait? cachée ŕ cette place, il reviendra
peut-ętre t'y chercher.
_Elle s'assoit et attache le gland qui manquait._
SCČNE VI
MATHILDE, MADAME DE LÉRY.
MADAME DE LÉRY, _derričre la scčne_.
Personne nulle part! qu'est-ce que ça veut dire? on entre ici comme
dans un moulin.
_Elle ouvre la porte et crie en riant_:
Madame de Léry!
_Elle entre. Mathilde se lčve._
Rebonsoir, chčre; pas de domestique chez vous; je cours partout pour
trouver quelqu'un. Ah! je suis rompue!
_Elle s'assoit._
MATHILDE.
Débarrassez-vous de vos fourrures.
MADAME DE LÉRY.
Tout ŕ l'heure; je suis gelée. Aimez-vous ce renard-lŕ? on dit que
c'est de la martre d'Éthiopie, je ne sais quoi; c'est M. de Léry qui
me l'a apporté de Hollande. Moi, je trouve ça laid, franchement; je le
porterai trois fois, par politesse, et puis je le donnerai ŕ Ursule.
MATHILDE.
Une femme de chambre ne peut pas mettre cela.
MADAME DE LÉRY.
C'est vrai; je m'en ferai un petit tapis.
MATHILDE.
Eh bien! ce bal était-il beau?
MADAME DE LÉRY.
Ah! mon Dieu, ce bal! mais je n'en viens pas. Vous ne croiriez jamais
ce qui m'arrive.
MATHILDE.
Vous n'y ętes donc pas allée?
MADAME DE LÉRY.
Si fait, j'y suis allée, mais je n'y suis pas entrée. C'est ŕ mourir
de rire. Figurez-vous une queue,... une queue...
_Elle éclate de rire._
Ces choses-lŕ vous font-elles peur, ŕ vous?
MATHILDE.
Mais oui; je n'aime pas les embarras de voitures.
MADAME DE LÉRY.
C'est désolant quand on est seule. J'avais beau crier au cocher
d'avancer, il ne bougeait pas; j'étais d'une colčre! j'avais envie
de monter sur le sičge; je vous réponds bien que j'aurais coupé leur
queue. Mais c'est si bęte d'ętre lŕ, en toilette, vis-ŕ-vis d'un
carreau mouillé; car, avec cela, il pleut ŕ verse. Je me suis divertie
une demi-heure ŕ voir patauger les passants, et puis j'ai dit de
retourner. Voilŕ mon bal.--Ce feu me fait un plaisir! je me sens
renaître!
_Elle ôte sa fourrure. Mathilde sonne, et un domestique entre._
MATHILDE.
Le thé.
_Le domestique sort._
MADAME DE LÉRY.
M. de Chavigny est donc parti?
MATHILDE.
Oui; je pense qu'il va ŕ ce bal, et il sera plus obstiné que vous.
MADAME DE LÉRY.
Je crois qu'il ne m'aime gučre, soit dit entre nous.
MATHILDE.
Vous vous trompez, je vous assure; il m'a dit cent fois qu'ŕ ses yeux
vous étiez une des plus jolies femmes de Paris.
MADAME DE LÉRY.
Vraiment? c'est trčs poli de sa part; mais je le mérite, car je le
trouve fort bien. Voulez-vous me pręter une épingle.
MATHILDE.
Vous en avez ŕ côté de vous.
MADAME DE LÉRY.
Cette Palmire vous fait des robes, on ne se sent pas des épaules;
on croit toujours que tout va tomber. Est-ce elle qui vous fait ces
manches-lŕ?
MATHILDE.
Oui.
MADAME DE LÉRY.
Trčs jolies, trčs bien, trčs jolies. Décidément il n'y a que les
manches plates; mais j'ai été longtemps ŕ m'y faire; et puis je trouve
qu'il ne faut pas ętre trop grasse pour les porter, parce que sans
cela on a l'air d'une cigale, avec un gros corps et de petites pattes.
MATHILDE.
J'aime assez la comparaison.
_On apporte le thé._
MADAME DE LÉRY.
N'est-ce pas? Regardez mademoiselle Saint-Ange. Il ne faut pourtant
pas ętre trop maigre non plus, parce qu'alors il ne reste plus rien.
On se récrie sur la marquise d'Ermont; moi, je trouve qu'elle a l'air
d'une potence. C'est une belle tęte, si vous voulez, mais c'est une
madone au bout d'un bâton.
MATHILDE, _riant_.
Voulez-vous que je vous serve, ma chčre?
MADAME DE LÉRY.
Rien que de l'eau chaude, avec un soupçon de thé et un nuage de lait.
MATHILDE, _versant le thé_.
Allez-vous demain chez madame d'Égly? Je vous prendrai, si vous
voulez.
MADAME DE LÉRY.
Ah! madame d'Égly! en voilŕ une autre! avec sa frisure et ses
jambes, elle me fait l'effet de ces grands balais pour épousseter les
araignées.
_Elle boit._
Mais, certainement, j'irai demain. Non, je ne peux pas; je vais au
concert.
MATHILDE.
Il est vrai qu'elle est un peu drôle.
MADAME DE LÉRY.
Regardez-moi donc, je vous en prie.
MATHILDE.
Pourquoi?
MADAME DE LÉRY.
Regardez-moi en face, lŕ, franchement.
MATHILDE.
Que me trouvez-vous d'extraordinaire?
MADAME DE LÉRY.
Eh! certainement, vous avez les yeux rouges; vous venez de pleurer,
c'est clair comme le jour. Qu'est-ce qui se passe donc, ma chčre
Mathilde?
MATHILDE.
Rien, je vous jure. Que voulez-vous qu'il se passe?
MADAME DE LÉRY.
Je n'en sais rien, mais vous venez de pleurer; je vous dérange, je
m'en vais.
MATHILDE.
Au contraire, chčre; je vous supplie de rester.
MADAME DE LÉRY.
Est-ce bien franc? Je reste, si vous voulez; mais vous me direz vos
peines.
_Mathilde secoue la tęte._
Non? Alors je m'en vais, car vous comprenez que du moment que je ne
suis bonne ŕ rien, je ne peux que nuire involontairement.
MATHILDE.
Restez, votre présence m'est précieuse, votre esprit m'amuse, et s'il
était vrai que j'eusse quelque souci, votre gaieté le chasserait.
MADAME DE LÉRY.
Tenez, je vous aime. Vous me croyez peut-ętre légčre; personne n'est
si sérieux que moi pour les choses sérieuses. Je ne comprends pas
qu'on joue avec le coeur, et c'est pour cela que j'ai l'air d'en
manquer. Je sais ce que c'est que de souffrir, on me l'a appris bien
jeune encore. Je sais aussi ce que c'est que de dire ses chagrins. Si
ce qui vous afflige peut se confier, parlez hardiment: ce n'est pas la
curiosité qui me pousse.
MATHILDE.
Je vous crois bonne, et surtout trčs sincčre; mais dispensez-moi de
vous obéir.
MADAME DE LÉRY.
Ah, mon Dieu! j'y suis! c'est la bourse bleue. J'ai fait une sottise
affreuse en nommant madame de Blainville. J'y ai pensé en vous
quittant; est-ce que M. de Chavigny lui fait la cour?
_Mathilde se lčve, ne pouvant répondre, se détourne et porte son
mouchoir ŕ ses yeux._
MADAME DE LÉRY.
Est-il possible?
_Un long silence. Mathilde se promčne quelque temps, puis va s'asseoir
ŕ l'autre bout de la chambre. Madame de Léry semble réfléchir. Elle se
lčve et s'approche de Mathilde; celle-ci lui tend la main._
MADAME DE LÉRY.
Vous savez, ma chčre, que les dentistes vous disent de crier quand ils
vous font mal. Moi, je vous dis: Pleurez! pleurez! Douces ou amčres,
les larmes soulagent toujours.
MATHILDE.
Ah! mon Dieu!
MADAME DE LÉRY.
Mais c'est incroyable, une chose pareille! On ne peut pas aimer madame
de Blainville; c'est une coquette ŕ moitié perdue, qui n'a ni esprit
ni beauté. Elle ne vaut pas votre petit doigt; on ne quitte pas un
ange pour un diable.
MATHILDE, _sanglotant_.
Je suis sűre qu'il l'aime, j'en suis sűre.
MADAME DE LÉRY.
Non, mon enfant, ça ne se peut pas; c'est un caprice, une fantaisie.
Je connais M. de Chavigny plus qu'il ne pense; il est méchant, mais
il n'est pas mauvais. Il aura agi par boutade; avez-vous pleuré devant
lui?
MATHILDE.
Oh! non, jamais!
MADAME DE LÉRY.
Vous avez bien fait; il ne m'étonnerait pas qu'il en fűt bien aise.
MATHILDE.
Bien aise? bien aise de me voir pleurer?
MADAME DE LÉRY.
Eh! mon Dieu, oui. J'ai vingt-cinq ans d'hier, mais je sais ce qui en
est sur bien des choses. Comment tout cela est-il venu?
MATHILDE.
Mais... je ne sais...
MADAME DE LÉRY.
Parlez. Avez-vous peur de moi? je vais vous rassurer tout de suite;
si, pour vous mettre ŕ votre aise, il faut m'engager de mon côté, je
vais vous prouver que j'ai confiance en vous et vous forcer ŕ l'avoir
en moi; est-ce nécessaire? je le ferai. Qu'est-ce qu'il vous plaît de
savoir sur mon compte?
MATHILDE.
Vous ętes ma meilleure amie; je vous dirai tout, je me fie ŕ vous.
Il ne s'agit de rien de bien grave; mais j'ai une folle tęte qui
m'entraîne. J'avais fait ŕ M. de Chavigny une petite bourse en
cachette que je comptais lui offrir aujourd'hui; depuis quinze jours,
je le vois ŕ peine; il passe ses journées chez madame de Blainville.
Lui offrir ce petit cadeau, c'était lui faire un doux reproche de son
absence et lui montrer qu'il me laissait seule. Au moment oů j'allais
lui donner ma bourse, il a tiré l'autre.
MADAME DE LÉRY.
Il n'y a pas lŕ de quoi pleurer.
MATHILDE.
Oh! si, il y a de quoi pleurer, car j'ai fait une grande folie; je lui
ai demandé l'autre bourse.
MADAME DE LÉRY.
Aďe! ce n'est pas diplomatique.
MATHILDE.
Non, Ernestine, et il m'a refusé... Et alors... Ah! j'ai honte...
MADAME DE LÉRY.
Eh bien?
MATHILDE.
Eh bien! je l'ai demandée ŕ genoux. Je voulais qu'il me fît ce petit
sacrifice, et je lui aurais donné ma bourse en échange de la sienne.
Je l'ai prié,... je l'ai supplié...
MADAME DE LÉRY.
Et il n'en a rien fait; cela va sans dire. Pauvre innocente! il n'est
pas digne de vous!
MATHILDE.
Ah! malgré tout, je ne le croirai jamais!
MADAME DE LÉRY.
Vous avez raison, je m'exprime mal. Il est digne de vous et vous aime;
mais il est homme et orgueilleux. Quelle pitié! Et oů est donc votre
bourse?
MATHILDE.
La voilŕ ici sur la table.
MADAME DE LÉRY, _prenant la bourse_.
Cette bourse-lŕ? Eh bien! ma chčre, elle est quatre fois plus
jolie que la sienne. D'abord elle n'est pas bleue, ensuite elle est
charmante. Prętez-la-moi, je me charge bien de la lui faire trouver de
son goűt.
MATHILDE.
Tâchez. Vous me rendrez la vie.
MADAME DE LÉRY.
En ętre lŕ aprčs un an de mariage, c'est inouď! Il faut qu'il y ait
de la sorcellerie lŕ-dedans. Cette Blainville, avec son indigo, je la
déteste des pieds ŕ la tęte. Elle a les yeux battus jusqu'au menton.
Mathilde, voulez-vous faire une chose? Il ne nous en coűte rien
d'essayer. Votre mari viendra-t-il ce soir?
MATHILDE.
Je n'en sais rien, mais il me l'a dit.
MADAME DE LÉRY.
Comment étiez-vous quand il est sorti?
MATHILDE.
Ah! j'étais bien triste, et lui bien sévčre.
MADAME DE LÉRY.
Il viendra. Avez-vous du courage? Quand j'ai une idée, je vous
en avertis, il faut que je me saisisse au vol; je me connais, je
réussirai.
MATHILDE.
Ordonnez donc, je me soumets.
MADAME DE LÉRY.
Passez dans ce cabinet, habillez-vous ŕ la hâte et jetez-vous dans
ma voiture. Je ne veux pas vous envoyer au bal, mais il faut qu'en
rentrant vous ayez l'air d'y ętre allée. Vous vous ferez mener oů vous
voudrez, aux Invalides ou ŕ la Bastille; ce ne sera peut-ętre pas trčs
divertissant, mais vous serez aussi bien lŕ qu'ici pour ne pas dormir.
Est-ce convenu? Maintenant, prenez votre bourse, et enveloppez-la dans
ce papier, je vais mettre l'adresse. Bien, voilŕ qui est fait. Au coin
de la rue, vous ferez arręter; vous direz ŕ mon groom d'apporter
ici ce petit paquet, de le remettre au premier domestique qu'il
rencontrera, et de s'en aller sans autre explication.
MATHILDE.
Dites-moi du moins ce que vous voulez faire.
MADAME DE LÉRY.
Ce que je veux faire, enfant, est impossible ŕ dire, et je vais voir
si c'est possible ŕ faire. Une fois pour toutes, vous fiez-vous ŕ moi?
MATHILDE.
Oui, tout au monde pour l'amour de lui.
MADAME DE LÉRY.
Allons, preste! Voilŕ une voiture.
MATHILDE.
C'est lui; j'entends sa voix dans la cour.
MADAME DE LÉRY.
Sauvez-vous! Y a-t-il un escalier dérobé par lŕ?
MATHILDE.
Oui, heureusement. Mais je ne suis pas coiffée, comment croira-t-on ŕ
ce bal?
MADAME DE LÉRY, _ôtant la guirlande qu'elle a sur la tęte et la
donnant ŕ Mathilde_.
Tenez, vous arrangerez cela en route.
_Mathilde sort._
SCČNE VII
MADAME DE LÉRY, _seule_.
Ŕ genoux! une telle femme ŕ genoux! Et ce monsieur-lŕ qui la refuse!
Une femme de vingt ans, belle comme un ange et fidčle comme un
lévrier! Pauvre enfant, qui demande en grâce qu'on daigne accepter une
bourse faite par elle, en échange d'un cadeau de madame de Blainville!
Mais quel abîme est donc le coeur de l'homme! Ah! ma foi! nous
valons mieux qu'eux.
_Elle s'assoit et prend une brochure sur la table. Un instant aprčs,
on frappe ŕ la porte._
Entrez.
SCČNE VIII
MADAME DE LÉRY, CHAVIGNY.
MADAME DE LÉRY, _lisant d'un air distrait_.
Bonsoir, comte. Voulez-vous du thé?
CHAVIGNY.
Je vous rends grâces. Je n'en prends jamais.
_Il s'assoit et regarde autour de lui._
MADAME DE LÉRY.
Était-il amusant, ce bal?
CHAVIGNY.
Comme cela. N'y étiez-vous pas?
MADAME DE LÉRY.
Voilŕ une question qui n'est pas galante. Non, je n'y étais pas; mais
j'y ai envoyé Mathilde, que vos regards semblent chercher.
CHAVIGNY.
Vous plaisantez, ŕ ce que je vois?
MADAME DE LÉRY.
Plaît-il? je vous demande pardon, je tiens un article d'une _Revue_
qui m'intéresse beaucoup.
_Un silence. Chavigny, inquiet, se lčve et se promčne._
CHAVIGNY.
Est-ce que vraiment Mathilde est ŕ ce bal?
MADAME DE LÉRY.
Mais oui; vous voyez que je l'attends.
CHAVIGNY.
C'est singulier; elle ne voulait pas sortir lorsque vous le lui avez
proposé.
MADAME DE LÉRY.
Apparemment qu'elle a changé d'idée.
CHAVIGNY.
Pourquoi n'y est-elle pas allée avec vous?
MADAME DE LÉRY.
Parce que je ne m'en suis plus souciée.
CHAVIGNY.
Elle s'est donc passée de voiture?
MADAME DE LÉRY.
Non, je lui ai pręté la mienne. Avez-vous lu ça, monsieur de Chavigny?
CHAVIGNY.
Quoi?
MADAME DE LÉRY.
C'est la _Revue des Deux Mondes_; un article trčs joli de madame Sand
sur les orangs-outangs.
CHAVIGNY.
Sur les?...
MADAME DE LÉRY.
Sur les orangs-outangs. Ah! je me trompe, ce n'est pas d'elle, c'est
celui d'ŕ côté; c'est trčs amusant[A].
[Note A: Au moment d'écrire ces mots, l'auteur, qui avait sur sa
table de travail plusieurs livraisons de la _Revue des Deux Mondes_,
en ouvrit deux au hasard. La premičre, du 15 mars 1837, contenait un
article de M. Roulin sur les orangs-outangs; la seconde, du 1er
avril suivant, contenait un chapitre de _Mauprat_, par George Sand.
L'étrange confusion que fait madame de Léry prouve qu'elle ne lit que
des yeux et qu'elle est toute ŕ son plan de campagne.]
CHAVIGNY.
Je ne comprends rien ŕ cette idée d'aller au bal sans me prévenir.
J'aurais pu du moins la ramener.
MADAME DE LÉRY.
Aimez-vous les romans de madame Sand?
CHAVIGNY.
Non, pas du tout. Mais si elle y est, comment se fait-il que je ne
l'aie pas trouvée?
MADAME DE LÉRY.
Quoi? la _Revue_? Elle était lŕ-dessus.
CHAVIGNY.
Vous moquez-vous de moi, madame?
MADAME DE LÉRY.
Peut-ętre; c'est selon ŕ propos de quoi.
CHAVIGNY.
C'est de ma femme que je vous parle.
MADAME DE LÉRY.
Est-ce que vous me l'avez donnée ŕ garder?
CHAVIGNY.
Vous avez raison; je suis trčs ridicule; je vais de ce pas la
chercher.
MADAME DE LÉRY.
Bah! vous allez tomber dans la queue.
CHAVIGNY.
C'est vrai; je ferai aussi bien d'attendre, et j'attendrai.
_Il s'approche du feu et s'assoit._
MADAME DE LÉRY, _quittant sa lecture_.
Savez-vous, monsieur de Chavigny, que vous m'étonnez beaucoup?
Je croyais vous avoir entendu dire que vous laissiez Mathilde
parfaitement libre, et qu'elle allait oů bon lui semblait.
CHAVIGNY.
Certainement; vous en voyez la preuve.
MADAME DE LÉRY.
Pas tant; vous avez l'air furieux.
CHAVIGNY.
Moi? par exemple! pas le moins du monde.
MADAME DE LÉRY.
Vous ne tenez pas sur votre fauteuil. Je vous croyais un tout autre
homme, je l'avoue, et, pour parler sérieusement, je n'aurais pas pręté
ma voiture ŕ Mathilde si j'avais su ce qui en est.
CHAVIGNY.
Mais je vous assure que je le trouve tout simple, et je vous remercie
de l'avoir fait.
MADAME DE LÉRY.
Non, non, vous ne me remerciez pas; je vous assure, moi, que vous ętes
fâché. Ŕ vous dire vrai, je crois que, si elle est sortie, c'était un
peu pour vous rejoindre.
CHAVIGNY.
J'aime beaucoup cela! Que ne m'accompagnait-elle?
MADAME DE LÉRY.
Eh oui! c'est ce que je lui ai dit. Mais voilŕ comme nous sommes, nous
autres; nous ne voulons pas, et puis nous voulons. Décidément, vous ne
prenez pas de thé?
CHAVIGNY.
Non, il me fait mal.
MADAME DE LÉRY.
Eh bien! donnez-m'en.
CHAVIGNY.
Plaît-il, madame?
MADAME DE LÉRY.
Donnez-m'en.
_Chavigny se lčve et remplit une tasse qu'il offre ŕ madame de Léry._
MADAME DE LÉRY.
C'est bon; mettez ça lŕ. [Avons-nous un ministčre ce soir?
CHAVIGNY.
Je n'en sais rien.
MADAME DE LÉRY.
Ce sont de drôles d'auberges que ces ministčres. On y entre et on en
sort sans savoir pourquoi; c'est une procession de marionnettes.]
CHAVIGNY.
Prenez donc ce thé ŕ votre tour; il est déjŕ ŕ moitié froid.
MADAME DE LÉRY.
Vous n'y avez pas mis assez de sucre. Mettez-m'en un ou deux morceaux.
CHAVIGNY.
Comme vous voudrez; il ne vaudra rien.
MADAME DE LÉRY.
Bien; maintenant, encore un peu de lait.
CHAVIGNY.
Ętes-vous satisfaite?
MADAME DE LÉRY.
Une goutte d'eau chaude ŕ présent. Est-ce fait? Donnez-moi la tasse.
CHAVIGNY, _lui présentant la tasse_.
La voilŕ; mais il ne vaudra rien.
MADAME DE LÉRY.
Vous croyez? En ętes-vous sűr?
CHAVIGNY.
Il n'y a pas le moindre doute.
MADAME DE LÉRY.
Et pourquoi ne vaudrait-il rien?
CHAVIGNY.
Parce qu'il est froid et trop sucré.
MADAME DE LÉRY.
Eh bien! s'il ne vaut rien, ce thé, jetez-le.
_Chavigny est debout, tenant la tasse; madame de Léry le regarde en
riant._
MADAME DE LÉRY.
Ah! mon Dieu! que vous m'amusez! Je n'ai jamais rien vu de si
maussade.
CHAVIGNY, _impatienté, vide la tasse dans le feu, puis il se promčne ŕ
grand pas, et dit avec humeur_:
Ma foi, c'est vrai, je ne suis qu'un sot.
MADAME DE LÉRY.
Je ne vous avis jamais vu jaloux, mais vous l'ętes comme un Othello.
CHAVIGNY.
Pas le moins du monde; je ne peux pas souffrir qu'on se gęne, ni qu'on
gęne les autres en rien. Comment voulez-vous que je sois jaloux?
MADAME DE LÉRY.
Par amour-propre, comme tous les maris.
CHAVIGNY.
Bah! propos de femme. On dit: «Jaloux par amour-propre,» parce
que c'est une phrase toute faite, comme on dit: «Votre trčs humble
serviteur.» Le monde est bien sévčre pour ces pauvres maris.
MADAME DE LÉRY.
Pas tant que pour ces pauvres femmes.
CHAVIGNY.
Oh! mon Dieu, si. Tout est relatif. Peut-on permettre aux femmes de
vivre sur le męme pied que nous? C'est d'une absurdité qui saute aux
yeux. Il y a mille choses trčs graves pour elles, qui n'ont aucune
importance pour un homme.
MADAME DE LÉRY.
Oui, les caprices, par exemple.
CHAVIGNY.
Pourquoi pas? Eh bien! oui, les caprices. Il est certain qu'un homme
peut en avoir, et qu'une femme...
MADAME DE LÉRY.
En a quelquefois. Est-ce que vous croyez qu'une robe est un talisman
qui en préserve?
CHAVIGNY.
C'est une barričre qui doit les arręter.
MADAME DE LÉRY.
Ŕ moins que ce ne soit un voile qui les couvre. J'entends marcher.
C'est Mathilde qui rentre.
CHAVIGNY.
Oh! que non; il n'est pas minuit.
_Un domestique entre, et remet un petit paquet ŕ M. de Chavigny._
CHAVIGNY.
Qu'est-ce que c'est? Que me veut-on?
LE DOMESTIQUE.
On vient d'apporter cela pour monsieur le comte.
_Il sort. Chavigny défait le paquet, qui renferme la bourse de
Mathilde._
MADAME DE LÉRY.
Est-ce encore un cadeau qui vous arrive? Ŕ cette heure-ci, c'est un
peu fort.
CHAVIGNY.
Que diable est-ce que ça veut dire? Hé! François, hé! qui est-ce qui a
apporté ce paquet?
LE DOMESTIQUE, _rentrant_.
Monsieur?
CHAVIGNY.
Qui est-ce qui a apporté ce paquet?
LE DOMESTIQUE.
Monsieur, c'est le portier qui vient de monter.
CHAVIGNY.
Il n'y a rien avec? pas de lettre?
LE DOMESTIQUE.
Non, monsieur.
CHAVIGNY.
Est-ce qu'il avait ça depuis longtemps, ce portier?
LE DOMESTIQUE.
Non, monsieur; on vient de le lui remettre.
CHAVIGNY.
Qui le lui a remis?
LE DOMESTIQUE.
Monsieur, il ne sait pas.
CHAVIGNY.
Il ne sait pas! Perdez-vous la tęte? Est-ce un homme ou une femme?
LE DOMESTIQUE.
C'est un domestique en livrée, mais il ne le connaît pas.
CHAVIGNY.
Est-ce qu'il est en bas, ce domestique?
LE DOMESTIQUE.
Non, monsieur; il est parti sur-le-champ.
CHAVIGNY.
Il n'a rien dit?
LE DOMESTIQUE.
Non, monsieur.
CHAVIGNY.
C'est bon.
_Le domestique sort._
MADAME DE LÉRY.
J'espčre qu'on vous gâte, monsieur de Chavigny. Si vous laissez tomber
votre argent, ce ne sera pas la faute de ces dames.
CHAVIGNY.
Je veux ętre pendu si j'y comprends rien.
MADAME DE LÉRY.
Laissez donc! vous faites l'enfant.
CHAVIGNY.
Non; je vous donne ma parole d'honneur que je ne devine pas. Ce ne
peut ętre qu'une méprise.
MADAME DE LÉRY.
Est-ce que l'adresse n'est pas dessus?
CHAVIGNY.
Ma foi! si, vous avez raison. C'est singulier; je connais l'écriture.
MADAME DE LÉRY.
Peut-on voir?
CHAVIGNY.
C'est peut-ętre une indiscrétion ŕ moi de vous la montrer; mais
tant pis pour qui s'y expose. Tenez. J'ai certainement vu de cette
écriture-lŕ quelque part.
MADAME DE LÉRY.
Et moi aussi, trčs certainement.
CHAVIGNY.
Attendez donc... Non, je me trompe. Est-ce en bâtarde ou en coulée?
MADAME DE LÉRY.
Fi donc! c'est une anglaise pur sang. Regardez-moi comme ces
lettres-lŕ sont fines. Oh! la dame est bien élevée.
CHAVIGNY.
Vous avez l'air de la connaître.
MADAME DE LÉRY, _avec une confusion feinte_.
Moi! pas du tout.
_Chavigny, étonné, la regarde, puis continue ŕ se promener._
MADAME DE LÉRY.
Oů en étions-nous donc de notre conversation?--Eh! mais il me semble
que nous parlions caprice. Ce petit poulet rouge arrive ŕ propos.
CHAVIGNY.
Vous ętes dans le secret, convenez-en.
MADAME DE LÉRY.
Il y a des gens qui ne savent rien faire; si j'étais de vous, j'aurais
déjŕ deviné.
CHAVIGNY.
Voyons! soyez franche; dites-moi qui c'est.
MADAME DE LÉRY.
Je croirais assez que c'est madame de Blainville.
CHAVIGNY.
Vous ętes impitoyable, madame; savez-vous bien que nous nous
brouillerons?
MADAME DE LÉRY.
Je l'espčre bien, mais pas cette fois-ci.
CHAVIGNY.
Vous ne voulez pas m'aider ŕ trouver l'énigme?
MADAME DE LÉRY.
Belle occupation! Laissez donc cela; on dirait que vous n'y ętes pas
fait. Vous ruminerez lorsque vous serez couché, quand ce ne serait que
par politesse.
CHAVIGNY.
Il n'y a donc plus de thé? J'ai envie d'en prendre.
MADAME DE LÉRY.
Je vais vous en faire; dites donc que je ne suis pas bonne!
_Un silence._
CHAVIGNY, _se promenant toujours_.
Plus je cherche, moins je trouve.
MADAME DE LÉRY.
Ah çŕ! dites donc, est-ce un parti pris de ne penser qu'ŕ cette
bourse? Je vais vous laisser ŕ vos ręveries.
CHAVIGNY.
C'est qu'en vérité je tombe des nues.
MADAME DE LÉRY.
Je vous dis que c'est madame de Blainville. Elle a réfléchi sur la
couleur de sa bourse, et elle vous en envoie une autre par repentir.
Ou mieux encore: elle veut vous tenter, et voir si vous porterez
celle-ci ou la sienne.
CHAVIGNY.
Je porterai celle-ci sans aucun doute. C'est le seul moyen de savoir
qui l'a faite.
MADAME DE LÉRY.
Je ne comprends pas; c'est trop profond pour moi.
CHAVIGNY.
Je suppose que la personne qui me l'a envoyée me la voie demain entre
les mains; croyez-vous que je m'y tromperais?
MADAME DE LÉRY, _éclatant de rire_.
Ah! c'est trop fort; je n'y tiens pas.
CHAVIGNY.
Est-ce que ce serait vous, par hasard?
_Un silence._
MADAME DE LÉRY.
Voilŕ votre thé, fait de ma blanche main, et il sera meilleur que
celui que vous m'avez fabriqué tout ŕ l'heure. Mais finissez donc de
me regarder. Est-ce que vous me prenez pour une lettre anonyme?
CHAVIGNY.
C'est vous, c'est quelque plaisanterie. Il y a un complot lŕ-dessous.
MADAME DE LÉRY.
C'est un petit complot assez bien tricoté.
CHAVIGNY.
Avouez donc que vous en ętes.
MADAME DE LÉRY.
Non.
CHAVIGNY.
Je vous en prie.
MADAME DE LÉRY.
Pas davantage.
CHAVIGNY.
Je vous en supplie.
MADAME DE LÉRY.
Demandez-le ŕ genoux, je vous le dirai.
CHAVIGNY.
Ŕ genoux? tant que vous voudrez.
MADAME DE LÉRY.
Allons! voyons!
CHAVIGNY.
Sérieusement?
_Il se met ŕ genoux en riant devant madame de Léry._
MADAME DE LÉRY, _sčchement_.
J'aime cette posture, elle vous va ŕ merveille; mais je vous conseille
de vous relever, afin de ne pas trop m'attendrir.
CHAVIGNY, _se relevant_.
Ainsi, vous ne direz rien, n'est-ce pas?
MADAME DE LÉRY.
Avez-vous lŕ votre bourse bleue?
CHAVIGNY.
Je n'en sais rien, je crois que oui.
MADAME DE LÉRY.
Je crois que oui aussi. Donnez-la-moi, je vous dirai qui a fait
l'autre.
CHAVIGNY.
Vous le savez donc?
MADAME DE LÉRY.
Oui, je le sais.
CHAVIGNY.
Est-ce une femme?
MADAME DE LÉRY.
Ŕ moins que ce ne soit un homme, je ne vois pas...
CHAVIGNY.
Je veux dire: est-ce une jolie femme?
MADAME DE LÉRY.
C'est une femme qui, ŕ vos yeux, passe pour une des plus jolies femmes
de Paris.
CHAVIGNY.
Brune ou blonde?
MADAME DE LÉRY.
Bleue.
CHAVIGNY.
Par quelle lettre commence son nom?
MADAME DE LÉRY.
Vous ne voulez pas de mon marché? Donnez-moi la bourse de madame de
Blainville.
CHAVIGNY.
Est-elle petite ou grande?
MADAME DE LÉRY.
Donnez-moi la bourse.
CHAVIGNY.
Dites-moi seulement si elle a le pied petit.
MADAME DE LÉRY.
La bourse ou la vie!
CHAVIGNY.
Me direz-vous le nom si je vous donne la bourse?
MADAME DE LÉRY.
Oui.
CHAVIGNY, _tirant la bourse bleue_.
Votre parole d'honneur?
MADAME DE LÉRY.
Ma parole d'honneur.
CHAVIGNY _semble hésiter; madame de Léry tend la main; il la
regarde attentivement. Tout ŕ coup il s'assoit ŕ côté d'elle, et dit
gaiement_:
Parlons caprice. Vous convenez donc qu'une femme peut en avoir?
MADAME DE LÉRY.
Est-ce que vous en ętes ŕ le demander?
CHAVIGNY.
Pas tout ŕ fait; mais il peut arriver qu'un homme marié ait deux
façons de parler, et, jusqu'ŕ un certain point, deux façons d'agir.
MADAME DE LÉRY.
Eh bien! et ce marché, est-ce qu'il s'envole? je croyais qu'il était
conclu.
CHAVIGNY.
Un homme marié n'en reste pas moins homme; la bénédiction ne le
métamorphose pas, mais elle l'oblige quelquefois ŕ prendre un rôle et
ŕ en donner les répliques. Il ne s'agit que de savoir, dans ce monde,
ŕ qui les gens s'adressent quand ils vous parlent, si c'est au réel ou
au convenu, ŕ la personne ou au personnage.
MADAME DE LÉRY.
J'entends, c'est un choix qu'on peut faire; mais oů s'y reconnaît le
public?
CHAVIGNY.
Je ne crois pas que, pour un public d'esprit, ce soit long ni bien
difficile.
MADAME DE LÉRY.
Vous renoncez donc ŕ ce fameux nom? Allons! voyons! donnez-moi cette
bourse.
CHAVIGNY.
Une femme d'esprit, par exemple (une femme d'esprit sait tant de
choses!), ne doit pas se tromper, ŕ ce que je crois, sur le vrai
caractčre des gens: elle doit bien voir, au premier coup d'oeil....
MADAME DE LÉRY.
Décidément, vous gardez la bourse?
CHAVIGNY.
Il me semble que vous y tenez beaucoup. Une femme d'esprit, n'est-il
pas vrai, madame, doit savoir faire la part du mari, et celle de
l'homme par conséquent? Comment ętes-vous donc coiffée? Vous étiez
toute en fleurs ce matin.
MADAME DE LÉRY.
Oui; ça me gęnait, je me suis mise ŕ mon aise. Ah! mon Dieu! mes
cheveux sont défaits d'un côté.
_Elle se lčve et s'ajuste devant la glace._
CHAVIGNY.
Vous avez la plus jolie taille qu'on puisse voir. Une femme d'esprit
comme vous...
MADAME DE LÉRY.
Une femme d'esprit comme moi se donne au diable quand elle a affaire ŕ
un homme d'esprit comme vous.
CHAVIGNY.
Qu'ŕ cela ne tienne; je suis assez bon diable.
MADAME DE LÉRY.
Pas pour moi, du moins, ŕ ce que je pense.
CHAVIGNY.
C'est qu'apparemment quelque autre me fait tort.
MADAME DE LÉRY.
Qu'est-ce que ce propos-lŕ veut dire?
CHAVIGNY.
Il veut dire que, si je vous déplais, c'est que quelqu'un m'empęche de
vous plaire.
MADAME DE LÉRY.
C'est modeste et poli; mais vous vous trompez: personne ne me plaît,
et je ne veux plaire ŕ personne.
CHAVIGNY.
Avec votre âge et ces yeux-lŕ, je vous en défie.
MADAME DE LÉRY.
C'est cependant la vérité pure.
CHAVIGNY.
Si je le croyais, vous me donneriez bien mauvaise opinion des hommes.
MADAME DE LÉRY.
Je vous le ferai croire bien aisément. J'ai une vanité qui ne veut pas
de maître.
CHAVIGNY.
Ne peut-elle souffrir un serviteur?
MADAME DE LÉRY.
Bah! serviteurs ou maîtres, vous n'ętes que des tyrans.
CHAVIGNY, _se levant_.
C'est assez vrai, et je vous avoue que lŕ-dessus j'ai toujours détesté
la conduite des hommes. Je ne sais d'oů leur vient cette manie de
s'imposer, qui ne sert qu'ŕ se faire haďr.
MADAME DE LÉRY.
Est-ce votre opinion sincčre?
CHAVIGNY.
Trčs sincčre; je ne conçois pas comment on peut se figurer que, parce
qu'on a plu ce soir, on est en droit d'en abuser demain.
MADAME DE LÉRY.
C'est pourtant le chapitre premier de l'histoire universelle.
CHAVIGNY.
Oui, et si les hommes avaient le sens commun lŕ-dessus, les femmes ne
seraient pas si prudentes.
MADAME DE LÉRY.
C'est possible; les liaisons d'aujourd'hui sont des mariages, et quand
il s'agit d'un jour de noce, cela vaut la peine d'y penser.
CHAVIGNY.
Vous avez mille fois raison; et, dites-moi, pourquoi en est-il ainsi?
pourquoi tant de comédie et si peu de franchise? Une jolie femme qui
se fie ŕ un galant homme ne saurait-elle le distinguer? Il n'y a pas
que des sots sur la terre.
MADAME DE LÉRY.
C'est une question en pareille circonstance.
CHAVIGNY.
Mais je suppose que, par hasard, il se trouve un homme qui, sur ce
point, ne soit pas de l'avis des sots; et je suppose qu'une
occasion se présente oů l'on puisse ętre franc sans danger, sans
arričre-pensée, sans crainte des indiscrétions.
_Il lui prend la main._
Je suppose qu'on dise ŕ une femme: Nous sommes seuls, vous ętes jeune
et belle, et je fais de votre esprit et de votre coeur tout le cas
qu'on en doit faire. Mille obstacles nous séparent, mille chagrins
nous attendent, si nous essayons de nous revoir demain. Votre fierté
ne veut pas d'un joug, et votre prudence ne veut pas d'un lien;
vous n'avez ŕ redouter ni l'un ni l'autre. On ne vous demande ni
protestation, ni engagement, ni sacrifice, rien qu'un sourire de ces
lčvres de rose et un regard de ces beaux yeux. Souriez pendant que
cette porte est fermée: votre liberté est sur le seuil; vous la
retrouverez en quittant cette chambre; ce qui s'offre ŕ vous n'est
pas le plaisir sans amour, c'est l'amour sans peine et sans amertume;
c'est le caprice, puisque nous en parlons, non l'aveugle caprice
des sens, mais celui du coeur, qu'un moment fait naître et dont le
souvenir est éternel.
MADAME DE LÉRY.
Vous me parliez de comédie; mais il paraît qu'ŕ l'occasion vous en
joueriez d'assez dangereuses. J'ai quelque envie d'avoir un caprice,
avant de répondre ŕ ce discours-lŕ. Il me semble que c'en est
l'instant, puisque vous en plaidez la thčse. Avez-vous lŕ un jeu de
cartes?
CHAVIGNY.
Oui, dans cette table; qu'en voulez-vous faire?
MADAME DE LÉRY.
Donnez-le-moi, j'ai ma fantaisie, et vous ętes forcé d'obéir si vous
ne voulez vous contredire.
_Elle prend une carte dans le jeu._
Allons, comte, dites rouge ou noir.
CHAVIGNY.
Voulez-vous me dire quel est l'enjeu?
MADAME DE LÉRY.
L'enjeu est une discrétion[B].
[Note B: On appelle _discrétion_ un pari dans lequel le perdant
s'oblige ŕ donner au gagnant ce que celui-ci lui demande, ŕ sa
discrétion.
(_Note de l'auteur._)]
CHAVIGNY.
Soit.--J'appelle rouge.
MADAME DE LÉRY.
C'est le valet de pique; vous avez perdu. Donnez-moi cette bourse
bleue.
CHAVIGNY.
De tout mon coeur, mais je garde la rouge, et quoique sa couleur
m'ait fait perdre, je ne le lui reprocherai jamais; car je sais aussi
bien que vous quelle est la main qui me l'a faite.
MADAME DE LÉRY.
Est-elle petite ou grande, cette main?
CHAVIGNY.
Elle est charmante et douce comme le satin.
MADAME DE LÉRY.
Lui permettez-vous de satisfaire un petit mouvement de jalousie?
_Elle jette au feu la bourse bleue._
CHAVIGNY.
Ernestine, je vous adore!
MADAME DE LÉRY _regarde brűler la bourse. Elle s'approche de Chavigny
et lui dit tendrement_:
Vous n'aimez donc plus madame de Blainville?
CHAVIGNY.
Ah, grand Dieu! je ne l'ai jamais aimée.
MADAME DE LÉRY.
Ni moi non plus, monsieur de Chavigny.
CHAVIGNY.
Mais qui a pu vous dire que je pensais ŕ cette femme-lŕ? Ah! ce n'est
pas elle ŕ qui je demanderai jamais un instant de bonheur; ce n'est
pas elle qui me le donnera!
MADAME DE LÉRY.
Ni moi non plus, monsieur de Chavigny. Vous venez de me faire un petit
sacrifice, c'est trčs galant de votre part; mais je ne veux pas vous
tromper: la bourse rouge n'est pas de ma façon.
CHAVIGNY.
Est-il possible? Qui est-ce donc qui l'a faite?
MADAME DE LÉRY.
C'est une main plus belle que la mienne. Faites-moi la grâce de
réfléchir une minute et de m'expliquer cette énigme ŕ mon tour. Vous
m'avez fait en bon français une déclaration trčs aimable; vous vous
ętes mis ŕ deux genoux par terre, et remarquez qu'il n'y a pas de
tapis; je vous ai demandé votre bourse bleue, et vous me l'avez laissé
brűler. Que suis-je donc, dites-moi, pour mériter tout cela? Que me
trouvez-vous de si extraordinaire? Je ne suis pas mal, c'est vrai; je
suis jeune; il est certain que j'ai le pied petit. Mais enfin ce n'est
pas si rare. Quand nous nous serons prouvé l'un ŕ l'autre que je suis
une coquette et vous un libertin, uniquement parce qu'il est minuit
et que nous sommes en tęte ŕ tęte, voilŕ un beau fait d'armes que nous
aurons ŕ écrire dans nos mémoires! C'est pourtant lŕ tout, n'est-ce
pas? Et ce que vous m'accordez en riant, ce qui ne vous coűte pas męme
un regret, ce sacrifice insignifiant que vous faites ŕ un caprice plus
insignifiant encore, vous le refusez ŕ la seule femme qui vous aime, ŕ
la seule femme que vous aimiez!
_On entend le bruit d'une voiture._
CHAVIGNY.
Mais, madame, qui a pu vous instruire?
MADAME DE LÉRY.
Parlez plus bas, monsieur, la voilŕ qui rentre, et cette voiture vient
me chercher. Je n'ai pas le temps de vous faire ma morale; vous ętes
homme de coeur, et votre coeur vous la fera. Si vous trouvez que
Mathilde a les yeux rouges, essuyez-les avec cette petite bourse que
ses larmes reconnaîtront, car c'est votre bonne, brave et fidčle
femme qui a passé quinze jours ŕ la faire. Adieu; vous m'en voudrez
aujourd'hui, mais vous aurez demain quelque amitié pour moi, et,
croyez-moi, cela vaut mieux qu'un caprice. Mais s'il vous en faut un
absolument, tenez, voilŕ Mathilde, vous en avez un beau ŕ vous passer
ce soir. Il vous en fera, j'espčre, oublier un autre que personne au
monde, pas męme elle, ne saura jamais.
_Mathilde entre, madame de Léry va ŕ sa rencontre et l'embrasse._
CHAVIGNY _les regarde, il s'approche d'elles, prend sur la tęte de sa
femme la guirlande de fleurs de madame de Léry, et dit ŕ celle-ci en
la lui rendant:_
Je vous demande pardon, madame, elle le saura, et je n'oublierai
jamais qu'un jeune curé fait les meilleurs sermons.
FIN D'UN CAPRICE.
C'est ŕ Saint-Pétersbourg, devant la cour de Russie, que cette comédie
a été jouée pour la premičre fois par madame Allan-Despréaux, qui
l'avait découverte aprčs dix ans de publicité. Lorsque madame Allan
revint en France, elle voulut faire sa rentrée au Théâtre-Français
par le rôle de madame de Léry. On sait le succčs prodigieux qu'elle
y obtint. Le _Caprice_, représenté ŕ Paris le 27 novembre 1847, jouit
encore aujourd'hui de la męme faveur que dans sa nouveauté. On peut le
considérer désormais comme faisant partie du répertoire classique de
la Comédie-Française.
* * * * *
IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE
PROVERBE EN UN ACTE
PUBLIÉ EN 1845, REPRÉSENTÉ EN 1848
PERSONNAGES. ACTEURS QUI ONT CRÉÉ LES RÔLES.
LE COMTE. M. BRINDEAU.
LA MARQUISE. Mme ALLAN-DESPRÉAUX.
_La scčne est ŕ Paris._
_Un petit salon._
LE COMTE, LA MARQUISE.
_La marquise, assise sur un canapé, prčs de la cheminée, fait de la
tapisserie. Le comte entre et salue._
LE COMTE.
Je ne sais pas quand je me guérirai de ma maladresse, mais je suis
d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi de me
rappeler votre jour, et toutes les fois que j'ai envie de vous voir,
cela ne manque jamais d'ętre un mardi.
LA MARQUISE.
Est-ce que vous avez quelque chose ŕ me dire?
LE COMTE.
Non; mais, en le supposant, je ne le pourrais pas, car c'est un hasard
que vous soyez seule, et vous allez avoir, d'ici ŕ un quart d'heure,
une cohue d'amis intimes qui me fera sauver, je vous en avertis.
LA MARQUISE.
Il est vrai que c'est aujourd'hui mon jour, et je ne sais trop
pourquoi j'en ai un. C'est une mode qui a pourtant sa raison. Nos
mčres laissaient leur porte ouverte; la bonne compagnie n'était pas
nombreuse, et se bornait, pour chaque cercle, ŕ une fournée d'ennuyeux
qu'on avalait ŕ la rigueur. Maintenant, dčs qu'on reçoit, on reçoit
tout Paris; et tout Paris, au temps oů nous sommes, c'est bien
réellement Paris tout entier, ville et faubourgs. Quand on est chez
soi, on est dans la rue. Il fallait bien trouver un remčde; de lŕ
vient que chacun a son jour. C'est le seul moyen de se voir le moins
possible, et quand on dit: Je suis chez moi le mardi, il est clair que
c'est comme si on disait: Le reste du temps, laissez-moi tranquille.
LE COMTE.
Je n'en ai que plus de tort de venir aujourd'hui, puisque vous me
permettez de vous voir dans la semaine.
LA MARQUISE.
Prenez votre parti et mettez-vous lŕ. Si vous ętes de bonne humeur,
vous parlerez; sinon, chauffez-vous. Je ne compte pas sur grand monde
aujourd'hui, vous regarderez défiler ma petite lanterne magique. Mais
qu'avez-vous donc? vous me semblez...
LE COMTE.
Quoi?
LA MARQUISE.
Pour ma gloire, je ne veux pas le dire.
LE COMTE.
Ma foi, je vous l'avouerai; avant d'entrer ici, je l'étais un peu.
LA MARQUISE.
Quoi? Je le demande ŕ mon tour.
LE COMTE.
Vous fâcherez-vous si je vous le dis?
LA MARQUISE.
J'ai un bal ce soir oů je veux ętre jolie: je ne me fâcherai pas de la
journée.
LE COMTE.
Eh bien! j'étais un peu ennuyé. Je ne sais ce que j'ai; c'est un mal ŕ
la mode, comme vos réceptions.
Je me désole depuis midi; j'ai fait quatre visites sans trouver
personne. Je devais dîner quelque part; je me suis excusé sans raison.
Il n'y a pas un spectacle ce soir. Je suis sorti par un temps glacé;
je n'ai vu que des nez rouges et des joues violettes. Je ne sais que
faire, je suis bęte comme un feuilleton.
LA MARQUISE.
Je vous en offre autant; je m'ennuie ŕ crier. C'est le temps qu'il
fait, sans aucun doute.
LE COMTE.
Le fait est que le froid est odieux; l'hiver est une maladie. Les
badauds voient le pavé propre, le ciel clair, et, quand un vent bien
sec leur coupe les oreilles, ils appellent cela une belle gelée. C'est
comme qui dirait une belle fluxion de poitrine. Bien obligé de ces
beautés-lŕ.
LA MARQUISE.
Je suis plus que de votre avis. Il me semble que mon ennui me vient
moins de l'air du dehors, tout froid qu'il est, que de celui que les
autres respirent. C'est peut-ętre que nous vieillissons. Je commence ŕ
avoir trente ans, et je perds le talent de vivre.
LE COMTE.
Je n'ai jamais eu ce talent-lŕ, et ce qui m'épouvante, c'est que je le
gagne. En prenant des années, on devient plat ou fou, et j'ai une peur
atroce de mourir comme un sage.
LA MARQUISE.
Sonnez pour qu'on mette une bűche au feu; votre idée me gčle.
_On entend le bruit d'une sonnette au dehors._
LE COMTE.
Ce n'est pas la peine; on sonne ŕ la porte, et votre procession
arrive.
LA MARQUISE.
Voyons quelle sera la banničre, et surtout, tâchez de rester.
LE COMTE.
Non; décidément je m'en vais.
LA MARQUISE.
Oů allez-vous?
LE COMTE.
Je n'en sais rien.
_Il se lčve, salue et ouvre la porte._
Adieu, madame, ŕ jeudi soir.
LA MARQUISE.
Pourquoi jeudi?
LE COMTE, _debout, tenant le bouton de la porte_.
N'est-ce pas votre jour aux Italiens? J'irai vous faire une petite
visite.
LA MARQUISE.
Je ne veux pas de vous; vous ętes trop maussade. D'ailleurs, j'y mčne
M. Camus.
LE COMTE.
M. Camus, votre voisin de campagne?
LA MARQUISE.
Oui; il m'a vendu des pommes et du foin avec beaucoup de galanterie,
et je veux lui rendre sa politesse.
LE COMTE.
C'est bien vous, par exemple! L'ętre le plus ennuyeux! on devrait le
nourrir de sa marchandise. Et, ŕ propos, savez-vous ce qu'on dit?
LA MARQUISE.
Non. Mais on ne vient pas: qui avait donc sonné?
LE COMTE, _regardant ŕ la fenętre_.
Personne, une petite fille, je crois, avec un carton, je ne sais quoi,
une blanchisseuse. Elle est lŕ, dans la cour, qui parle ŕ vos gens.
LA MARQUISE.
Vous appelez cela je ne sais quoi; vous ętes poli, c'est mon bonnet.
Eh bien! qu'est-ce qu'on dit de moi et de M. Camus?--Fermez donc cette
porte... Il vient un vent horrible.
LE COMTE, _fermant la porte_.
On dit que vous pensez ŕ vous remarier, que M. Camus est millionnaire,
et qu'il vient chez vous bien souvent.
LA MARQUISE.
En vérité! pas plus que cela? Et vous me dites cela au nez tout
bonnement?
LE COMTE.
Je vous le dis, parce qu'on en parle.
LA MARQUISE.
C'est une belle raison. Est-ce que je vous répčte tout ce qu'on dit de
vous aussi par le monde?
LE COMTE.
De moi, madame? Que peut-on dire, s'il vous plaît, qui ne puisse pas
se répéter?
LA MARQUISE.
Mais vous voyez bien que tout peut se répéter, puisque vous m'apprenez
que je suis ŕ la veille d'ętre annoncée madame Camus. Ce qu'on dit de
vous est au moins aussi grave, car il paraît malheureusement que c'est
vrai.
LE COMTE.
Et quoi donc? Vous me feriez peur.
LA MARQUISE.
Preuve de plus qu'on ne se trompe pas.
LE COMTE.
Expliquez-vous, je vous en prie.
LA MARQUISE.
Ah! pas du tout; ce sont vos affaires.
LE COMTE, _se rasseyant_.
Je vous en supplie, marquise, je vous le demande en grâce. Vous ętes
la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi.
LA MARQUISE.
L'une des personnes, vous voulez dire.
LE COMTE.
Non, madame, je dis: la personne, celle dont l'esprit, le sentiment,
la...
LA MARQUISE.
Ah, ciel! vous allez faire une phrase.
LE COMTE.
Pas du tout. Si vous ne voyez rien, c'est qu'apparemment vous ne
voulez rien voir.
LA MARQUISE.
Voir quoi?
LE COMTE.
Cela s'entend de reste.
LA MARQUISE.
Je n'entends que ce qu'on me dit, et encore pas des deux oreilles.
LE COMTE.
Vous riez de tout; mais, sincčrement, serait-il possible que, depuis
un an, vous voyant presque tous les jours, faite comme vous ętes, avec
votre esprit, votre grâce et votre beauté...
LA MARQUISE.
Mais mon Dieu! c'est bien pis qu'une phrase, c'est une déclaration que
vous me faites lŕ. Avertissez au moins: est-ce une déclaration, ou un
compliment de bonne année?
LE COMTE.
Et si c'était une déclaration?
LA MARQUISE.
Oh! c'est que je n'en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j'allais
au bal, je suis exposée ŕ en entendre ce soir; ma santé ne me permet
pas ces choses-lŕ deux fois par jour.
LE COMTE.
En vérité, vous ętes décourageante, et je me réjouirai de bon coeur
quand vous y serez prise ŕ votre tour.
LA MARQUISE.
Moi aussi, je m'en réjouirai. Je vous jure qu'il y a des instants oů
je donnerais de grosses sommes pour avoir seulement un petit chagrin.
Tenez, j'étais comme cela pendant qu'on me coiffait, pas plus tard
que tout ŕ l'heure. Je poussais des soupirs ŕ me fendre l'âme, de
désespoir de ne penser ŕ rien.
LE COMTE.
Raillez, raillez! Vous y viendrez.
LA MARQUISE.
C'est bien possible; nous sommes tous mortels. Si je suis raisonnable,
ŕ qui la faute? Je vous assure que je ne me défends pas.
LE COMTE.
Vous ne voulez pas qu'on vous fasse la cour?
LA MARQUISE.
Non. Je suis trčs bonne personne, mais quant ŕ cela, c'est par trop
bęte. Dites-moi un peu, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que
signifie cette chose-lŕ: faire la cour ŕ une femme?
LE COMTE.
Cela signifie que cette femme vous plaît, et qu'on est bien aise de le
lui dire.
LA MARQUISE.
Ŕ la bonne heure; mais cette femme, cela lui plaît-il, ŕ elle, de vous
plaire? Vous me trouvez jolie, je suppose, et cela vous amuse de m'en
faire part. Eh bien, aprčs? Qu'est-ce que cela prouve? Est-ce une
raison pour que je vous aime? J'imagine que, si quelqu'un me plaît, ce
n'est pas parce que je suis jolie. Qu'y gagne-t-il ŕ ces compliments?
La belle maničre de se faire aimer que de venir se planter devant une
femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds ŕ la tęte, comme une
poupée dans un étalage, et de lui dire bien agréablement: Madame, je
vous trouve charmante! Joignez ŕ cela quelques phrases bien fades, un
tour de valse et un bouquet, voilŕ pourtant ce qu'on appelle faire sa
cour. Fi donc! Comment un homme d'esprit peut-il prendre goűt ŕ ces
niaiseries-lŕ? Cela me met en colčre, quand j'y pense.
LE COMTE.
Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher.
LA MARQUISE.
Ma foi, si. Il faut supposer ŕ une femme une tęte bien vide et un
grand fonds de sottise, pour se figurer qu'on la charme avec de
pareils ingrédients. Croyez-vous que ce soit bien divertissant de
passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises, et d'avoir du matin
au soir les oreilles pleines de balivernes? Il me semble, en vérité,
que, si j'étais homme et si je voyais une jolie femme, je me dirais:
Voilŕ une pauvre créature qui doit ętre bien assommée de compliments.
Je l'épargnerais, j'aurais pitié d'elle, et, si je voulais essayer de
lui plaire, je lui ferais l'honneur de lui parler d'autre chose que de
son malheureux visage. Mais non, toujours: Vous ętes jolie, et puis:
Vous ętes jolie, et encore jolie. Eh, mon Dieu! on le sait bien.
Voulez-vous que je vous dise? vous autres hommes ŕ la mode, vous
n'ętes que des confiseurs déguisés.
LE COMTE.
Eh bien! madame, vous ętes charmante, prenez-le comme vous voudrez.
_On entend la sonnette._
On sonne de nouveau; adieu, je me sauve.
_Il se lčve et ouvre la porte._
LA MARQUISE.
Attendez donc, j'avais ŕ vous dire,... je ne sais plus ce que
c'était... Ah! passez-vous par hasard du côté de Fossin, dans vos
courses?
LE COMTE.
Ce ne sera pas par hasard, madame, si je puis vous ętre bon ŕ quelque
chose.
LA MARQUISE.
Encore un compliment! Mon Dieu, que vous m'ennuyez! C'est une bague
que j'ai cassée; je pourrais bien l'envoyer tout bonnement, mais c'est
qu'il faut que je vous explique...
_Elle ôte la bague de son doigt._
Tenez, voyez-vous, c'est le chaton. Il y a lŕ une petite pointe, vous
voyez bien, n'est-ce pas? Ça s'ouvrait de côté, par lŕ; je l'ai heurté
ce matin je ne sais oů, le ressort a été forcé.
LE COMTE.
Dites donc, marquise, sans indiscrétion, il y avait des cheveux lŕ
dedans.
LA MARQUISE.
Peut-ętre bien. Qu'avez-vous ŕ rire?
LE COMTE.
Je ne ris pas le moins du monde.
LA MARQUISE.
Vous ętes un impertinent; ce sont des cheveux de mon mari. Mais je
n'entends personne. Qui avait donc sonné encore?
LE COMTE, _regardant ŕ la fenętre_.
Une autre petite fille, et un autre carton. Encore un bonnet, je
suppose. Ŕ propos, avec tout cela, vous me devez une confidence.
LA MARQUISE.
Fermez donc cette porte, vous me glacez.
LE COMTE.
Je m'en vais. Mais vous me promettez de me répéter ce qu'on vous a dit
de moi, n'est-ce pas, marquise?
LA MARQUISE.
Venez ce soir au bal, nous causerons.
LE COMTE.
Ah, parbleu! oui, causer dans un bal! Joli endroit de conversation,
avec accompagnement de trombones et un tintamarre de verres d'eau
sucrée! L'un vous marche sur le pied, l'autre vous pousse le coude,
pendant qu'un laquais tout poissé vous fourre une glace dans votre
poche. Je vous demande un peu si c'est lŕ...
LA MARQUISE.
Voulez-vous rester ou sortir? Je vous répčte que vous m'enrhumez.
Puisque personne ne vient, qu'est-ce qui vous chasse?
LE COMTE, _fermant la porte et venant se rasseoir_.
C'est que je me sens, malgré moi, de si mauvaise humeur, que je crains
vraiment de vous excéder. Il faut décidément que je cesse de venir
chez vous.
LA MARQUISE.
C'est honnęte; et ŕ propos de quoi?
LE COMTE.
Je ne sais pas, mais je vous ennuie, vous me le disiez vous-męme tout
ŕ l'heure, et je le sens bien; c'est trčs naturel. C'est ce malheureux
logement que j'ai lŕ en face; je ne peux pas sortir sans regarder vos
fenętres, et j'entre ici machinalement, sans réfléchir ŕ ce que j'y
viens faire.
LA MARQUISE.
Si je vous ai dit que vous m'ennuyez ce matin, c'est que ce n'est pas
une habitude. Sérieusement, vous me feriez de la peine; j'ai beaucoup
de plaisir ŕ vous voir.
LE COMTE.
Vous? Pas du tout. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais retourner
en Italie.
LA MARQUISE.
Ah! qu'est-ce que dira mademoiselle...
LE COMTE.
Quelle demoiselle, s'il vous plaît?
LA MARQUISE.
Mademoiselle je ne sais qui, mademoiselle votre protégée. Est-ce que
je sais le nom de vos danseuses?
LE COMTE.
Ah! c'est donc lŕ ce beau propos qu'on vous a tenu sur mon compte?
LA MARQUISE.
Précisément. Est-ce que vous niez?
LE COMTE.
C'est un conte ŕ dormir debout.
LA MARQUISE.
Il est fâcheux qu'on vous ait vu trčs distinctement au spectacle avec
un certain chapeau rose ŕ fleurs, comme il n'en fleurit qu'ŕ l'Opéra.
Vous ętes dans les choeurs, mon voisin; cela est connu de tout le
monde.
LE COMTE.
Comme votre mariage avec M. Camus.
LA MARQUISE.
Vous y revenez? Eh bien! pourquoi pas? M. Camus est un fort honnęte
homme; il est plusieurs fois millionnaire; son âge, bien qu'assez
respectable, est juste ŕ point pour un mari. Je suis veuve, et il est
garçon; il est trčs bien quand il a des gants.
LE COMTE.
Et un bonnet de nuit: cela doit lui aller.
LA MARQUISE.
Voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît! Est-ce qu'on parle de
choses pareilles?
LE COMTE.
Dame! ŕ quelqu'un qui peut les voir.
LA MARQUISE.
Ce sont apparemment ces demoiselles qui vous apprennent ces jolies
façons-lŕ.
LE COMTE, _se levant et prenant son chapeau_.
Tenez, marquise, je vous dis adieu. Vous me feriez dire quelque
sottise.
LA MARQUISE.
Quel excčs de délicatesse!
LE COMTE.
Non, mais, en vérité, vous ętes trop cruelle. C'est bien assez de
défendre qu'on vous aime, sans m'accuser d'aimer ailleurs.
LA MARQUISE.
De mieux en mieux. Quel ton tragique! Moi, je vous ai défendu de
m'aimer?
LE COMTE.
Certainement,--de vous en parler, du moins.
LA MARQUISE.
Eh bien! je vous le permets; voyons votre éloquence.
LE COMTE.
Si vous le disiez sérieusement...
LA MARQUISE.
Que vous importe? pourvu que je le dise.
LE COMTE.
C'est que, tout en riant, il pourrait bien y avoir quelqu'un ici qui
courűt des risques.
LA MARQUISE.
Oh! oh! de grands périls, monsieur?
LE COMTE.
Peut-ętre, madame; mais, par malheur, le danger ne serait que pour
moi.
LA MARQUISE.
Quand on a peur, on ne fait pas le brave. Eh bien! voyons. Vous ne
dites rien? Vous me menacez, je m'expose, et vous ne bougez pas? Je
m'attendais ŕ vous voir au moins vous précipiter ŕ mes pieds comme
Rodrigue, ou M. Camus lui-męme. Il y serait déjŕ, ŕ votre place.
LE COMTE.
Cela vous divertit donc beaucoup de vous moquer du pauvre monde?
LA MARQUISE.
Et vous, cela vous surprend donc bien de ce qu'on ose vous braver en
face?
LE COMTE.
Prenez garde! Si vous ętes brave, j'ai été hussard, moi, madame, je
suis bien aise de vous le dire, et il n'y a pas encore si longtemps.
LA MARQUISE.
Vraiment! Eh bien! ŕ la bonne heure. Une déclaration de hussard, cela
doit ętre curieux; je n'ai jamais vu cela de ma vie. Voulez-vous que
j'appelle ma femme de chambre? Je suppose qu'elle saura vous répondre.
Vous me donnerez une représentation.
_On entend la sonnette._
LE COMTE.
Encore cette sonnerie! Adieu donc, marquise. Je ne vous en tiens pas
quitte, au moins.
_Il ouvre la porte._
LA MARQUISE.
Ŕ ce soir, toujours, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce donc que ce bruit
que j'entends?
LE COMTE, _regardant ŕ la fenętre_.
C'est le temps qui vient de changer. Il pleut et il gręle ŕ faire
plaisir. On vous apporte un troisičme bonnet, et je crains bien qu'il
n'y ait un rhume dedans.
LA MARQUISE.
Mais ce tapage-lŕ, est-ce que c'est le tonnerre? en plein mois de
janvier! Et les almanachs?
LE COMTE.
Non; c'est seulement un ouragan, une espčce de trombe qui passe.
LA MARQUISE.
C'est effrayant. Mais fermez donc la porte; vous ne pouvez pas sortir
de ce temps-lŕ. Qu'est-ce qui peut produire une chose pareille?
LE COMTE, _fermant la porte_.
Madame, c'est la colčre céleste qui châtie les carreaux de vitre, les
parapluies, les mollets des dames et les tuyaux de cheminée.
LA MARQUISE.
Et mes chevaux qui sont sortis!
LE COMTE.
Il n'y a pas de danger pour eux, s'il ne leur tombe rien sur la tęte.
LA MARQUISE.
Plaisantez donc ŕ votre tour! Je suis trčs propre, moi, monsieur, je
n'aime pas ŕ crotter mes chevaux. C'est inconcevable! Tout ŕ l'heure
il faisait le plus beau ciel du monde.
LE COMTE.
Vous pouvez bien compter, par exemple, qu'avec cette gręle vous
n'aurez personne. Voilŕ un jour de moins parmi vos jours.
LA MARQUISE.
Non pas, puisque vous ętes venu. Posez donc votre chapeau, qui
m'impatiente.
LE COMTE.
Un compliment, madame! Prenez garde. Vous qui faites profession de les
haďr, on pourrait prendre les vôtres pour la vérité.
LA MARQUISE.
Mais je vous le dis, et c'est trčs vrai. Vous me faites grand plaisir
en venant me voir.
LE COMTE, _se rasseyant prčs de la marquise_.
Alors laissez-moi vous aimer.
LA MARQUISE.
Mais je vous le dis aussi, je le veux bien; cela ne me fâche pas le
moins du monde.
LE COMTE.
Alors laissez-moi vous en parler.
LA MARQUISE.
Ŕ la hussarde, n'est-il pas vrai?
LE COMTE.
Non, madame; soyez convaincue qu'ŕ défaut de coeur, j'ai assez de
bon sens pour vous respecter. Mais il me semble qu'on a bien le droit,
sans offenser une personne qu'on respecte...
LA MARQUISE.
D'attendre que la pluie soit passée, n'est-ce pas? Vous ętes entré ici
tout ŕ l'heure sans savoir pourquoi, vous l'avez dit vous-męme; vous
étiez ennuyé, vous ne saviez que faire, vous pouviez męme passer pour
assez grognon. Si vous aviez trouvé ici trois personnes, les premičres
venues, lŕ, au coin de ce feu, vous parleriez, ŕ l'heure qu'il est,
littérature ou chemins de fer, aprčs quoi vous iriez dîner. C'est donc
parce que je me suis trouvée seule que vous vous croyez tout ŕ coup
obligé, oui, obligé, pour votre honneur, de me faire cette męme cour,
cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si inutile, si
ridicule, si rebattue. Mais qu'est-ce que je vous ai donc fait? Qu'il
arrive ici une visite, vous allez peut-ętre avoir de l'esprit; mais je
suis seule, vous voilŕ plus banal qu'un vieux couplet de vaudeville;
et vite, vous abordez votre thčme, et si je voulais vous écouter,
vous m'exhiberiez une déclaration, vous me réciteriez votre amour.
Savez-vous de quoi les hommes ont l'air en pareil cas? De ces pauvres
auteurs sifflés qui ont toujours un manuscrit dans leur poche, quelque
tragédie inédite et injouable, et qui vous tirent cela pour vous en
assommer, dčs que vous ętes seul un quart d'heure avec eux.
LE COMTE.
Ainsi, vous me dites que je ne vous déplais pas, je vous réponds que
je vous aime, et puis c'est tout, ŕ votre avis?
LA MARQUISE.
Vous ne m'aimez pas plus que le Grand Turc.
LE COMTE.
Oh! par exemple, c'est trop fort. Écoutez-moi un seul instant, et si
vous ne me croyez pas sincčre...
LA MARQUISE.
Non, non, et non! Mon Dieu! croyez-vous que je ne sache pas ce que
vous pourriez me dire? J'ai trčs bonne opinion de vos études; mais,
parce que vous avez de l'éducation, pensez-vous que je n'aie rien lu?
Tenez, je connaissais un homme d'esprit qui avait acheté, je ne sais
oů, une collection de cinquante lettres, assez bien faites, trčs
proprement écrites, des lettres d'amour, bien entendu. Ces cinquante
lettres étaient graduées de façon ŕ composer une sorte de petit roman,
oů toutes les situations étaient prévues. Il y en avait pour les
déclarations, pour les dépits, pour les espérances, pour les moments
d'hypocrisie oů l'on se rabat sur l'amitié, pour les brouilles,
pour les désespoirs, pour les instants de jalousie, pour la mauvaise
humeur, męme pour les jours de pluie comme aujourd'hui. J'ai lu ces
lettres. L'auteur prétendait, dans une sorte de préface, en avoir fait
usage pour lui-męme, et n'avoir jamais trouvé une femme qui résistât
plus tard que le trente-troisičme numéro. Eh bien! j'ai résisté, moi,
ŕ toute la collection. Je vous demande si j'ai de la littérature, et
si vous pourriez vous flatter de m'apprendre quelque chose de nouveau.
LE COMTE.
Vous ętes bien blasée, marquise.
LA MARQUISE.
Des injures? J'aime mieux cela; c'est moins fade que vos sucreries.
LE COMTE.
Oui, en vérité, vous ętes bien blasée.
LA MARQUISE.
Vous le croyez? Eh bien! pas du tout.
LE COMTE.
Comme une vieille Anglaise, mčre de quatorze enfants.
LA MARQUISE.
Comme la plume qui danse sur mon chapeau. Vous vous figurez donc que
c'est une science bien profonde que de vous savoir tous par coeur?
Mais il n'y a pas besoin d'étudier pour apprendre; il n'y a qu'ŕ vous
laisser faire. Réfléchissez; c'est un calcul bien simple. Les hommes
assez braves pour respecter nos pauvres oreilles, et pour ne pas
tomber dans la sucrerie, sont extręmement rares. D'un autre côté, il
n'est pas contestable que, dans ces tristes instants oů vous tâchez
de mentir pour essayer de plaire, vous vous ressemblez tous comme des
capucins de cartes. Heureusement pour nous, la justice du ciel n'a pas
mis ŕ votre disposition un vocabulaire trčs varié. Vous n'avez tous,
comme on dit, qu'une chanson, en sorte que le seul fait d'entendre les
męmes phrases, la seule répétition des męmes mots, des męmes gestes
apprętés, des męmes regards tendres, le spectacle seul de ces figures
diverses qui peuvent ętre plus ou moins bien par elles-męmes, mais
qui prennent toutes, dans ces moments funestes, la męme physionomie
humblement conquérante, cela nous sauve par l'envie de rire, ou du
moins par le simple ennui. Si j'avais une fille, et si je voulais
la préserver de ces entreprises qu'on appelle dangereuses, je me
garderais bien de lui défendre d'écouter les pastorales de ses
valseurs. Je lui dirais seulement: N'en écoute pas un seul, écoute-les
tous; ne ferme pas le livre et ne marque pas la page; laisse-le
ouvert, laisse ces messieurs te raconter leurs petites drôleries. Si,
par malheur, il y en a un qui te plaît, ne t'en défends pas, attends
seulement; il en viendra un autre tout pareil qui te dégoűtera de tous
les deux. Tu as quinze ans, je suppose; eh bien! mon enfant, cela ira
ainsi jusqu'ŕ trente, et ce sera toujours la męme chose. Voilŕ mon
histoire et ma science; appelez-vous cela ętre blasée?
LE COMTE.
Horriblement, si ce que vous dites est vrai; et cela semble si peu
naturel, que le doute pourrait ętre permis.
LA MARQUISE.
Qu'est-ce que cela me fait que vous me croyiez ou non?
LE COMTE.
Encore mieux. Est-ce bien possible? Quoi! ŕ votre âge, vous méprisez
l'amour? Les paroles d'un homme qui vous aime vous font l'effet d'un
méchant roman? Ses regards, ses gestes, ses sentiments vous semblent
une comédie? Vous vous piquez de dire vrai, et vous ne voyez que
mensonge dans les autres? Mais d'oů revenez-vous donc, marquise?
Qu'est-ce qui vous a donné ces maximes-lŕ?
LA MARQUISE.
Je reviens de loin, mon voisin.
LE COMTE.
Oui, de nourrice. Les femmes s'imaginent qu'elles savent toute
chose au monde; elles ne savent rien du tout. Je vous le demande ŕ
vous-męme, quelle expérience pouvez-vous avoir? Celle de ce voyageur
qui, ŕ l'auberge, avait vu une femme rousse, et qui écrivait sur son
journal: «Les femmes sont rousses dans ce pays-ci.»
LA MARQUISE.
Je vous avais prié de mettre une bűche au feu.
LE COMTE, _mettant la bűche_.
Ętre prude, cela se conçoit; dire non, se boucher les oreilles,
haďr l'amour, cela se peut; mais le nier, quelle plaisanterie! Vous
découragez un pauvre diable en lui disant: Je sais ce que vous allez
me dire. Mais n'est-il pas en droit de vous répondre: Oui, madame,
vous le savez peut-ętre; et moi aussi, je sais ce qu'on dit quand on
aime, mais je l'oublie en vous parlant! Rien n'est nouveau sous le
soleil; mais je dis ŕ mon tour: Qu'est-ce que cela prouve?
LA MARQUISE.
Ŕ la bonne heure, au moins! vous parlez trčs bien; ŕ peu de chose
prčs, c'est comme un livre.
LE COMTE.
Oui, je parle, et je vous assure que, si vous ętes telle qu'il vous
plaît de le paraître, je vous plains trčs sincčrement.
LA MARQUISE.
Ŕ votre aise; faites comme chez vous.
LE COMTE.
Il n'y a rien lŕ qui puisse vous blesser. Si vous avez le droit de
nous attaquer, n'avons-nous pas raison de nous défendre? Quand vous
nous comparez ŕ des auteurs sifflés, quel reproche croyez-vous nous
faire? Eh! mon Dieu! si l'amour est une comédie...
LA MARQUISE.
La feu ne va pas; la bűche est de travers.
LE COMTE, _arrangeant le feu_.
Si l'amour est une comédie, cette comédie, vieille comme le monde,
sifflée ou non, est, au bout du compte, ce qu'on a encore trouvé de
moins mauvais. Les rôles sont rebattus, j'y consens; mais, si la pičce
ne valait rien, tout l'univers ne la saurait pas par coeur;--et je
me trompe en disant qu'elle est vieille. Est-ce ętre vieux que d'ętre
immortel?
LA MARQUISE.
Monsieur, voilŕ de la poésie.
LE COMTE.
Non, madame; mais ces fadaises, ces balivernes qui vous ennuient, ces
compliments, ces déclarations, tout ce radotage, sont de trčs bonnes
anciennes choses, convenues, si vous voulez, fatigantes, ridicules
parfois, mais qui en accompagnent une autre, laquelle est toujours
jeune.
LA MARQUISE.
Vous vous embrouillez; qu'est-ce qui est toujours vieux, et qu'est-ce
qui est toujours jeune?
LE COMTE.
L'amour.
LA MARQUISE.
Monsieur, voilŕ de l'éloquence.
LE COMTE.
Non, madame; je veux dire ceci: que l'amour est immortellement jeune,
et que les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement
vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de romans qui
vous sortent du coeur on ne sait pas pourquoi, tout cet entourage,
tout cet attirail, c'est un cortčge de vieux chambellans, de vieux
diplomates, de vieux ministres, c'est le caquet de l'antichambre d'un
roi; tout cela passe, mais ce roi-lŕ ne meurt pas. L'amour est mort,
vive l'amour!
LA MARQUISE.
L'amour?
LE COMTE.
L'amour. Et quand męme on ne ferait que s'imaginer...
LA MARQUISE.
Donnez-moi l'écran qui est lŕ.
LE COMTE.
Celui-lŕ?
LA MARQUISE.
Non, celui de taffetas; voilŕ votre feu qui m'aveugle.
LE COMTE, _donnant l'écran ŕ la marquise_.
Quand męme on ne ferait que s'imaginer qu'on aime, est-ce que ce n'est
pas une chose charmante?
LA MARQUISE.
Mais je vous dis, c'est toujours la męme chose.
LE COMTE.
Et toujours nouveau, comme dit la chanson. Que voulez-vous donc qu'on
invente? Il faut apparemment qu'on vous aime en hébreu. Cette Vénus
qui est lŕ sur votre pendule, c'est aussi toujours la męme chose;
en est-elle moins belle, s'il vous plaît? Si vous ressemblez ŕ votre
grand'mčre, est-ce que vous en ętes moins jolie?
LA MARQUISE.
Bon, voilŕ le refrain: jolie. Donnez-moi le coussin qui est prčs de
vous.
LE COMTE, _prenant le coussin et le tenant ŕ la main_.
Cette Vénus est faite pour ętre belle, pour ętre aimée et admirée,
cela ne l'ennuie pas du tout. Si le beau corps trouvé ŕ Milo a jamais
eu un modčle vivant, assurément cette grande gaillarde a eu plus
d'amoureux qu'il ne lui en fallait, et elle s'est laissé aimer comme
une autre, comme sa cousine Astarté, comme Aspasie et Manon Lescaut.
LA MARQUISE.
Monsieur, voilŕ de la mythologie.
LE COMTE, _tenant toujours le coussin_.
Non, madame; mais je ne puis dire combien cette indifférence ŕ la
mode, cette froideur qui raille et dédaigne, cet air d'expérience
qui réduit tout ŕ rien, me font peine ŕ voir ŕ une jeune femme. Vous
n'ętes pas la premičre chez qui je les rencontre; c'est une maladie
qui court les salons. On se détourne, on bâille, comme vous en ce
moment, on dit qu'on ne veut pas entendre parler d'amour. Alors,
pourquoi mettez-vous de la dentelle? Qu'est-ce que ce pompon-lŕ fait
sur votre tęte?
LA MARQUISE.
Et qu'est-ce que ce coussin fait dans votre main? Je vous l'avais
demandé pour mettre sous mes pieds.
LE COMTE.
Eh bien! l'y voilŕ, et moi aussi; et je vous ferai une déclaration,
bon gré, mal gré, vieille comme les rues, et bęte comme une oie; car
je suis furieux contre vous.
_Il pose le coussin ŕ terre devant la marquise, et se met ŕ genoux
dessus._
LA MARQUISE.
Voulez-vous me faire la grâce de vous ôter de lŕ, s'il vous plaît?
LE COMTE.
Non; il faut d'abord que vous m'écoutiez.
LA MARQUISE.
Vous ne voulez pas vous lever?
LE COMTE.
Non, non, et non! comme vous le disiez tout ŕ l'heure, ŕ moins que
vous ne consentiez ŕ m'entendre.
LA MARQUISE.
J'ai bien l'honneur de vous saluer.
_Elle se lčve._
LE COMTE, _toujours ŕ genoux_.
Marquise, au nom du ciel! cela est trop cruel. Vous me rendrez fou,
vous me désespérez.
LA MARQUISE.
Cela vous passera au _Café de Paris_.
LE COMTE, _de męme_.
Non, sur l'honneur, je parle du fond de l'âme. Je conviendrai, tant
que vous voudrez, que j'étais entré ici sans dessein; je ne comptais
que vous voir en passant; témoin cette porte que j'ai ouverte trois
fois pour m'en aller. La conversation que nous venons d'avoir, vos
railleries, votre froideur męme, m'ont entraîné plus loin qu'il ne
fallait peut-ętre; mais ce n'est pas d'aujourd'hui seulement, c'est du
premier jour oů je vous ai vue, que je vous aime, que je vous adore...
Je n'exagčre pas en m'exprimant ainsi;... oui, depuis plus d'un an, je
vous adore, je ne songe...
LA MARQUISE.
Adieu.
_La marquise sort et laisse la porte ouverte._
LE COMTE, _demeuré seul, reste un moment encore ŕ genoux, puis il se
lčve et dit_:
C'est la vérité que cette porte est glaciale.
_Il va pour sortir, et voit la marquise._
LE COMTE.
Ah! marquise, vous vous moquez de moi.
LA MARQUISE, _appuyée sur la porte entr'ouverte_.
Vous voilŕ debout?
LE COMTE.
Oui, et je m'en vais pour ne plus jamais vous revoir.
LA MARQUISE.
Venez ce soir au bal, je vous garde une valse.
LE COMTE.
Jamais, jamais je ne vous reverrai! je suis au désespoir, je suis
perdu.
LA MARQUISE.
Qu'avez-vous?
LE COMTE.
Je suis perdu, je vous aime comme un enfant. Je vous jure sur ce qu'il
y a de plus sacré au monde...
LA MARQUISE.
Adieu.
_Elle veut sortir._
LE COMTE.
C'est moi qui sors, madame; restez, je vous en supplie. Ah! je sens
combien je vais souffrir!
LA MARQUISE, _d'un ton sérieux_.
Mais, enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez?
LE COMTE.
Mais, madame, je veux,... je désirerais...
LA MARQUISE.
Quoi? car enfin vous m'impatientez. Vous imaginez-vous que je vais
ętre votre maîtresse, et hériter de vos chapeaux roses? Je vous
préviens qu'une pareille idée fait plus que me déplaire, elle me
révolte.
LE COMTE.
Vous, marquise! grand Dieu! s'il était possible, ce serait ma vie
entičre que je mettrais ŕ vos pieds; ce serait mon nom, mes biens, mon
honneur męme que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un
seul instant, je ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous
ne parlez que pour me chagriner, mais avec aucune femme au monde!
L'avez-vous bien pu supposer? me croyez-vous si dépourvu de sens? mon
étourderie ou ma déraison a-t-elle donc été si loin, que de vous
faire douter de mon respect? Vous qui me disiez tantôt que vous aviez
quelque plaisir ŕ me voir, peut-ętre quelque amitié pour moi (n'est-il
pas vrai, marquise?), pouvez-vous penser qu'un homme ainsi distingué
par vous, que vous avez pu trouver digne d'une si précieuse, d'une
si douce indulgence, ne saurait pas ce que vous valez? Suis-je donc
aveugle ou insensé? Vous, ma maîtresse! non pas, mais ma femme!
LA MARQUISE.
Ah!--Eh bien! si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne nous
serions pas disputés.--Ainsi, vous voulez m'épouser?
LE COMTE.
Mais certainement, j'en meurs d'envie, je n'ai jamais osé vous le
dire, mais je ne pense pas ŕ autre chose depuis un an; je donnerais
mon sang pour qu'il me fűt permis d'avoir la plus légčre espérance...
LA MARQUISE.
Attendez donc, vous ętes plus riche que moi.
LE COMTE.
Oh, mon Dieu! je ne crois pas, et qu'est-ce que cela vous fait? Je
vous en supplie, ne parlons pas de ces choses-lŕ! Votre sourire, en ce
moment, me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot, par grâce! ma
vie est dans vos mains.
LA MARQUISE.
Je vais vous dire deux proverbes: le premier, c'est qu'il n'y a rien
de tel que de s'entendre. Par conséquent, nous causerons de ceci.
LE COMTE.
Ce que j'ai osé vous dire ne vous déplaît donc pas?
LA MARQUISE.
Mais non. Voici mon second proverbe: c'est qu'il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée. Or, voilŕ trois quarts d'heure que celle-ci,
grâce ŕ vous, n'est ni l'un ni l'autre, et cette chambre est
parfaitement gelée. Par conséquent aussi, vous allez me donner le bras
pour aller dîner chez ma mčre. Aprčs cela, vous irez chez Fossin.
LE COMTE.
Chez Fossin, madame? pour quoi faire?
LA MARQUISE.
Ma bague.
LE COMTE.
Ah! c'est vrai, je n'y pensais plus. Eh bien! votre bague, marquise?
LA MARQUISE.
Marquise, dites-vous? Eh bien! ŕ ma bague, il y a justement sur le
chaton une petite couronne de marquise; et comme cela peut servir de
cachet... Dites donc, comte, qu'en pensez-vous? il faudra peut-ętre
ôter les fleurons? Allons, je vais mettre un chapeau.
LE COMTE.
Vous me comblez de joie!... comment vous exprimer...
LA MARQUISE.
Mais fermez donc cette malheureuse porte! cette chambre ne sera plus
habitable.
FIN DE IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE.
Le succčs imprévu du _Caprice_ donna l'idée aux artistes de la
Comédie-Française de chercher parmi les ouvrages d'Alfred de Musset
quelque autre pičce du męme genre. Madame Allan-Despréaux et M.
Brindeau choisirent le proverbe: _Il faut qu'une porte soit ouverte
ou fermée_, publiée par la _Revue des Deux Mondes_ en 1845. Ce
petit acte, joué sans aucun changement par les męmes artistes que le
_Caprice_, fut écouté avec le męme plaisir. Depuis le 7 avril 1848,
qu'on l'a représenté pour la premičre fois, il est resté au répertoire
du Théâtre-Français.
* * * * *
LOUISON
COMÉDIE EN DEUX ACTES
1849
PERSONNAGES. ACTEURS QUI ONT CRÉÉ LES RÔLES.
LE DUC. MM. BRINDEAU.
BERTHAUD. RÉGNIER.
LA MARÉCHALE. Mme MÉLINGUE.
LA DUCHESSE. Mlles JUDITH.
LISETTE. ANAĎS.
VALETS, UNE FEMME.
_Costumes du temps de Louis XVI._
Ŕ MADEMOISELLE ANAĎS
RONDEAU
Que rien ne puisse en liberté
Passer sous le sacré portique
Sans ętre quelque peu heurté
Par les bornes de la critique,
C'est un axiome authentique.
Pourquoi tant de sévérité?
Grétry disait avec gaîté:
«J'aime mieux un peu de musique
Que rien.»
Ŕ ma Louison ce mot s'applique.
Sur le théâtre elle a jeté
Son petit bouquet poétique.
Pourvu que vous l'ayez porté,
Le reste est moins, en vérité,
Que rien.
[Illustration: Louison]
ACTE PREMIER
SCČNE PREMIČRE
LISETTE, _seule_.
Me voilŕ bien chanceuse; il n'en faut plus qu'autant.
Le sort est, quand il veut, bien impatientant.
Que les honnętes gens se mettent ŕ ma place,
Et qu'on me dise un peu ce qu'il faut que je fasse.
Voici tantôt vingt ans que je vivais chez nous;
Dieu m'a faite pour rire et pour planter des choux.
J'avais pour précepteur le curé du village;
J'appris ce qu'il savait, męme un peu davantage.
Je vivais sur parole, et je trouvais moyen
D'avoir des amoureux sans qu'il m'en coűtât rien.
Mon pčre était fermier; j'étais sa ménagčre.
Je courais la maison, toujours brave et légčre,
Et j'aurais de grand coeur, pour obliger nos gens,
Mené les vaches paître ou les dindons aux champs.
Un beau jour on m'embarque, on me met dans un coche,
Un paquet sous le bras, dix écus dans ma poche,
On me promet fortune et la fleur des maris,
On m'expédie en poste, et je suis ŕ Paris.
Aussitôt, de paniers largement affublée,
De taffetas vętue et de poudre aveuglée,
On m'apprend que je suis gouvernante céans.
Gouvernante de quoi? monsieur n'a pas d'enfants.
Il en fera plus tard.--On meuble une chambrette;
On me dit: Désormais, tu t'appelles Lisette.
J'y consens, et mon rôle est de régner en paix
Sur trois filles de chambre et neuf ou dix laquais.
Jusque-lŕ mon destin ne faisait pas grand'peine.
La maréchale m'aime; au fait, c'est ma marraine.
Sa bru, notre duchesse, a l'air fort innocent.
Mais monseigneur le duc alors était absent;
Oů? je ne sais pas trop, ŕ la noce, ŕ la guerre.
Enfin, ces jours derniers, comme on n'y pensait gučre,
Il écrit qu'il revient, il arrive, et, ma foi,
Tout juste, en arrivant, tombe amoureux de moi.
Je vous demande un peu quelle étrange folie!
Sa femme est sage et douce autant qu'elle est jolie.
Elle l'aime, Dieu sait! et ce libertin-lŕ
Ne peut pas bonnement s'en tenir ŕ cela;
Il m'écrit des poulets, me conte des fredaines,
Me donne des rubans, des noeuds et des mitaines;
Puis enfin, plus hardi, pas plus tard qu'ŕ présent,
Du brillant que voici veut me faire présent.
Un diamant, ŕ moi! la chose est assez claire.
Hors de l'argent comptant, que diantre en puis-je faire?
Je ne suis pas duchesse, et ne puis le porter.
Ainsi, tout simplement, monsieur veut m'acheter.
Voyons, me fâcherai-je?--Il n'est pas trčs commode
De les heurter de front, ces tyrans ŕ la mode,
Et la prison est lŕ, pour un oui, pour un non,
Quand sur un talon rouge on glisse ŕ Trianon.
Faut-il ętre sincčre et tout dire ŕ madame?
C'est lui mettre, d'un mot, bien du chagrin dans l'âme,
Troubler une maison, peut-ętre pour toujours,
Et pour un pur caprice en chasser les amours.
Vaut-il pas mieux agir en personne discrčte,
Et garder dans le coeur cette injure secrčte?
Oui, c'est le plus prudent.--Ah! que j'ai de souci!
Ce brillant est gentil... et monseigneur aussi.
Je vais lui renvoyer sa bague ŕ l'instant męme,
Ici, dans ce papier.--Ma foi, tant pis s'il m'aime!
SCČNE II
LISETTE, LE DUC.
LE DUC, _ŕ part_.
Personne encore ici?--L'on va souper, je croi.
C'est Lisette.--Elle écrit.--Bon! c'est sans doute ŕ moi.
Les femmes ont vraiment un instinct que j'admire,
D'écrire bravement ce qu'elles n'osent dire.
Tu te défends, ma belle? Oh! j'en triompherai!
J'en ai fait la gageure, et je la gagnerai.
_Haut._
Le souper est-il pręt? Bonsoir, belle Lisette.
LISETTE, _se levant_.
Monseigneur...
LE DUC.
Qu'as-tu donc? Tu sembles inquičte,
Troublée, oui, sur l'honneur. Qu'est-ce? quoi? tu ręvais?
Et que faisais-tu lŕ?
LISETTE.
Monseigneur, j'écrivais.
LE DUC.
Ŕ qui donc, par hasard? ŕ quelque amant, petite?
LISETTE.
Ŕ vous-męme; tenez.
_Elle lui donne la lettre et veut sortir._
LE DUC.
Et tu t'en vas si vite?
Non parbleu! Reste lŕ. Que veut dire ceci?
Que vois-je? Mon anneau que tu me rends ainsi?
_Il lit._
«Monseigneur, vous me dites que vous m'aimez...»
Oui, certes, je le dis, le fait est véritable.
Penses-tu que je trompe, et m'en crois-tu capable?
_Il lit._
«Vous me dites que vous m'aimez, mais cela est bien difficile ŕ
croire, car, pour aimer une personne, il faut, j'imagine, commencer
par la connaître, et toute servante que je suis...»
Servante! que dis-tu? Fi donc, tu ne l'es point.
Servante! ce mot-lŕ me choque au dernier point.
_Il lit._
«Toute servante que je suis, vous me connaissez assurément bien peu si
vous me croyez intéressée, et si vous avez pensé, monseigneur, qu'on
pouvait payer un amour qui refuse de se donner.»
Qu'est-ce ŕ dire, payer? Moi, te payer, ma belle?
Quoi! pour un simple anneau, pour une bagatelle,
Pour un hochet d'enfant qui plaît ŕ voir briller,
Tu me crois assez sot pour vouloir te payer?
Si tel était mon but, si j'osais l'entreprendre,
Si l'amour de Lisette était jamais ŕ vendre,
Pour payer dignement de semblables appas,
Mes biens y passeraient et n'y suffiraient pas.
Est-ce donc une offense ŕ la personne aimée,
Et s'en doit-elle au fond croire moins estimée,
Si l'on veut la parer, sans pouvoir l'embellir,
D'un pauvre diamant que ses yeux font pâlir?
Comment! mettre une bague aux plus beaux doigts du monde,
_Il lui remet la bague au doigt._
Poser quelques bijoux sur cette épaule ronde,
Sur ce coeur qui palpite un céladon changeant,
Serrer ce petit pied dans un réseau d'argent,
Entourer la beauté, dans sa fleur et sa grâce,
Des prestiges de l'art qu'elle égale et surpasse,
Ce serait donc, ma chčre, un grand crime ŕ tes yeux?
Payer! efface donc: ce mot est odieux.
Oublions ce billet, n'y songeons plus, Lisette.
On paie un intendant, un rustre, une grisette;
Mais, dans ce monde-ci, je ne sais pas encor
Qu'on se soit avisé de payer un trésor,
Et ton coeur est sans prix, quand tu serais moins belle.
LISETTE.
Mais, monseigneur, pourtant...
LE DUC.
Fi! tu fais la cruelle.
_On ouvre la porte du fond._
Deux mots:--on va souper; les gens ouvrent déjŕ.
Écoute:--nous allons au bal de l'Opéra;
Mais je reviendrai seul, et grâce ŕ la cohue,
Ŕ peine entré, je sors et regagne la rue.
Tu seras seule aussi, mes laquais ne voient rien;
Accorde-moi, de grâce, un moment d'entretien,
Un seul instant, pour moi, Lisette, et pour toi-męme.
Ce n'est pas un amant, c'est un ami qui t'aime,
Songes-y.
LISETTE.
Mais vraiment...
LE DUC.
Je comprends ton souci.
Je voudrais de grand coeur te voir ailleurs qu'ici,
Et, dans quelque retraite aux bavards inconnue,
Tu me rendrais bien mieux ma liberté perdue.
Ce n'est assurément mon goűt ni ma façon
De donner au plaisir cet air de trahison.
Mais, dans ce triste hôtel toujours emprisonnée,
Tu n'en saurais sortir sans ętre soupçonnée.
Chez moi, seuls, en secret, nous trompons tous les yeux.
Ŕ quatre pas d'ici nous serions odieux.
Telle est la loi du monde; il en faut ętre esclave.
Facile ŕ qui s'en rit, sévčre ŕ qui le brave,
Débonnaire et terrible, il ne compte pour rien
Qu'on se moque de lui, si l'on s'en moque bien.
Tout s'excuse ici-bas, hormis la maladresse.
Bonsoir, Louison.
SCČNE III
LISETTE, _seule_.
Bonsoir! Quelle étrange faiblesse!
Il me trompe, il me raille, il ment comme un paďen;
Comment arrive-t-il que je ne dise rien?
Nous serons seuls, dit-il. Que c'est d'une belle âme
D'aller chez le voisin pour y laisser sa femme,
Et revenir gaîment sur la pointe du pié,
Sitôt que dans la foule il se croit oublié!
Ah! quand j'étais Louison avant d'ętre Lisette,
Au lieu d'un pouf en l'air quand j'avais ma cornette,
Si j'avais rencontré ces diseurs de grands mots,
Je leur aurais au nez jeté mes deux sabots.
--Mais avec tout cela, je n'ai su que répondre.
Que faire s'il revient? Le laisser se morfondre?
M'enfermer dans ma chambre et sous deux bons verrous...
Ouais! il faut y songer; monseigneur n'est pas doux.
Avec ses airs badins et sa cajolerie,
Je ne sais trop comment il prend la raillerie.
Ne faut-il pas plutôt l'attendre bravement,
Lui donner mes raisons, l'écouter un moment?
N'est-il donc pas possible?... Ah! Louison, malheureuse!
Est-ce qu'un grand seigneur va te rendre amoureuse?
Est-ce que?... Qui vient lŕ?
SCČNE IV
LISETTE, BERTHAUD.
BERTHAUD.
C'est moi.
LISETTE.
Qui, toi?
BERTHAUD.
Berthaud.
LISETTE.
Berthaud? Que nous veux-tu?
BERTHAUD.
Moi? Rien.
LISETTE.
Tu n'es qu'un sot.
On n'entre pas ainsi que l'on ne vous appelle.
BERTHAUD.
Oh! mam'selle Louison, comme vous ętes belle!
Comme vous voilŕ propre et de bonne façon!
LISETTE.
Que dis-tu donc, l'ami?--Je connais ce garçon.
BERTHAUD.
Quels beaux tire-bouchons vous avez aux oreilles!
Quelle robe! on dirait d'une ruche d'abeilles.
LISETTE.
Tu te nommes, dis-tu?
BERTHAUD.
Berthaud. Quel gros chignon!
Et ces souliers tout blancs, ça doit vous coűter bon;
Pas moins, vous devez bien ętre un brin empętrée.
LISETTE.
M'as-tu de pied en cap assez considérée?
Hé! mais, c'est toi, Lucas!
BERTHAUD.
Vous me reconnaissez?
LISETTE.
Oui certe; et d'oů viens-tu?
BERTHAUD.
Par ma foi, je ne sais.
LISETTE.
Bon!
BERTHAUD.
Pour venir ici, j'ai pris par tant de rues,
J'en ai l'esprit tout bęte et les jambes fourbues.
LISETTE.
Assieds-toi.
BERTHAUD.
Que non pas! je suis bien trop courtois.
Quand j'ai mon habit neuf, jamais je ne m'assois.
LISETTE.
Fort bien, cela pourrait gâter ta broderie.
Tu n'es donc plus berger dans notre métairie?
Mais tu viens du pays? Comment va-t-on chez nous?
BERTHAUD.
Je n'en sais rien non plus; moi, j'ai fait comme vous.
Oh! je ne garde plus les vaches!--Au contraire,
C'est Jean qui les conduit, et Suzon les va traire.
Oh! ce n'est plus du tout comme de votre temps.
C'est la grande Nanon qui fait de l'herbe aux champs.
Pierrot est sacristain, et Thomas fait la guerre;
Catherine est nourrice, et Nicole...
LISETTE.
Et mon pčre?
BERTHAUD.
Votre pčre, pardine! il ne lui manque rien.
On est sűr, celui-lŕ, qu'il mange et qu'il dort bien.
Ceux qui vivent chez lui n'ont pas la clavelée.
LISETTE.
Mais, toi, par quel hasard as-tu pris ta volée?
BERTHAUD.
Voyez-vous, quand j'ai vu que vous étiez ici,
Et que votre départ vous avait réussi,
Je me suis dit: Paris, ça n'est pas dans la lune.
J'avais comme un instinct de faire ma fortune,
Et puis je m'ennuyais avec mes animaux;
Et puis je vous aimais, pour tout dire en trois mots.
LISETTE.
Toi, Lucas?
BERTHAUD.
Moi, Lucas. En ętes-vous fâchée?
Un chien regarde bien...
LISETTE.
Non, non, j'en suis touchée.
Tu te nommes Berthaud? d'oů te vient ce nom-lŕ?
BERTHAUD.
C'est mon nom de famille; ŕ Paris, il faut ça.
Quand on va dans le monde...
LISETTE.
Et tu vis bien, j'espčre?
BERTHAUD.
Vingt-six livres par mois, et presque rien ŕ faire.
Quand on a de l'esprit, l'emploi ne manque pas.
LISETTE.
Sans doute; et ton chemin s'est donc fait ŕ grands pas?
BERTHAUD.
Je crois bien, je suis clerc.
LISETTE.
Ah! ah! chez un notaire?
BERTHAUD.
Non.
LISETTE.
Chez un procureur?
BERTHAUD.
Chez un apothicaire.
LISETTE.
Peste! voilŕ de quoi mettre en jeu tes talents.
Eh bien! monsieur Berthaud, que voulez-vous céans?
BERTHAUD.
Ah! dame! en arrivant, j'avais bien une idée;
J'ai l'imaginative un tant soit peu bridée:
Je ne m'attendais pas ŕ tous vos affiquets.
Jarni! vos jupons courts étaient bien plus coquets;
Vous étiez bien plus leste, et bien plus féminine.
On ne vous voit plus rien, qu'un peu dans la poitrine.
Pourtant, malgré vos noeuds et vos mignons souliers,
Je vous épouserais encor, si vous vouliez.
LISETTE.
Toi?
BERTHAUD.
Mon pčre est fermier, pas si gros que le vôtre;
Mais enfin, dans ce monde, on vit l'un portant l'autre.
LISETTE.
Tu crois donc que ma main serait digne de toi?
BERTHAUD.
Dame! si vous vouliez, il ne tiendrait qu'ŕ moi.
Écoutez, puisqu'enfin la parole est lâchée,
Et puisqu'ŕ votre avis vous n'ętes point fâchée.
Vous ętes bien gentille, on le sait, on voit clair;
Mais, moi, je ne suis pas si laid que j'en ai l'air.
Si la grosse Margot n'était point tant fautive,
J'en aurais vu le tour, oui, sans crier qui vive,
Et dans la rue aux Ours, oů je loge ŕ présent,
On ne remarque pas que je sois déplaisant.
Je sais signer moi-męme, et je lis dans des livres.
Je viens de vous conter que j'avais vingt-six livres,
Mais il est des secrets qu'on peut vous confier;
Mon maître, au jour de l'an, va me gratifier.
C'est déjŕ quelque chose. Ŕ présent, autre idée:
Ma tante Labalue est presque décédée.
Elle a dans ses tiroirs, qu'il soit dit entre nous,
Pour plus de cent écus en joyaux et bijoux.
On ne sait pas les grains qu'elle amassait chez elle,
Ni les hardes qu'elle a sans compter sa vaisselle.
Elle a mis trois quarts d'heure ŕ faire un testament,
Et j'hérite de tout universellement.
Ça commence ŕ sourire. Encore une autre histoire:
Thomas donc est soldat, embarqué pour la gloire.
Moi, j'aurais ŕ sa place épousé Jeanneton;
Mais il ne lui faudrait qu'un coup de mousqueton.
C'est mon cousin germain; que le ciel le protčge!
Ce métier-lŕ, toujours, n'est pas blanc comme neige.
Vous voyez que je suis un assez bon parti;
Nous pourrions faire un couple un peu bien assorti.
Contre la pharmacie avez-vous ŕ reprendre?
On n'est point obligé d'y goűter pour en vendre.
Mon pourparler vous semble un peu risible et sot;
Vous avez l'esprit riche et vous visez de haut.
Mais, voyez-vous, le tout est d'ętre ou de paraître.
Vous portez du clinquant, mais c'est ŕ votre maître.
Que l'on vous remercie, il ne vous reste rien;
Moi je n'ai qu'un habit, d'accord, mais c'est le mien.
J'ai lu dans les écrits de monsieur de Voltaire
Que les mortels entre eux sont égaux sur la terre.
Sur ce proverbe-lŕ j'ai beaucoup médité,
Et j'ai vu de mes yeux que c'est la vérité.
Il ne faut mépriser personne dans la vie,
Car tout le monde peut mettre ŕ la loterie.
Ce grand homme l'a dit, c'est son opinion,
Et c'est pourquoi, jarni! j'ai de l'ambition.
LISETTE.
Je t'écoute, Lucas; ta rhétorique est forte.
Changeras-tu d'avis?
BERTHAUD.
Non, le diable m'emporte.
LISETTE.
Eh bien! reste ŕ l'hôtel, et ne t'éloigne pas.
Observe monseigneur, et suis bien tous ses pas.
BERTHAUD.
Oui.
LISETTE.
Si tu le vois seul, mets-toi sur son passage.
BERTHAUD.
Bien!
LISETTE.
Dis-lui tes projets pour notre mariage!
BERTHAUD.
Bon!
LISETTE.
Dis-lui que c'est moi qui le prie instamment
D'y pręter sa faveur et son consentement.
BERTHAUD.
Mais vous consentez donc?
LISETTE.
Sans doute.--Le temps presse;
Va-t'en.
BERTHAUD.
Vous consentez?
LISETTE.
On vient, c'est la duchesse.
Dépęche,--hors d'ici.
BERTHAUD.
Vous consentez, Louison!
LISETTE.
Va, ne bavarde pas surtout dans la maison.
SCČNE V
LA MARÉCHALE, LE DUC, LA DUCHESSE, LISETTE, _dans le fond_.
LE DUC.
Vous ne venez donc pas ŕ l'Opéra, ma chčre?
LA DUCHESSE.
Non, monsieur, pas ce soir.
LE DUC.
Pourquoi pas?
LA DUCHESSE.
Pour quoi faire?
LE DUC.
C'est une fęte oů va tout ce qui touche au roi.
LA DUCHESSE.
Une fęte? pour qui?
LE DUC.
Pour nous.
LA DUCHESSE.
Non pas pour moi.
LA MARÉCHALE.
Vos querelles, mon fils, me font mourir de rire.
_Ŕ Lisette, qui veut sortir._
Lisette, demeurez; j'ai deux mots ŕ vous dire.
LE DUC.
Riez, si vous voulez, madame, ŕ vous permis;
Vous ne me ferez pas du tout changer d'avis.
Non, je ne conçois pas, sur quoi que l'on se fonde,
Cette obstination ŕ s'exiler du monde,
Cette rage de vivre au fond d'un vieil hôtel,
De bouder le plaisir comme un péché mortel,
Et de rester ŕ coudre une tapisserie,
Quand tout Paris se masque, et quand je vous en prie.
LA DUCHESSE.
Je ne veux rien qui soit contre votre désir;
Monsieur, je suis souffrante, et je ne puis sortir.
LE DUC.
Bon! souffrante, c'est lŕ votre excuse ordinaire.
LA MARÉCHALE.
Mais s'il est vrai, mon fils...
LE DUC.
Il n'en est rien, ma mčre.
Souffrante! voilŕ bien le grand mot féminin.
Mais l'étiez-vous hier? le serez-vous demain?
Non, vous l'ętes ce soir, et qu'avez-vous, de grâce?
Un mal qui vous arrive aussi vite qu'il passe,
Des vapeurs, sűrement. La belle invention!
LA DUCHESSE.
L'exigez-vous, monsieur? J'obéis.
LE DUC.
Mon Dieu, non.
Exiger!--Obéir!--Le bon Dieu vous bénisse!
Dirait-on pas vraiment qu'on vous traîne au supplice?
LA MARÉCHALE, _au duc_.
Ne la chagrinez pas.--Pour l'égayer un peu,
Nous ferons un piquet ce soir au coin du feu.
LA DUCHESSE.
Permettez-vous, monsieur?
LE DUC.
Certainement.
_Ŕ part._
J'enrage.
Voilŕ mes projets morts.--Quel ennui! Quel dommage!
Lisette, j'en suis sűr, en a le coeur navré;
Mais, avant de sortir, je la retrouverai.
Le diable est donc logé dans la tęte des femmes!
_Haut._
Allons! j'irai donc seul.--Ŕ votre jeu, mesdames.
Holŕ! Jasmin! Lafleur! Des cartes, des flambeaux!
Vite!--Je vous souhaite un millier de capots,
De pics et de repics, et de quintes majeures.
Combien un si beau jeu doit abréger les heures!
LA MARÉCHALE.
Un bon piquet, mon fils, n'est point ŕ dédaigner;
Le roi l'aime.
LE DUC.
Le roi... ferait mieux de régner.
LA DUCHESSE.
On joue aussi, monsieur, quelquefois chez la reine.
LE DUC.
Jouez donc. Mais, morbleu! ce n'est gučre la peine
D'avoir un nom, du bien, de l'esprit et vingt ans,
Et ce visage-lŕ, pour perdre ainsi son temps.
Vraiment la patience en devient malaisée.
Pourquoi donc, s'il vous plaît, vous avoir épousée?
Pourquoi donc ętes-vous jeune et faite ŕ ravir?
Ŕ quoi bon tout cela, pour ne pas s'en servir?
Que faites-vous d'avoir cent mille écus de rente,
Et, comme Trissotin, un carrosse amarante,
Et quatre grands chevaux qui se meurent d'ennui,
Pour vivre hier, demain, toujours, comme aujourd'hui?
Ŕ quoi bon, dites-moi, cette taille élégante,
Cet air et ce regard?... car vous seriez charmante!
Je suis votre mari, mais, quand c'est arrivé,
J'avais sur votre compte étrangement ręvé;
Oui, ne vous en déplaise, et je vous le confesse.
Le feu roi dans sa cour montrait bien sa maîtresse,
Et de ses courtisans un murmure flatteur
Parfois, n'en doutez pas, lui fit plaisir au coeur.
Moi, duc, et votre époux, n'ai-je donc pu me croire,
En vous montrant aussi, le droit d'en tirer gloire?
Quand de m'appartenir vous m'avez fait l'honneur,
Ne puis-je donc avoir l'orgueil de mon bonheur?
Vous étiez belle et noble, et je vous tiens pour telle.
Ŕ quoi sert d'ętre noble, ŕ quoi sert d'ętre belle,
Si vous ne savez pas marcher avec fierté
Et dans cette noblesse et dans cette beauté?
Si vous ne savez pas monter dans votre chaise,
Dans un panier doré vous étendre ŕ votre aise,
Et, lorsque devant vous l'huissier crie un grand nom,
Le bonnet sur l'oreille entrer ŕ Trianon?
Ma foi, je vous croyais d'un autre caractčre;
Je croyais sans déchoir, qu'on pouvait daigner plaire;
Je vous jugeais moins sage, et ne m'attendais pas
Qu'en me donnant la main vous compteriez vos pas.
Je m'en vais me vętir; adieu.
_Ŕ sa mčre._
Bonsoir, madame.
SCČNE VI
LA MARÉCHALE, LA DUCHESSE, LISETTE.
LA MARÉCHALE.
Lucile, vous souffrez?
LA DUCHESSE.
Jusques au fond de l'âme.
LA MARÉCHALE.
Qu'avez-vous, dites-moi?
LA DUCHESSE.
Je suis triste ŕ mourir.
LA MARÉCHALE.
On vous tourmente un peu.
LA DUCHESSE.
Je devrais obéir.
Je devrais,--pardonnez,--je ne sais pas moi-męme.
LA MARÉCHALE.
Lisette, laissez-nous.
LISETTE, _en sortant_.
Mon Dieu, comme elle l'aime!
SCČNE VII
LA MARÉCHALE, LA DUCHESSE.
LA MARÉCHALE.
Quoi! vous prenez au grave un propos si léger?
Faites-vous un chagrin d'un ennui passager?
LA DUCHESSE.
Madame, il a raison.--J'ai tort, je suis coupable...
Je devrais obéir,... et j'en suis incapable.
Tout ce qu'il dit est vrai; la faute en est ŕ moi.
Je le blesse, le fâche, et je ne sais pourquoi.
LA MARÉCHALE.
Vous sentez, dites-vous, qu'il faut qu'on obéisse,
Et vous ne savez pas d'oů vous vient un caprice?
LA DUCHESSE.
Non; lorsque mon coeur parle, il raisonne bien mal.
Je ne sais quel effroi, quel sentiment fatal,
Né de ce triste coeur ou dans ma pauvre tęte,
Prčs de lui par moments me saisit et m'arręte.
Je voudrais lui complaire et sortir avec lui,
Songer ŕ ma parure, oublier mon ennui,
Puisqu'il le veut, enfin, essayer d'ętre belle,
Et tout cela me cause une frayeur mortelle.
Je sens trembler ma main quand je lui prends le bras...
Quelqu'un est entre nous, que je ne connais pas.
LA MARÉCHALE.
Ma belle, y songez-vous? quelle est votre pensée?
Parlez-vous, ŕ votre âge, en femme délaissée?
Avez-vous un reproche ŕ faire ŕ votre époux?
Qu'est-ce donc?
LA DUCHESSE.
Je ne sais.
LA MARÉCHALE.
Quelqu'un est entre vous?
Une femme, ŕ coup sűr; vous est-elle connue?
Parlez.
LA DUCHESSE.
Je n'en sais rien, mais j'en suis convaincue.
LA MARÉCHALE.
Ainsi, pour quatre mots, vous vous désespérez,
Et ce qui vous chagrine, au fond, vous l'ignorez.
Dirait-on pas vraiment, ŕ voir votre tristesse,
Qu'un grand secret bien noir vous trouble et vous oppresse?
Et c'est un bal manqué qui produit tout cela!
J'en avais, ŕ vingt ans, de ces gros chagrins-lŕ.
Ne vous en plaignez pas! Vos pleurs me font envie.
Quand vous saurez un jour ce que c'est que la vie,
Ces pleurs, si doucement et sitôt répandus,
Vous les regretterez, et n'en verserez plus.
LA DUCHESSE.
Oui, si cela vous plaît, vous en pouvez sourire;
Mais en sont-ils moins vrais, madame, et peut-on dire,
Quand la souffrance est lŕ, qu'on souffre sans raison?
LA MARÉCHALE.
Tout aveu d'une peine aide ŕ sa guérison.
Laissez-vous ętre vraie, et sachons ce mystčre.
LA DUCHESSE.
Je n'ai point de secret. Que puis-je dire ou taire?
LA MARÉCHALE.
Bah! quand ce ne serait qu'un caprice d'enfant,
Est-ce que prčs de moi votre coeur se défend?
Qui vous fait hésiter et manquer de courage?
Est-ce la défiance? est-ce mon rang, mon âge?
Est-ce mon amitié dont vous vous éloignez?
Est-ce la maréchale ou moi que vous craignez?
De grâce, allons.
LA DUCHESSE.
Je sais combien vous ętes bonne,
Mais je ne puis parler.
LA MARÉCHALE.
Alors, je vous l'ordonne.
Votre mčre, Lucile, ŕ son dernier soupir,
Vous a léguée ŕ moi.--Vous devez obéir.
LA DUCHESSE.
J'obéirai toujours, et de toute mon âme;
Mais, encore une fois, je ne sais rien, madame,
Si ce n'est ma souffrance, et mon amour pour lui.
LA MARÉCHALE.
S'il est vrai, mon enfant...
_Ŕ Lisette qui entre._
Qui vous amčne ici?
SCČNE VIII
LISETTE, LA MARÉCHALE, LA DUCHESSE.
LISETTE, _ŕ la duchesse_.
Votre marchande est lŕ, madame; on m'a chargée...
LA DUCHESSE.
Pas ce soir,--qu'on revienne.
LA MARÉCHALE.
Allons, chčre affligée,
Qu'est-ce qui vous arrive? une robe de bal?
Eh bien! essayez-la;--ce n'est pas un grand mal.
Tantôt, s'il m'en souvient, vous l'aviez demandée.
Rien qu'en changeant de robe on peut changer d'idée.
--Comme vous pâlissez! Qu'avez-vous, mon enfant?
LA DUCHESSE.
Oui,... cette femme-lŕ;... sa vue,... en ce moment...
LA MARÉCHALE.
Mais cette femme-lŕ, ma belle, c'est Lisette.
Entrons chez vous.--Venez faire un peu de toilette.
Plaisons d'abord, petite, et le reste est ŕ nous.
Allons, courage, allons.
LA DUCHESSE.
Je m'abandonne ŕ vous.
Devant votre bonté ma volonté s'incline:
Vous m'avez rappelé que j'étais orpheline.
Je vous dirai mes maux, mes craintes, mon tourment,
Tout, et vous comprendrez, madame, assurément,
Qu'un pauvre coeur blessé, cherchant qui le soutienne,
Ait besoin d'une mčre, ayant perdu la sienne.
FIN DE L'ACTE PREMIER.
ACTE DEUXIČME
SCČNE PREMIČRE
BERTHAUD, _seul_.
Comme ces grands seigneurs sont longs ŕ s'habiller!
Le monde est si lambin que ça m'en fait bâiller.
Louison m'a dit d'attendre et de guetter son maître,
Pour lui glisser mon mot sitôt qu'il va paraître.
Je suis depuis tantôt caché dans le grenier.
Il lui faut plus de temps, rien que pour un soulier,
Qu'ŕ moi pour ma perruque. On le peigne, on le frise;
Sas bas sur ses talons, sa veste ŕ moitié mise,
Un coiffeur par derričre, un tailleur par devant,
Une houppe ŕ la main, il se mire en ręvant.
Et du blanc, et du rouge, et du musc, et de l'ambre,
Des tourbillons de poudre ŕ ravager la chambre;
Pouah!--s'il faut pour un duc faire ce métier-lŕ,
Autant vaut ętre femme, ou danseur d'Opéra.
Je voudrais bien savoir ce que dirait mon pčre
Si je m'enfarinais d'une telle maničre,
Lui qui savait si bien me pousser par le dos
Lorsque je m'attardais derričre nos troupeaux.
Ce n'est pas moi, du moins, avec mon humeur leste,
Qu'on verrait perdre une heure ŕ boutonner ma veste.
Ętre vif et gaillard fut toujours ma vertu;
Il me semble pourtant que je suis bien vętu.
Voyons; j'avais tantôt préparé ma harangue.
Il ne faut point ici s'entortiller la langue.
Que vais-je dire au duc?--Je dirai: Monseigneur...
Oui, monseigneur, d'abord; c'est juste et c'est flatteur.
Or, mam'selle Louison... Non, je dirai: Lisette.
C'est son nom de gala; respectons l'étiquette.
Lisette donc et moi, nous sommes résolus...
Non,... nous sommes enclins... Ce n'est pas ça non plus.
Reprenons: Monseigneur... C'est vexant quand j'y pense;
Tantôt, dans le grenier, j'étais plein d'éloquence.
Et dire qu'un bon mot peut tout enjoliver!
Oui-da, j'ai vu la chose au théâtre arriver.
Si je me rappelais, dans quelque comédie,
Une attitude heureuse, une phrase arrondie?
--Monseigneur, si les dieux,... si le ciel,... les enfers...
J'y suis.--Si les héros qui purgeaient l'univers...
Est-ce bien ces gens-lŕ qu'il convient que j'invoque?
Non, pour un pharmacien, ça pręte ŕ l'équivoque.
--Monseigneur, si les rois, si les ducs ont aimé...
Je ne trouverai rien, je suis trop enrhumé.
_On entend une sonnette._
On a sonné lŕ-bas.--C'est Louison qu'on appelle.
SCČNE II
BERTHAUD, LISETTE, _portant une robe sur le bras_.
LISETTE.
Que fais-tu lŕ, Lucas?
BERTHAUD.
Hé! je fais sentinelle.
Ne m'avez-vous pas dit de rester aux aguets?
LISETTE.
Oui, mais tu trouveras quelque honnęte laquais
Qui, trčs discrčtement, va te mettre ŕ la porte.
BERTHAUD.
Ouais!--qu'est-ce que cela?
LISETTE.
Des hardes que j'apporte.
BERTHAUD.
Encor des ornements! des objets féminins?
Mais vous en avez donc ici des magasins?
LISETTE.
On vient de ce côté; c'est monseigneur sans doute.
BERTHAUD.
Bon, je vais lui parler.
LISETTE.
Oui, pourvu qu'il t'écoute.
BERTHAUD.
Oh! j'ai dans le grenier préparé mon discours.
LISETTE.
Songe que les meilleurs sont toujours les plus courts.
BERTHAUD.
Le mien est admirable, et j'en fais mon affaire.
Il est vrai qu'ŕ présent je ne m'en souviens gučre.
LISETTE.
Je te quitte, on m'attend; mais je vais revenir.
SCČNE III
LE DUC, LISETTE, BERTHAUD.
LE DUC, _habillé_.
Eh bien! Lisette, eh bien! mon aspect te fait fuir?
Suis-je ŕ ton gré, dis-moi?
_Il se mire dans une glace._
LISETTE.
Toujours.
LE DUC.
Quel est cet homme?
BERTHAUD, _saluant ŕ plusieurs reprises_.
Monseigneur,... monseigneur,... c'est Berthaud qu'on me nomme.
Je suis venu...
LE DUC.
Va-t'en.
BERTHAUD.
Monseigneur, je...
LE DUC.
Va-t'en.
BERTHAUD.
Monseigneur...
_Il se retire en saluant._
SCČNE IV
LE DUC, LISETTE.
LE DUC.
Toi, viens çŕ.
LISETTE.
Ma maîtresse m'attend.
LE DUC.
Eh! qu'elle attende! Elle a ses femmes, je suppose.
Elle boude ce soir, mais, pour si peu de chose.
Crois-tu du rendez-vous l'espoir abandonné?
LISETTE.
Monseigneur, c'est vous seul qui vous l'étiez donné.
LE DUC.
Je te le donne encor.
LISETTE.
Permettez...
LE DUC.
Point d'affaire.
Écoute; la duchesse est lŕ, prčs de ma mčre;
Sur mon compte, sans doute, on jase en ce moment:
Vas-y.--Je sortirai par cet appartement.
Je serai ręveur, sombre, et d'une humeur atroce;
Mais, dčs qu'on entendra le bruit de mon carrosse,
Compte qu'aprčs avoir dűment délibéré,
Dit quelque mal de moi, peut-ętre un peu pleuré,
La duchesse pourra changer de fantaisie.
Ses caprices ne sont qu'un peu de jalousie.
Elle prétend, au vrai, détester l'Opéra;
Elle n'y viendrait pas, mais elle m'y suivra.
LISETTE.
De grâce, écoutez-moi.
LE DUC.
J'y gagerais ma tęte!
Déjŕ dans ce dessein sans doute elle s'appręte.
Sois sűre qu'elle va demander ses chevaux,
Choisir le plus coquet parmi ses dominos,
Et, les yeux aveuglés sous un capuchon rose,
D'un petit mal bien clair chercher bien loin la cause.
Puisse-t-elle ŕ ce bal trouver beaucoup d'appas!
Quant ŕ moi, tu sais bien que je n'y reste pas.
Tu sais que je reviens.--Ainsi tu vois, ma belle,
Que lever tout obstacle est une bagatelle.
Je vais faire, au hasard, une visite ou deux,
Perdre quelques louis, peut-ętre, ŕ leurs sots jeux,
Dépenser ma soirée ŕ parler sans rien dire;
Le jour est aux ennuis, et le reste ŕ Zaďre.
_On sonne._
On t'appelle.--Au revoir.
SCČNE V
BERTHAUD, _seul._
Quelle horreur! J'ai tout vu.
C'est dit, je suis berné,--je suis presque... O vertu!
Aurait-on supposé tant de scélératesse?
Le duc parle assez clair,--Louison est sa maîtresse.
Je ne l'ai pas ręvé;--j'en suis sűr,--j'étais lŕ;
Traîtresse! Épousez donc des tendrons comme ça!
Cassez-vous donc la tęte ŕ chercher, pour lui plaire,
Des mots mieux compilés que dans une grammaire,
Pour trouver que l'objet de tous vos sentiments,
Męme avant qu'on l'épouse, a déjŕ des amants!
Et tu crois que je vais, comme un mari crédule,
Avaler bonnement ta malsaine pilule?
Nenni, ma belle enfant, tu ne m'y prendras pas.
Je verrai la duchesse, et j'y vais de ce pas.
J'irai, je lui dirai...--Voyons, que lui dirai-je?
Madame, si jamais...--Non, il faut que j'abrčge.
Madame...--O ciel! je sens mon sang-froid s'altérer.
En l'état oů je suis, je crains de m'égarer;
Je vais aller plutôt trouver la maréchale.
La voici justement qui traverse la salle;
Je vais tout dévoiler.--Allons! ferme! du coeur!
SCČNE VI
LA MARÉCHALE, BERTHAUD.
BERTHAUD.
Madame...
LA MARÉCHALE.
Que veut-on?
BERTHAUD.
Madame, j'ai l'honneur...
LA MARÉCHALE.
Que voulez-vous, l'ami?
BERTHAUD.
Madame, je me nomme...
LA MARÉCHALE.
Hé bien! qu'est-ce?
BERTHAUD.
Berthaud.
LA MARÉCHALE.
Retirez-vous, brave homme.
BERTHAUD.
Madame, je venais...
LA MARÉCHALE.
Laissez-moi.
BERTHAUD, _ŕ part_.
Grand merci!
Il paraît que l'on a l'oreille dure ici.
_Haut._
S'il se pouvait pourtant, madame...
LA MARÉCHALE.
Allez, vous dis-je.
BERTHAUD, _saluant_.
Je sors.
_Ŕ part._
En vérité, cela tient du prodige.
Oh! mon heure viendra.--Je vais, dans mon grenier,
Retoucher mon discours pour me désennuyer.
SCČNE VII
LA MARÉCHALE, _seule._
Il n'en faut plus douter, la duchesse est jalouse.
Mon fils a méconnu sa bonne et tendre épouse;
Lisette a fait le mal, je le dois arręter.
Lucile doute encore et voudrait hésiter.
Faible contre elle-męme et contre ses alarmes,
Ses regards indécis sont voilés par les larmes.
Elle ne saurait croire ŕ cette cruauté,
Donnant si bien son coeur, de le voir rejeté;
Elle croit aimer trop fort pour n'ętre point aimée.
Mais, bien qu'ŕ tout soupçon son âme soit fermée,
La souffrance l'emporte, elle y résiste en vain;
Je la sens me parler, rien qu'en pressant sa main.
Qui sait, tel qu'est mon fils, dans la folle jeunesse,
Oů pourrait l'entraîner un instant de faiblesse?
Le hasard, d'un seul pas, va si vite et si loin!
C'est ŕ moi d'y songer;--j'en veux prendre le soin.
SCČNE VIII
LA MARÉCHALE, LISETTE.
LA MARÉCHALE.
Lisette, oů courez-vous d'une telle vitesse?
LISETTE.
Madame, on a coiffé madame la duchesse;
Je vais chercher lŕ-bas un de ses dominos.
LA MARÉCHALE.
Elle va donc se mettre en masque? Ŕ quel propos?
Veut-elle aller au bal?
LISETTE.
Madame, je le pense.
LA MARÉCHALE.
C'est étrange. Et mon fils?
LISETTE.
Il est parti d'avance.
LA MARÉCHALE.
Seul?
LISETTE.
Tout seul.
LA MARÉCHALE.
Et ma bru va donc le retrouver?
LISETTE.
Je ne sais; sa toilette a peine ŕ s'achever.
Telle robe lui plaît qui bientôt l'importune;
Elle en regarde dix avant d'en choisir une.
Elle a presque grondé ses femmes, et je crois
Ętre grondée aussi pour la premičre fois.
LA MARÉCHALE.
Faites qu'en ce moment une autre vous remplace.
LISETTE, _ouvrant la porte du fond_.
Holŕ! quelqu'un! Marton!
LA MARÉCHALE.
Faites aussi qu'on passe
Par la grand'salle.
_Une des femmes paraît, Lisette lui parle bas; la femme sort par le fond._
Eh bien?
LISETTE.
Madame, me voici.
LA MARÉCHALE.
Louison, c'est grâce ŕ moi que vous ętes ici.
Votre pčre est chez nous fermier dans un domaine;
Vos parents sont ŕ moi; je suis votre marraine.
J'ai pris grand soin de vous dčs vos plus jeunes ans,
Et je vous ai reçue enfant chez mes enfants.
M'aimez-vous?
LISETTE.
Dieu merci, plus que je ne puis dire.
LA MARÉCHALE.
Votre coeur parle franc?
LISETTE.
Aussi vrai qu'il respire.
LA MARÉCHALE.
Si, par obéissance ou par nécessité,
Il fallait devant moi celer la vérité
(La crainte d'un péril ôte celle du blâme),
S'il vous fallait mentir?
LISETTE.
Je me tairais, madame.
LA MARÉCHALE.
Mais si vous le deviez?
LISETTE.
Personne ne le doit.
LA MARÉCHALE.
D'oů vous vient le brillant que vous avez au doigt?
LISETTE, _ŕ part_.
Ah! malheureuse!
LA MARÉCHALE.
Eh bien! vous gardez le silence?
Songez que, me voyant avertie ŕ l'avance,
Votre silence parle, et peut en dire assez.
LISETTE.
Ce brillant... m'appartient.
LA MARÉCHALE.
D'oů vient-il?
LISETTE.
Je ne sais.
LA MARÉCHALE.
Prenez garde, Louison!
LISETTE.
Madame, il se peut faire
Qu'on soit, je le répčte, obligée ŕ se taire.
Si ma bouche est muette et doit ainsi rester,
De mon respect pour vous est-ce donc m'écarter?
LA MARÉCHALE.
Lisette peut se taire alors que je commande,
Mais Louison doit parler si je le lui demande.
LISETTE.
On m'appelle Lisette.
LA MARÉCHALE.
Oui, dans cette maison.
A-t-on changé le coeur aussi bien que le nom?
LISETTE.
De grâce excusez-moi; je me sens si confuse...
Ce coeur voudrait s'ouvrir, mais...
LA MARÉCHALE.
Mais il s'y refuse?
LISETTE.
Non, madame, hésiter quand vous parlez ainsi,
C'est trop souffrir pour moi; cette bague... est ŕ lui.
_Elle se met ŕ genoux._
LA MARÉCHALE.
Mon fils? Je le savais.--Levez-vous donc, ma chčre.
Vous avez, en tout cas, mieux fait que de vous taire.
Mais que prétendez-vous?
LISETTE, _se levant_.
Rien au monde.
LA MARÉCHALE.
Et pourquoi,
Puisque votre secret s'échappe devant moi,
Cette sorte d'audace avec cette imprudence?
LISETTE.
On parle comme on peut, on agit comme on pense.
LA MARÉCHALE.
Pensez-vous que le duc soit pour vous un amant,
Et qu'on puisse, ŕ son gré, trahir impunément?
Vous croyez-vous assez pour ętre une maîtresse?...
Ma question vous choque et votre orgueil s'en blesse?
LISETTE.
Je viens de m'incliner, madame, devant vous.
Mon orgueil tout entier est encore ŕ genoux.
Il peut, sans murmurer, souffrir qu'on m'humilie,
Mais non pas qu'on m'outrage ou qu'on me calomnie;
On ne doit m'accuser d'aucune trahison!
LA MARÉCHALE.
Oui, cela porte atteinte ŕ l'honneur de Louison!
LISETTE.
Ŕ mon honneur, madame? et pourquoi non, de grâce?
Un brin d'herbe au soleil, comme on dit, a sa place.
Pourquoi n'aurais-je pas la mienne, s'il vous plaît?
Le monde est assez grand pour tout ce que Dieu fait.
LA MARÉCHALE.
Vous parlez haut, Lisette, et changez de langage.
LISETTE.
Ma foi, madame, c'est celui de mon village.
Mon pčre s'en servait, et je l'ai toujours pris
Lorsque sur mon chemin j'ai trouvé le mépris.
Certes, lorsque l'honneur s'unit ŕ la noblesse,
C'est un bien beau hasard qu'il trouve la richesse;
Mais s'il est dans le coeur des gens qui ne sont rien,
On devrait le laisser ŕ qui l'a pour tout bien.
LA MARÉCHALE.
Mais, dans cette maison, ŕ jaser de la sorte,
Songez-vous qu'il se peut...
LISETTE.
Qu'il se peut que j'en sorte?
Je ne le sais que trop, et c'est ce triste pas
Qui m'a fait hésiter, je ne m'en défends pas.
Dire adieu tout ŕ coup, d'abord ŕ vous, madame,
Puis ŕ tant de bienfaits, ŕ tant de bonté d'âme,
Perdre tout d'un seul mot, le présent, l'avenir,
Oui, c'est lŕ ce qui fait que j'ai failli mentir.
Mais je le dis encor, męme étant accusée,
Je ne puis supporter de me voir méprisée.
Quand m'a-t-on jamais vue ou tromper ou trahir?
Qu'on m'apprenne mon crime, avant de m'en punir.
LA MARÉCHALE.
Vous venez ŕ l'instant de l'avouer vous-męme.
LISETTE.
Est-ce ma faute, ŕ moi, si le duc dit qu'il m'aime?
Si de tristes présents, ŕ regret acceptés,
Ses discours importuns, son caprice...
LA MARÉCHALE.
Arrętez.
Je ne saurais vouloir ni de vos confidences,
Ni certe, et moins encor, de vos impertinences.
Votre maîtresse est lŕ; pas un mot de ceci.
Mon fils dit qu'il vous aime,--éloignez-vous d'ici.
Puisque votre vertu se croit calomniée,
Vous la verrez sans peine ainsi justifiée.
Vous avez tant d'esprit! trouvez quelque raison;
Inventez un prétexte, et quittez la maison.
LISETTE.
Mais je ne l'aime pas, madame!
LA MARÉCHALE.
Toi, Lisette!
LISETTE.
Non, je l'écoute dire, et je reste muette.
LA MARÉCHALE.
Je perdrais patience ŕ voir ainsi mentir.
LISETTE.
Je perdrais patience ŕ plus longtemps souffrir.
Ainsi vous me chassez? Est-il vraiment possible
Qu'un franc aveu vous trouve ŕ tel point insensible?
_La maréchale va pour sortir._
Hé quoi! sans un regret! sans laisser ŕ mes yeux
Ce regard qu'on accorde aux plus tristes adieux!
Et mon pčre, madame?... Est-ce donc bien sa fille,
Louison, l'honnęte enfant d'une honnęte famille,
Louison, qui, par votre ordre et contre son désir,
Est venue ŕ Paris obéir et servir,
Et qu'on verra demain, seule et désespérée,
Sous notre pauvre toit rentrer déshonorée?
Qu'ai-je fait? votre fils, riche, aimé, tout-puissant,
Me marchande au hasard et m'achčte en passant;
Sűr qu'un peu d'or suffit, et qu'un mot fait qu'on aime,
Il s'écoute, il se plaît, et se répond lui-męme.
Et moi, lorsque je parle ŕ force de tourments,
Au lieu de m'écouter on me dit que je mens!
Soit!--Il me souviendra d'avoir été sincčre.
Justice des heureux et des grands de la terre!
Qu'importe un peu de mal, pourvu que dans un coin
La victime oubliée aille pleurer plus loin,
Et qu'en marchant sur nous, la vanité blasée
N'entende pas gémir la souffrance écrasée!
LA MARÉCHALE.
Ne te fais pas trop vite un chagrin sans raison.
Nous en reparlerons demain;--bonsoir, Louison.
SCČNE IX
LISETTE, _seule_.
Demain! Elle est partie.--Un accent de colčre
N'a point accompagné sa parole derničre.
Peut-ętre elle me plaint, tout en me condamnant.
Mais que me reste-t-il? que faire maintenant?
Demain, a-t-elle dit.--Jamais! c'est impossible.
Le mal est trop réel, le soupçon trop horrible.
Quand demain sa pitié voudrait me retenir,
Je suis de trop ici;--mais comment en sortir?
SCČNE X
LISETTE, LA DUCHESSE, _habillée en domino ouvert, un masque ŕ la main_.
LA DUCHESSE.
Ma mčre n'est pas lŕ? Que fais-tu donc, Lisette?
LISETTE.
Je savais que madame achevait sa toilette.
J'attendais, pour entrer, qu'on voulűt bien de moi.
LA DUCHESSE.
Mais, ma chčre, en effet, j'ai grand besoin de toi.
Tantôt j'étais souffrante, inquičte, et peut-ętre
J'ai laissé devant toi quelque souci paraître.
Un mot dit au hasard ne doit pas t'occuper;
Tu me connais assez pour ne t'y pas tromper.
Voici ma main; oublie un instant de caprice.
LISETTE, _baisant la main de la duchesse_.
Ah! madame!
LA DUCHESSE.
Il s'agit de me rendre un service.
Le duc est cette nuit au bal de l'Opéra.
Je voudrais bien un peu voir ce qu'il y fera;
Mais je suis malgré moi si triste et si maussade
Que je n'ai pas le coeur ŕ cette mascarade.
Maintenant que les gens me viennent avertir,
Le courage me manque au moment de partir.
Vas-y, Louison; veux-tu?
LISETTE.
Moi, madame?
LA DUCHESSE.
Oui, par grâce.
Prends ce domino-lŕ, qui m'étouffe et me lasse.
_Elle lui donne son domino et son masque._
Tâche d'entendre un peu, de beaucoup regarder.
Si tu vois le duc seul, tu pourras l'aborder,
L'intriguer au besoin,--sans qu'il te reconnaisse;
Mais s'il est en conquęte avec quelque déesse,
Du ciel de l'Opéra descendue un moment,
Tu me comprends, ma chčre? écoute seulement.
LISETTE.
Se peut-il qu'ŕ ce point ce bal vous inquičte?
LA DUCHESSE.
Non, mais vas-y toujours.--Reviens bientôt, Lisette.
SCČNE XI
LISETTE, _seule_.
Le sort prend-il plaisir ŕ se jouer de moi?
Dois-je rester? partir? aller au bal? pourquoi?
--Et pourquoi pas?--Peut-ętre aurais-je dű tout dire.
Comment briser le coeur, quand la main vous attire?
Non, non, la maréchale est seule ŕ m'accuser;
C'est elle seule aussi qu'il faut désabuser,
Et jamais un seul mot...
SCČNE XII
LISETTE, BERTHAUD.
BERTHAUD, _d'un ton froid_.
Bonjour, mademoiselle.
LISETTE.
C'est encor toi, Lucas? eh bien! quelle nouvelle?
Et qu'as-tu fait?
BERTHAUD.
Je viens prendre congé de vous.
Vous voyez un ami, mais non plus un époux.
LISETTE.
Vraiment? et d'oů te vient ce visage tragique?
BERTHAUD.
Ne m'interrogez pas.
LISETTE.
Quand on part, on s'explique.
BERTHAUD.
Ce n'est pas malaisé.--Je sais tout.
LISETTE.
Que sais-tu?
BERTHAUD.
Vous l'osez demander?--J'ai tout vu.
LISETTE.
Qu'as-tu vu?
BERTHAUD.
Vos délits, vos horreurs, monstre affreux, crocodile,
Serpent Python!
LISETTE.
Hé quoi! jusqu'ŕ cet imbécile!
Tout est donc aujourd'hui contre moi déclaré?
Ma foi, pour rire un peu, j'ai bien assez pleuré.
_Elle éclate de rire._
BERTHAUD.
Vous riez? vous joignez l'astuce ŕ l'artifice?
LISETTE, _lui faisant tenir le domino_.
Tiens, nigaud, prends ceci.
BERTHAUD.
Que je me travestisse?
LISETTE.
Hé! non, c'est pour m'aider. Viens, marchons de ce pas.
BERTHAUD.
Oů?
LISETTE.
Je te le dirai.
BERTHAUD.
Comment?
LISETTE.
Tu le sauras.
SCČNE XIII
LA DUCHESSE, LA MARÉCHALE.
LA DUCHESSE.
Oui, madame, je reste, et Louison prend ma place.
Le chagrin me poursuit, quelque effort que je fasse;
Je lutte en vain, le coeur me manque ŕ chaque pas.
Cette pauvre Louison, vous l'aimez, n'est-ce pas?
LA MARÉCHALE.
Sans doute.
LA DUCHESSE.
Ai-je mal fait de lui dire ma peine?
Puisque j'en souffre tant, j'en veux ętre certaine.
J'étais bien aise aussi de réparer mes torts,
Car j'ai failli tantôt mettre Louison dehors.
Oui, je ne sais pourquoi, cette méchante envie
M'a durant tout le jour malgré moi poursuivie.
Je prenais du dépit contre elle ŕ tout moment;
Je l'ai męme grondée, et bien injustement.
Qu'il est cruel ŕ nous, n'est-il pas vrai, madame,
De maltraiter ces gens, de les blesser dans l'âme,
Eux qui passent leur vie ŕ nous servir ainsi,
Parce que nous avons un instant de souci!
LA MARÉCHALE.
Et Lisette, en partant, n'a rien dit, je suppose?
LA DUCHESSE.
Non.--Est-ce qu'elle avait ŕ dire quelque chose?
LA MARÉCHALE.
Elle aurait pu d'abord vous demander pardon.
LA DUCHESSE.
Ŕ moi? de quelle faute, hélas! et pourquoi donc?
C'est ŕ moi bien plutôt qu'il faut que l'on pardonne.
Dčs qu'aux soupçons jaloux mon esprit s'abandonne,
On ne croirait jamais, madame, ŕ quel excčs
Ils peuvent m'égarer si je leur donne accčs.
Mille ręves affreux s'offrent ŕ ma pensée;
J'ai beau me répéter que je suis insensée,
Rien ne peut m'en distraire, ils sont plus forts que moi.
Ma raison me trahit et se change en effroi.
Comme d'un voile épais je suis enveloppée;
Je me vois méconnue, et je me vois trompée,
Fâcheuse ŕ mon époux, inutile ici-bas...
Je me vois laide.
LA MARÉCHALE.
Au vrai, l'on ne vous croirait pas.
LA DUCHESSE.
Et lui, madame, hélas! c'est bien tout le contraire.
Le ciel a pris plaisir ŕ le former pour plaire.
De son luxe élégant si l'oeil est ébloui,
On croit voir sa parure, et l'on ne voit que lui.
Et cet esprit si fin, tant de délicatesse,
Cette grâce qui semble ignorer sa noblesse!...
Est-ce que j'y vois mal, madame, et, sur ce point,
Me direz-vous encor qu'on ne me croirait point?
LA MARÉCHALE.
Je puis malaisément vous répondre, ma chčre.
Si vous ętes sa femme...
LA DUCHESSE.
Eh bien?
LA MARÉCHALE.
Je suis sa mčre.
LA DUCHESSE.
Si nous n'étions que deux ŕ le trouver charmant!
Mais tout le monde l'aime, et c'est lŕ mon tourment.
Puis-je, le croyez-vous, garder un coeur tranquille,
Ŕ le voir comme il est, par la cour et la ville,
Au milieu d'un fracas de jeunes étourdis,
Au jeu comme ŕ cheval passant les plus hardis,
Poursuivre, en se jouant, de regards infidčles
Ces heureuses beautés qui savent ętre belles?
Ah! c'est lŕ que je sens, ŕ mon mortel ennui,
Combien je dois sembler peu de chose pour lui!
Combien de qualités ne me sont point données
Que peut-ętre ŕ ma place une autre eűt devinées,
Et combien il est vrai que, sur un tel chemin,
Il faudra tôt ou tard qu'il me quitte la main!
LA MARÉCHALE.
Je vous l'ai déjŕ dit, c'est une crainte folle[C].
[Note C: Ces vers et les dix-neuf suivants se suppriment au théâtre.
(_Note de l'auteur._)]
LA DUCHESSE.
Oui, j'ai tort de pleurer, c'est ce qui me désole.
L'autre jour, par exemple, ŕ ce bal chez le roi,
Madame de Versel a passé prčs de moi.
Vous savez ses grands airs, et combien elle est belle.
Un flot d'admirateurs murmurait autour d'elle,
S'écartant toutefois, de peur de la toucher,
Sitôt que par hasard elle daignait marcher.
LA MARÉCHALE.
Oui, c'est une superbe et sotte créature.
LA DUCHESSE.
Un noeud qu'elle portait tomba de sa coiffure.
Ces messieurs l'ayant vu, je vous laisse ŕ penser
Si chacun s'élança, pręt ŕ le ramasser.
Le duc fut le plus prompt; mais au lieu de le rendre,
Il défia tout haut qu'on s'en vînt le lui prendre.
Sur quoi cette marquise, au lieu de s'étonner,
Le prit en souriant, mais pour le lui donner.
Je sais bien lŕ-dessus ce que vous m'allez dire,
Mais je me suis senti pâlir de ce sourire.
C'est un jeu, j'en conviens, c'est un propos de bal,
Tout ce qu'il vous plaira, mais cela fait bien mal.
LA MARÉCHALE.
Je ne vous blâme pas d'ętre un peu trop sensible.
Prenez quelque repos, enfant, s'il est possible.
Laissez lŕ vos chagrins, et la dame aux grands airs[D].
[Note D: Au lieu de ce vers on dit au théâtre:
Ce sont de doux chagrins qui vous semblent amers.
(_Note de l'auteur._)]
LA DUCHESSE.
Grâce pour mes chagrins, madame, ils me sont chers.
Au couvent, l'an passé, quand j'appris de l'abbesse
Que j'avais un époux et que j'étais duchesse,
Le coeur me battait bien un peu, mais pas bien fort.
On fit ce mariage, et je n'y vis d'abord
Qu'un jeune grand seigneur, plein de galanterie,
Qui me donnait gaiement son nom, son rang, sa vie.
Tous ces biens me semblaient si doux ŕ partager
Que je ne pensais pas qu'un tel sort pűt changer.
Si c'est lŕ le bonheur, disais-je, il est bizarre
Qu'ŕ le voir si facile on le trouve si rare.
Mais lorsqu'aprčs un an de ce charmant sommeil,
Arriva par degrés le moment du réveil;
Quand le duc, fatigué d'une paix importune,
Rougissant tout ŕ coup d'oublier sa fortune,
Voulut, en m'entraînant, la rejoindre ŕ grands pas,
Je compris que si loin je ne le suivrais pas.
Alors prenant pour moi son aspect véritable,
Apparut ŕ mes yeux ce spectre redoutable,
Le monde... Ses plaisirs, ses attraits, ses dangers,
L'air enivrant des cours et leurs bruits passagers,
Il me fallut tout voir;--alors la méfiance
M'enseigna lentement sa froide expérience.
Je vis le duc fęté, bienvenu prčs du roi,
Joyeux, heureux partout,... excepté prčs de moi.
Mon coeur, qui d'un soutien s'était fait l'habitude,
Pour la premičre fois connut la solitude.
Puis je devins jalouse, et je me dis un jour:
Ce n'est plus le bonheur que je sens, c'est l'amour!
LA MARÉCHALE.
Qu'est-ce ŕ dire?
LA DUCHESSE.
Oui, l'amour!--ŕ l'âge oů tout s'ignore,
En prononçant ce mot sans le comprendre encore,
On ne voit qu'un beau ręve, une douce amitié,
Oů d'un commun trésor chacun a la moitié;
On croit qu'aimer, enfin, c'est le bonheur supręme...
Non. Aimer, c'est douter d'un autre et de soi-męme,
C'est se voir tour ŕ tour dédaigner ou trahir,
Pleurer, veiller, attendre;... avant tout, c'est souffrir!
_Elle pleure._
LA MARÉCHALE.
Je ne vous blâme point, je vous l'ai dit, Lucile.
Vous voulez qu'on vous aime, et rien n'est plus facile.
Je vous en prie encor, prenez quelque repos.
Je veux, en vous quittant, vous répondre en deux mots.
Vous vous imaginez que le duc vous délaisse:
Votre tort, c'est la crainte, et le sien, sa jeunesse.
Mon fils est vain, léger, frivole en ses discours;
Mais, s'il aime jamais, il aimera toujours;
Et c'est vous, j'en réponds, qu'il aimera, ma chčre.
Rappelez-vous ceci, que vous dit une mčre.
_Elle l'embrasse._
Marton est lŕ, je crois, je vais vous l'envoyer.
LA DUCHESSE.
Pas encore.
LA MARÉCHALE.
Adieu donc.
SCČNE XIV
LA DUCHESSE, _seule_.
Rester seule ŕ veiller!
C'est mon rôle ŕ présent.--
Ah! je me sens brisée.
_Elle s'assoit sur un sofa._
Mon Dieu, quel triste jour! ma force est épuisée.
Louison ne revient pas;--que font-ils ŕ ce bal?
Singulier passe-temps que ce plaisir banal!
Déguiser son visage et sa voix,--pour quoi faire?
Si ce qu'on dit est mal, autant vaudrait le taire.
S'il en est autrement, ŕ quoi bon s'en cacher?
Mais quoi! c'est l'Inconnu qu'ils vont tous y chercher.
Le sommeil, malgré moi, m'accable;--ma pensée
M'échappe, puis revient, puis s'arręte lassée.
Voyons, tâchons de lire un peu.
_Elle prend un livre, l'ouvre, puis le remet sur la table._
C'est encor pis.
Un roman, juste ciel!--mes yeux sont assoupis.
Quel ennui que l'attente!
_Elle tire sa montre._
Hélas! pauvre petite,
Je puis du bout du doigt te faire aller plus vite;
Je puis briser aussi ton rouage léger;--
Mais le temps!--toi ni moi n'y pouvons rien changer.
_Elle s'endort._
SCČNE XV
LA DUCHESSE, _endormie_, LE DUC.
LE DUC.
Non, l'on ne vit jamais pareille extravagante.
Se voir apostropher au bal par sa servante!
C'est un peu plus qu'étrange. Était-ce bien Louison?
Il faut que cette fille ait perdu la raison.
Je lui donne ici męme un rendez-vous fort tendre;
La chose est convenue: elle n'a qu'ŕ m'attendre;
J'entre au bal par hasard, et qu'est-ce que je voi?
Mon rendez-vous qui passe, et va souper sans moi.
Et ce monsieur Berthaud, son chapeau sur la tęte,
D'un air victorieux promenant sa conquęte,
Devant un poulet froid en train de se griser,
M'annonçant bravement qu'il la veut épouser!
J'ai fait lŕ, sur mon âme, une belle trouvaille!
Morbleu! si de mes jours jamais je m'encanaille,
Je consens... Qu'est-ce donc?--Ma femme seule ici?
Elle dort, sauvons-nous.--
_Il va pour sortir et s'arręte._
Elle est gentille ainsi.
Que faisait-elle lŕ?--Dort-elle en conscience?
Qui sait? J'en veux un peu faire l'expérience.
Hé, duchesse!--Elle dort et trčs profondément.
Je ne suis qu'un mari.--Si j'étais un amant!
En semblable rencontre on pourrait, sans mensonge,
Essayer, comme on dit, de passer pour un songe.
Je ne l'ai jamais vue ainsi;--mais c'est charmant.
Qu'a-t-elle dans la main? Sa montre? Hé, oui vraiment.
Que fait-elle, en dormant, d'une chose pareille?
On sait l'heure qu'il est, tout au plus, quand on veille.
A-t-elle donc veillé ce soir?--par quel hasard?
_Il regarde ŕ la montre de la duchesse._
Une heure du matin!--on prétend que c'est tard.
Veiller!--Pourquoi veiller? pour moi? bon! quelle idée!
Elle avait de ce bal la tęte possédée;
Son dessein n'était pas de rester ŕ dormir,--
Mais peut-ętre était-il de me voir revenir?
Oui; pourquoi chercherais-je ŕ me tromper moi-męme?
Si ma femme est jalouse, il faut donc qu'elle m'aime.
Je ne lui vis jamais faux-semblant ni détour.
C'est moi qu'elle attendait, c'est clair comme le jour.
Ma foi, je suis bien bon d'aller ŕ l'aventure
Chercher, sous un sot masque, une sotte figure,
Pour rencontrer en somme, ŕ ce triste Opéra,
Quoi? rien de ce qu'on veut, et tout ce qu'on voudra!
Beau métier d'écouter, au bruit des ritournelles,
Trois morceaux de carton jasant sous leurs dentelles!
De me faire berner par Javotte ou Louison,
Quand la grâce et l'amour sont lŕ, dans ma maison!
Faut-il que nous ayons la cervelle assez folle
Pour fuir ce qui nous plaît, nous charme et nous console,
Pour chercher le bonheur oů son ombre n'est pas,
Et lui tourner le dos quand il nous tend les bras!
Pauvre duchesse, hélas! si jeune et si jolie,
Avec sa patience et sa mélancolie,
Je devrais l'adorer; mais non, je vais plutôt
Me faire obscurément le rival de Berthaud!
Quelle pitié, grand Dieu! quelle pauvreté d'âme!
Il est de mauvais goűt d'oser aimer sa femme.
Les bavards sont fâchés si l'on ne vit comme eux,
Et l'on est ridicule ŕ vouloir ętre heureux!
_En ce moment, la duchesse s'éveille, puis écoute, en feignant de dormir._
Hé quoi! suis-je donc fait pour suivre leur méthode?
Je puis mettre un chiffon, une veste ŕ la mode,
Pour une broderie on se rčgle sur moi,
Et, dans mon propre coeur, les sots me font la loi!
Si je voulais pourtant, quoi qu'ils en puissent dire,
En leur montrant ce coeur, les défier d'en rire?
Oui, l'on peut, quand on hait, cacher la vérité;
Renier ce qu'on aime est une lâcheté.
Si j'osais les braver et m'en passer l'envie?
Leur dire: Je suis las de votre sotte vie;
J'ai, dans votre cohue, erré jusqu'ŕ ce jour,
Mais la honte m'en chasse et me rend ŕ l'amour!
Que me répondraient-ils, ces roués en peinture,
S'ils voyaient cette belle et noble créature
M'accompagner, et moi la couvrant en chemin
De mon manteau d'hermine, une épée ŕ la main?
Et si je leur disais: Cette fičre duchesse,
C'est ma soeur, mon enfant, ma femme et ma maîtresse;
Ma vie est dans son coeur, ma place est ŕ ses pieds!
_Il se met ŕ genoux; la maréchale paraît dans le fond de la scčne._
LA DUCHESSE.
Dans mes bras, mon ami.
LE DUC.
Comment! vous m'écoutiez?
LA DUCHESSE.
Valait-il mieux dormir?
LE DUC, _ŕ la maréchale_.
Et vous aussi, ma mčre?
J'ai donc parlé bien haut?
LA MARÉCHALE.
Valait-il mieux vous taire?
LE DUC.
Non. Je me croyais seul, et je rends grâce aux cieux
D'avoir eu pour témoins ce que j'aime le mieux.
_On entend rire dans la coulisse._
Qu'est ceci?
LA DUCHESSE.
C'est Louison.
LE DUC.
Que Dieu la tienne en joie!
Vous savez qu'elle part?
LA DUCHESSE.
Non pas. Qui la renvoie?
LE DUC.
Elle-męme. Elle vient, ce soir, ŕ l'Opéra,
De tout me déclarer, jusqu'au mari qu'elle a.
Eh! tenez, les voici.
SCČNE XVI
LA MARÉCHALE, LA DUCHESSE, LE DUC, LOUISON, BERTHAUD.
LA MARÉCHALE.
Que nous dit-on, Lisette?
Vous voulez nous quitter sans qu'on vous le permette?
LISETTE.
Je venais demander cette permission.
LA MARÉCHALE.
Vous épousez... monsieur?
LE DUC.
C'est une passion.
BERTHAUD.
Oh! oui.
LISETTE.
Non, Monseigneur, ce n'est qu'un honnęte homme,
Fils d'un de vos fermiers.
BERTHAUD, _ŕ la duchesse_.
Oui, madame, on me nomme...
LISETTE.
Tais-toi.
BERTHAUD.
Pour quoi donc faire? on me parle.
LISETTE.
Tais-toi.
LA DUCHESSE, _ŕ Lisette_.
Il n'est pas beau, Louison.
LISETTE, _ŕ la duchesse_.
Il l'est assez pour moi.
LE DUC.
Parbleu! monsieur Berthaud, vous ne vous gęnez gučres
De venir ŕ Paris braconner sur nos terres,
Et nous ravir ainsi les coeurs en un moment.
Vous ętes un fripon.
BERTHAUD, _ŕ Louison_.
Ce seigneur est charmant.
LE DUC.
Et votre poulet froid, sans compter la bouteille,
Vous en trouvez-vous bien?
BERTHAUD.
Monseigneur, ŕ merveille;
Je...
LISETTE.
Tais-toi donc.
BERTHAUD.
Encor? toujours se taire ici!
Je me rattraperai chez nous.
LISETTE, _ŕ la maréchale_.
Et vous aussi,
Madame, riez-vous de mon futur ménage?
LA MARÉCHALE, _l'attirant ŕ part_.
Non, Louise, j'ai compris, et je vois ton courage.
Si j'ai peine, ŕ présent, ŕ te laisser partir,
Tu n'auras pas du moins lieu de t'en repentir.
Ta dot, bien entendu, me regarde, et j'espčre
Rendre aussi ton retour agréable ŕ ton pčre.
Quant ŕ ton prétendu...
LISETTE.
Vous m'avez dit tantôt
De trouver un prétexte.
LE DUC.
Allons, monsieur Berthaud,
Aimez bien votre femme; elle est bonne et jolie.
C'est encore ici-bas la plus sage folie.
FIN DE LOUISON.
Cette comédie a été écrite pour le Théâtre-Français, qui en donna la
premičre représentation le 22 février 1849. L'auteur avait compté sur
mademoiselle Mante pour le rôle de la maréchale; mais, au moment oů
les répétitions commençaient, cette grande actrice était déjŕ atteinte
de la maladie ŕ laquelle elle devait succomber. La pičce, accueillie
avec faveur, fut cependant traitée fort sévčrement par la critique;
c'est ŕ quoi le počte fait allusion dans le sonnet adressé ŕ
mademoiselle Anaďs. qui avait joué le rôle de Louison avec beaucoup de
talent.
* * * * *
ON NE SAURAIT PENSER Ŕ TOUT
PROVERBE EN UN ACTE
1849
PERSONNAGES ACTEURS QUI ONT CRÉÉ LES RÔLES
LE MARQUIS DE VALBERG. MM. MAILLARD.
LE BARON. VOLNYS.
GERMAIN. GOT.
LA COMTESSE DE VERNON. Mme ALLAN-DESPRÉAUX.
VICTOIRE, femme de chambre de la comtesse.
_La scčne est ŕ la campagne_.
SCČNE PREMIČRE
LE BARON, GERMAIN.
LE BARON.
Mon neveu, dis-tu, n'est point ici?
GERMAIN.
Non, monsieur, je l'ai cherché partout.
LE BARON.
C'est impossible; il est cinq heures précises. Ne sommes-nous pas chez
la comtesse?
GERMAIN.
Oui, monsieur, voilŕ son piano.
LE BARON.
Est-ce que mon neveu n'est plus amoureux d'elle?
GERMAIN.
Si fait, monsieur, comme d'habitude.
LE BARON.
Est-ce qu'il ne vient pas la voir tous les jours?
GERMAIN.
Monsieur, il ne fait pas autre chose.
LE BARON.
Est-ce qu'il n'a point reçu ma lettre?
GERMAIN.
Pardonnez-moi, ce matin męme.
LE BARON.
Il doit donc ętre dans ce château, puisque je ne l'ai pas trouvé chez
lui. Je lui avais mandé que je quitterais Paris ŕ une heure et quart,
que je serais par conséquent ŕ Montgeron ŕ trois heures. De Montgeron
ici il y a deux lieues et demie. Deux lieues et demie, mettons
cinq quarts d'heure, en supposant les chemins mauvais, mais, ŕ tout
prendre, ils ne le sont point.
GERMAIN.
Bien au contraire, ils sont fort bons.
LE BARON.
Partant ŕ trois heures de Montgeron, je devais par conséquent ętre au
tourne-bride positivement ŕ quatre heures un quart. J'avais une
visite ŕ faire ŕ M. Duplessis, qui devait durer tout au plus un quart
d'heure. Donc, avec le temps de venir ensuite ici, cela ne pouvait me
mener plus tard que cinq heures. Je lui avais mandé tout cela avec
la plus grande exactitude. Or, il est cinq heures précisément, et
quelques minutes maintenant. Mon calcul n'est-il pas exact?
GERMAIN.
Parfaitement, monsieur, mais mon maître n'y est point.
LE BARON.
Ses paquets, du moins, sont-ils faits?
GERMAIN.
Quels paquets, monsieur, s'il vous plaît?
LE BARON.
Ses malles sont-elles préparées, lŕ-bas, ŕ son château?
GERMAIN.
Pas que je sache, monsieur, aucunement.
LE BARON.
Je lui avais cependant mandé que la grande-duchesse était accouchée,
la duchesse de Saxe-Gotha, Germain; ce n'est pas une petite affaire.
GERMAIN.
Je le crois bien.
LE BARON.
Je lui avais écrit que M. Desprez, avant-hier soir, était venu me
rendre visite. M. Desprez arrivait de Saint-Cloud. Il venait me
prévenir que le ministre me priait de passer dans la matinée du
lendemain, c'est-ŕ-dire hier, ŕ son cabinet. J'allais obéir ŕ cet
ordre, lorsque je reçus l'avertissement que le ministre était ŕ
Compičgne; il y avait accompagné le roi. Ce fut donc ŕ Compičgne que
je me rendis. Comme je savais de quoi il s'agissait, il n'y avait pas
de temps ŕ perdre, tu le comprends.
GERMAIN.
Sans aucun doute.
LE BARON.
Le ministre était ŕ la chasse. On me dit d'aller chez M. de Gercourt,
qui me conduisit en secret jusqu'aux petits appartements;--le roi
venait de partir pour Fontainebleau.
GERMAIN.
Cela était fâcheux.
LE BARON.
Point du tout. Je tiens seulement ŕ te faire remarquer combien je suis
ponctuel en toute chose.
GERMAIN.
Oh! pour cela oui.
LE BARON.
La ponctualité est, en ce monde, la premičre des qualités. On peut
męme dire que c'est la base, la véritable clef de toutes les autres.
Car de męme que le plus bel air d'opéra ou le plus joli morceau
d'éloquence ne sauraient plaire hors de leur lieu et place, de męme
les plus rares vertus et les plus gracieux procédés n'ont de prix qu'ŕ
la condition de se produire en un moment distinct et choisi. Retiens
cela, Germain: rien n'est plus pitoyable que d'arriver mal ŕ propos,
eűt-on d'ailleurs le plus grand mérite; témoin ce célčbre diplomate
qui arriva trop tard ŕ la mort de son prince, et vit la reine mettant
ses papillotes. Ainsi se détruisent les plus beaux talents, et l'on a
vu des gens couverts de gloire dans les armées et męme dans le cabinet
perdre leur fortune, faute d'une montre convenable et ponctuellement
réglée. La tienne va-t-elle bien, mon ami?
GERMAIN.
Je la mets ŕ l'heure continuellement, monsieur.
LE BARON.
Fort bien. Tu sauras donc enfin que, ayant rencontré ŕ Compičgne la
marquise de Morivaux, qui me donna une place dans sa voiture, j'appris
que l'on m'avait trompé par des renseignements peu exacts, et que le
ministre revenait ŕ Paris. Son Excellence me reçut, ŕ deux heures et
demie, et voulut bien m'annoncer elle-męme que la grande-duchesse de
Gotha était accouchée, comme je te le disais tout ŕ l'heure, et que
le roi avait fait choix de moi et de mon neveu pour aller la
complimenter.
GERMAIN.
Ŕ Gotha, monsieur?
LE BARON.
Ŕ Gotha. C'est un grand honneur pour ton maître.
GERMAIN.
Oui, monsieur, mais il est sorti.
LE BARON.
Voilŕ ce que je ne puis comprendre. Il est donc toujours aussi
étourdi, aussi distrait que de coutume? Toujours oubliant tout!
GERMAIN.
On ne peut pas trop dire, monsieur. Ce n'est pas qu'il oublie, c'est
qu'il pense ŕ autre chose.
LE BARON.
Il faut qu'il soit en route, sans faute, demain matin, pour
l'Allemagne. Et il n'a donné aucun ordre pour son départ?
GERMAIN.
Non, monsieur. Ce matin seulement, avant de sortir, il a ouvert une
grande caisse de voyage, et il s'est promené bien longtemps tout
alentour.
LE BARON.
Et qu'a-t-il mis dedans?
GERMAIN.
Un papier de musique.
LE BARON.
Un papier de musique?
GERMAIN.
Oui, monsieur; aprčs quoi il a fermé la caisse avec bien du soin, et
il a mis la clef dans sa poche.
LE BARON.
Un papier de musique! toujours des folies! si le roi savait cette
maladie-lŕ, oserait-on lui confier une mission d'une si haute
importance! heureusement il est sous ma garde. Enfin, qu'a-t-il dit,
qu'a-t-il fait?
GERMAIN.
Il a chanté, monsieur, toute la journée.
LE BARON.
Il a chanté?
GERMAIN.
Ŕ merveille, monsieur; c'était un plaisir de l'entendre.
LE BARON.
Le beau prélude pour un ambassadeur! Tu as quelque bon sens, Germain.
Dis-moi, le crois-tu réellement capable de se conduire sainement dans
une conjoncture si délicate?
GERMAIN.
Quoi, monsieur, d'aller ŕ Gotha, faire la révérence ŕ une accouchée?
Il me semble que j'irais moi-męme.
LE BARON.
Tu ne sais pas de quoi tu parles.
GERMAIN.
Dame! monsieur, de la grande-duchesse; c'est vous qui me dites qu'elle
est accouchée.
LE BARON.
Il est vrai qu'elle a donné le jour ŕ un nouveau rejeton d'une tige
auguste. Mais qu'a fait encore mon neveu?
GERMAIN.
Il est venu ici, je ne sais combien de fois, frapper ŕ la porte de
madame la comtesse.
LE BARON.
Et oů est-elle, la comtesse?
GERMAIN.
Monsieur, elle n'est pas levée.
LE BARON.
Ŕ cette heure-ci! c'est inconcevable. Elle ne dîne donc pas, cette
femme-lŕ?
GERMAIN.
Non, monsieur, elle soupe.
LE BARON.
Autre cervelle fęlée! Beau voisinage pour un fou!
GERMAIN.
Mon maître serait bien fâché, monsieur, s'il s'entendait traiter de
la sorte. Lorsqu'on se hasarde ŕ lui faire remarquer la moindre
distraction de sa part, il entre dans une colčre affreuse. Ŕ telle
enseigne que, l'autre jour, il a manqué de m'assommer parce qu'il
avait, au lieu de sucre, versé son tabac sur ses fraises, et hier
encore...
LE BARON.
Juste Dieu! Est-il croyable qu'un homme de mérite, et du plus haut
mérite, Germain (car mon neveu est fort distingué), tombe d'une
maničre aussi puérile dans des égarements déplorables!
GERMAIN.
Cela est bien funeste, monsieur.
LE BARON.
Ne l'ai-je pas vu, de mes propres yeux, traverser, les mains dans ses
poches, une contredanse royale, et se promener au milieu du quadrille,
comme dans l'allée d'un jardin?
GERMAIN.
Parbleu! monsieur, il a fait la pareille, l'autre soir, chez madame
la comtesse. Il y avait grande compagnie, et M. Vertigo, le počte
d'ŕ côté, lisait un mélodrame en vers. Ŕ l'endroit le plus touchant,
monsieur, quand la jeune fille empoisonnée reconnaissait son pčre
parmi les assassins, quand toutes ces dames fondaient en larmes, voilŕ
mon maître qui se lčve et s'en va boire le verre d'eau que l'auteur
avait sur sa table. Tout l'effet de la scčne a été manqué.
LE BARON.
Cela ne m'étonne pas. Il a bien mis un jour trente sous dans une tasse
de thé que lui présentait une charmante personne, croyant qu'elle
quętait pour les pauvres.
GERMAIN.
L'hiver dernier, vous étiez absent, lors du mariage de monsieur son
frčre. Il devait, comme vous pensez, faire les honneurs au repas
de noces. J'entre chez lui, vers le soir, pour l'aider ŕ faire sa
toilette. Il me renvoie, se déshabille lui-męme, puis se promčne une
heure durant, sauf votre respect, en chemise; aprčs quoi il s'arręte
court, se regarde dans la glace avec étonnement: Que diable fais-je
donc? se demande-t-il; parbleu! il fait nuit, je me couche. Et
lŕ-dessus il se mettait au lit, oubliant la noce et le dîner, si nous
n'étions venus l'avertir.
LE BARON.
Et tu crois qu'un pareil extravagant est capable, d'aller ŕ Gotha!
Vois quelle tâche j'entreprends, Germain, car il faut bien, bon gré,
mal gré, que la volonté du roi s'accomplisse. Il n'y a pas ŕ dire,
c'est mon neveu qui a le titre, je ne fais que l'accompagner; on lui
donne ce titre parce qu'il porte un nom; celui de son pčre, qui est
plus que le mien, et c'est moi qui suis responsable.
GERMAIN.
Puisque mon maître a du mérite.
LE BARON.
Sans doute, mais cela suffit-il? Il m'avait promis de se corriger.
GERMAIN.
Il s'y étudie, monsieur, tout doucement, mais il n'aime pas qu'on le
contrarie, et si vous m'en croyez... Le voici.
SCČNE II
LE BARON, GERMAIN, LE MARQUIS.
LE MARQUIS.
Ah ça! c'est donc une gageure? on me volera donc toujours mes papiers!
GERMAIN.
Monsieur, voilŕ monsieur le baron...
LE MARQUIS.
Qu'as-tu fait, drôle, d'un papier de musique que j'avais tantôt? Oů
l'as-tu mis? oů est-il passé?
LE BARON.
Bonjour, Valberg; que vous arrive-t-il?
LE MARQUIS.
Je ferai maison nette un de ces jours; je vous mettrai tous ŕ la
porte.
_Au baron qui rit._
Et vous, maraud, tout le premier.
GERMAIN.
Monsieur, c'est monsieur le baron.
LE MARQUIS.
Ah! pardon, mon cher oncle, vous venez donc de Paris? C'est que j'ai
perdu un papier de musique.
GERMAIN.
C'est sűrement celui-lŕ qu'il a si bien serré.
LE BARON.
Vous voyez, mon neveu, que je suis exact, je suis arrivé ŕ l'heure
dite. Et vous, ętes-vous disposé ŕ partir?
LE MARQUIS.
Ŕ partir?
LE BARON.
Oui, demain matin.
LE MARQUIS.
Oui, je vous le jure, si j'éprouve un refus, je pars sur-le-champ, et
vous ne me reverrez de la vie.
LE BARON.
Quel refus? que voulez-vous dire?
LE MARQUIS.
Oui, sur l'honneur, si je suis reçu avec froideur, si ma démarche est
mal accueillie, mon parti est pris irrévocablement.
LE BARON.
Eh! quelle froideur, quel mauvais accueil avez-vous ŕ craindre, venant
de la part du roi?
LE MARQUIS.
Est-ce que le roi se męle de tout ceci?
LE BARON.
Parbleu! apparemment, puisque vous serez porteur d'une lettre
autographe de Sa Majesté.
LE MARQUIS.
Pour la comtesse?
LE BARON.
Pour la grande-duchesse. Oubliez-vous que vous ętes chargé?...
LE MARQUIS.
C'est que je confondais, parce que j'ai aussi une lettre ŕ écrire ŕ la
comtesse. L'avez-vous vue?
LE BARON.
Non, elle dort.
LE MARQUIS.
Eh bien! que dites-vous de cette affaire-lŕ? Ne fais-je pas bien?
LE BARON.
Quelle affaire?
LE MARQUIS.
Oh, mon Dieu! je sais bien ce que vous m'allez dire. Vous n'avez
jamais pu la souffrir, vous vous ętes brouillé avec elle, vous lui
avez fait un procčs; eh bien! je vous le demande, qu'est-ce qu'on
gagne ŕ ces choses-lŕ? Votre avocat a fait de belles phrases pour
un méchant quartier de vigne; le voilŕ maintenant au parlement. Ses
discours n'ont pas le sens commun. On dit que c'est de la grande
politique, moi je prétends qu'il n'en a point du tout, et vous verrez
que la loi sera rejetée.
LE BARON.
De quoi venez-vous me parler? Il s'agit ici de choses sérieuses et qui
réclament toute votre attention.
LE MARQUIS.
S'il en est ainsi, vous n'avez qu'ŕ dire. Parlez, monsieur, je vous
écoute.
LE BARON.
Il s'agit de notre ambassade. Avez-vous lu ce que je vous ai mandé?
LE MARQUIS.
De notre ambassade? oui, sans doute; je suis toujours aux ordres du
roi.
LE BARON.
Fort bien.
LE MARQUIS.
Sa Majesté connaît mon dévouement.
LE BARON.
Ŕ merveille. Vous serez donc pręt...
LE MARQUIS.
En doutez-vous? mes ordres sont donnés; Germain, tout est-il préparé?
GERMAIN.
Monsieur, je n'ai point reçu d'ordres.
LE MARQUIS.
Comment, coquin! Et cette grande malle que je t'ai fait mettre au
milieu de ma chambre?
GERMAIN.
Ah! si monsieur veut chanter en route...
LE MARQUIS.
Chanter en route, impertinent!
GERMAIN.
Dame! monsieur, votre musique est dedans, et la clef est dans votre
poche.
LE MARQUIS.
Dans ma... Ah! parbleu! c'est vrai. On me l'aura donnée sans doute
avec mes gants et mon mouchoir. Ces gens-lŕ ne font attention ŕ rien.
GERMAIN.
Je puis vous assurer, monsieur...
LE BARON.
Laisse-nous, ne dis mot, et va tout préparer.
_Germain sort._
Maintenant, Valberg, il faut que je vous quitte, pour retourner chez
M. Duplessis, prendre les lettres de la cour. Je n'ai que deux mots ŕ
vous dire: songez, mon neveu, que notre voyage n'est point une mission
ordinaire, et que, selon l'habileté que vous y déploierez, votre
avenir peut en dépendre.
LE MARQUIS.
Hélas! je ne le sais que trop.
LE BARON.
Il faut donc que vous me promettiez de tenter sur vous-męme un
effort salutaire, de vaincre ces petites distractions, ces faiblesses
d'esprit parfois si fâcheuses, afin de conduire sagement les choses.
LE MARQUIS.
Oh! pour cela, je vous le promets.
LE BARON.
Sérieusement?
LE MARQUIS.
Trčs sérieusement.
LE BARON.
Allez donc achever de donner vos ordres. Il est six heures moins vingt
minutes; je vais chez M. Duplessis; ce n'est pas loin; je serai de
retour pour le dîner. Allons, vous me promettez donc de suivre en tout
point mes conseils? vous savez ce que c'est que ces messieurs de la
cour.
LE MARQUIS.
Oh! ne vous mettez pas en peine. Je sais comment il faut s'y prendre
vis-ŕ-vis d'eux. Je me ferai écrire partout. Il faut que je sache
seulement le nom de votre rapporteur, et j'irai moi-męme.
LE BARON.
Je n'ai point de rapporteur; que voulez-vous donc dire?
LE MARQUIS.
Si vous n'avez pas de rapporteur, il n'est pas temps de solliciter vos
juges.
LE BARON.
Mes juges? ŕ propos de quoi?
LE MARQUIS.
Pour votre procčs.
LE BARON.
Mais je n'ai point de procčs.
LE MARQUIS.
Comment! vous ne m'avez pas dit de voir ces messieurs de la cour?
LE BARON.
Je vous parle de la cour de Saxe.
LE MARQUIS.
Ah! oui, c'est pour notre ambassade.--Je suis un peu préoccupé; c'est
la comtesse qui a un procčs, et je me suis chargé de le suivre. C'est
une femme charmante!
LE BARON.
Oui, oui, nous savons que vous ętes coiffé d'elle, et que le voisinage
est cause que vous vous enterrez dans votre château. Mais il ne faut
pas que cette inclination traverse nos plans, s'il vous plaît.
LE MARQUIS.
Ne craignez rien, allez, soyez en paix. Quand je n'y songe pas,
voyez-vous, je parais, comme cela, un peu insouciant; mais quand je me
męle de choses graves, personne n'est plus attentif que moi.
LE BARON.
Ŕ la bonne heure.
LE MARQUIS.
Allez chez M. Duplessis, soyez en paix, je me charge du reste.
LE BARON.
Nous verrons votre exactitude.
LE MARQUIS.
Je vais surveiller Germain, de peur qu'il ne fasse quelque méprise.
LE BARON.
Fort bien.
LE MARQUIS.
Je vais achever de mettre mes papiers en ordre. J'en ai beaucoup.
LE BARON.
Ne m'arrętez donc pas, je vous prie.
LE MARQUIS.
Dieu m'en préserve! Allez, monsieur, allez prendre les lettres
royales; de mon côté, j'écrirai ŕ ma mčre;--il est bien juste aussi
que je remercie le ministre; je laisserai mes chiens ŕ madame de
Belleroche; j'avertirai tous nos parents, et ŕ votre retour, je
l'espčre, le mariage sera décidé.
LE BARON, _s'arrętant au moment de sortir_.
Comment, le mariage! Quel mariage?
LE MARQUIS.
Hé! le mien, ne le savez-vous pas?
LE BARON.
Que signifie cette plaisanterie? votre mariage, dites-vous?
LE MARQUIS.
Oui, avec la comtesse; ne vous ai-je pas dit que je l'épousais?
LE BARON.
Non, vraiment. En voici bien d'une autre!
LE MARQUIS.
Cela me donne beaucoup d'affaires, comme vous voyez.
LE BARON.
Mais on ne se marie pas la veille d'un départ. C'est apparemment pour
votre retour.
LE MARQUIS.
Non pas; mon sort se décide aujourd'hui.
LE BARON.
Vous n'y pensez pas, mon ami.
LE MARQUIS.
J'y pense trčs fort, car je ne partirai qu'aprčs et selon sa réponse.
LE BARON.
Mais que cette réponse soit bonne ou mauvaise, qu'a-t-elle ŕ faire
avec notre ambassade? Vous ne voulez pas, je suppose, emmener la
comtesse?
LE MARQUIS.
Pourquoi non, si elle y consent?
LE BARON.
Miséricorde! une femme en voyage! Des chapeaux, des robes, des femmes
de chambre, une pluie de cartons, des nuits d'auberge, des cris pour
un carreau cassé!
LE MARQUIS.
Vous parlez lŕ de bagatelles.
LE BARON.
Je parle de ce qui est convenable, et ceci ne l'est pas du tout. Il
n'est point dit, dans les lettres que j'ai, que vous emmčneriez une
femme, et je ne sais si on le trouverait bon.
LE MARQUIS.
C'est ce dont je me soucie fort peu.
LE BARON.
Mais je m'en soucie beaucoup, moi qui vous parle; et si vous insistez,
je vous déclare...
_Le marquis se met au piano et prélude.--Ŕ part._
En vérité, ce garçon-lŕ est fou; il est impossible qu'il aille ŕ
Gotha. Que faire? je ne puis partir seul, son nom est tout au long
dans la lettre royale. Si je dis ce qui en est, voilŕ un scandale, et
quand bien męme j'obtiendrais que mon nom fűt mis ŕ la place du sien
(ce qui serait de toute justice), voilŕ un retard considérable, et
l'ŕ-propos sera manqué.
_On entend sonner._
Grand Dieu! c'est la comtesse qui sonne... Je vais manquer M.
Duplessis. Mon neveu, de grâce, écoutez-moi.
LE MARQUIS.
Monsieur, je vous croyais parti.
LE BARON.
Vous ętes amoureux de la comtesse.
LE MARQUIS.
C'est mon secret.
LE BARON.
Vous venez de me le dire.
LE MARQUIS.
Si cela m'est échappé, je ne m'en cache pas.
LE BARON.
Ne plaisantons point, je vous prie. Je ne puis parler pour vous ŕ la
comtesse; elle me déteste, et je suis pressé. Voici ce que je vous
propose. Deux choses sont qu'il faut mener ŕ bien, votre mariage et
votre ambassade. Ne sacrifiez pas l'un ŕ l'autre.
LE MARQUIS.
Je ne demande pas mieux.
LE BARON.
Voyez donc la comtesse, obtenez une réponse. Si elle accepte, je ne
m'oppose pas ŕ ce qu'elle vienne en Allemagne, mais ce ne saurait ętre
du jour au lendemain; cela se conçoit naturellement.
LE MARQUIS.
Naturellement.
LE BARON.
Ainsi elle pourrait nous rejoindre.
LE MARQUIS.
Vous avez lŕ une excellente idée.
LE BARON.
N'est-il pas vrai? Si elle refuse...
LE MARQUIS.
Si elle refuse, je la quitte pour jamais.
LE BARON.
C'est cela męme; vous fuyez une ingrate.
LE MARQUIS.
Ah! je l'adorerai toujours!
LE BARON.
Certainement.
_Ŕ part._
Il n'est point méchant, et ses distractions męmes, entre des mains
habiles, peuvent tourner ŕ son profit. On n'a pas su le guider
jusqu'ici. Allons, il peut venir ŕ Gotha.
_Haut._
Voilŕ qui est convenu; je vous laisse. Ŕ mon retour, votre démarche
sera faite, et le succčs, je l'espčre, sera favorable, car la
comtesse, apparemment, s'attend ŕ votre proposition.
LE MARQUIS.
Mais je ne sais pas trop, car voilŕ plusieurs fois que je viens ici
pour lui en parler, et, je ne sais comment cela se fait, je l'oublie
toujours; mais, cette fois-ci, j'ai mis un papier dans ma boîte pour
m'en souvenir.
LE BARON.
Cela fait un mariage bien avancé!
LE MARQUIS.
Je ne sais pas si elle y consentira, car il est difficile de la fixer
longtemps sur le męme objet. Quand vous lui parlez, elle semble vous
écouter, et elle est ŕ cent lieues de lŕ.
LE BARON.
Elle est peut-ętre distraite?
LE MARQUIS.
Oui, elle est distraite. C'est insupportable, cela.
LE BARON.
Oh! je vous en réponds.--Je vais chez M. Duplessis.
LE MARQUIS.
Oui, vous ferez bien, parce que ce mariage, le procčs de la comtesse
et cette ambassade, tout cela m'occupe beaucoup. On a mille lettres ŕ
répondre. Elle veut que je lise un roman nouveau,... tout cela ne peut
pas s'accorder ensemble,... vous en conviendrez bien.
LE BARON.
Oui, oui, songez ŕ votre mariage.
LE MARQUIS.
C'est vrai. Cette diable d'affaire-lŕ me tourne la tęte! Je n'y pense
jamais. Je ne vous reconduis pas.
LE BARON.
Hé! non, non. Vous vous moquez de moi.
_Ŕ part, en s'en allant._
Il voulait, disait-il, surveiller Germain, mais je vais le faire
surveiller lui-męme.
SCČNE III
LE MARQUIS, VICTOIRE.
LE MARQUIS.
Holŕ! oh! quelqu'un!
VICTOIRE.
Qu'est-ce que veut monsieur le marquis?
LE MARQUIS.
Donnez-moi ma robe de chambre.
VICTOIRE.
Vous badinez, monsieur le marquis.
LE MARQUIS.
Hé! ah!... oui, oui.
VICTOIRE.
On a dit ŕ madame la comtesse que vous étiez ici, et elle va venir.
LE MARQUIS.
Pourquoi cela? Je m'en vais faire mettre mes chevaux, et j'irai chez
elle.
VICTOIRE.
Mais, monsieur, vous y ętes, chez elle.
LE MARQUIS.
Vous avez raison;... c'est que je pensais...
VICTOIRE.
Monsieur, voilŕ madame.
SCČNE IV
LA COMTESSE, LE MARQUIS, VICTOIRE.
LA COMTESSE, _en entrant_.
François, dites ŕ Victoire de venir.
VICTOIRE.
Me voilŕ, madame.
LA COMTESSE.
C'est bon.--Monsieur de Valberg, je suis enchantée de vous voir...
Vous avez été hier de la distraction la plus divertissante du monde...
Je vous aime ŕ la folie comme cela.
LE MARQUIS.
Ce n'est pas lŕ le moyen de m'en corriger, madame, au contraire;
cependant, comme on dit souvent, les contraires se rapprochent
quelquefois.
LA COMTESSE.
Mademoiselle, je veux absolument avoir ma robe.
VICTOIRE.
Oui, madame.
LA COMTESSE.
Donnez-moi un autre collet.
_Elle s'assied ŕ sa toilette._
Celui-ci va ŕ faire horreur.
_Au marquis._
Asseyez-vous donc.
VICTOIRE.
Mais, madame n'a qu'ŕ le rendre si elle n'en veut pas; cependant il
est bien fait. C'est qu'il y a lŕ un pli... Attendez.
_Elle l'arrange._
LA COMTESSE.
Oui, un pli, voyons.
_Elle se mire._
Eh bien! voilŕ ce que je veux dire. Il va ŕ merveille comme cela. Ayez
soin que mademoiselle Dufour m'en fasse un autre tout pareil, mais je
dis tout de męme, entendez-vous?
VICTOIRE.
Oui, madame. Et quand madame le veut-elle?
LA COMTESSE.
Quand? mais demain matin. Il n'y a qu'ŕ envoyer François tout ŕ
l'heure, j'en suis trčs pressée.
VICTOIRE.
Il n'y aura peut-ętre pas assez de temps.
LA COMTESSE.
Oh! sans doute, vous trouvez toujours ce que je désire impossible, et
puis vous viendrez dire que vous m'ętes bien attachée.
VICTOIRE.
C'est que rien n'est plus vrai.--Madame me gronde.
LA COMTESSE.
C'est bon, c'est bon, donnez-moi du rouge. Eh bien! monsieur de
Valberg, vous ne dites rien?
LE MARQUIS.
Mais vous ne m'écoutez pas, madame.
LA COMTESSE, _mettant son ruban_.
Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ne parliez-vous pas des contraires?
LE MARQUIS.
Des contraires? N'est-ce pas des contrats, plutôt?
LA COMTESSE.
Cela peut bien ętre. Victoire!
VICTOIRE.
Madame?
LA COMTESSE.
Je ne sais plus ce que je voulais dire, avec vos contrats.
LE MARQUIS.
Ah! je vous le dirai, moi, quand vous voudrez m'entendre.
LA COMTESSE.
Je vous entends toujours avec plaisir.
LE MARQUIS.
Aurez-vous du monde aujourd'hui?
LA COMTESSE.
Non, si vous voulez. C'est męme ce que je voulais dire, car tous les
ennuyeux de la ville prennent ce parc pour leur promenade. Victoire!
qu'on ne laisse entrer personne.
VICTOIRE.
Je m'en vais le dire, madame.
LE MARQUIS.
Je vous suis obligé, parce que j'ai ŕ vous parler trčs sérieusement.
LA COMTESSE, _ŕ Victoire_.
Ma belle-soeur, pourtant.
VICTOIRE.
Oui, madame.
LA COMTESSE.
Elle raffole de vous, monsieur de Valberg.
LE MARQUIS.
Moi, je la trouve charmante! Il y a des femmes comme cela, qui vous
séduisent dčs le premier moment qu'on les voit.
LA COMTESSE.
Victoire, dites qu'on laisse entrer aussi M. de Clervaut.
VICTOIRE.
Est-ce lŕ tout?
LE MARQUIS.
Ah! madame, M. de Latour aussi, je vous prie.
LA COMTESSE.
M. de Latour? Eh bien! oui, M. de Latour; je le veux bien.
VICTOIRE.
Je m'en vais le dire.
LA COMTESSE.
Attendez.--La liste d'hier.
VICTOIRE.
Mais, madame a laissé entrer tout le monde.
LA COMTESSE.
Vous croyez?
VICTOIRE.
J'en suis sűre.
LA COMTESSE.
Eh bien! en ce cas-lŕ, tout le monde.
VICTOIRE.
Madame aura-t-elle besoin de moi?
LA COMTESSE.
Non, non.--Cependant ne vous éloignez pas... Qu'on m'avertisse quand
mes étoffes viendront.
SCČNE V
LE MARQUIS, LA COMTESSE.
LE MARQUIS.
Vous faites des emplettes?
LA COMTESSE.
Oui, pour cet hiver.
LE MARQUIS.
Vous aimez beaucoup le monde, madame.
LA COMTESSE.
Sans doute, je ne connais que cela. Vous savez comme mon mari m'a
rendue malheureuse pendant trois ans qu'il m'a tenue enfermée avec
lui, dans une de ses terres.
LE MARQUIS.
Dans une de ses terres?
LA COMTESSE.
Oui, vraiment, excepté ce voyage que nous avons fait sur les bords du
Rhin.
LE MARQUIS.
Sur les bords du Rhin?
LA COMTESSE.
Oui.
LE MARQUIS.
Est-ce un beau pays?
LA COMTESSE.
Je ne peux pas trop vous dire, je ne m'y connais pas. On se donne
beaucoup de fatigue pour visiter toutes sortes d'endroits, et je ne
vois pas la différence. C'est une faculté qui m'est refusée. On me
montre des châteaux, des bois, des rivičres, des églises surtout...
Ah, Dieu! les églises, les églises gothiques, il y fait un froid!
c'est un rhume de tous les jours. Je me souviens encore de mes
réveils, quand j'étais le matin dans un lit bien chaud, brisée par un
voyage en poste, et que M. de Vernon entrait dans ma chambre avec la
perspective d'une cathédrale!
LE MARQUIS.
Oui, cela doit ętre fort pénible.
LA COMTESSE.
Ŕ se faire Turc pour rester chez soi. Et notez bien que ce n'était pas
assez d'essuyer des caveaux humides, de se tordre le cou pour voir des
rosaces. Le triomphe de mon mari était de monter dans les flčches, et
l'on me hissait aprčs lui. Connaissez-vous ce travail-lŕ? On grimpe en
rond autour d'un pilier, dans une tourelle qui vous suffoque, et l'on
s'en va montant et tournant toujours, comme avec un tire-bouchon dans
la tęte, jusqu'ŕ ce que le mal de mer vous prenne, et qu'on ferme les
yeux pour ne pas tomber. C'est alors que votre cornac tire de sa poche
une lorgnette pour vous faire admirer le pays. Voilŕ comme j'ai vu
l'Allemagne.
LE MARQUIS.
C'est pourtant cette route-lŕ, sans doute, que nous allons prendre
avec le baron.
LA COMTESSE.
Est-ce qu'il est ici, le baron?
LE MARQUIS.
Oui, madame, il vient d'arriver. Il est venu de Paris ce matin, par ce
grand orage;--c'est lŕ ce qui a dérangé le temps, sűrement.
LA COMTESSE, _riant_.
L'arrivée du baron! ah! vous ętes délicieux!
LE MARQUIS.
Comment! ne parliez-vous pas de lui?
LA COMTESSE, _riant_.
Si fait, si fait, c'est ŕ merveille.
LE MARQUIS.
Je le croyais. Je me trompe quelquefois, et c'est insupportable.
LA COMTESSE.
Non, non.--Je vous trouve charmant comme cela.
_Elle cherche quelque chose._
LE MARQUIS.
Qu'est-ce que vous voulez? Du tabac? j'en ai de fort bon.
_Il ouvre sa tabatičre._
Ah! j'oubliais bien!
LA COMTESSE.
Quoi?
LE MARQUIS.
Vous voyez ce papier-lŕ. Devinez.
LA COMTESSE.
Je ne sais pas deviner, dites-moi tout de suite.
LE MARQUIS.
C'est que si vous voulez vous remarier...
LA COMTESSE, _cherchant sur son piano_.
Eh bien?
LE MARQUIS.
Qu'est-ce que vous cherchez encore?
LA COMTESSE, _cherchant_.
Parlez, parlez toujours.
LE MARQUIS.
Vous seriez la plus heureuse femme du monde avec moi.
LA COMTESSE, _cherchant toujours_.
Avec vous?
LE MARQUIS.
Oh! sűrement.
LA COMTESSE.
Je ne le trouve pas; c'est inconcevable.
LE MARQUIS.
Qu'est-ce que vous cherchez donc lŕ?
LA COMTESSE.
Un papier que j'avais tout ŕ l'heure.
LE MARQUIS.
Est-ce une chose de conséquence?
LA COMTESSE.
Oui et non, c'est une chanson.
LE MARQUIS.
J'en ai un recueil; si vous voulez, je vous le pręterai. Il est trčs
complet depuis 1650.
LA COMTESSE.
C'était une chanson, nouvelle.
LE MARQUIS.
Il y en a beaucoup dedans.
LA COMTESSE.
Des chansons nouvelles?
LE MARQUIS.
Oui, pour ce temps-lŕ.
LA COMTESSE, _riant_.
De 1650! ah! ah! ah! vous ętes toujours le męme.
LE MARQUIS.
Oui, je suis constant. Cela ne réussit pas toujours, comme vous savez,
avec les femmes.
LA COMTESSE.
Est-ce que vous avez ŕ vous plaindre des femmes?
LE MARQUIS.
Ah! si vous vouliez ętre la mienne!... Voici une visite.
LA COMTESSE.
Eh! c'est votre domestique.
SCČNE VI
LA COMTESSE, LE MARQUIS, GERMAIN.
GERMAIN.
Pardon, madame, c'est un papier que j'apporte ŕ monsieur le marquis,
de la part de monsieur le baron.
LE MARQUIS.
Eh, morbleu! il s'agit bien... Ah! ah! madame, c'est assez singulier;
c'est une romance. Est-ce celle que vous cherchiez?
LA COMTESSE.
Voyons; mais il me semble que oui. Vous me l'aviez volée apparemment.
_Elle se met au piano et joue._
GERMAIN, _ŕ part_.
Justement, c'est celle de la malle.
_Au marquis._
Monsieur, monsieur le baron m'a dit de vous demander...
LE MARQUIS.
Quoi? qu'est-ce que c'est.
GERMAIN.
Si vous songiez ŕ vos affaires.
LE MARQUIS.
Eh! oui, tu viens nous déranger...
GERMAIN.
C'est que monsieur le baron tout ŕ l'heure a reçu un exprčs de
Fontainebleau, et cela l'inquičte beaucoup. Il est retourné encore
chez M. Duplessis; il paraissait tout bouleversé.
LE MARQUIS.
En vérité?
GERMAIN.
Oui, et je vous ai apporté cette musique, afin d'avoir une raison
d'entrer et afin de pouvoir vous dire en męme temps qu'il faut une
réponse sur-le-champ.
LE MARQUIS _réfléchit_.
Tu as bien fait. Mais il me semble... Ce n'est pas cela, madame, ce
n'est pas cela, vous vous trompez.
_Il va au piano._
LA COMTESSE.
Mais j'y vois clair apparemment. Tenez...
_Elle joue._
GERMAIN.
Il ne me semble pas qu'ils parlent beaucoup d'affaires. Monsieur le
baron m'a dit de saisir au vol quelques mots de leur entretien.
_Il se retire lentement._
LA COMTESSE.
Vous voyez bien que c'est écrit ainsi.
LE MARQUIS.
Oui, pour la musique. Mais les paroles...
LA COMTESSE.
Les paroles, je ne les sais pas.
LE MARQUIS.
Comment! elles sont de...
_Il chante._
Fanny, l'heureux mortel qui prčs de toi respire...
GERMAIN, _prčs de la porte_.
Cela ne prend pas le chemin de Gotha.
LE MARQUIS.
J'ai oublié le reste; c'est singulier.
LA COMTESSE.
Trčs singulier, avec votre mémoire!
LE MARQUIS.
Oui, ordinairement je retiens tout ce que je veux.
SCČNE VII
LA COMTESSE, LE MARQUIS, GERMAIN, VICTOIRE.
VICTOIRE.
Voilŕ vos étoffes, madame.
LA COMTESSE.
C'est bon.
LE MARQUIS.
On vous demande? je ne veux pas vous retenir plus longtemps.
LA COMTESSE.
Ne venez-vous pas avec moi? vous me donnerez votre avis.
LE MARQUIS.
Non, je ne sortirai pas aujourd'hui. J'attends quelqu'un ŕ qui j'ai ŕ
parler.
LA COMTESSE.
Ici? chez moi?
LE MARQUIS.
Oui;--et ŕ propos.--C'est vous.
LA COMTESSE.
Moi?
LE MARQUIS.
Oui, mais ne vous l'ai-je pas dit?
LA COMTESSE.
Quoi?
LE MARQUIS.
Que j'avais la plus grande envie de vous épouser.
LA COMTESSE.
Je ne sais pas quand.
LE MARQUIS.
Tout ŕ l'heure. Je ne suis venu ici que pour cela.
LA COMTESSE.
Je ne m'en souviens pas.
LE MARQUIS.
Mais ŕ quoi donc pensez-vous? vos distractions, vraiment, ne sont pas
concevables. Il me semble pourtant...
LA COMTESSE.
Dites.
LE MARQUIS.
Que je vous ai parlé de mon voyage.
LA COMTESSE.
Quel voyage?
LE MARQUIS.
En Allemagne.
LA COMTESSE.
Hé! non, c'est moi qui vous ai parlé du mien.
LE MARQUIS.
Comment du vôtre?
LA COMTESSE.
Oui, de ce voyage aux bords du Rhin, que j'ai fait avec mon mari.
LE MARQUIS.
Je vous demande pardon, je vous assure...
LA COMTESSE.
Vous extravaguez; venez voir mes étoffes. Je vous donnerai mon volume
de je ne sais plus qui, et vous trouverez la fin de notre romance.
LE MARQUIS, _s'en allant_.
Mais c'est moi...
LA COMTESSE, _de męme_.
Je vous dis que c'est moi...
SCČNE VIII
GERMAIN, VICTOIRE.
GERMAIN.
Mam'selle Victoire, que dites-vous de cela? Vous savez que monsieur
aime madame.
VICTOIRE.
Et je sais que madame aime monsieur.
GERMAIN.
Et que monsieur veut épouser madame.
VICTOIRE.
Et que madame ne demande pas mieux.
GERMAIN.
En ętes-vous sűre?
VICTOIRE.
Parfaitement.
GERMAIN.
Mais vous ne savez peut-ętre pas que nous allons en ambassade.
VICTOIRE.
Oů?
GERMAIN.
Ŕ Gotha. Il paraît, d'aprčs ce qu'on m'a dit, que la duchesse est
accouchée, et nous allons lui faire compliment de la part de Sa
Majesté.
VICTOIRE.
Qu'est-ce que cela signifie?
GERMAIN.
Cela signifie que mon maître veut que la comtesse dise oui ou non
avant ce départ, afin d'en avoir la conscience nette; que nous partons
demain matin avec le baron, qu'il ne faudrait qu'un mot pour arranger
tout, et qu'au lieu de le dire, ils chantent.
VICTOIRE.
Il a pourtant parlé mariage et voyage.
GERMAIN.
Et elle lui a répondu chanson.
VICTOIRE.
Pourquoi votre baron ne vient-il pas au secours?
GERMAIN.
Par crainte de tout gâter, parce qu'il est brouillé, ŕ ce qu'il croit,
avec votre maîtresse.
VICTOIRE.
Monsieur Germain.
GERMAIN.
Mam'selle Victoire.
VICTOIRE.
Nos maîtres sont de grands enfants; il faut arranger cette affaire-lŕ.
Vous venez d'apporter un papier; n'est-ce pas cela qu'ils chantaient?
GERMAIN.
Oui, le voici.
VICTOIRE.
Donnez-le moi, et maintenant...
_Elle écrit sur la romance._
GERMAIN.
Qu'est-ce que vous écrivez lŕ-dessus?
VICTOIRE.
Ne vous mettez pas en peine. Posons cela sur le piano.
GERMAIN, _lisant_.
Mais s'ils se fâchent?
VICTOIRE.
Est-ce que cela se peut? Elle ręve de lui en plein jour. Ŕ plus forte
raison...
GERMAIN.
Les voici qui viennent; sauvons-nous.
VICTOIRE.
Et écoutons.
SCČNE IX
LA COMTESSE, LE MARQUIS.
LA COMTESSE.
Vous n'aimez pas ce pou-de-soie rose?
LE MARQUIS, _un livre ŕ la main_.
Non, ce n'est pas ce que je choisirais.
_Lisant._
Fanny, l'heureux mortel qui prčs de toi respire...
LA COMTESSE.
Vous voilŕ bien content. Avec votre livre en main, vous ętes bien sűr
de votre mémoire.
LE MARQUIS.
Oh, mon Dieu! je n'avais que faire du livre, et cela me serait revenu
tout de suite.
_Lisant._
Fanny, l'heureux mortel qui prčs de toi respire
Sait, ŕ te voir parler, et rougir, et sourire,
De quels hôtes divins le ciel est habité.
LA COMTESSE.
Vous y mettez une expression!...
LE MARQUIS.
Il n'est pas difficile, madame, d'exprimer ce qu'on sent du fond du
coeur, et ces vers ne semblent-ils pas faits tout exprčs pour qu'on
vous les dise?
Fanny, l'heureux mortel...
LA COMTESSE.
Vous vous divertissez, je crois.
LE MARQUIS.
Non, je vous le jure sur mon âme, et par tout ce qu'il y a de plus
sacré au monde, je... je trouve ces vers-lŕ charmants.
LA COMTESSE.
Eh bien! venez les chanter, je vous accompagnerai.
_Elle s'assied au piano._
LE MARQUIS, _prčs d'elle_.
Vous verrez que je me passerai de livre... Ŕ quoi pensez-vous donc,
madame?
LA COMTESSE.
Ŕ ce pou-de-soie rose. Vous ne l'aimez pas?
LE MARQUIS.
Non, j'aime mieux ce taffetas feuille-morte.
LA COMTESSE.
C'est une étoffe trop âgée.
LE MARQUIS.
Elle m'a paru toute neuve.
LA COMTESSE.
Laissez donc! Il y a de ces choses qui sont toujours de l'an passé.
LE MARQUIS.
Que c'est bien femme, ce que vous dites lŕ!
LA COMTESSE.
Comment, bien femme? Que voulez-vous dire?
LE MARQUIS.
Eh! mon Dieu, oui. Toujours du nouveau,--voilŕ ce qu'il vous faut, ŕ
vous autres.
LA COMTESSE.
Ŕ vous autres! Vous ętes poli.
LE MARQUIS.
Hors le moment présent, vous ne connaissez rien. Vous ne vous souciez
plus des choses de la veille, et celles du lendemain, vous n'y songez
pas. Je vous réponds bien que, si j'étais marié, ma femme n'aurait pas
tant de fantaisies.
LA COMTESSE.
Vous lui feriez porter une robe feuille-morte?
LE MARQUIS.
Feuille-morte, soit, si c'était mon goűt.
LA COMTESSE.
Elle s'en moquerait, et ne la porterait pas.
LE MARQUIS.
Elle la porterait toute sa vie, madame, si elle m'aimait
véritablement.
LA COMTESSE.
Eh bien! ŕ ce compte-lŕ, vous resterez garçon.
LE MARQUIS.
Parlez-vous sérieusement, madame?
LA COMTESSE.
Oui, je vous conseille de renoncer ŕ trouver une victime de bonne
volonté.
LE MARQUIS.
O ciel! mais c'est ma mort que vous m'annoncez lŕ!
LA COMTESSE.
Comment, votre mort?
LE MARQUIS.
Assurément. Je ne suis pas comme vous, moi, madame. Il ne faut pas
me dire deux fois les choses. Oh! je craignais cette cruelle parole,
mais, en la prévoyant, je ne l'entendais pas. Elle me désespčre, elle
m'accable,... au nom du ciel! ne la répétez pas.
LA COMTESSE.
Mais, bon Dieu! quelle mouche vous pique?
LE MARQUIS.
Croyez-vous donc que je puisse rester au monde loin de vous, loin
de tout ce qui m'est cher? La vie me serait insupportable. Riez-en,
madame, tant qu'il vous plaira. Je sais bien que vous me direz qu'un
voyage ŕ la hâte est toujours fâcheux; que, si j'ai mes projets,
vous avez les vôtres; que sais-je?--Vous trouverez cent raisons, cent
obstacles,... mais en est-il un seul, en voit-on quand on aime? Est-ce
votre procčs qui vous retient? mais je vous ai dit qu'il était gagné.
Je suis allé vingt fois chez votre avoué. Il demeure un peu loin, mais
qu'importe? Ce n'est pas lŕ ce qui vous occupe;--non, madame, vous ne
m'aimez pas.
LA COMTESSE.
Je vous demande bien pardon; mais quel galimatias me faites-vous lŕ?
LE MARQUIS.
Je ne dis que l'exacte vérité; mais, puisque vous ne voulez pas
l'entendre, je me retire. Adieu, madame.
LA COMTESSE.
Savez-vous une chose, marquis? c'est que les distractions ne plaisent
qu'ŕ la condition d'ętre plaisantes. Quand vous prenez le chapeau
du voisin, ou quand vous appelez le curé «mademoiselle», personne
ne songe ŕ s'en fâcher; mais il ne faut pas que cela vous encourage
jusqu'ŕ perdre tout ŕ fait le sens, et ŕ parler, pour une robe
feuille-morte, comme un homme qui va se noyer; car vous comprenez que,
dans ce cas-lŕ, notre part ŕ nous, qui vous voyons faire, ce n'est
plus de la gaieté, c'est de la patience, et il n'est jamais bon
d'avoir affaire ŕ elle; c'est l'ennemie mortelle des femmes.
LE MARQUIS.
Cela veut dire que je vous importune. Raison de plus pour m'éloigner
de vous.
LA COMTESSE.
En vérité, vous perdez l'esprit.
LE MARQUIS.
De mieux en mieux.--Que je suis malheureux!
LA COMTESSE.
Vous ne soupez pas avec moi?
LE MARQUIS.
Non, je m'en vais.--Adieu, madame.
_Il s'assied dans un coin._
LA COMTESSE.
Ma foi, faites ce que vous voudrez, vous ętes intolérable et
incompréhensible. Tenez, laissez-moi ŕ ma musique. Qu'est-ce que c'est
que cela?
_Elle se retourne vers le piano, et lit tout bas ce qu'il y a sur la
romance._
LE MARQUIS, assis.
Elle que j'aimais si tendrement! faut-il que j'aie pu lui déplaire!
qu'ai-je donc fait qui l'ait offensée? Quoi! je viens ici, le coeur
tout plein d'elle, mettre ŕ ses pieds ma vie entičre; je lui fais en
toute confiance l'aveu sincčre de mon amour; je lui demande sa main le
plus clairement et le plus honnętement du monde, et elle me repousse
avec cette dureté! C'est une chose inconcevable; plus j'y réfléchis,
moins je le comprends.
_Il se lčve et se promčne ŕ grands pas sans voir la comtesse._
Il faut sans doute que j'aie commis ŕ mon insu quelque faute
impardonnable.
LA COMTESSE, _lui présentant le papier quand il passe devant elle_.
Tenez, Valberg, lisez donc cela.
LE MARQUIS, _de męme_.
Impardonnable? ce n'est pas possible. Quand je la reverrai, elle me
pardonnera. Allons, Germain, je veux sortir. Oui, sans doute, il faut
que je la revoie. Elle est si bonne, si indulgente! et si gracieuse et
si belle! pas une femme ne lui est comparable.
LA COMTESSE, _ŕ part_.
Je laisse passer cette distraction-lŕ.
LE MARQUIS, _de męme_.
Il est bien vrai qu'elle est coquette en diable, et paresseuse... ŕ
faire pitié! Son étourderie continuelle...
LA COMTESSE, _présentant le papier_.
Le portrait se gâte... Monsieur de Valberg!
LE MARQUIS, _de męme_.
Son étourderie continuelle pourrait-elle véritablement convenir ŕ
un homme raisonnable? Aurait-elle ce calme, cette présence d'esprit,
cette égalité de caractčre nécessaires dans un ménage?--J'aurais fort
ŕ faire avec cette femme-lŕ.
LA COMTESSE.
Ceci mérite d'ętre écouté.
LE MARQUIS.
Mais elle est si bonne musicienne!--Germain!--Ah! que nous serions
heureux, seuls, dans quelque retraite paisible, avec quelques amis,
avec tout ce qu'elle aime, car je serais sűr de l'aimer aussi.
LA COMTESSE.
Ŕ la bonne heure.
LE MARQUIS.
Mais non, elle aime le monde, les fętes!--Germain!--Eh bien! Je
ne serais pas jaloux. Qui pourrait l'ętre d'une pareille
femme?--Germain!--Je la laisserais faire; j'aimerais pour elle ces
plaisirs qui m'ennuient; je mettrais mon orgueil ŕ la voir admirée;
je me fierais ŕ elle comme ŕ moi-męme, et si jamais elle me
trahissait...--Germain!--je lui plongerais un poignard dans le
coeur.
LA COMTESSE, _lui prenant la main_.
Oh! que non, monsieur de Valberg.
LE MARQUIS.
C'est vous, comtesse! grand Dieu! je ne croyais pas...
LA COMTESSE.
Avant de me tuer, lisez cela.
LE MARQUIS.
Qu'est-ce que c'est donc?
_Il lit:_
«Monsieur le marquis est prié de vouloir bien se souvenir d'épouser
madame la comtesse avant de partir pour l'Allemagne.»
Eh bien! madame, vous voyez bien que c'était moi, et non pas vous, qui
avais parlé de ce voyage-lŕ.
LA COMTESSE.
Mais c'est donc réel, ce départ?
LE MARQUIS.
Vous le demandez! voilŕ deux heures que je me tue ŕ vous le répéter.
LA COMTESSE.
Vous aurez pris ma femme de chambre pour moi, car ces trois lignes
sont de son écriture.
LE MARQUIS.
Vraiment? elle n'écrit pas trop mal.
LA COMTESSE.
Non, mais elle écrit des impertinences.
LE MARQUIS.
Point du tout, c'était ma pensée.
LA COMTESSE.
Mais qu'allez-vous faire en Allemagne?
LE MARQUIS.
Des compliments, de la part du roi, ŕ la grande-duchesse.
LA COMTESSE.
Et quand partez-vous?
LE MARQUIS.
Demain matin.
LA COMTESSE.
Vous vouliez donc m'épouser en poste?
LE MARQUIS.
Justement, je voulais vous emmener. Ce serait le plus délicieux
voyage!
LA COMTESSE.
Un enlčvement?
LE MARQUIS.
Oui, dans les formes.
LA COMTESSE.
Elles seraient jolies.
LE MARQUIS.
Certainement, nous publierions nos bans...
LA COMTESSE.
Ŕ chaque relais, n'est-il pas vrai? Et les témoins?
LE MARQUIS.
Nous avons mon oncle.
LA COMTESSE.
Et nos parents?
LE MARQUIS.
Ils ne demandent pas mieux.
LA COMTESSE.
Et le monde?
LE MARQUIS.
Que pourrait-on dire? Nous sommes d'honnętes gens, je suppose. Parce
que nous montons dans une chaise de poste, on ne va pas nous prendre
tout ŕ coup pour des banqueroutiers.
LA COMTESSE.
Votre projet est si absurde, si extravagant, qu'il m'amuse.
LE MARQUIS.
Suivons-le, il sera tout simple.
LA COMTESSE.
J'en suis presque tentée.
LE MARQUIS.
J'en suis enchanté. Holŕ! Germain!
_Entre Germain._
GERMAIN.
Vous avez appelé, monsieur?
_Ŕ part._
Je crois que le danger est passé.
LE MARQUIS.
Va vite chercher cette grande malle, qui est lŕ-bas au milieu de la
chambre, et apporte-la tout de suite.
GERMAIN.
Ici, monsieur?
LE MARQUIS.
Oui; dépęche-toi.
_Germain sort._
LA COMTESSE, _riant_.
Ah, mon Dieu! mais quelle folie! vous envoyez prendre votre malle?
LE MARQUIS.
Oui, il faut faire nos paquets sur-le-champ, parce que, voyez-vous,
quand on a une bonne idée, il faut s'y tenir; je ne connais que cela.
LA COMTESSE.
Un instant, marquis; avant de s'embarquer, bride abattue, pour les
Grandes-Indes, il faut prendre son passe-port. Ętes-vous bien-sűr
que je sois douée de toutes les qualités requises pour faire
convenablement votre ménage dans quelqu'un de ces grands châteaux que
vous possédez en Espagne?
LE MARQUIS.
En Espagne? Je ne vous comprends pas.
LA COMTESSE.
Ai-je bien ce calme, cette présence d'esprit, cette égalité de
caractčre, si nécessaires dans une maison, surtout quand le maître en
donne l'exemple?
LE MARQUIS.
Vous vous moquez. Est-il donc besoin que je vous répčte ce que sait
tout le monde, qu'on voit en vous toutes les qualités, comme tous les
talents et toutes les grâces?
LA COMTESSE.
Mais vous oubliez que je suis coquette, paresseuse ŕ faire pitié, et
étourdie, surtout étourdie...
LE MARQUIS.
Qui a jamais dit cela, madame?
LA COMTESSE.
Un de mes amis.
LE MARQUIS.
Un impertinent.
LA COMTESSE.
Pas toujours. C'est un original qui fait des portraits devant son
miroir et qui les peint ŕ son image. Devinez-le. C'est un diplomate
qui est assez bon musicien; un počte connaisseur en étoffes; un
chasseur trčs dangereux pour la haie du voisin, trčs redoutable au
whist pour son partenaire; un homme d'esprit qui dit des bętises; un
fort galant homme qui en fait quelquefois; enfin, c'est un amant plein
de délicatesse qui, pour gagner le coeur d'une femme, lui adresse
des compliments par usage, et des injures par distraction.
LE MARQUIS.
Si j'ai commis celle-lŕ, madame, ce sera la derničre de ma vie, et
vous verrez si dans ce voyage...
LA COMTESSE.
Mais ce voyage, est-ce que j'y consens?
LE MARQUIS.
Vous avez dit oui.
LA COMTESSE.
J'ai dit presque oui. Entre ces deux mots-lŕ il y a tout un monde.
LE MARQUIS.
Consentez donc, madame, et ce portrait que vous venez de faire, ce
portrait ne sera plus le mien. Oui, s'il est ressemblant aujourd'hui,
c'est grâce ŕ vous, je le proteste. C'est le doute, la crainte,
l'espérance, l'inquiétude oů j'étais sans cesse, qui m'empęchaient
de voir et d'entendre, de comprendre ce qui n'était pas vous. Ne me
faites pas l'injure de croire que j'aurais perdu la raison si je vous
avais moins aimée; je l'avais laissée dans vos yeux; il ne vous faut
qu'un mot pour me la rendre.
LA COMTESSE.
Ce que vous dites lŕ me donne une idée plaisante, c'est qu'il pourrait
se faire que, sans nous en douter, nous nous fussions volé notre
raison l'un ŕ l'autre. Vous ętes distrait, dites-vous, pour l'amour
de moi; peut-ętre suis-je étourdie par amitié pour vous. Dites donc,
marquis, si nous essayions de réparer mutuellement le dommage que nous
nous sommes fait? Puisque j'ai pris votre bon sens et vous le mien, si
nous nous conduisions tous deux d'aprčs nos conseils réciproques? Ce
serait peut-ętre un moyen excellent de parvenir ŕ une grande sagesse.
LE MARQUIS.
Je ne demande pas mieux que de vous obéir.
LA COMTESSE.
Il ne s'agit pas de cela, mais d'un simple échange. Par exemple, je
suis paresseuse, vous me l'avez dit...
LE MARQUIS.
Mais, madame...
LA COMTESSE.
Vous me l'avez dit, et j'en conviens. Vous, au contraire, vous remuez
toujours; vous revenez de la chasse quand je me lčve; vous avez
sans cesse les doigts tachés d'encre, et c'est pour moi un chagrin
d'écrire. Pour la lecture, c'est tout de męme; vous dévorez jusqu'ŕ
des tragédies avec un appétit féroce, pendant que je dors ŕ leur doux
murmure. Dans le monde, vous ne savez que faire, ŕ moins que ce ne
soit, comme M. de Brancas, d'accrocher votre perruque ŕ un lustre;
vous ne dites mot, ou vous parlez tout seul, sans vous soucier de
ce qui vous entoure; moi, je l'avoue, j'aime la causerie, j'irais
volontiers jusqu'au bavardage si tant de gens ne s'en męlaient pas, et
pendant que vous ętes dans un coin, boudant d'un air sauvage, le
bruit m'amuse, m'entraîne, un bal m'éblouit. Est-ce qu'avec toutes ces
disparates on ne pourrait pas faire un tableau? Trouvons un cadre oů
nous pourrions mettre, vous, votre feuille morte, moi, ma couleur de
rose, nos qualités par-dessus nos défauts; oů nous serions, ŕ tour
de rôle, tantôt le chien, tantôt l'aveugle. Ne serait-ce pas un
bel exemple ŕ donner au monde, qu'un homme ayant assez d'amour pour
renoncer ŕ dire: Je veux, et une femme, sacrifiant plus encore, le
plaisir de dire: Si je voulais?
LE MARQUIS.
Vous me ravissez, vous me transportez. Ah! madame, si vous me jugiez
digne de vous confier ma vie entičre, je mourrais de joie ŕ vos pieds.
LA COMTESSE.
Non pas; oů seraient mes profits?
_Entre Germain avec la malle._
GERMAIN, _entrant_.
Voilŕ votre malle, monsieur le marquis.
LE MARQUIS.
Et mon oncle?
GERMAIN.
Il n'est pas revenu de chez M. Duplessis.
LE MARQUIS.
Eh bien! madame?
LA COMTESSE.
Eh bien!... essayons.
LE MARQUIS.
Vite, Germain, François, Victoire, apportez tout ce qu'il y a ici.
LA COMTESSE.
C'est lŕ votre maničre de me remercier?
LE MARQUIS.
Hé! madame, j'aurai bien le temps.
LA COMTESSE.
Comment, bien le temps? c'est honnęte.
LE MARQUIS.
Certainement, puisqu'ŕ compter de ce jour je ne veux plus faire autre
chose pendant tout le reste de ma vie.
_Entre Victoire._
VICTOIRE.
Madame a besoin de moi?
LA COMTESSE.
C'est donc vous, mademoiselle Victoire, qui vous ętes permis tantôt...
LE MARQUIS.
Ne la grondez pas. Si j'avais maintenant le diamant de Buckingham, au
lieu de le jeter par la fenętre, je le lui mettrais dans sa poche.
_Il y met une bourse._
LA COMTESSE.
Est-ce lŕ cet homme si raisonnable!
LE MARQUIS.
Ah! madame, grâce pour aujourd'hui. Plaçons d'abord ici toute votre
musique.
LA COMTESSE.
Voilŕ un bon commencement.
LE MARQUIS, _arrangeant la musique_.
On l'aime beaucoup en Allemagne. Nous trouverons des connaisseurs
lŕ-bas. Je me fais une fęte de vous voir chanter devant eux.
_Il chante._
Fanny, l'heureux mortel...
Ils vous adoreront, ces braves gens.--Germain!
GERMAIN.
Monsieur?
LE MARQUIS.
Va me chercher mon violon.
_Germain sort._
LA COMTESSE.
N'oubliez pas cette romance, au moins.
LE MARQUIS.
Elle me rappellera le plus beau jour de ma vie.
LA COMTESSE.
Et ma robe feuille-morte? Victoire!
VICTOIRE.
Oui, madame.
_Elle apporte la robe, Germain le violon un peu plus tard._
LE MARQUIS.
Vous voulez la prendre?
GERMAIN.
Puisque c'est une de vos conditions.
LE MARQUIS.
Ah! grand Dieu! elle est cause que j'ai pu vous déplaire! Apportez-en
d'autres, mademoiselle.
_Il la jette sur un meuble._
LA COMTESSE.
Savez-vous ce qu'il faut faire? Emportons trčs peu de choses, rien que
le plus important; nous ferons toutes sortes d'emplettes dans le pays.
LE MARQUIS.
C'est cela męme.--Germain!
GERMAIN.
Monsieur?
LE MARQUIS.
Mon fusil et mon cor de chasse; oui, nous achčterons le reste ŕ Gotha.
LA COMTESSE.
Comment, ŕ Gotha?
LE MARQUIS.
Eh! oui, c'est lŕ que nous allons.
LA COMTESSE.
Ah! tenez, prenez ce petit coffre.
LE MARQUIS.
Qu'y a-t-il dedans, des papiers de famille?
_Regardant._
Non, c'est du thé; mais on en trouve partout.
LA COMTESSE.
Oh! je ne peux pas en prendre d'autre.
LE MARQUIS.
Que d'heureux jours nous allons passer!
LA COMTESSE.
Nous achčterons lŕ-bas des costumes allemands; ce sera ravissant pour
un bal masqué.
LE MARQUIS.
Madame, si nous prenions mon cadran solaire? Il va trčs bien.
LA COMTESSE.
Ętes-vous fou, Valberg? et vos belles promesses?
LE MARQUIS.
Vous avez raison; ma montre suffit.
_Il la met dans la malle._
LA COMTESSE.
Songez qu'il faut veiller sur vous, maintenant que vous voilŕ
diplomate.
LE MARQUIS.
Oh! ne craignez rien, j'ai fait mes preuves.
_Il prend divers objets au hasard dans la chambre et les met dans la
malle. Tout en parlant, il y met aussi son portefeuille, ses gants,
son mouchoir et son chapeau._
J'ai déjŕ été en Danemark et je m'en suis trčs bien tiré. Mon oncle,
qui se croit un génie, voulait me faire la leçon, mais il n'a pas la
tęte parfaitement saine; entre nous, il radote un peu!
_Fermant la malle._
LA COMTESSE.
Le voici.
SCČNE X
LA COMTESSE, LE MARQUIS, LE BARON, GERMAIN, VICTOIRE.
LE BARON.
Madame, je vous demande pardon d'entrer ainsi ŕ l'improviste sans en
demander la permission; mais une circonstance imprévue...
LA COMTESSE.
Vous me faites grand plaisir, monsieur.
LE MARQUIS.
Oh! mon cher oncle, embrassez-moi. Il faut aussi que vous embrassiez
madame. Tout est fini, tout est oublié!... Je veux dire tout est
convenu. Vous devez comprendre mon bonheur.
LE BARON.
Hélas! mon neveu, tout est perdu. La grande-duchesse de Gotha est
morte.
LE MARQUIS.
C'est malheureux, nos paquets étaient faits.
LE BARON.
C'est chez M. Duplessis, tout ŕ l'heure, que je viens d'apprendre
cette affreuse nouvelle.
LA COMTESSE.
Comment, Valberg, nous ne partons pas? Moi qui n'avais pas d'autre
idée.
LE MARQUIS.
Juste ciel! m'abandonnez-vous?
LA COMTESSE.
Non, mais emmenez-moi quelque part.
LE MARQUIS.
En Italie, madame, en Turquie, en Norwčge, si vous voulez.
LE BARON.
Qui est-ce qui se serait jamais attendu ŕ cette épouvantable
catastrophe! toutes mes dispositions étaient prises, j'avais les
lettres royales, les cadeaux ŕ donner, j'avais tout préparé, tout
prévu; il faut que la seule chance ŕ laquelle on n'eűt pas songé!...
LE MARQUIS.
Hé! oui, c'est ce que dit le proverbe: On ne saurait penser ŕ tout.
FIN DE ON NE SAURAIT PENSER Ŕ TOUT.
Ce petit proverbe, dans le genre de ceux de Carmontelle, fut composé
pour une matinée de musique et de récits donnée, au printemps de 1849,
dans la salle de concerts de M. Pleyel, au bénéfice d'un artiste.
Madame Viardot, mademoiselle Rachel, madame Allan-Despréaux et
plusieurs autres sociétaires de la Comédie-Française prętaient le
concours de leurs talents ŕ cette bonne oeuvre. Devant un public
d'élite et dans cette petite salle, le proverbe obtint un grand
succčs. Transporté, peu de jours aprčs, au Théâtre-Français, il y
produisit peu d'effet; mais le but que l'auteur s'était proposé se
trouvait atteint.
* * * * *
BETTINE
COMÉDIE EN UN ACTE
1851
PERSONNAGES ACTEURS
QUI ONT CRÉÉ LES
RÔLES
LE MARQUIS STÉFANI. MM. GEFFROY.
LE BARON DE STEINBERG. LAFONTAINE.
CALABRE, _valet de chambre du baron_. PERRIN.
LE NOTAIRE. LESUEUR.
UN DOMESTIQUE. BORDIER.
BETTINE, _cantatrice italienne_. Mme ROSE CHÉRI.
_La scčne est en Italie._
SCČNE PREMIČRE
_Un salon de campagne._
CALABRE, LE NOTAIRE.
CALABRE.
Venez par ici, monsieur le notaire; venez, monsieur Capsucefalo.
Veuillez entrer lŕ, dans le pavillon.
LE NOTAIRE.
Les futurs conjoints, oů sont-ils?
CALABRE.
Il faut que vous ayez la bonté d'attendre quelques instants, s'il
vous plaît. Désirez-vous vous rafraîchir? Il n'y a pas loin d'ici ŕ la
ville, mais il fait chaud.
LE NOTAIRE.
Oui, et je suis venu ŕ pied par un soleil bien incommode. Mais je ne
vois pas les futurs conjoints.
CALABRE.
Madame n'est pas encore levée.
LE NOTAIRE.
Comment! il est midi passé.
CALABRE.
Alors elle ne tardera gučre.
LE NOTAIRE.
Et M. de Steinberg, est-il levé, lui?
CALABRE.
Il est ŕ la chasse.
LE NOTAIRE.
Ŕ la chasse! Voilŕ, en vérité, une plaisante maničre de se marier. On
me fait dresser un contrat, on me fait venir ŕ une heure expresse,
et quand j'arrive, madame dort et monsieur court les champs. Vous
conviendrez, mon cher monsieur Calabre...
CALABRE.
C'est qu'il faut vous imaginer, mon cher monsieur Capsucefalo, que
nous ne vivons pas comme tout le monde. Madame est une artiste, vous
savez.
LE NOTAIRE.
Oui, une grande artiste; elle chante fort bien. Je ne l'ai jamais
entendue elle-męme, mais je l'ai ouď dire, vous comprenez.
CALABRE.
Justement, c'est qu'elle a chanté cette nuit jusqu'ŕ trois heures du
matin. Aimez-vous la musique, monsieur Capsucefalo?
LE NOTAIRE.
Certainement, monsieur Calabre, autant que mes fonctions me le
permettent. Il y avait donc chez vous grande soirée, beaucoup de
monde?
CALABRE.
Non, ils étaient tous deux tout seuls, madame et monsieur le baron, et
ils se sont donné ainsi un grand concert en tęte ŕ tęte. Ce n'est pas
la premičre fois. C'est une habitude que madame a prise depuis qu'elle
a quitté le théâtre. Elle ne peut pas dormir si elle n'a pas chanté.
Au point du jour, elle s'est couchée, et monsieur a pris son fusil.
LE NOTAIRE.
Vous en direz ce qu'il vous plaira, cela me paraît de l'extravagance.
La chasse et la musique sont deux fort bonnes choses; mais quand on se
marie, monsieur Calabre, on se marie. Et les témoins?
CALABRE.
Monsieur a dit qu'il les amčnerait. Un peu de patience. Que me
veut-on?
UN DOMESTIQUE, _entrant_.
Monsieur, c'est une lettre de la princesse.
CALABRE, _prenant la lettre_.
C'est bon. Vous savez bien que monsieur n'y est pas.
LE DOMESTIQUE.
Il y a lŕ un homme ŕ cheval.
CALABRE.
Qu'il attende. Ah! voici monsieur le baron.
SCČNE II
LES PRÉCÉDENTS, STEINBERG.
STEINBERG.
Pas encore levée! C'est bien de la paresse. Bonjour, Cefalo, vous ętes
exact, et moi aussi, comme vous voyez; mais la signora ne l'est gučre.
LE NOTAIRE.
Voici le contrat, monsieur le baron, dans ce portefeuille. Si vous
vouliez, en attendant, jeter un coup d'oeil...
STEINBERG.
Tout ŕ l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette lettre?
CALABRE.
C'est de la part de la princesse, monsieur.
STEINBERG, _ouvrant la lettre_.
Voyons.
LE NOTAIRE.
Je me retire, monsieur, j'attendrai vos ordres.
SCČNE III
STEINBERG, CALABRE.
CALABRE, _ŕ part_.
Si c'est encore quelque invitation, quelque partie de plaisir en
l'air, nous allons avoir un orage.
STEINBERG, _lisant_.
Qu'est-ce que tu marmottes entre tes dents?
CALABRE.
Moi, monsieur, je n'ai pas dit un mot.
STEINBERG.
Vous vous męlez de bien des choses, monsieur Calabre; vous vous
donnez des airs d'importance, sous prétexte de discrétion, qui ne me
conviennent pas du tout, je vous en avertis.
CALABRE.
Si la discrétion est un tort...
STEINBERG.
Assurément, lorsqu'elle est affectée, lorsqu'en se taisant, on laisse
croire qu'on pourrait avoir quelque chose ŕ dire.
CALABRE.
Hé! de quoi parlerais-je, monsieur? Est-ce ma faute si la
princesse?...
STEINBERG.
Eh bien! qu'est-ce? que voulez-vous dire? Toujours cette princesse!
Qu'est-ce donc? Nous habitons cette maison depuis un mois. La
princesse est notre voisine de campagne, et son palais est ŕ deux
pas de nous. Qu'y a-t-il d'étonnant, qu'y a-t-il d'étrange ŕ ce qu'il
existe entre nous des relations de bon voisinage et męme d'amitié, si
l'on veut? Nous ne sommes pas ici en France, oů l'on vit dix ans sur
le męme palier sans se saluer quand on se rencontre, ni en Angleterre,
oů l'on n'avertirait pas le voisin que sa bourse est tombée de sa
poche, si on ne lui est pas présenté dans les rčgles. Nous sommes
en Italie, oů les moeurs sont franches, libres, exemptes de cette
morgue inventée par l'orgueil timide ŕ la plus grande gloire de
l'ennui; nous sommes dans ce pays de liberté charmante, brave, honnęte
et hospitaličre, sous ce beau soleil oů l'ombre d'un homme, quoi
qu'on en dise, n'en a jamais gęné un autre, oů l'on se fait un ami en
demandant son chemin, oů enfin la mauvaise humeur est aussi inconnue
que le mauvais temps.
CALABRE.
Monsieur le baron prend bien chaudement les choses. Je demande pardon
ŕ monsieur, mais les réflexions d'un pauvre diable comme moi ne valent
pas la peine qu'on s'en occupe.
STEINBERG.
Quelles sont ces réflexions? Je veux le savoir. Dites votre pensée, je
le veux.
CALABRE.
Oh, mon Dieu! c'est bien peu de chose. Seulement, quand monsieur le
baron s'en va comme cela pour toute une journée chez la princesse, il
m'a semblé quelquefois que madame était triste.
STEINBERG.
Est-ce lŕ tout?
CALABRE.
Je n'en sais pas plus long, mais je vous avoue...
STEINBERG.
Quoi?
CALABRE.
Rien, monsieur, je n'ai rien ŕ dire.
STEINBERG.
Parlerez-vous, quand je l'ordonne?
CALABRE.
Eh bien! monsieur, ŕ vous dire vrai, cela me fait de la peine. Elle
vous aime tant!
STEINBERG.
Elle m'aime tant!
CALABRE.
Oh! oui, monsieur, presque autant que je vous aime. Si vous saviez,
quand vous n'ętes pas lŕ, que de questions elle me fait, et que de
petits cadeaux de temps en temps, pour tâcher de savoir ce que
vous dites, ce que vous pensez au fond du coeur, si vous l'aimez
toujours, si vous lui ętes fidčle... Vous m'accusez d'ętre bavard...
Eh bien! monsieur, demandez-lui comment je parle de mon maître, et si
jamais la moindre indiscrétion... Voilŕ pourquoi j'ose dire que cela
me fait de la peine, quand je sais qu'elle en a, oui, monsieur, et
quand elle pleure... Mais enfin, puisque vous allez l'épouser...
STEINBERG.
Calabre! mon pauvre vieux Calabre!
CALABRE.
Plaît-il, monsieur?
STEINBERG.
Ce mariage...
CALABRE.
Eh bien?
STEINBERG.
Eh bien! je sais que je suis engagé. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas
voulu me donner le temps de réfléchir, je me suis laissé entraîner,
ou, pour mieux dire, je me suis trompé moi-męme. J'ai cédé, je me suis
aveuglé, je me suis étourdi de ma passion pour elle.
CALABRE.
Pardonnez-moi encore, monsieur, mais...
STEINBERG, _se levant_.
Écoute-moi. Bettine est charmante; avec son talent, sa brillante
renommée, au milieu de tous les plaisirs, de toutes les séductions qui
entourent et assičgent une actrice ŕ la mode, elle a su vivre de telle
sorte que la calomnie elle-męme n'a jamais osé approcher d'elle, et
l'honnęteté de son coeur est aussi visible que la pure clarté de ses
yeux. Assurément, si rien ne s'y opposait, personne plus qu'elle ne
serait capable de faire le bonheur d'un mari; mais...
CALABRE.
Eh bien! monsieur, s'il en est ainsi,... pourquoi alors?...
STEINBERG.
Tu le demandes? Eh! sais-tu ce que c'est que d'épouser une cantatrice?
CALABRE.
Non, par moi-męme, je ne m'en doute pas. Il me semble pourtant...
STEINBERG.
Quoi?
CALABRE.
Que si monsieur épousait madame, il ne pourrait y avoir grand mal. Il
me semble qu'il y a bien des exemples... Elle est jeune et jolie; sa
réputation, comme vous le disiez, est excellente. Elle est riche,...
vous l'ętes aussi.
STEINBERG.
En es-tu sűr?
CALABRE.
Vous ętes si généreux!...
STEINBERG.
Preuve de plus que je ne suis pas riche! Je l'ai été, mais je ne le
suis plus.
CALABRE.
Est-il possible, monsieur?
STEINBERG.
Oui, Calabre. Quand je n'aimais que le plaisir, ce que m'ont coűté mes
folies, je ne le regrette pas, je n'en sais rien; mais depuis que j'ai
l'amour au coeur, c'est une ruine. Rien ne coűte si cher que les
femmes qui ne coűtent rien,--et par lŕ-dessus le lansquenet...
CALABRE.
Vous jouez donc toujours, monsieur?
STEINBERG.
Eh! pas plus tard qu'hier cela m'est arrivé.
CALABRE.
Chez la princesse? Et vous avez perdu...
STEINBERG.
Cinq cents louis. Ce n'est pas lŕ ce qui me ruine, je vais les payer
ce matin, et je compte bien prendre ma revanche; mais, je te le dis,
je suis ruiné, je n'ai plus le sou, je n'ai plus de quoi vivre.
CALABRE.
Si une pareille chose pouvait ętre vraie, et si monsieur le baron se
trouvait gęné, j'ai quelques petites économies...
STEINBERG.
Je te remercie, je n'en suis pas encore lŕ. Tu n'as pas compris ce que
je voulais dire. Ma fortune étant ŕ moitié perdue...
CALABRE.
Il me semble alors que ce serait le cas...
STEINBERG.
De me marier, n'est-il pas vrai? D'autres que toi pourraient me donner
ce conseil, d'autres que moi pourraient le suivre. Voilŕ justement le
motif, la raison impossible ŕ dire, mais impossible ŕ oublier, qui me
force ŕ quitter Bettine.
CALABRE.
Quitter madame? est-ce vrai?...
STEINBERG.
Eh! que veux-tu donc que je fasse? J'avais le dessein, en l'épousant,
de lui faire abandonner le théâtre; mais, si je ne suis plus assez
riche pour cela, ne veux-tu pas que je l'y suive, quitte ŕ rester dans
la coulisse?--Que me veut-on? qu'est-ce que c'est?
SCČNE IV
LES PRÉCÉDENTS, UN DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUE.
Monsieur le baron, c'est une carte que je porte ŕ madame.
STEINBERG.
Elle n'est pas levée.
LE DOMESTIQUE.
Pardon, monsieur le baron.
STEINBERG.
Tu as raison; voyons cette carte. Le marquis Stéfani? Qu'est-ce que
c'est que cela?
LE DOMESTIQUE.
Monsieur le baron, c'est un monsieur qui se promčne dans le jardin.
STEINBERG.
Dans le jardin?
LE DOMESTIQUE.
Monsieur, voyez plutôt; le voilŕ auprčs du bassin, qui regarde les
poissons rouges. Il dit qu'il revient d'un grand voyage.
STEINBERG.
Eh bien! qu'est-ce qu'il veut?
LE DOMESTIQUE.
Il veut voir madame, et il attend qu'elle soit visible.
STEINBERG, _ŕ part_.
Stéfani! Je connais ce nom-lŕ.
_Haut._
Calabre, n'est-ce pas ce Stéfani dont on parlait tant ŕ Florence?
CALABRE.
Mais... oui, monsieur,... je le crois du moins.
STEINBERG, _regardant au balcon_.
C'est lui-męme, je le reconnais. C'est un vrai pilier de coulisses,
soi-disant connaisseur, et grand admirateur de la signora Bettina.
CALABRE.
C'est un homme riche, monsieur, un grand personnage.
STEINBERG.
Oui, c'est un patricien qui a fait du commerce ŕ l'ancienne mode de
Venise; mais il n'est pas prouvé que son engouement pour la signora
s'en soit tenu ŕ l'admiration. Tu me feras le plaisir, Calabre, de
dire ŕ Bettine que je la prie de ne pas recevoir cet homme-lŕ. Je
sors; je reviendrai tantôt.
CALABRE.
Vous allez encore jouer, monsieur?
STEINBERG.
Fais ce que je le dis; tu m'as entendu?
_Il sort._
CALABRE.
Oui, monsieur.
SCČNE V
CALABRE, LE NOTAIRE, _puis_ BETTINE.
CALABRE, _ŕ part_.
Cela va mal, cela va bien mal. Pauvre jeune dame, si bonne, si jolie!
LE NOTAIRE.
Monsieur Calabre, voici quelque temps que je suis dans le pavillon, et
je ne vois pas les futurs conjoints.
CALABRE.
Tout ŕ l'heure, monsieur Capsucefalo.
LE NOTAIRE.
Et les témoins?
CALABRE.
Je vous ai dit que monsieur le baron les amčnerait.
BETTINE, _arrivant en chantant_.
Ah! te voilŕ, notaire, ô cher notaire, mon cher ami! As-tu tes
paperasses?
LE NOTAIRE.
Oui, madame, le contrat est pręt. J'ai seulement laissé en blanc les
sommes qui ne sont point stipulées.
BETTINE.
Tu ne stipuleras pas grand'chose, quand ce seraient tous mes
trésors.--Est-ce que tu n'as pas vu Filippo Valle, mon chargé
d'affaires? Il a dű t'instruire lŕ-dessus.
LE NOTAIRE.
Madame veut plaisanter, mais monsieur le baron est connu pour
puissamment riche.
BETTINE.
Je n'en sais rien. Oů est-il donc?
CALABRE.
Il est sorti, madame, pour un instant.
BETTINE.
Sorti maintenant? Est-ce que tu ręves?
CALABRE.
C'est-ŕ-dire,... je ne sais pas trop...
BETTINE.
Va donc le chercher.--Capsucefalo, attendez-nous dans le pavillon.
LE NOTAIRE.
J'en sors, madame, je suis ŕ vos ordres.
_Ŕ Calabre._
Que ces grandes artistes sont charmantes! Avez-vous observé qu'elle
m'a tutoyé?
CALABRE.
C'est sa maničre quand elle est contente.
LE NOTAIRE.
Hum! vous m'aviez promis quelques rafraîchissements.
BETTINE.
Mais certainement.
_Ŕ Calabre._
Ŕ quoi penses-tu donc?
CALABRE.
Je l'avais oublié, madame.
BETTINE.
Vite, des citrons, du sucre, de l'eau bien fraîche, ou du café, du
chocolat, ce qu'il voudra. Non, il a peut-ętre faim; vite, un flacon
de moscatelle et un grand plat de macaroni.
LE NOTAIRE.
Madame, je suis bien reconnaissant.
_Il se retire avec de grandes salutations._
BETTINE, _ŕ Calabre_.
Eh bien! toi, qu'est-ce que tu fais lŕ? Tu as l'air d'un âne qu'on
étrille. Je t'avais dit d'aller chercher Steinberg. Tiens, le voilŕ
dans le jardin.
CALABRE.
Pardon, madame, ce n'est pas lui.
BETTINE.
Qui est-ce donc? Ah! jour heureux! c'est Stéfani, mon cher Stéfani.
Est-ce qu'il y a longtemps qu'il est lŕ?... Dis-lui qu'il vienne,
dépęche-toi.
CALABRE.
Il vous a sans doute aperçue, madame, car le voilŕ qui monte le
perron; mais je dois vous dire que monsieur le baron...
BETTINE.
Que je suis contente! Eh bien! le baron, le perron, qu'est-ce que tu
chantes? Est-ce que tu fais des vers?
CALABRE.
Non, madame, pas si bęte! Je dis seulement que M. de Steinberg m'a
recommandé...
BETTINE.
Parle donc.
CALABRE.
Monsieur le baron m'a chargé de vous prier...
BETTINE.
Tu me feras mourir avec tes phrases.
CALABRE.
De ne pas recevoir ce seigneur.
BETTINE.
Qui? Stéfani? tu perds la tęte.
CALABRE.
Non, madame; monsieur le baron m'a ordonné expressément...
BETTINE, _riant_.
Ah! tu es fou... Ah! le pauvre homme! il ne sait ce qu'il dit, c'est
clair, il radote... Ne pas recevoir Stéfani! un vieil ami que j'aime
de tout mon coeur!... Ah! le voici... Va-t'en vite, va chercher
Steinberg.
CALABRE, _ŕ part, en sortant_.
Qu'est-ce que j'y peux? Je n'y peux rien... Cela va mal, cela va bien
mal.
SCČNE VI
BETTINE, LE MARQUIS.
BETTINE, _allant au-devant du marquis_.
Et depuis quand dans ce pays? et par quel hasard, cher marquis?...
Comment vous portez-vous? que faites-vous? que devenez-vous?... Vous
avez bon visage... Que je suis ravie de vous voir!
LE MARQUIS.
Et moi aussi, belle dame, et moi aussi je suis ravi, je suis enchanté;
mais, dčs qu'on vous voit, c'est tout simple.
BETTINE.
Des compliments! Vous ętes toujours le męme.
LE MARQUIS.
Je ne vous en dirai pas autant, car vous voilŕ plus charmante que
jamais; et savez-vous qu'il y a quelque chose comme deux ou trois ans
que je ne vous ai vue?
BETTINE.
Cher Stéfani, si vous saviez dans quel moment vous arrivez!... Je vais
me marier!... Avez-vous déjeuné?
LE MARQUIS.
Oui, certes; vous me connaissez trop pour me croire capable de
m'embarquer sans avoir pris...
BETTINE.
Vos précautions. D'oů venez-vous donc?
LE MARQUIS.
Lŕ, d'ŕ côté, de chez la princesse, votre voisine.
BETTINE.
Ah! vous ętes lié avec elle? On dit qu'elle est trčs-séduisante.
LE MARQUIS.
Mais oui, elle est fort bien. C'est elle qui par hasard, en causant,
m'a appris que vous étiez ici. Je ne m'en doutais pas, je suis
accouru... Et vous allez vous marier?
BETTINE.
Oui, mon ami, aujourd'hui męme.
LE MARQUIS.
Aujourd'hui męme?
BETTINE.
Le notaire est lŕ.
LE MARQUIS.
Eh bien! tant mieux, voilŕ une bonne nouvelle. C'est bien de votre
part, cela, c'est trčs bien. Je ne m'y attendais pas, je suis
enchanté.
BETTINE.
Vous ne vous y attendiez pas? Voilŕ un beau compliment cette fois!
Est-ce que vous ętes venu ici pour me dire des injures, monsieur le
marquis?
LE MARQUIS.
Non pas, non pas, ma belle, Dieu m'en garde! Oh! comme je vous
retrouve bien lŕ! Voilŕ déjŕ vos beaux yeux qui s'enflamment.
Calmez-vous; je sais que vous ętes sage, trčs sage, je vous estime
autant que je vous aime, c'est assez dire que je vous connais. Mais
vous avez une certaine tęte...
BETTINE.
Comment, une tęte?
LE MARQUIS.
Eh! oui, une tęte...
_Il la regarde._
Une tęte charmante, pleine de grâce et de finesse, d'esprit et
d'imagination, qui comprend tout, ŕ qui rien n'échappe, et qui
porterait une couronne au besoin, témoin le dernier acte de
_Cendrillon_.
BETTINE.
Oui, vous aimiez ŕ me voir dans ma gloire.
LE MARQUIS.
C'est vrai; avec votre blouse grise, vous aviez beau chanter comme un
ange, quand je vous voyais courbée dans les cendres, j'avais toujours
envie de sauter sur la scčne, de rosser monsieur votre pčre, et de
vous enlever dans mon carrosse.
BETTINE.
Miséricorde, marquis! quelle vivacité!
LE MARQUIS.
Aussi, quand je vous voyais revenir dans votre grande robe lamée d'or,
avec vos trois diadčmes l'un sur l'autre, étincelante de diamants...
BETTINE.
Je chantais bien mieux, n'est-ce pas?
LE MARQUIS.
Je n'en sais rien, mais c'était charmant. Tra, tra, comment était-ce
donc?
BETTINE, _chante les premičres mesures de l'air final de la_
Cencrentola _, puis s'arręte tout ŕ coup et dit_:
Ah! que tout cela est loin maintenant!
LE MARQUIS.
Que dites-vous donc lŕ? Renoncez-vous au théâtre?
BETTINE.
Il le faut bien. Est-ce que mon mari (je dis mon mari, il le sera tout
ŕ l'heure) me laisserait remonter sur la scčne? Cela ne se pourrait
pas, marquis. Songez-y donc sérieusement.
LE MARQUIS.
C'est selon le goűt et les idées des gens. Mais vous ne renoncez pas
du moins ŕ la musique?
BETTINE.
Ah! je crois bien. Est-ce que je pourrais? Nous en vivons ici, cher
marquis, et quand vous nous ferez l'honneur de venir manger la soupe,
nous vous en ferons tant que vous voudrez,... plus que vous n'en
voudrez.
LE MARQUIS.
Oh! pour cela, j'en défie... Mais c'est égal, cela me fend le coeur
de penser que je ne pourrai plus, aprčs le dîner, m'aller blottir
dans ce cher petit coin oů j'étais ŕ demeure pour me délecter ŕ vous
entendre.
BETTINE.
Oui, vous étiez un de mes fidčles.
LE MARQUIS.
Pour cela, je m'en vante. L'allumeur de chandelles me faisait chaque
soir un petit salut en accrochant son dernier quinquet, car je ne
manquais pas d'arriver dans ce moment-lŕ. Ma foi, j'étais de la
maison.
BETTINE.
Mieux que cela, marquis; je m'en souviens trčs bien que vous avez été
mon chevalier.
LE MARQUIS.
C'est vrai. Contre ce grand benęt d'officier.
BETTINE.
Qui m'avait sifflée dans _Tancrčde_.
LE MARQUIS.
Justement. Je le provoquai en Orbassan, et j'en reçus le plus rude
coup d'épée... Ah! c'était le bon temps, celui-lŕ!
BETTINE.
Oui. Ah, Dieu! que tout cela est loin!
LE MARQUIS.
C'est votre refrain, ŕ ce qu'il paraît? Que dirai-je donc, moi qui
suis vieux?
BETTINE.
Vous, marquis? Est-ce que vous pouvez? Victor Hugo a fait son vers
pour vous, lorsqu'il a dit que le coeur n'a pas de rides.
LE MARQUIS.
Si fait, si fait, je m'en aperçois. Et savez-vous pourquoi, Bettine?
C'est que je commence ŕ aimer mes souvenirs plus qu'il ne faudrait;
c'est un grand tort. Je m'étais promis toute ma vie de ne jamais
tomber dans ce travers-lŕ. J'ai vu tant de bons esprits devenir
injustes, tant de connaisseurs incurables, par ce triste effet des
années, que je m'étais juré de rester impartial pour les choses
nouvelles comme pour les anciennes. Je ne voulais pas ętre de ces
bonnes gens qui ressemblent aux cloches de Boileau:
Pour honorer les morts font mourir les vivants.
Eh bien! j'ai beau faire, j'aime mieux maintenant ce que j'ai aimé que
ce que j'aime. Je ne dis point de mal de vos auteurs nouveaux; mais
Rossini est toujours mon homme. Ici marchait la grande Pasta avec ses
gestes de statue antique; lŕ gazouillait ce rossignol que Rubini avait
dans la gorge; je vois le vieux Garcia avec sa fičre tournure,
escorté du long nez de Pellegrini; Lablache m'a fait rire, la Malibran
pleurer. Eh! que diantre voulez-vous que j'y fasse?
BETTINE.
Je ne vois pas que vous ayez si grand tort. Et moi aussi, j'aime mes
souvenirs.
LE MARQUIS.
Est-ce qu'on peut en avoir ŕ votre âge?
BETTINE.
Pourquoi donc pas, monsieur le marquis? Si vos souvenirs sont les
aînés des miens, cela n'empęche pas qu'ils ne se ressemblent.
LE MARQUIS.
Bah! les vôtres sont nés d'hier; ce sont des enfants qui grandissent.
Vous reviendrez tôt ou tard au théâtre.
BETTINE.
Jamais, cher Stéfani, jamais.
LE MARQUIS.
Mais, voyons, dans ce temps-lŕ, n'étiez-vous pas heureuse?
BETTINE.
C'est-ŕ-dire que je ne pensais ŕ rien. Ah! c'est que je n'avais pas
aimé.
LE MARQUIS.
Qu'est-ce que vous voulez dire par lŕ?
BETTINE.
Ce que je dis. J'ai été un peu folle, c'est vrai, insouciante,
coquette, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas notre droit, par
hasard? Mais je ne suis plus rien de tout cela, depuis que j'ai senti
mon coeur.
LE MARQUIS.
L'amour vous a rendu la raison? Ah, morbleu! prouvez-nous cela! Mais
ce serait ŕ en devenir fou, rien que pour tâcher de se guérir de la
sorte. Vous l'aimez donc beaucoup, ce monsieur de... de..., vous ne
m'avez pas dit...
BETTINE.
Si je l'aime! ah! mon cher ami, que les mots sont froids,
insignifiants, que la parole est misérable quand on veut essayer de
dire combien l'on aime! Vous n'avez pas l'idée de notre bonheur, vous
ne pouvez pas vous en douter.
LE MARQUIS.
Si fait, si fait, pardonnez-moi.
BETTINE.
C'est tout un roman que ma vie. Ne disiez-vous pas tout ŕ l'heure que
vous aviez eu quelquefois l'envie de m'enlever?
LE MARQUIS.
Oui, le diable m'emporte!
BETTINE.
Eh bien! il l'a fait, lui. Figurez-vous, mon cher, quel charme
inexprimable! Nous avons tout quitté, nous sommes partis ensemble, en
chaise de poste, comme deux oiseaux dans l'air, sans regarder ŕ
rien, sans songer ŕ rien; j'ai rompu tous mes engagements, et lui m'a
sacrifié toute sa carričre; j'ai désespéré tous mes directeurs...
LE MARQUIS.
Peste! vous disiez bien, en effet, que l'amour vous avait rendue sage.
BETTINE.
Eh! que voulez-vous! quand on s'aime! Nous avons fait le plus
délicieux voyage! Imaginez, marquis, que nous n'avons rien vu, ni une
ville, ni une montagne, ni un palais, pas la plus petite cathédrale,
pas un monument, pas la moindre statue, pas seulement le plus petit
tableau!
LE MARQUIS.
Voilŕ une maničre nouvelle de faire le voyage d'Italie.
BETTINE.
N'est-ce pas, marquis? quand on s'aime! Qu'est-ce que cela nous
faisait, vos curiosités? Si vous saviez comme il est bon, aimable!
Que de soins il prenait de moi! Ah! quel voyage, bonté divine! Moi
qui bâillais en chemin de fer, rien que pour aller ŕ Saint-Denis, j'ai
fait quatre cents lieues comme un ręve.--Votre Italie! qui veut peut
la voir, mais je défie qu'on la traverse comme nous! Nous avons passé
comme une flčche, et nous sommes venus droit ici.
LE MARQUIS.
Pourquoi ici, dans cette province?
BETTINE.
Pourquoi?... mais je ne sais trop;... parce qu'il l'a voulu,... parce
qu'il avait loué cette campagne... Que vous dirais-je?... Je n'en sais
rien... Je serais aussi bien allée autre part,... au bout du monde,...
que m'importait? Je me suis arrętée ici, parce qu'en descendant devant
la grille, il m'a dit: Nous sommes arrivés.
LE MARQUIS.
Que ne vous épousait-il ŕ Paris?
BETTINE.
Sa famille s'y opposait. C'est encore lŕ un des cent mille
obstacles...
LE MARQUIS.
Vous ne m'avez pas encore dit son nom.
BETTINE.
Ah, bah! je ne vous l'ai pas dit? C'est qu'il me semble que tout le
monde le sait. Il se nomme Steinberg, le baron de Steinberg.
LE MARQUIS.
Mais ce n'est pas un nom français, cela.
BETTINE.
Non, mais sa famille habite la France.
LE MARQUIS.
En ętes-vous sűre?
BETTINE.
Oh! il me l'a dit.
LE MARQUIS.
Steinberg! je connais cela. Il me semble męme me rappeler certaines
circonstances... assez peu gracieuses... Eh, parbleu! c'est lui que je
viens de voir ce matin.
BETTINE.
Oů cela? Dites. Chez la princesse?
LE MARQUIS.
Précisément, chez la princesse.
BETTINE.
Ah! malheureuse! il y est encore!
LE MARQUIS.
Eh! qu'avez-vous, ma bonne amie?
BETTINE.
Il y est encore, c'est évident; c'est pour cela qu'il ne vient pas.
Il y est encore, un jour comme celui-ci! quand tout est pręt, quand le
notaire est lŕ, quand je l'attends!... Ah! quel outrage!
LE MARQUIS.
Vous vous fâchez pour peu de chose.
BETTINE.
Pour peu de chose! oů avez-vous donc le coeur? Vous ne ressentez pas
l'insulte qu'on me fait? Et cet impertinent valet qui me répond d'un
air embarrassé... Calabre! Calabre! oů es-tu?
SCČNE VII
LES PRÉCÉDENTS, CALABRE.
CALABRE.
Me voilŕ, madame, me voilŕ. Vous m'avez appelé?
BETTINE.
Oui, réponds. Pourquoi tout ŕ l'heure as-tu fait l'ignorant quand je
t'ai demandé oů était ton maître?
CALABRE.
Moi, madame?
BETTINE.
Oui; essaie donc de me mentir encore, lorsque tu sais qu'il est chez
la princesse.
CALABRE.
Ma foi, madame, je ne savais pas...
BETTINE.
Tu ne savais pas!
CALABRE.
Pardon, je ne savais pas si je devais en instruire madame.
BETTINE.
Ah! on te l'avait donc défendu? Parleras-tu?
CALABRE.
Eh bien! madame, puisque vous le voulez, je ne vous cacherai rien.
Monsieur le baron avait joué hier, il avait perdu sur parole. Il
s'était engagé ŕ payer ce matin. Il a voulu, ayant toute autre
affaire, tenir sa promesse.
BETTINE.
Il avait perdu, mon ami? Ah, mon Dieu! je n'en savais rien. Vous le
voyez, marquis, c'était lŕ son secret, c'était lŕ tout ce qu'il me
cachait. Et il l'avait dit ŕ Calabre! N'est-ce pas que c'est mal de ne
m'en avoir rien dit?
LE MARQUIS.
Je ne vois de sa part, dans tout cela, qu'un excčs de délicatesse.
BETTINE.
N'est-ce pas? Oh! c'est que mon Steinberg n'a pas l'âme faite comme
tout le monde... Il pourrait pourtant revenir plus vite.
LE MARQUIS.
Une femme qui joue et qui gagne au jeu, et qu'on paye dans les
vingt-quatre heures, comme un huissier, croyez-moi, ma chčre, ce n'est
pas celle-lŕ qu'on aime.
BETTINE.
Mais j'y pense, je me trompe encore. Dis-moi, Calabre, que ne
t'envoyait-il porter cet argent?
CALABRE.
Madame, c'est qu'il ne l'avait pas. Il lui fallait aller ŕ la ville le
demander ŕ son correspondant.
BETTINE.
Mais j'en avais, moi, de l'argent. Ah! que c'est mal! que c'est cruel!
C'est donc une somme considérable?
CALABRE.
Non, madame, je ne sais pas au juste, mais il m'a dit que cela ne le
gęnait point.
LE MARQUIS.
Allons, madame et charmante amie, je vous quitte, je reprends ma
course. Je suis heureux de vous voir heureuse. Adieu.
BETTINE.
Mais vous nous reviendrez? Oh! je veux que vous soyez notre ami,
d'abord, entendez-vous? notre ami ŕ tous deux! Je prétends vous voir
tous les jours, ŕ la mode de notre pays. Oů demeurez-vous?
LE MARQUIS.
Ŕ trois pas d'ici, ŕ cette maison blanche, lŕ, derričre les arbres.
BETTINE.
C'est délicieux! nous voisinerons.
LE MARQUIS.
Je le voudrais, mais c'est que je pars demain.
BETTINE.
Ah, bah! si vite! c'est impossible! nous ne permettrons jamais cela.
Et oů allez-vous?
LE MARQUIS.
Je vais ŕ Parme. Vous savez que j'ai lŕ ma famille, et, dans ce
moment-ci, je suis absolument forcé...
BETTINE.
Ah, mon Dieu! quel ennui! Vous ętes forcé, dites-vous? Eh bien! tenez,
j'aimerais mieux ne pas vous avoir revu du tout. Oui, en vérité, car
ce n'est qu'un regret de plus que vous ętes venu m'apporter, et Dieu
sait maintenant quand vous reviendrez! Allez! vous ętes un méchant
homme!--Mais au moins restez ŕ dîner. Je veux que vous signiez mon
contrat.
LE MARQUIS.
Je ne le peux pas, je suis engagé; mais je reviendrai vous faire ma
visite d'adieu; et, puisque je ne puis signer votre contrat, je vous
enverrai un bouquet de noce.
BETTINE.
Un bouquet?
LE MARQUIS.
Oui.
BETTINE.
Va pour un bouquet.
LE MARQUIS.
Oů allez-vous donc, s'il vous plaît?
BETTINE.
Je vous reconduis jusqu'ŕ la grille. Je veux vous garder le plus
longtemps possible. Dieu! que vous ętes ennuyeux! que vous ętes
insupportable!
SCČNE VIII
CALABRE, _seul_, _puis_ LE NOTAIRE.
CALABRE.
Allons, cela va un peu mieux. Je pense que monsieur le baron rendra
cette fois quelque justice ŕ mon intelligence. Ah, mon Dieu! le voilŕ
qui rentre; il va rencontrer madame avec le marquis;... et la défense
qu'il m'a faite!
_Il regarde au balcon._
Non, non! il prend une autre allée; il va du côté du petit bois, comme
s'il faisait exprčs de les éviter. Serait-il possible? Oui, c'est bien
clair; il les a vus, il fait un détour.
LE NOTAIRE.
Monsieur Calabre, les futurs conjoints sont-ils disposés?...
CALABRE.
Non, monsieur Capsucefalo, non, pas encore; dans un instant, dans une
minute.
LE NOTAIRE.
Fort bien, monsieur, je suis tout pręt.
CALABRE.
Plaît-il?
LE NOTAIRE.
Comment?
CALABRE, _regardant toujours_.
Je croyais que vous disiez quelque chose.
LE NOTAIRE.
Oui, je disais que je suis tout pręt.
CALABRE.
Fort bien. Vous avez encore de la moscatelle?
LE NOTAIRE.
Oui, monsieur, plus qu'il ne m'en faut.
CALABRE.
Ŕ merveille, monsieur, ŕ merveille. Il est inutile de vous déranger.
Je vous avertirai quand il sera temps.
LE NOTAIRE.
Je ne bougerai point, monsieur, je ne bougerai point d'ici.
SCČNE IX
CALABRE, STEINBERG.
STEINBERG.
C'est donc ainsi qu'on suit mes ordres?
CALABRE.
Monsieur, je puis vous assurer...
STEINBERG.
Quoi? Ne vous avais-je pas dit que je ne voulais pas voir cet homme
ici?
CALABRE.
Monsieur, j'ai fait votre commission; mais madame n'en a pas tenu
compte.
STEINBERG.
Ce n'est pas possible. Lui avez-vous répété?...
CALABRE.
Tout ce que monsieur m'avait ordonné. J'ai męme trouvé une excuse pour
justifier l'absence de monsieur.
STEINBERG.
Quelle excuse as-tu trouvée?
CALABRE.
Monsieur, j'ai dit que vous aviez joué.
STEINBERG.
Comment, malheureux! Et qu'en savais-tu?
CALABRE.
Voilŕ encore que j'ai eu tort! Je n'avais pas d'autre ressource,
monsieur; vous me l'aviez dit ce matin, et j'ai eu bien soin d'ajouter
que c'était peu de chose.
STEINBERG.
Oui, peu de chose! C'était peu ce matin, mais maintenant... Mort et
furies! c'est une maison de jeu, c'est un enfer que ce palais!
CALABRE.
Vous avez encore joué, monsieur? Hélas! je vous l'avais bien dit.
STEINBERG.
Tu me l'avais bien dit, animal! Répčte-le donc encore une fois! Y
a-t-il au monde une phrase plus sotte et plus inepte que celle-lŕ?
et dčs qu'il vous arrive malheur, elle est dans la bouche de tout le
monde. Mon cheval trébuche en sautant un fossé, je tombe, je me
casse la jambe: Nous vous l'avions bien dit, s'écrient ceux qui vous
relčvent. Quel doux effort de l'amitié!
CALABRE.
Monsieur, j'ai déjŕ essayé de prendre la liberté de vous dire que si
mes petites économies...
STEINBERG.
Eh, morbleu! tes économies, que diantre veux-tu que j'en fasse?
CALABRE.
J'ai quinze mille francs ŕ moi, monsieur. Il me semble...
STEINBERG.
Quinze mille francs! La belle avance! Écoute-moi; mais sur ta vie,
garde pour toi ce que je vais te dire. Il faut que je parte.
CALABRE.
Vous, monsieur! Est-ce bien possible?
STEINBERG.
Je n'ai pas autre chose ŕ faire. Cet argent perdu, je ne l'ai pas; il
faut que je le trouve, et pour le trouver, il faut que j'aille ŕ
Rome ou ŕ Naples. Je connais lŕ quelques banquiers. Je partirai
secrčtement, je trouverai un prétexte.
CALABRE.
Et madame, monsieur, madame? Elle en mourra.
STEINBERG.
Elle en souffrira. Crois-tu donc que je ne souffre pas moi-męme? C'est
avec le désespoir dans l'âme que je m'éloigne de ces lieux; mais, je
le répčte, il faut que je parte,... ou que je me donne la mort. Ainsi,
que veux-tu? Va dans ma chambre, appelle Pietro et Giovanni, prépare
tout,... et pas un mot de trop. Tu enverras ensuite ŕ la poste
demander des chevaux pour ce soir.
CALABRE.
Et vous ne voulez pas de mes quinze mille francs, monsieur?
STEINBERG.
Quinze mille francs! Il m'en faut cent mille!
SCČNE X
LES PRÉCÉDENTS, BETTINE.
BETTINE.
Cent mille francs, Steinberg! Il vous faut cent mille francs?
STEINBERG.
Qui dit cela, ma chčre Bettine?
_Il lui baise la main._
Comment vous portez-vous ce matin? Vous ętes fraîche comme une rose.
BETTINE.
Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Parlez franchement. Vous avez
joué?
STEINBERG.
Vous avez mal entendu, ma chčre.
BETTINE.
Mal entendu? est-ce vrai, Calabre?
CALABRE.
Moi, madame! je ne sais pas...
STEINBERG.
Allez ŕ votre besogne, Calabre. Pour aujourd'hui, c'est assez
bavarder.
CALABRE, _ŕ part, en sortant_.
Bon! encore une gourmade en passant. Mon Dieu! tout cela va de mal en
pis.
SCČNE XI
STEINBERG, BETTINE.
BETTINE.
Vous n'ętes pas sincčre, mon ami.
STEINBERG.
Je vous dis que vous vous méprenez. Cette somme dont je parlais,
c'était dans l'idée d'un changement, d'une fantaisie.
BETTINE.
D'un changement?
STEINBERG.
Oui, ŕ propos d'une terre, d'une terre assez belle avec un palais,
qui est ŕ vendre, qui est pour rien et que vous trouveriez peut-ętre
ŕ votre goűt. Nous en causerons plus tard, s'il vous plaît. J'ai
quelques ordres ŕ donner.
BETTINE.
Steinberg, vous n'ętes pas sincčre.
STEINBERG.
Pourquoi me dites-vous cela?
BETTINE.
Parce que je le vois.
STEINBERG.
Que puis-je vous dire, du moment que vous ne me croyez pas?
BETTINE.
Vous pouvez me dire pourquoi, lorsque je vous ai vu venir de loin dans
le jardin, vous étiez pâle, pourquoi vous parliez tout seul, pourquoi
vous avez pris l'allée pour nous éviter.
STEINBERG.
J'ai pris l'allée couverte, parce que je ne me souciais pas de vous
rencontrer dans la compagnie oů je vous voyais.
BETTINE.
Comment! Stéfani! Vous ne le connaissez pas! C'est un ancien ami. Quel
motif pourriez-vous avoir?...
STEINBERG.
Je n'aime pas les méchants propos. Je ne puis pas toujours m'empęcher
d'en entendre; mais je ne les répčte jamais.
BETTINE.
Des propos, sur quoi? Sur mon compte et sur celui de ce bon
marquis?--Ah! cela n'est pas sérieux... Mais, maintenant je me
rappelle,... vous l'avez vu chez moi, ŕ Florence... Est-ce lŕ qu'on
tenait des _propos_?
STEINBERG.
Peut-ętre bien.
BETTINE.
Quoi! ŕ Florence? Mais Stéfani venait comme tout le monde.
Souvenez-vous donc, j'avais une cour, j'étais reine alors, mon ami;
j'avais mes flatteurs et mes courtisans, voire mes soldats et mon
peuple, ce brave parterre qui m'aimait tant, et ŕ qui je le rendais si
bien... Ingrat! qui, seul dans cette foule, m'étiez plus cher que mes
triomphes, et que j'ai appelé entre tous pour mettre ma couronne ŕ vos
pieds,... vous, Steinberg, jaloux d'un propos, fâché d'une visite
que je reçois par hasard! Allons, voyons, c'est une plaisanterie,
convenez-en, un pur caprice, ou plutôt, tenez, je vous devine, c'est
un prétexte, un biais que vous prenez pour me faire oublier ce que je
voulais savoir et vous délivrer de mes questions.
STEINBERG, _s'asseyant_.
Oh! ma chčre Bettine, vous ętes bien charmante, et moi je suis... bien
malheureux.
BETTINE.
Malheureux, vous! prčs de moi! Qu'est-ce que c'est? Vite, dites-moi,
de quoi s'agit-il?
STEINBERG.
J'ai tort, je me suis mal exprimé. Vous savez ce que c'est qu'un
joueur;... eh bien! Bettine, c'est vrai, j'ai joué, et je suis rentré
de mauvaise humeur; mais ce n'est rien, rien qui en vaille la peine;
n'y pensons plus, pardonnez-moi.
BETTINE.
Ce n'est pas encore bien vrai, ce que vous dites lŕ.
STEINBERG.
Je vous demande en grâce d'y croire.
BETTINE.
Vous le voulez?
STEINBERG.
Je vous en supplie.
BETTINE.
Eh bien! j'y crois, puisque cela vous plaît. Calmez-vous, voyons,
tręve aux noirs soucis. Éclaircissez-nous ce front plein d'orages.
Vous souvenez-vous de cette chanson?
_Elle se met au piano et joue la ritournelle d'une romance._
STEINBERG, _se levant_.
Bettine, pas cette chanson-lŕ.
BETTINE.
Pourquoi? vous l'avez faite pour moi en passant ŕ Sorrente, aprčs une
promenade en mer. Est-ce parce qu'elle se rattache ŕ ces souvenirs
qu'elle a déjŕ cessé de vous plaire? Elle vous ôtait jadis vos ennuis.
_Elle chante._
Nina, ton sourire,
Ta voix qui soupire,
Tes yeux qui font dire
Qu'on croit au bonheur,--
Ces belles années,
Ces douces journées,
Ces roses fanées,
Mortes sur ton coeur...
STEINBERG, _ŕ part, tandis que Bettine joue sans chanter_.
Pourrais-je jamais l'abandonner? et pour qui? grand Dieu! par quelle
infernale puissance me suis-je laissé subjuguer?
BETTINE.
Ŕ quoi ręvez-vous donc, monsieur? est-ce que c'est poli, ce que vous
faites-lŕ?... Il me semble que je me trompe,... je ne me rappelle pas
bien,... venez donc...
STEINBERG, _se rapprochant du piano et chantant_.
Nina, ma charmante,
Pendant la tourmente,
La mer écumante
Grondait ŕ nos yeux;
Riante et fertile,
La plage tranquille
Nous montrait l'asile
Qu'appelaient nos voeux!
ENSEMBLE.
Aimable Italie,
Sagesse ou folie,
Jamais, jamais ne t'oublie
Qui t'a vue un jour!
Toujours plus chérie,
Ta rive fleurie
Toujours sera la patrie
Que cherche l'amour.
STEINBERG.
Mon amie, écoutez-moi. Cette chanson, ces paroles du coeur, ces
souvenirs me pénčtrent l'âme, me rendent ŕ moi-męme... Non, tant
d'amour ne sera point un ręve! tant d'espoir de bonheur ne sera point
un mensonge! j'en fais le serment ŕ vos pieds.
_Il se met ŕ genoux._
Je viens de me montrer jaloux sans motif, mais je vous ai donné
souvent trop de raison de l'ętre...
BETTINE.
Ne parlons pas de cela, Steinberg.
STEINBERG, _se levant_.
J'en veux parler, je suis las de feindre, de me contraindre, de me
sentir indigne de vous. Mes visites chez la princesse vous ont coűté
des larmes, je le sais...
BETTINE.
Charles!
STEINBERG.
Je ne veux plus la voir, je ne veux plus entendre parler d'elle.
Vivons chez nous, en nous, pour nous, et que l'univers nous oublie ŕ
son tour! Le notaire est lŕ, n'est-ce pas? Eh bien! Bettine, signons
ŕ l'instant męme. Les témoins ne sont pas arrivés? Je sais bien
pourquoi, et je vous le dirai. Prenez la premičre voisine venue, et
moi, morbleu! je prendrai Calabre. Que je sois votre mari, et advienne
que pourra! Je répčte, avec le vieux proverbe: Celui qui aime et qui
est aimé est ŕ l'abri des coups du sort!
SCČNE XII
LES PRÉCÉDENTS, CALABRE.
CALABRE, _entrant avec une lettre et une boîte_.
On apporte cette lettre pour monsieur le baron.
STEINBERG.
Eh, que diantre! est-ce donc si pressé?
CALABRE.
Oui, monsieur; l'homme qu'on envoie a dit qu'on attendait la réponse.
STEINBERG.
Voyons ce que c'est.
_Il prend la lettre._
CALABRE, _donnant la boîte ŕ Bettine_.
Ceci est pour madame.
STEINBERG, _aprčs avoir lu précipitamment la lettre_.
Calabre!
CALABRE.
Monsieur.
STEINBERG.
Qui est-ce qui est lŕ?
CALABRE.
Monsieur, c'est un homme... de lŕ-bas...
STEINBERG.
De chez la princesse? Oů est-il, cet homme?
CALABRE.
Lŕ, dans l'antichambre.
STEINBERG.
Je vais lui parler.
SCČNE XIII
BETTINE, CALABRE.
BETTINE.
Qu'arrive-t-il encore, mon ami? As-tu remarqué, en ouvrant cette
lettre, comme il a changé de visage? Est-ce encore un nouveau malheur?
Ah! cette femme nous fait bien du mal.
CALABRE.
La lettre n'est pas d'elle, madame; c'est un de ses gens qui l'a
apportée, mais ce n'est pas son écriture.
BETTINE.
Son écriture, hélas! excepté moi, tout le monde la connaît donc dans
cette maison?
CALABRE, _désignant la boîte_.
Ceci, madame, vient de la part du marquis.
BETTINE.
Ah! je n'y pensais plus.
_Elle ouvre la boîte._
Des diamants!
CALABRE.
Il y a un petit billet.
BETTINE.
Voyons:
_Elle lit._
«Vous m'avez permis, belle dame, de vous envoyer un bouquet de
noce...»
Ah! ciel! j'entends la voix de Steinberg; il parle avec une violence!
L'entends-tu, Calabre? Il revient ici... Garde cet écrin, il ne
faut pas qu'il le voie, pas maintenant, et dis-moi vite, avant qu'il
vienne, combien a-t-il perdu?
CALABRE.
Ah! madame, il m'est impossible...
BETTINE.
Il faut que je sache, il faut que tu parles, quand tu serais lié par
mille serments! Faut-il te le demander ŕ genoux?
CALABRE.
Ah! ma chčre dame!
BETTINE.
Est-ce cent mille francs?
CALABRE, _ŕ voix basse_.
Eh bien! oui.
SCČNE XIV
LES PRÉCÉDENTS, STEINBERG.
STEINBERG, _ŕ Calabre_.
Que faites-vous lŕ? retirez-vous.
_Calabre sort._
BETTINE.
Vous paraissez ému, Steinberg; cette lettre semble vous avoir...
contrarié.
STEINBERG.
Pas le moins du monde.--Qu'est-ce donc que cette boîte que l'on vient
de vous envoyer?
BETTINE.
Une bagatelle.--Dites-moi, mon ami, tout ŕ l'heure...
STEINBERG.
Une bagatelle! mais enfin, quoi?
BETTINE.
Mon Dieu, ce n'est pas un mystčre,... c'est un cadeau de Stéfani.
STEINBERG.
Ah! un cadeau? et ŕ quel propos?
BETTINE.
Ŕ propos... de notre mariage.
STEINBERG.
Un cadeau de noce!... Est-il votre parent?
BETTINE.
Non, mais, je vous l'ai dit, c'est un ancien ami.
STEINBERG.
Et les anciens amis font aussi des présents? Je ne connaissais pas cet
usage. Voyons cette boîte, si vous le voulez bien.
BETTINE.
Elle n'est pas lŕ, on l'a portée chez moi. Mais, mon ami, ne me
ferez-vous pas la grâce de me dire ce que cette lettre...
STEINBERG.
Voulez-vous que j'appelle votre femme de chambre?
BETTINE.
Pourquoi?
STEINBERG.
Pour voir ce cadeau. Vous savez que je suis un connaisseur.
BETTINE.
Je me trompais... Cet écrin n'est pas chez moi... Calabre, je crois,
l'a gardé.
STEINBERG.
Ah!... si c'est un objet de prix, la précaution est fort sage.
_Appelant._
Calabre! holŕ! Calabre! oů ętes-vous donc?
SCČNE XV
LES PRÉCÉDENTS, CALABRE.
CALABRE.
Monsieur...
STEINBERG.
Oů ętes-vous donc quand j'appelle?
CALABRE.
Monsieur, j'étais dans votre appartement. Vous vous rappelez sans
doute les ordres...
STEINBERG.
Il n'est pas question de cela.
BETTINE.
Calabre, avez-vous lŕ l'écrin que je viens de vous confier?
CALABRE.
Oui, madame.
BETTINE.
Donnez-le moi.
_Elle le remet ŕ Steinberg._
STEINBERG, _ouvrant l'écrin_.
Ce sont de fort beaux diamants. Peste! un bouquet de fleurs
en brillants, męlés de rubis et d'émeraudes! c'est tout ŕ fait
galant!--Il y a un mot d'écrit.
BETTINE.
Vous pouvez le lire.
STEINBERG.
Ŕ Dieu ne plaise! ma curiosité ne va pas jusque-lŕ.
BETTINE.
Je vous en prie; je ne l'ai pas lu.
STEINBERG.
Vraiment? Puisque vous le voulez...
_Il lit:_
«Vous m'avez permis, belle dame, de vous envoyer un bouquet de noce.
Si je devais rester longtemps dans ce pays, je vous enverrais des
fleurs qui, lorsqu'elles seraient fanées, se remplaceraient aisément;
mais puisque ma mauvaise étoile me défend de vivre prčs de vous,
laissez-moi vous offrir, je vous le demande en grâce, quelques brins
d'herbe un peu moins fragiles. Puisse ce souvenir d'une vieille
amitié vous en rappeler parfois quelques autres que, pour ma part, je
n'oublierai jamais.--J'aurai l'honneur de vous voir ce soir.»
C'est ŕ merveille!--Monsieur Calabre, avez-vous fait demander des
chevaux?
_Il pose l'écrin sur une table._
CALABRE.
Pas encore, monsieur; je pensais...
STEINBERG.
Combien de fois faut-il donc que je parle pour qu'on m'entende? Que
Pietro parte sur-le-champ.
BETTINE.
Des chevaux, Steinberg? pour quoi faire?
STEINBERG.
Il faut que j'aille ŕ la ville. Hâtez-vous, Calabre.
BETTINE.
Un instant encore! Ne se pourrait-il?...
STEINBERG.
Ŕ qui obéit-on ici?
_Calabre s'incline et va pour sortir._
BETTINE.
Charles, je sais votre secret! Je ne voulais vous en rien dire.
J'aurais attendu, j'aurais désiré que la confidence m'en vînt de votre
part; mais vous voulez partir... Pourquoi?
STEINBERG.
Vous savez tout, dites-vous, et vous le demandez! Il paraît qu'il y a
ici une inquisition dans les rčgles, et qu'on s'inquičte fort de
mes intéręts; mais il semble aussi que M. Calabre conserve plus
discrčtement ce que vous lui confiez qu'il ne sait respecter mes
ordres.
CALABRE.
Monsieur, je vous jure sur mon âme...
STEINBERG.
Je ne vous interroge pas.--Et moi aussi je voulais garder le silence;
mais puisque vous avez voulu tout savoir, eh bien! madame, soyez
satisfaite! Oui, j'ai agi imprudemment; oui, ma parole est engagée;
ma fortune, déjŕ compromise, est aujourd'hui ŕ peu prčs perdue. Cette
lettre vient d'un créancier qui m'annonce tout d'un coup un voyage,
qui prétexte un départ subit pour me demander de l'or, comme votre
marquis pour vous en donner.
BETTINE.
Bonté divine! perdez-vous la raison?
STEINBERG.
Non pas. Croyez-vous, s'il vous plaît, que je ne sache pas par coeur
ces finesses, ces artifices de comédie, ces petites ruses de coulisse?
Supposer qu'on s'en va pour se faire retenir! accompagner cela d'un
présent bien solide, afin qu'on sente tout ce qu'on va perdre! voilŕ
qui est nouveau, voilŕ qui est merveilleux! Mais il faudrait, pour n'y
pas voir clair, n'avoir jamais mis le pied dans le foyer d'un théâtre,
n'avoir jamais connu vos pareilles!
BETTINE.
Mes pareilles, Steinberg?--Vous voulez m'offenser. Vous n'y
parviendrez pas, je vous en avertis, car ce n'est pas vous qui parlez.
Si vos ennuis vous rendent injuste, le plus simple est d'en détruire
la cause. Écoutez-moi.--Je n'ai pas, bien entendu, cent mille francs
dans mon tiroir; mais Filippo Valle, notre correspondant, les a pour
moi. Il n'y a qu'ŕ les faire prendre ŕ la ville, et vous les aurez
dans une heure.
STEINBERG.
Je n'en veux pas.
BETTINE.
Signons notre contrat; dčs cet instant, vous ętes mon mari.
STEINBERG.
Jamais!
BETTINE.
Vous le vouliez tout ŕ l'heure.
STEINBERG.
Jamais, jamais ŕ un tel prix!
BETTINE.
Ŕ un tel prix!... Ah! vous ne m'aimez plus.
STEINBERG.
Il ne s'agit pas d'amour dans une question d'argent. Et
qu'arriverait-il si je cédais? Vous seriez ridicule, et moi
méprisable.
BETTINE.
Ce ridicule me ferait rire, et ce mépris me ferait pitié.
STEINBERG.
Ririez-vous aussi de notre ruine?
BETTINE.
Je ne la crains pas. Si la pauvreté ne vous est pas insupportable,
elle n'a rien que je redoute. Si elle vous effraie, eh bien! je ne
suis pas morte, et ce que j'ai fait, peut se recommencer.
STEINBERG.
Remonter sur la scčne, n'est-il pas vrai? C'est lŕ votre secret désir,
d'autant plus vif, que vous savez bien que je n'y saurais consentir.
BETTINE.
Mon ami...
STEINBERG.
Brisons lŕ, je vous en prie. Je n'ajouterai qu'un seul mot: j'étais
pręt ŕ vous épouser lorsque je croyais pouvoir vous assurer une
existence honorable et libre; maintenant je ne le puis plus.
BETTINE.
Pourquoi cela? oů est le motif?
STEINBERG.
Oů est le motif? Et mon nom? et ma famille? et mes amis? et le
monde?...
BETTINE.
Ah! voilŕ l'obstacle.
STEINBERG.
Oui, le voilŕ, comprenez-le donc; oui, c'est le monde qui nous sépare,
le monde, dont personne ne peut se passer, qui est mon élément, qui
est ma vie, dont je n'attends rien, dont j'ai tout ŕ craindre, mais
que j'aime par-dessus tout; le monde, l'impitoyable monde, qui nous
laisse faire, nous regarde en souriant, qui ne nous préviendrait pas
d'un danger, mais qui, le lendemain d'une faute, se ferme devant nous
comme un tombeau.
BETTINE.
Je ne croyais pas le monde si méchant.
STEINBERG.
Il ne l'est pas du tout, madame. Il a raison dans tout ce qu'il fait.
C'est incroyable ce qu'il pardonne, et comme il vous soutient, comme
il vous défend, par respect pour lui-męme, dčs l'instant qu'on en est,
tant que vous vous conformez ŕ ses lois, les plus douces, les plus
praticables et les plus indulgentes qu'on puisse imaginer; mais
malheur ŕ qui les transgresse! Malheur ŕ qui brave cette impunité, ŕ
qui abuse de cette indulgence! Il est perdu, il n'a rien ŕ dire,
et cette affable cruauté, cette sévčre patience, qui ne frappe que
lorsqu'on l'y force, n'est que justice.
BETTINE.
Ainsi vous partez?
STEINBERG.
Et que voulez-vous donc? De quel front, avec quel visage irais-je
subir ce rôle d'un mari qui vit d'une fortune qui n'est pas la sienne,
et promener par toute l'Italie une femme que je ne ferais que suivre,
avec mon nom sur son passe-port et mes armes sur sa voiture? Encore
faudrait-il, si, par impossible, on consentait ŕ pareille chose,
encore faudrait-il que cette femme fűt digne d'un tel sacrifice!
BETTINE.
Est-ce bien lŕ le motif, Steinberg?
STEINBERG.
Je sais donc bien mal me faire comprendre?
_Montrant l'écrin._
Eh bien! le motif, le voilŕ.
_Il sort._
SCČNE XVI
BETTINE, CALABRE.
BETTINE.
Calabre.
CALABRE.
Madame.
BETTINE.
Je suis perdue.
CALABRE.
Patience, madame. Il ne faut pas croire...
BETTINE.
Je suis perdue, perdue ŕ jamais.
CALABRE.
Non, madame, je vous le répčte, il ne faut pas croire que monsieur
le baron vous ait dit lŕ son dernier mot, ni męme qu'il ait parlé
sincčrement; non, c'est impossible. Il changera de langage quand son
dépit sera calmé, car ce n'est pas contre vous qu'il peut ętre irrité;
il reviendra, madame, il va revenir.
BETTINE, _regardant au balcon_.
Le voilŕ qui part.
CALABRE.
Est-ce possible?
BETTINE.
Tu ne le vois pas? Il part seul, ŕ pied. Oů va-t-il? Sans doute ŕ
la ville. Cours aprčs lui, Calabre, retiens-le... Ah! le coeur me
manque.
CALABRE.
J'y vais, madame, je vous obéis... Mais permettez du moins...
BETTINE.
Non! arręte! laisse-le partir; mais il faut que tu partes aussi. Il
faut que tu sois avant lui ŕ la ville. Te sens-tu la force de prendre
la traverse par le chemin de la montagne?
_Elle va ŕ la table et écrit._
CALABRE.
Pour vous, madame, je monterais au Vésuve.
BETTINE.
Il n'y a que toi qui puisses faire ma commission. Filippo Valle te
connaît.--Et toi, connais-tu la personne ŕ qui Steinberg doit ce qu'il
a perdu?
CALABRE.
L'homme qui a apporté la lettre m'a dit que c'était le comte Alfani.
BETTINE.
Voici un mot pour Valle. Il doit avoir ŕ moi, chez lui, la somme
nécessaire. Il faut qu'il l'envoie sur-le-champ ŕ cet Alfani, et qu'il
fasse dire que c'est la princesse qui pręte cet argent ŕ Steinberg.
CALABRE.
Comment! madame, vous voulez...
BETTINE.
Oui. Il ne m'aime plus assez pour accepter de moi un service; mais,
croyant qu'il vient d'elle, il n'osera refuser. Allons, Calabre,
dépęche-toi; nous n'avons pas de temps ŕ perdre.
CALABRE.
Mais, madame, pensez donc que cette somme est considérable, et que
vous disiez ce matin męme au notaire que votre fortune ne l'était
gučre...
BETTINE.
C'est bon, c'est bon. Ne t'inquičte pas.
UN DOMESTIQUE, _entrant_.
Monsieur le marquis Stéfani demande si madame veut le recevoir.
BETTINE.
Stéfani!
_Aprčs un silence._
Oui, sans doute, qu'il vienne. Allons, Calabre, tu n'es pas parti?
CALABRE.
Hélas! madame...
BETTINE.
Ne t'inquičte pas, te dis-je. Je t'ai entendu tantôt, il me semble,
offrir quinze mille francs ŕ ton maître?
CALABRE.
Oui, madame, et s'il se pouvait...
BETTINE.
En possčdes-tu beaucoup davantage?
CALABRE.
Je ne dis pas; mais dans un cas pareil...
BETTINE.
Et tu ne veux pas que je fasse ce que tu voulais faire? Va, Calabre,
va, mon vieil ami,--et quand je serai ruinée, tu me feras tes offres,
ŕ moi, et j'accepterai.
CALABRE.
Je vais prendre le vieux cheval de chasse. Il a encore le jarret
ferme, et moi aussi, quoi qu'on en dise. Je serai bientôt parti et
revenu. Ah! si M. de Steinberg a du coeur, il sera dans un quart
d'heure ŕ vos pieds!
BETTINE.
Va, ne me fais pas penser ŕ cela.
SCČNE XVII
BETTINE, LE MARQUIS, _entrant ŕ droite pendant que Calabre sort ŕ
gauche_.
BETTINE, _ŕ part_.
C'est pourtant bien lŕ ce que j'espčre!
LE MARQUIS.
Voilŕ une action généreuse, ma chčre, digne en tout point de vous,
mais elle a son danger.
BETTINE.
C'est vous, Stéfani? De quoi parlez-vous?
LE MARQUIS.
Eh! de ce que vous venez de faire.
BETTINE.
Étiez-vous lŕ? M'auriez-vous écoutée?
LE MARQUIS.
Non, Dieu m'en garde! mais j'ai entendu.
BETTINE.
Marquis!
LE MARQUIS.
Ne vous fâchez pas, de grâce, et ne vous défendez pas non plus. Je
venais vous voir tout bonnement, comme je vous l'avais dit, pour vous
faire mes adieux. Il n'y avait personne ŕ la salle basse, ni personne
dans la galerie. J'attendais, devant vos tableaux, qu'il vint ŕ passer
quelqu'un de vos gens, lorsque votre voix est venue jusqu'ŕ moi. Je
n'ai pas tout saisi au juste, mais j'ai bien compris ŕ peu prčs. Vous
payez une petite dette et vous ne voulez pas qu'on le sache. Vous vous
cachez męme sous le nom d'un autre;--c'est bien vous, cela, Élisabeth.
Seriez-vous blessée de ce qu'une fois de plus j'ai eu la preuve de
tout ce que votre âme renferme de délicatesse et de générosité?
BETTINE.
Mais... est-ce qu'il y a longtemps que vous ętes lŕ?
LE MARQUIS.
Non, il n'y a pas plus de deux minutes, et, je vous le dis, j'ai
compris vaguement. Comme je mettais le pied sur l'escalier, j'ai
aperçu votre monsieur de... Steinberg, qui s'en allait par le jardin.
Il ne m'a pas rendu mon salut. Est-ce que je lui ai fait quelque
chose?
BETTINE.
Plaisantez-vous? Il vous connaît ŕ peine.
LE MARQUIS.
Vous pourriez męme dire pas du tout.
BETTINE.
Il ne vous aura sűrement pas vu. Il était trčs préoccupé.
LE MARQUIS.
Oui,... je comprends bien;... cet argent perdu, pas vrai? ce jeune
homme-lŕ joue trop gros jeu.
BETTINE.
Oui.
LE MARQUIS.
Oui, et il ne sait pas jouer.
_Bettine s'assied pensive._
Il ne faut pas croire que le lansquenet, tout bęte qu'il est, soit
de pur hasard. Il y a maničre de perdre son argent. Je sais bien
qu'ŕ tout prendre c'est un jeu aussi savant que pile ou face ou la
bataille. L'indifférent qui regarde n'en voit point davantage; mais
demandez ŕ celui qui touche aux cartes si elles ne lui représentent
que cela. Ces petits morceaux de carton peint ne sont pas seulement
pour lui rouge ou noir; ils veulent dire heur ou malheur. La fortune,
dčs qu'on l'appelle, peu importe par quel moyen, accourt et voltige
autour de la table, tantôt souriante, tantôt sévčre; ce qu'il faut
étudier pour lui plaire, ce n'est pas le carton peint ni les dés, ce
sont ses caprices, ce sont ses boutades qu'il faut pressentir, qu'il
faut deviner, qu'il faut savoir saisir au vol... Il y a plus de
science au fond d'un cornet que n'en a ręvé d'Alembert.
BETTINE.
Vous parlez en vrai joueur, marquis.--Est-ce que vous l'avez été?
LE MARQUIS.
Oui, et joueur assez heureux, parce que j'étais trčs hardi quand je
gagnais, et dčs que la fortune me tournait le dos, cela m'ennuyait.
BETTINE.
On dit que cette passion-lŕ ne se corrige jamais.
LE MARQUIS.
Bon! comme les autres. Mais je suis lŕ ŕ bavarder... Je ne voulais que
vous baiser la main, et je me sauve, car j'importunerais...
BETTINE.
Non, Stéfani, restez, je vous en prie. Puisque vous savez ŕ peu
prčs mes secrets, nous n'en dirons rien, n'est-ce pas? Et vous me
pardonnerez si je suis distraite.--Le chagrin n'est jamais aimable.
LE MARQUIS.
Celui que vous avez est bien mieux que cela: il est estimable, et il
vous honore. Je connais des gens qui rendent service comme l'ours de
la fable avec son pavé. Ils se font prier, ils vous marchandent,
et lorsqu'ils vous croient suffisamment plein d'une reconnaissance
éternelle, ils vous assomment d'un affreux bienfait. Ils détruisent
ainsi tout le vrai prix des choses, la bonne grâce d'une bonne action.
Vous n'avez pas de ces façons-lŕ, ma chčre, et votre main est plus
légčre encore lorsqu'elle obéit ŕ votre coeur que lorsqu'elle court
sur ce piano pour exprimer votre pensée.
BETTINE.
Asseyez-vous donc, je vous en supplie.
LE MARQUIS, _s'asseyant_.
Ŕ la bonne heure, pourvu que vous me promettiez, une minute avant que
je sois de trop, d'ętre assez de mes amis pour me mettre ŕ la porte.
BETTINE.
De vos amis, marquis? Ŕ propos, savez-vous bien que vous m'avez
envoyé un bouquet magnifique, mais ŕ tel point que je ne l'accepterais
certainement de personne au monde, excepté vous.
LE MARQUIS.
Il n'y a ni perle ni diamant qui vaille une telle parole échappée de
vos lčvres.--Mais il y a quelque chose qui me tracasse.--Laissez-moi
vous faire une seule question. Est-ce que, dans ces affaires-lŕ, vous
ne prenez pas vos précautions?
BETTINE.
Quelles précautions?
LE MARQUIS.
Mais, dame! une signature, une hypothčque, une garantie.
BETTINE.
Je n'entends rien ŕ tout cela.
LE MARQUIS.
Vous avez tort, morbleu! vous avez tort.
BETTINE.
C'était donc lŕ ce qui vous faisait dire, en entrant, qu'il y avait un
danger pour moi?
LE MARQUIS.
Précisément.
BETTINE.
Expliquez-vous donc.
LE MARQUIS.
C'est que cela est fort délicat, et puis j'augmenterais vos
inquiétudes.
BETTINE.
Le vrai moyen de les augmenter, c'est de ne parler qu'ŕ demi.
LE MARQUIS.
Vous avez raison, et j'ai tort. N'en parlons plus; prenez que je n'ai
rien dit.
_Il se lčve._
BETTINE.
Non pas, car je comprends vos craintes... Vous connaissez la
princesse?
LE MARQUIS.
Eh! oui, eh! oui, je la connais.
BETTINE.
La croyez-vous capable d'une mauvaise action?
LE MARQUIS.
Eh! je n'en sais rien.
BETTINE.
Mais je dis,... d'une perfidie,... d'une noirceur...
LE MARQUIS.
Eh! qui en répondrait?
BETTINE.
Stéfani, vous m'épouvantez. Écoutez-moi: vous m'avez vue ce matin
presque jalouse de cette femme.
LE MARQUIS.
Vous l'étiez bien un peu tout ŕ fait.
BETTINE.
Oui, par instants; mais vous savez ce que c'est, mon ami:--on croit
douter des gens qu'on aime, on les accable de reproches, on les
appelle parjures, infidčles;... au fond de l'âme on n'en croit pas un
mot, et pendant que la bouche accuse, le coeur absout. N'est-ce pas
vrai?
LE MARQUIS.
Sans doute. Eh bien? ma chčre Bettine...
BETTINE.
Eh bien! marquis, sincčrement, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais
cru possible qu'il aimât cette femme. Cette horrible idée me vient
maintenant. Vous l'avez vu chez elle,--qu'en pensez-vous?
LE MARQUIS.
Bon Dieu! ma belle, que demandez-vous lŕ? On ne voit pas les coeurs,
comme dit Moličre. Franchement, d'ailleurs, je n'en crois rien.
BETTINE.
Que voulait dire alors ce danger dont vous me parliez?
LE MARQUIS.
Ah! c'est qu'il y a princesse et princesse, comme il y a fagot et
fagot.
BETTINE.
Et vous croyez que celle-ci...
LE MARQUIS.
Elle me fait tant soit peu l'effet de n'ętre pas de bien bonne
fabrique, et d'avoir été achetée de hasard.
BETTINE.
S'il en est ainsi...
LE MARQUIS.
Je n'en suis pas sűr; mais je conviens qu'il m'est pénible de voir le
sort d'une personne comme vous entre les mains d'une femme comme elle.
BETTINE.
Je ne saurais croire que Steinberg...
LE MARQUIS.
Puisse vous tromper? Je suis de votre avis. Eh! palsambleu! s'il ne
vous adore pas, je le plains bien sincčrement. Tenez, on vient, c'est
lui, je me retire. Non, ce n'est pas lui, c'est son valet de chambre.
SCČNE XVIII
LES PRÉCÉDENTS, CALABRE.
BETTINE.
Eh bien! Calabre, qu'as-tu fait?
CALABRE.
Tout ce que vous m'aviez dit, madame.
BETTINE.
L'argent est payé?
CALABRE.
Oui, madame.
BETTINE.
As-tu vu Steinberg?
CALABRE.
Hélas! oui.
BETTINE.
Que t'a-t-il dit?
CALABRE.
Voici une lettre.
BETTINE, _aprčs avoir lu vite_.
Ah! c'est trčs bien,... parfaitement bien,... c'est ŕ merveille.
_Elle tombe évanouie sur un fauteuil._
CALABRE.
Madame! madame!
LE MARQUIS.
Qu'y a-t-il donc?
CALABRE.
Veillez sur elle, monsieur, je vais chercher ce qu'il faut.
LE MARQUIS, _tirant un flacon_.
Ce flacon suffira. Qu'ętes-vous donc venu lui annoncer?
CALABRE.
Ah! monsieur, c'est horrible ŕ dire!... Il est parti avec la
princesse.
LE MARQUIS.
Parti!--La voici qui rouvre les yeux. Il faut lui ôter cette lettre...
_Il va pour prendre la lettre que Bettine tient ŕ la main._
BETTINE.
Non, non!... oh! ne m'ôtez pas cela... Oů suis-je donc? J'ai fait un
ręve. C'est vous, marquis? Je vous demande pardon.
LE MARQUIS.
Restez en repos; ne vous levez pas.
BETTINE.
Ah! malheureuse! je me souviens. Il est parti; n'est-ce pas, Calabre?
Savez-vous cela, Stéfani?--Il est parti avec cette femme! Tenez, lisez
cette lettre, lisez-la tout haut.
LE MARQUIS.
Je sais tout, ma chčre.
BETTINE.
Ah! vraiment? Cette nouvelle est-elle déjŕ connue? Suis-je déjŕ la
fable de la ville? Sans doute il y a du plaisant dans cette aventure,
elle fournira matičre ŕ la gaieté publique; mais comment oseraient-ils
rire de moi, avant de savoir ce que je vais faire? Tout n'est pas
fini, et apparemment j'ai aussi le droit de dire mon mot dans cette
comédie.
LE MARQUIS.
Personne ne se rira de vous. Il n'y a rien de moins plaisant que de
voler l'argent du prochain.
BETTINE, _s'animant par degrés_.
Voler! qui parle d'une chose pareille? Cette somme dont j'ai disposé,
je l'ai donnée volontairement, j'ai supplié qu'on l'acceptât. J'ai été
obligée d'employer la ruse pour vaincre un refus obstiné. Il est vrai
que mon stratagčme n'a pas tourné ŕ mon avantage; mais qui peut dire
que je m'en repente? Si c'est de cela que vous me plaignez, vous me
supposez un singulier chagrin.
_Elle se lčve._
LE MARQUIS.
Je ne sais pas quelle est la somme, mais il paraît que ce n'est pas
peu de chose.
BETTINE.
Eh! que m'importe? Quelle étrange idée vous faites-vous donc des
personnes męmes que vous prétendez estimer, si vous ne voyez ici
qu'une affaire d'intéręt? Ah! que Steinberg fűt revenu ŕ moi, est-ce
que le reste comptait pour quelque chose? Mais c'est ainsi que juge
le monde.--Un amour trompé, qu'est-ce que cela? Une femme qu'on
abandonne, un serment qu'on trahit, un lien sacré qu'on brise, ce ne
sont que des bagatelles! cela se voit tous les jours, cela se raconte,
cela égaie la bonne compagnie! mais qu'il s'agisse de quelques écus de
moins, de quelques misérables poignées de jetons qu'on aura perdus par
hasard, oh! alors chacun vous plaindra, et votre souffrance pécuniaire
sera l'objet d'une pitié sordide, ŕ faire monter la rougeur au front.
LE MARQUIS.
Votre chagrin est cause, Bettine, que vous adressez mal vos reproches.
BETTINE.
Oui, mon ami, vous avez raison. Je sais qui vous ętes, je vous
offense; mais ce que j'éprouve est si affreux, qu'il faut me pardonner
ce que je puis dire, car je n'en sais rien, je suis au fond d'un
abîme. Tenez, Stéfani, lisez-moi cela. Lisez tout haut, je vous en
prie.
LE MARQUIS, _lisant_.
«Ma chčre Bettine,
«Bien que vous ayez agi sans mon consentement, je suis obligé de vous
remercier de ce que vous venez de faire pour moi...»
BETTINE.
Obligé de me remercier!
LE MARQUIS, _continuant_.
«Mais vous comprenez que mon premier soin doit ętre de chercher les
moyens de vous rendre la somme que vous avez bien voulu m'avancer...»
BETTINE.
On n'écrirait pas mieux ŕ un homme d'affaires.
LE MARQUIS, _de męme_.
«Le projet que nous avions formé ne pouvant plus se réaliser,
les convenances męmes semblent s'opposer ŕ ce que je demeure plus
longtemps prčs de vous...»
BETTINE.
Que dites-vous de cela, marquis?
LE MARQUIS, _de męme_.
«Je vais donc quitter ce pays. Une personne de nos amies...»
BETTINE.
Quelle audace!
LE MARQUIS, _de męme_.
«... De nos amies part maintenant pour Rome, et m'offre de
l'accompagner. Je sais, du reste, que je ne vous laisse pas seule...»
BETTINE.
Continuez, continuez.
LE MARQUIS, _de męme_.
«Et que je puisse revenir ou non, vous pouvez compter, chčre Bettine,
que vous recevrez bientôt de mes nouvelles.
«STEINBERG.»
BETTINE.
Steinberg! Que le monde prononce ton nom quand il voudra parler d'un
ingrat!
LE MARQUIS.
Il est certain que tout cela n'est pas beau. En vérité, cela
demanderait vengeance.
BETTINE.
Vengeance! ah! oui, n'en doutez pas! Mais quelle vengeance puis-je
trouver? Vous parlez en homme, Stéfani, et vous ressentez en homme un
affront. Vous-męme, cependant, que pouvez-vous faire quand vous avez
un ennemi? Que pouvez-vous de plus que de le tuer? Vous croyez vous
venger ainsi... Ah! mon ami, pour un coeur honnęte, il y a des maux
plus affreux que la mort; mais pour un lâche, ce qu'il y a de plus
terrible, c'est la mort, qui n'est rien.
LE MARQUIS.
Je gagerais que cette lettre impertinente n'est pas entičrement du
fait de votre baron. Il y a de la femme lŕ dedans,--c'est un monstre ŕ
deux tętes,--car enfin quelle nécessité de vous avertir qu'il ne s'en
va pas seul? La lâcheté est de lui, l'insulte est féminine.
BETTINE.
Je l'ai senti comme vous. Il le sait bien aussi, et il a voulu mettre
entre nous une barričre infranchissable. Il craignait que je ne
voulusse le suivre, il avait peur de mon pardon, et il a pris ce moyen
de l'éviter; il savait que, lorsqu'une femme frappe le coeur d'une
autre, elle rend toute espčce de retour impossible, et que la blessure
ne se guérit pas. O perfide! le jour męme qui était fixé, qu'il avait
choisi pour notre mariage!... Hier au soir, il fallait voir comme
il savait dissimuler! Il semblait, dans son impatience, souffrir
d'attendre qu'il fît jour. O ciel! c'est moi qu'on joue ainsi! mon âme
loyale ainsi traitée! Vous me connaissez, marquis, n'est-ce pas? Eh
bien! j'ai combattu mon caractčre trop vif, j'ai plié mon orgueil,
afin de supporter ce qui me révoltait souvent, mais du moins ce que je
croyais fait sans fausseté, sans dessein de nuire. Maintenant, je
te vois tel que tu es, traître, et tu déchires mon coeur et mon
honneur!
LE MARQUIS.
Ah ça! je pense ŕ un mot de cette lettre. Lorsqu'il vous dit qu'il ne
vous laisse pas seule, qu'est-ce qu'il entend par ces paroles? Est-ce
donc que Calabre reste auprčs de vous?
CALABRE.
Oh! non, monsieur, cela signifie autre chose.
BETTINE.
Tais-toi, Calabre.
LE MARQUIS.
Pourquoi donc?--Est-ce une indiscrétion que je viens de commettre?
_Bettine ne répond pas. Calabre fait un signe au marquis, et lui
montre l'écrin qui est sur la table._
LE MARQUIS.
Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ŕ ton tour?
CALABRE.
Madame me défend de parler.
BETTINE.
Parle si tu veux.
LE MARQUIS, _se levant et allant ŕ la table_.
Ceci pique fort ma curiosité. Qu'y a-t-il donc, monsieur Calabre?
CALABRE.
Eh bien! monsieur, puisqu'on me permet de le dire, c'est que cet écrin
est cause en partie de tout ce qui arrive.
LE MARQUIS.
Vous voulez badiner, sans doute?
CALABRE.
Pas le moins du monde. Monsieur le baron a fait des reproches
horribles ŕ madame d'avoir accepté ces bijoux.
LE MARQUIS.
Mais cela n'a pas le sens commun!
CALABRE.
Et ce matin, monsieur, s'il faut ne vous rien taire, j'étais chargé
moi-męme de dire ŕ madame qu'elle eűt ŕ ne vous point recevoir.
LE MARQUIS.
Ah ça! mais cela a l'air d'un ręve... Est-ce que c'est vrai, Bettine,
ce qu'on me raconte lŕ?
BETTINE.
Trčs vrai.
LE MARQUIS.
Mais cela tient du prodige. Ŕ propos de quoi cette querelle
d'Allemand? ce ne pouvait ętre qu'un méchant prétexte dont il avait
besoin pour se fâcher.
CALABRE.
Oh! mon Dieu oui, monsieur, pas autre chose.
LE MARQUIS.
J'entends. Mais quelle bizarre idée!
CALABRE.
C'est que monsieur le marquis venait voir souvent madame, du temps
qu'elle était ŕ Florence, et monsieur le baron s'est imaginé...
LE MARQUIS.
Quelque sottise.
CALABRE.
Il s'est persuadé, en vous voyant arriver ici, que vous alliez
recommencer ŕ faire votre cour ŕ madame.
LE MARQUIS.
Eh bien?
CALABRE.
Et cela l'a fâché.
LE MARQUIS.
C'est malheureux. Quoi! il va l'épouser, et voilŕ le cas qu'il sait
faire d'elle? Mais c'est un drôle que ce monsieur.
BETTINE.
Stéfani! songez que je l'ai aimé.
LE MARQUIS.
C'est juste, je vous demande pardon. Je n'ai pas les męmes raisons que
vous pour le ménager. Ainsi donc, cher monsieur Calabre, vous dites
qu'on est jaloux de moi?
CALABRE.
Oui, monsieur.
LE MARQUIS.
En vérité? Eh bien! cela me fait plaisir, cela me rajeunit.--Ah! on
est jaloux de moi!
_Aprčs un silence._
Eh bien! morbleu! il a raison.--Bettine, écoutez-moi. Vous avez aimé,
vous vous ętes trompée, vous avez fait un mauvais choix, vous en
portez la peine; cela est fâcheux, mais cela arrive aux plus honnętes
gens, c'est męme ŕ eux que cela ne manque gučre. Si maintenant vous
avez quelque rancune, et la moindre disposition ŕ courir en poste
aprčs le passé, je suis tout pręt et je vous aiderai trčs volontiers
ŕ prendre une revanche qui vous est bien due. Si je n'ai plus le pied
assez leste pour me jeter dans une valse, je l'ai encore, Dieu merci,
assez ferme pour soutenir un coup d'épée, et je serais ravi de rendre
ŕ ce monsieur celui que j'ai reçu autrefois pour vous.
BETTINE.
Mon ami...
LE MARQUIS.
Si, au contraire (ce qui, ŕ mon avis, serait infiniment préférable),
vous pouviez avoir la patience, je dirai męme le bon sens, de laisser
faire le médecin qui guérit toute chose, le temps, connu depuis que le
monde existe, je m'offre ŕ vous.
BETTINE.
Vous, Stéfani?
LE MARQUIS.
Moi, non pas aujourd'hui, non pas demain, non pas dans un mois ni dans
six, mais quand vous voudrez, quand cela vous plaira, si jamais cela
peut vous plaire, quand vous serez calmée, guérie, redevenue tout
ŕ fait vous-męme, c'est-ŕ-dire gaie, aimable et charmante; quand la
blessure qu'un ingrat vous a faite s'effacera avec les jours d'oubli,
oui, je le répčte, je m'offre ŕ vous. On dit que je veux vous faire ma
cour, on a raison; que je vous ai aimée, on a raison; que je vous aime
encore, on a raison; et ce que je vous dis lŕ, il y a trois ans que
j'aurais dű vous le dire, et je vous le dirai toute ma vie.
BETTINE.
Puisque vous me parlez avec cette franchise, je ne veux pas ętre moins
sincčre que vous. Répondre sur-le-champ ŕ ce que vous me proposez,
vous comprenez que c'est impossible...
LE MARQUIS.
Quand vous voudrez.
BETTINE.
Mais ce que je puis et ce que je veux vous dire, tout de suite et sans
hésiter, c'est qu'au milieu des chagrins que j'éprouve et de toute
l'horreur qui m'accable, ŕ cet instant oů mon coeur est brisé par
un abandon si cruel et une trahison si basse, vos paroles viennent
d'y exciter une émotion qui m'est bien douce. Et pourquoi vous le
cacherais-je? oui, Stéfani, je suis heureuse de voir que ce monde
n'est pas encore désert, et que, si le mensonge et la perfidie peuvent
quelquefois s'y rencontrer, on y peut aussi trouver sur sa route la
main fidčle d'un ami. Je le savais, mais j'allais l'oublier. Vous m'en
avez fait souvenir,... voilŕ ce dont je vous remercie.
LE MARQUIS.
Et vous pourriez douter qu'on vous aime!
BETTINE.
Non, je crois ce que vous me dites; mais il y a une réflexion que vous
n'avez pas faite. Savez-vous bien ŕ qui vous parlez?
LE MARQUIS.
Ŕ la plus charmante femme que je connaisse.
BETTINE.
Considérez ceci, marquis: je suis tout ŕ fait désespérée. Le coup
que je viens de recevoir est si imprévu, si inconcevable, qu'il m'a
d'abord anéantie. Maintenant que ma raison se réveille peu ŕ peu, je
cherche comment je pourrais continuer de vivre, et, en vérité, je ne
le vois pas.
LE MARQUIS.
Prenez courage.
BETTINE.
Non, je ne le vois pas. Ŕ examiner froidement, raisonnablement ce
qui m'arrive, je ne veux pas vous tromper, je ne vois nul remčde, nul
espoir. Je perds l'homme que j'aimais, et ce qu'il y a de plus
affreux encore, je suis forcée de le mépriser. Que voulez-vous que je
devienne? Es-tu de mon avis, Calabre? Plus je réfléchis, et plus je
vois qu'il n'y a plus pour moi d'existence possible. Je ne peux plus
rien faire que prier et pleurer. Est-ce ŕ ce reste de moi-męme, ŕ
ce fantôme de votre amie que vous voulez donner la main? est-ce ŕ un
masque couvert de larmes?
_Elle pleure._
LE MARQUIS.
Oui, morbleu! et ces larmes-lŕ, je ne vous demanderai jamais de
les essuyer. Je respecte trop votre douleur pour tâcher de vous en
distraire, mais je vous dis: le temps s'en chargera,--et laissez-moi
aussi achever ma pensée, dűt-elle vous choquer en ce moment. Vous
n'avez plus, dites-vous, d'existence possible? Vous en avez une toute
faite, la seule qui vous convienne, celle que vous aimez, que
vous avez choisie, qui est notre plaisir et votre gloire... Vous
retournerez au théâtre.
BETTINE.
Y pensez-vous?
LE MARQUIS.
Pourquoi donc pas? Cela vous paraît-il si étrange, qu'en vous offrant
d'ętre votre époux, je vous parle de remonter sur la scčne? Oui, je
me souviens que, ce matin, vous me disiez qu'une fois mariée, vous
y comptiez renoncer pour toujours; mais je vous ai répondu, ce me
semble, que ce n'était point mon avis, ni de mon goűt, je vous assure.
Est-ce qu'on résiste ŕ son talent? En a-t-on la force, en a-t-on le
droit, surtout quand ce talent heureux vous a portée sur cette jolie
montagne oů les Muses dansent autour d'Apollon, et les abeilles autour
des Muses?... Croyez-vous donc que l'on puisse ętre tout bonnement
baronne ou marquise, en revenant de ce pays-lŕ? Oh! que non pas!
La nature parle: bon gré, mal gré, il faut qu'on l'écoute. Eh!
palsambleu! un počte fait des vers et un musicien des chansons, tout
comme un pommier fait des pommes. Lorsqu'on me raconte que Rossini se
tait, je déclare que je n'en crois rien. Et vous non plus, Bettine,
vous ne vous tairez pas. Vous retrouverez force et vaillance, vous
reprendrez la harpe de Desdémone, et moi ma place dans mon petit
coin, ŕ côté de mon cher quinquet. Vous reverrez cette foule émue,
attentive, qui suit vos moindres gestes, qui respire avec vous, ce
parterre qui vous aime tant, ces vieux dilettanti qui frappent de
leurs cannes, ces jeunes dandies qui, parés pour le bal, déchirent
leurs gants en vous applaudissant, ces belles dames dans leurs loges
dorées, qui, lorsque le coeur leur bat aux accents du génie, lui
jettent si noblement leurs bouquets parfumés! Tout cela vous attend,
vous regrette et vous appelle... Ah! je jouissais jadis de vos
triomphes! votre amitié m'en donnait une part.--Que serait-ce donc si
vous étiez ŕ moi!
BETTINE.
Ah! Stéfani... Mais c'est impossible.
LE MARQUIS.
Ne le dites pas trop vite, ne vous hâtez pas. C'est lŕ tout ce que je
vous demande.
_Il lui baise la main._
LE NOTAIRE, _sortant du pavillon_.
Monsieur Calabre!
CALABRE.
Ah! c'est vous?
LE NOTAIRE.
Oui, il n'y a plus de moscatelle, et je ne vois toujours pas les
futurs conjoints. Je vais retourner ŕ la ville.
CALABRE, _lui montrant Bettine, qui a laissé sa main dans celle du
marquis_.
Attendez, attendez un peu.
FIN DE BETTINE.
Le rôle de Bettine a été écrit pour madame Rose Chéri, qui joignait
ŕ son talent de comédienne ceux de pianiste habile et de musicienne
consommée. Cette pičce, représentée pour la premičre fois sur le
théâtre du Gymnase dramatique, le 30 octobre 1851, fut écoutée avec
une apparence d'attention et de respect, mais dans un morne silence.
Il ne serait pas facile d'expliquer aujourd'hui pourquoi ce charmant
ouvrage n'a pas obtenu plus de faveur.
* * * * *
CARMOSINE
COMÉDIE EN TROIS ACTES
PUBLIÉE EN 1852, REPRÉSENTÉE EN 1865.
PERSONNAGES. ACTEURS
QUI ONT CRÉÉ LES RÔLES.
PIERRE D'ARAGON, roi de Sicile. MM. BONDOIS.
MAITRE BERNARD, médecin. LAUTE.
MINUCCIO, troubadour. THIRON.
PERILLO, jeune avocat. LAROCHE.
SER VESPASIANO, chevalier de fortune. ROMANVILLE.
UN OFFICIER DU PALAIS.
MICHEL, domestique chez maître Bernard.
LA REINE CONSTANCE, femme du roi Pierre. Mlle OTHON.
DAME PAQUE, femme de maître Bernard. Mme MASSON.
CARMOSINE, leur fille. Mlle THUILLIER.
PAGES, ÉCUYERS, DEMOISELLES D'HONNEUR, SUIVANTES DE LA REINE.
_La scčne se passe ŕ Palerme._
[Illustration: Carmosine]
ACTE PREMIER
_Une salle chez maître Bernard._
SCČNE PREMIČRE
MAITRE BERNARD, DAME PAQUE.
DAME PAQUE.
Faites-moi le plaisir de laisser lŕ vos drogues, et d'écouter un peu
ce que je vous dis.
MAITRE BERNARD.
Faites-moi la grâce de ne pas me le dire du tout, ce sera tout
aussitôt fait.
DAME PAQUE.
Comme il vous plaira. Mélangez vos herbes empestées tout ŕ votre aise.
Le seul résultat de votre obstination sera de la voir mourir dans nos
bras.
MAITRE BERNARD.
Si mes remčdes ne peuvent rien, que peut donc votre bavardage? Mais
c'est votre unique passe-temps de nous inonder de discours inutiles.
Dieu merci, la patience est une belle vertu.
DAME PAQUE.
Si vous aimiez votre pauvre fille, elle serait bientôt guérie.
MAITRE BERNARD.
Pourquoi me dites-vous cela? Ętes-vous folle? Ne voyez-vous pas ce
que je fais du matin au soir? Pauvre chčre âme! tout ce que j'aime!
Dites-moi, n'est-ce donc pas assez de voir souffrir l'enfant de mon
coeur, sans avoir sur le dos vos éternels reproches? car on dirait,
ŕ vous entendre, que je suis cause de tout le mal. Y a-t-il moyen de
rien comprendre ŕ cette mélancolie qui la tue? Maudites soient les
fętes de la reine, et que les tournois aillent ŕ tous les diables!
DAME PAQUE.
Vous en revenez toujours ŕ vos moutons.
MAITRE BERNARD.
Oui, on ne m'ôtera pas de la tęte qu'elle est tombée malade un
dimanche, précisément en revenant de la passe d'armes. Je la vois
encore s'asseoir lŕ, sur cette chaise; comme elle était pâle et toute
pensive! comme elle regardait tristement ses petits pieds couverts de
poussičre? Elle n'a dit mot de la journée, et le souper s'est passé
sans elle.
DAME PAQUE.
Allez, vous n'ętes qu'un vieux ręveur. Le meilleur de tous les
remčdes, je vous le dirai, malgré votre barbe: c'est un beau garçon et
un anneau d'or.
MAITRE BERNARD.
Si cela était, pourquoi refuserait-elle tous les partis qu'on lui
présente? Pourquoi ne veut-elle męme pas entendre parler de Perillo,
qui était son ami d'enfance?
DAME PAQUE.
Vraiment, elle s'en soucie bien! Laissez-moi faire. On lui proposera
telle personne qu'elle ne refusera pas.
MAITRE BERNARD.
Je sais ce que vous voulez dire, et pour celui-lŕ, c'est moi qui le
refuse. Vous vous ętes coiffée d'un flandrin.
DAME PAQUE.
Vous verrez vous-męme ce qui en est.
MAITRE BERNARD.
Ce qui en est? Mais, dame Pâque, il y a pourtant dans ce monde
certaines choses ŕ considérer. Je ne suis pas un grand seigneur,
madame, mais je suis un honnęte médecin, un médecin assez riche,
dame Pâque, et męme fort riche pour cette ville; j'ai dans mon coffre
quantité de sacs bien et dűment cachetés. Je ne donnerai pas plus ma
fille pour rien, que je ne la vendrai, entendez-vous?
DAME PAQUE.
Vraiment, vous ferez bien, et votre fille mourra de votre sagesse, si
elle ne meurt de vos potions. Laissez donc lŕ ce flacon, je vous
en prie, et n'empoisonnez pas davantage cette pauvre enfant. Ne
voyez-vous donc pas, depuis deux mois, que vos drogueries ne servent
ŕ rien? Votre fille est malade d'amour, voilŕ ce que je sais, moi, de
bonne part. Elle aime ser Vespasiano, et toutes les fioles de la terre
n'y changeront pas un iota.
MAITRE BERNARD.
Ma fille n'est point une sotte, et ser Vespasiano est un sot.
Qu'est-ce qu'un âne peut faire d'une rose?
DAME PAQUE.
Ce n'est pas vous qui l'épouserez. Essayez donc d'avoir le sens
commun. Ne convenez-vous pas que c'est en revenant des fętes de la
reine que votre fille est tombée malade? N'en parle-t-elle pas sans
cesse? N'amčne-t-elle pas toujours les entretiens sur ce chapitre, sur
l'habileté des cavaliers, sur les prouesses de celui-lŕ, sur la belle
tournure de celui-ci? Est-il rien de plus naturel ŕ une jeune fille
sans expérience que de sentir son coeur battre tout ŕ coup pour la
premičre fois, ŕ la vue de tant d'armes resplendissantes, de tant de
chevaux, de banničres, au son des clairons, au bruit des épées? Ah!
quand j'avais son âge!...
MAITRE BERNARD.
Quand vous aviez son âge, dame Pâque, il me semble que vous m'avez
épousé, et il n'y avait point lŕ de trompettes.
DAME PAQUE.
Je le sais bien, mais ma fille est mon sang. Or, dans ces fętes, je
vous le demande, ŕ qui peut-elle s'intéresser? Qui doit-elle chercher
dans la foule, si ce n'est les gens qu'elle connaît? Et quel autre,
parmi nos amis, quel autre que le beau, le galant, l'invincible ser
Vespasiano?
MAITRE BERNARD.
Ŕ telle enseigne, qu'au premier coup de lance, il est tombé les quatre
fers en l'air.
DAME PAQUE.
Il se peut que son cheval ait fait un faux pas, que sa lance se soit
détournée, je ne nie pas cela; il se peut qu'il soit tombé.
MAITRE BERNARD.
Cela se peut assurément; il a pirouetté en l'air comme un volant, et
il est tombé, je vous le jure, autant qu'il est possible.
DAME PAQUE.
Mais de quel air il s'est relevé!
MAITRE BERNARD.
Oui, de l'air d'un homme qui a son dîner sur le coeur, et une forte
envie de rester par terre. Si un pareil spectacle a rendu ma fille
malade, soyez persuadée que ce n'est pas d'amour. Allons, laissez-moi
lui porter ceci.
DAME PAQUE.
Faites ce que vous voudrez. Je vous préviens que j'ai invité ce
chevalier ŕ souper. Que votre fille ait faim ou non, elle y viendra,
et vous jugerez par vous-męme de ce qui se passe dans son coeur.
MAITRE BERNARD.
Et pourquoi ne parlerait-elle pas, si vous aviez raison? Suis-je donc
un tyran, s'il vous plaît? Ai-je jamais rien refusé ŕ ma fille, ŕ mon
unique bien? Est-ce qu'il peut lui tomber une larme des yeux sans que
tout mon coeur... Juste ciel! plutôt que de la voir ainsi s'éteindre
sans dire une parole, est-ce que je ne voudrais pas?... Allons! vous
me rendriez fou!
_Ils sortent chacun d'un côté différent._
SCČNE II
PERILLO, _seul, entrant_.
Personne ici! Il me semblait avoir entendu parler dans cette chambre.
Les clefs sont aux portes, la maison est déserte. D'oů vient cela? En
traversant la cour, un pressentiment m'a saisi... Rien ne ressemble
tant au malheur que la solitude;... maintenant j'ose ŕ peine
avancer.--Hélas! je reviens de si loin, seul et presque au hasard;
j'avais écrit pourtant, mais je vois bien qu'on ne m'attendait
pas. Depuis combien d'années ai-je quitté ce pays? Six ans! Me
reconnaîtra-t-elle? Juste ciel! comme le coeur me bat! Dans cette
maison de notre enfance, ŕ chaque pas un souvenir m'arręte. Cette
salle, ces meubles, les murailles męme, tout m'est si connu, tout
m'était si cher! D'oů vient que j'éprouve ŕ cet aspect un charme
plein d'inquiétude qui me ravit et me fait trembler? Voilŕ la porte du
jardin, et celle-ci!... J'ai fait bien du chemin pour venir y frapper;
ŕ présent j'hésite sur le seuil. Hélas! lŕ est ma destinée; lŕ est
le but de toute ma vie, le prix de mon travail, ma supręme espérance!
Comment va-t-elle me recevoir? Que dira-t-elle? Suis-je oublié?
Suis-je dans sa pensée? Ah! voilŕ pourquoi je frissonne;... tout est
dans ces deux mots, l'amour ou l'oubli!... Eh bien! quoi? Elle est lŕ
sans doute. Je la verrai, elle me tendra la main: n'est-elle pas ma
fiancée? n'ai-je pas la promesse de son pčre? n'est-ce pas sur cette
promesse que je suis parti? n'ai-je pas rempli toutes les miennes?
Serait-il possible?... Non, mes doutes sont injustes; elle ne peut
ętre infidčle au passé. L'honneur est dans son noble coeur, comme
la beauté sur son visage, aussi pur que la clarté des cieux. Qui sait?
elle m'attend peut-ętre; et tout ŕ l'heure... O Carmosine!
SCČNE III
PERILLO, MAITRE BERNARD.
MAITRE BERNARD.
Silence! elle dort. Quelques heures de bon sommeil, et elle est
sauvée.
PERILLO.
Qui, monsieur?
MAITRE BERNARD.
Oui, sauvée, je le crois, du moins.
PERILLO.
Qui, monsieur?
MAITRE BERNARD.
C'est toi, Perillo? ma pauvre fille est bien malade.
PERILLO.
Carmosine! Quel est son mal?
MAITRE BERNARD.
Je n'en sais rien. Eh bien! garçon, tu reviens de Padoue; j'ai reçu ta
lettre l'autre jour; tu as terminé tes études, passé tes examens, tu
es docteur en droit, tu vas recevoir et bien porter le bonnet carré;
tu as tenu parole, mon ami; tu étais parti bon écolier, et tu reviens
savant comme un maître. Hé! hé! voilŕ une belle carričre devant toi.
Ma pauvre fille est bien malade.
PERILLO.
Qu'a-t-elle donc, au nom du ciel?
MAITRE BERNARD.
Hé! je te dis que je n'en sais rien. C'est une joie pour moi de
te revoir, mon brave Antoine, mais une triste joie; car pourquoi
viens-tu? Il était convenu entre ton pčre et moi que tu épouserais ma
fille dčs que tu aurais un état solide; tu as bien travaillé, n'est-ce
pas? ton coeur n'a pas changé, j'en suis sűr, le mien non plus, et
maintenant... O mon Dieu! Qu'a-t-elle donc fait?
PERILLO.
Vos paroles me font frémir. Quoi! sa vie est-elle en danger?
MAITRE BERNARD.
Veux-tu me faire mourir moi-męme, ŕ te répéter cent fois que je
l'ignore? Elle est malade, Perillo, bien malade.
PERILLO.
Se pourrait-il qu'un homme aussi habile, aussi expérimenté que
vous?...
MAITRE BERNARD.
Oui, expérimenté, habile! Voilŕ justement ce qu'ils disent tous. Ne
croirait-on pas que j'ai dans ma boutique la panacée universelle, et
que la mort n'ose pas entrer dans la maison d'un médecin? [Je ne
m'en suis pas fié ŕ moi seul, j'ai appelé ŕ mon aide tout ce que je
connais, tout ce que j'ai pu trouver au monde de docteurs, d'érudits,
d'empiriques męme, et nous avons dix fois consulté. Habileté de
ręveurs, expérience de routine! La nature, Perillo, qui mine et
détruit, quand elle veut se cacher, est impénétrable. Qu'on nous
montre une plaie, une blessure ouverte, une fičvre ardente, nous voilŕ
savants. Nous avons vu cent fois pareille chose, et l'habitude indique
le remčde; mais quand la cause du mal ne se découvre point, lorsque
la main, les yeux, les battements du coeur, l'enveloppe humaine tout
entičre est vainement interrogée; lorsqu'une jeune fille de dix-huit
ans, belle comme un soleil et fraîche comme une fleur, pâlit tout
ŕ coup et chancelle, puis, quand on lui demande ce qu'elle souffre,
répond seulement: Je me meurs... Antoine, combien de fois j'ai cherché
d'un oeil avide le secret de sa souffrance, dans sa souffrance męme!
Rien ne me répondait, pas un signe, pas un indice clair et visible,
rien devant moi que la douleur muette, car la pauvre enfant ne se
plaint jamais; et moi, le coeur brisé de tristesse, plein de mon
inutilité, je regarde les rayons poudreux oů sont entassés depuis des
années les misérables produits de la science. Peut-ętre, me dis-je,
y a-t-il lŕ dedans un remčde qui la sauverait, une goutte de cordial,
une plante salutaire; mais laquelle? comment deviner?]
PERILLO, _ŕ part_.
Mes pressentiments étaient donc fondés; je suis venu pour trouver
cela.
_Haut._
Ce que vous me dites, monsieur, est horrible. Me sera-t-il permis de
voir Carmosine?
MAITRE BERNARD.
Sans doute, quand elle s'éveillera; mais elle est bien faible,
Perillo. Peut-ętre nous faudra-t-il d'abord la préparer ŕ ta venue,
car la moindre émotion la fatigue beaucoup et suffit quelquefois pour
la priver de ses sens. Elle t'a aimé, elle t'aime encore, tu devais
l'épouser,... tu me comprends.
PERILLO.
J'agirai comme il vous plaira. Faut-il que je m'éloigne pour quelques
jours, pour un aussi long temps que vous le jugerez nécessaire?
Parlez, mon pčre, j'obéirai.
MAITRE BERNARD.
Non, mon ami, tu resteras. N'es-tu pas aussi de la famille?
PERILLO.
Il est bien vrai que j'espérais en ętre, et vous appeler toujours de
ce nom de pčre que vous me permettiez quelquefois de vous donner.
MAITRE BERNARD.
Toujours, et tu ne nous quitteras plus.
PERILLO.
Mais vous me dites que ma présence peut ętre nuisible ou fâcheuse.
Quand ma vue ne devrait causer qu'un moment de souffrance, la plus
faible impression, la plus légčre pâleur sur ses traits chéris, ô
Dieu! plutôt que de lui coűter seulement une larme, j'aimerais mieux
recommencer le long chemin que je viens de faire, et m'exiler ŕ jamais
de Palerme.
MAITRE BERNARD.
Ne crains rien, j'arrangerai cela.
PERILLO.
Aimez-vous mieux que j'aille loger dans un autre quartier de la ville?
Je puis trouver quelque maison du faubourg (j'en avais une avant
d'ętre orphelin). J'y demeurerais enfermé tout le jour, afin que mon
retour fűt ignoré; le soir seulement, n'est-ce pas, ou le matin de
bonne heure, je viendrais frapper ŕ votre porte et demander de ses
nouvelles, car vous concevez que sans cela je ne saurais... Elle
souffre donc beaucoup?
MAITRE BERNARD.
Tu pleures, garçon? Écoute donc, il ne faut pourtant pas nous désoler
si vite. Cette incompréhensible maladie ne nous a pas dit son dernier
mot. Elle dort dans ce moment-ci, et, je te l'ai dit, cela est de
bon augure. Qui sait? Prenons nos précautions tout doucement, avec
ménagement. Évitons, avant tout, qu'elle ne te voie trop vite; dans
l'état oů elle est, je n'oserais pas répondre...
SCČNE IV
LES PRÉCÉDENTS, DAME PAQUE.
DAME PAQUE.
Votre fille vient de se réveiller; elle voudrait... Ah! c'est vous,
seigneur Perillo? Je suis charmée de vous revoir.
_Perillo salue.--Ŕ part_.
Encore un amoureux transi! Nous nous serions bien passés de sa
visite...
_Haut ŕ son mari._
Votre fille voudrait aller au jardin.
MAITRE BERNARD.
Que me dites-vous lŕ? est-ce que cela est possible? ŕ peine depuis
trois jours peut-elle se soutenir.
DAME PAQUE.
Elle est debout, elle se sent beaucoup mieux, le sommeil lui a fait
grand bien. Elle veut marcher et respirer un peu.
MAITRE BERNARD.
En vérité!
_Ŕ Perillo._
Tu vois, mon cher Antoine, que je ne me trompais pas tout ŕ l'heure.
Voici un changement, un heureux changement. Elle va venir, retire-toi
un instant.
PERILLO.
Elle va venir, et il faut que je m'éloigne! Si j'osais vous faire une
demande...
MAITRE BERNARD.
Qu'est-ce que c'est?
PERILLO.
Laissez-moi la voir; je me cacherai derričre cette tapisserie; un seul
moment, que je la voie passer!
MAITRE BERNARD.
Je le veux bien, mais ne te montre point que je ne t'appelle; je
vais tenter en la faveur tout ce qui me sera possible;--et vous, dame
Pâque, ne soufflez mot, je vous prie.
DAME PAQUE.
Sur vos affaires? Je n'en suis pas pressée; je n'aime pas les
mauvaises commissions. Voici votre fille; je vais au jardin porter mon
grand fauteuil auprčs de la fontaine.
_Perillo se cache derričre une tapisserie._
SCČNE V
MAITRE BERNARD, PERILLO, _caché_, CARMOSINE.
CARMOSINE.
Eh bien! mon pčre, vous ętes inquiet, vous me regardez avec surprise?
Vous ne vous attendiez pas, n'est-il pas vrai, ŕ me voir debout comme
une grande personne? C'est pourtant bien moi.
_Elle l'embrasse._
Me reconnaissez-vous?
MAITRE BERNARD.
C'est de la joie que j'éprouve, et aussi de la crainte. Es-tu bien
sűre de n'avoir pas trop de courage?
CARMOSINE.
Oh! je voulais vous surprendre bien davantage encore, mais je vois que
ma mčre m'a trahie. Je voulais aller au jardin toute seule, et vous
faire dire en confidence qu'une belle dame de Palerme vous demandait.
Vous auriez pris bien vite votre belle robe de velours noir, votre
bonnet neuf, et comme j'avais un masque... Eh bien! qu'auriez-vous
dit?
MAITRE BERNARD.
Qu'il n'y a rien d'aussi charmant que toi; ainsi ta ruse eűt été
inutile. Hélas! ma bonne Carmosine, qu'il y a longtemps que je ne t'ai
vue sourire!
CARMOSINE.
Oui, je suis toute gaie, toute légčre, je ne sais pourquoi... C'est
que j'ai fait un ręve. Vous souvenez-vous de Perillo?
MAITRE BERNARD.
Assurément. Que veux-tu dire?
_Ŕ part._
C'est singulier; jamais elle ne parlait de lui.
CARMOSINE.
J'ai ręvé que j'étais sur le pas de notre porte. On célébrait une
grande fęte. Je voyais les personnes de la ville passer devant moi
vętues de leurs plus beaux habits, les grandes dames, les cavaliers...
Non, je me trompe, c'étaient des gens comme nous, tous nos voisins
d'abord, et nos amis, puis une foule, une foule innombrable qui
descendait par la Grand'-Rue, et qui se renouvelait sans cesse; plus
le flot s'écoulait, plus il grossissait, et tout ce monde se dirigeait
vers l'église, qui resplendissait de lumičre. J'entendais de loin le
bruit des orgues, les chants sacrés, et une musique céleste formée de
l'accord des harpes et de voix si douces, que jamais pareil son n'a
frappé mon oreille. La foule paraissait impatiente d'arriver le plus
tôt possible ŕ l'église, comme si quelque grand mystčre, unique,
impossible ŕ revoir une seconde fois, s'accomplissait. Pendant que je
regardais tout cela, une inquiétude étrange me saisissait [aussi, mais
je n'avais point envie de suivre les passants]. Au fond de l'horizon,
dans une vaste plaine entourée de montagnes, j'apercevais un voyageur
marchant péniblement dans la poussičre. Il se hâtait de toutes
ses forces; mais il n'avançait qu'ŕ grand'peine, et je voyais trčs
clairement qu'il désirait venir ŕ moi. De mon côté, je l'attendais;
il me semblait que c'était lui qui devait me conduire ŕ cette fęte.
Je sentais son désir et je le partageais; j'ignorais quels obstacles
l'arrętaient; mais, dans ma pensée, j'unissais mes efforts aux siens;
mon coeur battait avec violence, et pourtant je restais immobile,
sans pouvoir faire un pas vers lui. Combien de temps dura cette
vision, je n'en sais rien, peut-ętre une minute; mais, dans mon ręve,
c'étaient des années. Enfin, il approcha et me prit la main; aussitôt
la force irrésistible qui m'attachait ŕ la męme place cessa tout
ŕ coup, et je pus marcher. Une joie inexprimable s'empara de moi;
j'avais brisé mes liens, j'étais libre. Pendant que nous partions tous
deux avec la rapidité d'une flčche, je me retournai vers mon fantôme,
et je reconnus Perillo.
MAITRE BERNARD.
Et c'est lŕ ce qui t'a donné cette gaieté inattendue?
CARMOSINE.
Sans doute. Jugez de ma surprise lorsqu'on m'éveillant tout ŕ coup,
je trouvai que mon ręve était vrai dans ce qu'il avait d'heureux
pour moi, c'est-ŕ-dire que je pouvais me lever et marcher sans aucune
peine. Ma premičre pensée a été tout de suite de venir vous sauter au
cou; aprčs cela, j'ai voulu faire de l'esprit, mais j'ai échoué dans
mon entreprise.
MAITRE BERNARD.
Eh bien! ma chčre, puisque ce songe t'a mise de si bonne humeur, et
puisqu'il est vrai sur ce point, apprends qu'il l'est aussi sur un
autre. J'hésitais ŕ t'en informer, mais maintenant je n'ai plus de
scrupule: Perillo est dans cette ville.
CARMOSINE.
Vraiment! depuis quand?
MAITRE BERNARD.
De ce matin męme, et tu le verras quand tu voudras. Le pauvre garçon
sera bien heureux, car il t'aime plus que jamais. Dis un mot et il
sera ici.
CARMOSINE.
Vous m'effrayez.--Il y est peut-ętre!
MAITRE BERNARD.
Non, mon enfant, non, pas encore; il attend qu'on l'avertisse pour se
montrer. Est-ce que tu ne serais pas bien aise de le voir? Il ne t'a
pas déplu dans ton ręve; il ne te déplaisait pas jadis. Il est docteur
en droit ŕ présent: c'est un personnage que ce bambin, avec qui tu
jouais ŕ cligne-musette, et c'est pour toi qu'il a étudié, car tu sais
qu'il a ma parole. Je ne voulais pas t'en parler, mais grâce ŕ Dieu...
CARMOSINE.
Jamais! jamais!
MAITRE BERNARD.
Est-il possible? ton compagnon d'enfance, ce digne et excellent
garçon, le fils unique de mon meilleur ami tu refuserais de le voir?
A-t-il rien fait pour que tu le haďsses?
CARMOSINE.
Rien, non,... rien; je ne le hais pas;--qu'il vienne, si vous
voulez... Ah! je me sens mourir!
MAITRE BERNARD.
Calme-toi, je t'en prie; on ne fera rien contre ta volonté. Ne sais-tu
pas que je te laisse maîtresse absolue de toi-męme? Ce que je t'en ai
dit n'a rien de sérieux, c'était pour savoir seulement ce que tu en
aurais pensé dans le cas oů par hasard... Mais il n'est pas ici, il
n'est pas revenu, il ne reviendra pas.
_Ŕ part._
Malheureux que je suis, qu'ai-je fait?
CARMOSINE.
Je me sens bien faible.
_Elle s'assoit._
MAITRE BERNARD.
Seigneur mon Dieu! il n'y a qu'un instant, tu te trouvais si bien, tu
reprenais ta force! C'est moi qui ai détruit tout cela, c'est ma sotte
langue que je n'ai pas su retenir! Hélas! pouvais-je croire que je
t'affligerais? Ce pauvre Perillo était venu... Non, je veux dire...
Enfin, c'était toi qui m'en avais parlé la premičre.
CARMOSINE.
Assez, assez, au nom du ciel! il n'y a point de votre faute. Vous ne
saviez pas,... vous ne pouviez pas savoir... Ce songe qui me semblait
heureux, j'y vois clair maintenant, il me fait horreur!
MAITRE BERNARD.
Carmosine, ma fille bien-aimée! par quelle fatalité inconcevable...
_Perillo écarte la tapisserie sans ętre vu de Carmosine; il fait un
signe d'adieu ŕ Bernard, et sort doucement._
CARMOSINE.
Que regardez-vous donc, mon pčre?
MAITRE BERNARD.
Qu'as-tu, toi-męme? tu pâlis, tu frissonnes; qu'éprouves-tu?
Écoute-moi; il y a dans ta pensée un secret que je ne connais pas,
et ce secret cause ta souffrance; je ne voudrais pas te le demander;
mais, tant que je l'ignorerai, je ne puis te guérir, et je ne peux pas
te laisser mourir. Qu'as-tu dans le coeur? Explique-toi.
CARMOSINE.
Cela me fait beaucoup de mal, lorsque vous me parlez ainsi.
MAITRE BERNARD.
Que veux-tu? Je te le répčte, je ne peux pas te laisser mourir. Toi
si jeune, si forte, si belle! Doutes-tu de ton pčre? Ne diras-tu rien?
T'en iras-tu comme cela? Nous sommes riches, mon enfant; si tu as
quelques désirs,... les jeunes filles sont parfois bien folles,
qu'importe? il te faut un mot, rien de plus, un mot dit ŕ l'oreille de
ton pčre. Le mal dont tu souffres n'est pas naturel; [ces faux espoirs
que tu nous donnes, ces moments de bien-ętre que tu ressens, pour
nous rejeter ensuite dans des craintes plus graves; toutes ces
contradictions dans tes paroles, tous ces changements inexplicables,
sont un supplice!] Tu te meurs, mon enfant, je deviendrai
fou;--veux-tu faire mourir aussi de douleur ton pauvre pčre qui te
supplie!
_Il se met ŕ genoux._
CARMOSINE.
Vous me brisez, vous me brisez le coeur!
MAITRE BERNARD.
Je ne puis pas me taire, il faut que tu le saches. Ta mčre dit que tu
es malade d'amour,... elle a été jusqu'ŕ nommer quelqu'un...
CARMOSINE.
Prenez pitié de moi!
_Elle s'évanouit._
MAITRE BERNARD.
Ah! misérable, tu assassines ta fille! Ta fille unique, bourreau que
tu es! Holŕ, Michel! holŕ! ma femme! Elle se meurt, je l'ai tuée,
voilŕ mon enfant morte!
SCČNE VI
LES PRÉCÉDENTS, DAME PAQUE.
DAME PAQUE.
Que voulez-vous? Qu'est-il arrivé?
MAITRE BERNARD.
Vite du vinaigre, des sels, ce flacon, lŕ, sur cette table!
DAME PAQUE, _donnant le flacon_.
J'étais bien sűre que votre Perillo nous ferait ici de mauvaise
besogne.
MAITRE BERNARD.
Paix! sur le salut de votre âme! La voici qui rouvre les yeux.
DAME PAQUE.
Eh bien! mon pauvre ange, ma chčre Carmosine, comment te sens-tu ŕ
présent?
CARMOSINE.
Trčs bien. Oů allez-vous, mon pčre? Ne me quittez pas.
MAITRE BERNARD.
Laissez-moi! laissez-moi!
DAME PAQUE.
Que veux-tu?
CARMOSINE.
Je ne veux rien; pourquoi mon pčre s'en va-t-il?
MAITRE BERNARD.
Pourquoi? pourquoi? parce que tout est perdu. Que Dieu me juge!
CARMOSINE.
Restez, mon pčre, ne vous inquiétez pas; tout cela finira bientôt.
DAME PAQUE.
Ser Vespasiano vient souper avec nous; seras-tu assez forte pour te
mettre ŕ table?
CARMOSINE.
Certainement, j'essaierai.
DAME PAQUE, _ŕ son mari_.
Voyez-vous cela? elle y consent.
MAITRE BERNARD, _ŕ sa femme_.
Que le diable vous emporte, vous et votre marotte! Vous ne comprenez
donc rien ŕ rien?
CARMOSINE.
Me voilŕ tout ŕ fait bien maintenant. Le souper est-il pręt? Venez,
mon pčre; donnez-moi le bras pour descendre.
DAME PAQUE.
J'ai ordonné qu'on apportât la table ici. Ne te dérange pas, n'essaie
pas de marcher. Voici le seigneur Vespasiano.
MAITRE BERNARD, _ŕ part_.
La peste soit du sot empanaché!
SCČNE VII
LES PRÉCÉDENTS, SER VESPASIANO.
SER VESPASIANO.
Bonsoir, chčre dame.--Salut, maître Bernard.
MAITRE BERNARD.
Bonjour; ne parlez pas si haut.
SER VESPASIANO.
Que vois-je! la perle de mon âme ŕ demi privée de sentiment! Ses yeux
d'azur presque fermés ŕ la lumičre, et les lis remplaçant les roses!
DAME PAQUE.
C'est le troisičme accčs depuis deux jours.
SER VESPASIANO.
Pčre infortuné! tendre mčre! combien je sympathise avec votre douleur!
CARMOSINE, _ŕ Bernard qui veut sortir_.
Mon pčre, ne vous éloignez pas!
SER VESPASIANO, _ŕ Bernard_.
Votre aimable fille vous rappelle, maître Bernard.
MAITRE BERNARD.
Allez au diable, monsieur, et laissez-nous en repos chez nous!
_On apporte le souper._
CARMOSINE, _ŕ son pčre_.
Ne soyez donc pas triste; venez prčs de moi. Je veux vous verser un
verre de vin.
MAITRE BERNARD, _assis prčs d'elle_.
O mon enfant! que ne puis-je t'offrir ainsi tout le sang que la
vieillesse a laissé dans mes veines, pour ajouter un jour ŕ tes jours!
SER VESPASIANO, _s'asseyant prčs de dame Pâque_.
Aprčs ce que votre mari vient de me dire, je ne sais trop si je dois
rester.
DAME PAQUE.
Plaisantez-vous? est-ce qu'un homme de votre mérite fait attention ŕ
de pareilles choses?
SER VESPASIANO.
Il est vrai.--Voilŕ un rôti qui a une terrible mine.
CARMOSINE, _ŕ son pčre_.
Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Conseillez-moi,
donnez-moi votre avis.
MAITRE BERNARD.
Pas de cela, ma chčre, prends ceci, oui, je crois du moins;... hélas!
je ne sais pas.
SER VESPASIANO, _ŕ dame Pâque_.
Elle détourne les yeux quand je la regarde. Croyez-vous que je
réussisse?
DAME PAQUE.
Hélas! peut-on vous résister?
SER VESPASIANO.
Que ne m'est-il permis de fendre mon coeur en deux avec ce poignard,
et d'en offrir la moitié ŕ une personne que je respecte... Il m'est
impossible de m'expliquer.
DAME PAQUE.
Et il m'est défendu de vous entendre.
_On entend chanter dans la rue._
CARMOSINE.
N'est-ce pas la voix de Minuccio?
SER VESPASIANO.
Oui, ma reine toute belle; c'est Minuccio d'Arezzo lui-męme. Il
sautille sous ces fenętres, [sa viole ŕ la main.]
CARMOSINE.
Priez-le de monter ici, mon pčre; il égaiera notre souper.
MAITRE BERNARD, _ŕ la fenętre_.
Holŕ! Minuccio, mon ami, viens ici souper avec nous. Le voilŕ qui
monte, il me fait signe de la tęte.
SER VESPASIANO.
C'est un musicien remarquable, fort bon chanteur et joueur
d'instruments. Le roi l'écoute volontiers, et il a su, avec ses
aubades, s'attirer la protection des gens de cour. Il nous sonna
fort doucement l'autre soir d'une guitare qu'il avait apportée, avec
certaines amoureuses et tout ŕ fait gracieuses ariettes; nous sommes
lŕ une demi-douzaine qui avons des bontés pour lui.
[MAITRE BERNARD.
En vérité? Eh bien! ŕ mes yeux, c'est lŕ le moindre de ses mérites;
non que je méprise une bonne chanson, il n'y a rien qui aille mieux ŕ
table avec un verre de cerigo; mais avant d'ętre un savant musicien,
un troubadour, comme on dit, Minuccio, pour moi, est un honnęte homme,
un bon, loyal et ancien ami, tout jeune et frivole qu'il paraît, ami
dévoué ŕ notre famille, le meilleur peut-ętre qui nous reste depuis la
mort du pčre d'Antoine. Voilŕ ce que je prise en lui, et j'aime mieux
son coeur que sa viole.]
SCČNE VIII
LES PRÉCÉDENTS, MINUCCIO.
CARMOSINE.
Bonsoir, Minuccio. Puisque tu chantes pour le vent qui passe, ne
veux-tu pas chanter pour nous?
MINUCCIO.
Belle Carmosine, je chantais tout ŕ l'heure, mais maintenant j'ai
envie de pleurer.
CARMOSINE.
D'oů te vient cette tristesse?
MINUCCIO.
De vos yeux aux miens. Comment la gaieté oserait-elle rester sur mon
pauvre visage, lorsqu'on la voit s'éteindre et mourir dans le sein
męme de la fleur oů l'on devrait la respirer?
CARMOSINE.
Quelle est cette fleur merveilleuse?
MINUCCIO.
La beauté. Dieu l'a mise au monde dans trois excellentes intentions:
premičrement, pour nous réjouir; en second lieu, pour nous consoler,
et enfin, pour ętre heureuse elle-męme. Telle est la vraie loi de
nature, et c'est pécher que de s'en écarter.
CARMOSINE.
Crois-tu cela?
MINUCCIO.
Il n'y a qu'ŕ regarder. Trouvez sur terre une chose plus gaie et plus
divertissante ŕ voir qu'un sourire, quand c'est une belle fille qui
sourit! Quel chagrin y résisterait? Donnez-moi un joueur ŕ sec, un
magistrat cassé, un amant disgracié, un chevalier fourbu, un politique
hypocondriaque, les plus grands des infortunés, Antoine aprčs Actium,
Brutus aprčs Philippes, que dis-je? un sbire rogneur d'écrits, un
inquisiteur sans ouvrage; montrez ŕ ces gens-lŕ seulement une fine
joue couleur de pęche, relevée par le coin d'une lčvre de pourpre oů
le sourire voltige sur deux rangs de perles! Pas un ne s'en défendra,
sinon je le déclare indigne de pitié, car son malheur est d'ętre un
sot.
SER VESPASIANO, _ŕ dame Pâque_.
Il a du jargon, il a du jargon; on voit qu'il s'est frotté ŕ nous.
MINUCCIO.
Si donc cette chose plus légčre qu'une mouche, plus insaisissable que
le vent, plus impalpable et plus délicate que la poussičre de l'aile
d'un papillon, cette chose qui s'appelle une jolie femme, réjouit tout
et console de tout, n'est-il pas juste qu'elle soit heureuse, puisque
c'est d'elle que le bonheur nous vient? Le possesseur du plus riche
trésor peut, il est vrai, n'ętre qu'un pauvre, s'il enfouit ses ducats
en terre, ne donnant rien ŕ soi ni aux autres; mais la beauté ne
saurait ętre avare. Dčs qu'elle se montre, elle se dépense, elle se
prodigue sans se ruiner jamais; au moindre geste, au moindre mot, ŕ
chaque pas qu'elle fait, sa richesse lui échappe et s'envole autour
d'elle, sans qu'elle s'en aperçoive, dans sa grâce comme un parfum,
dans sa voix comme une musique, dans son regard comme un rayon de
soleil! Il faut donc bien que celle qui donne tant, se fasse un peu,
comme dit le proverbe, la charité ŕ elle-męme, et prenne sa part du
plaisir qu'elle cause... Ainsi, Carmosine, souriez.
CARMOSINE.
En vérité, ta folle éloquence mérite qu'on la paye un tel prix. C'est
toi qui es heureux, Minuccio; ce précieux trésor dont tu parles,
il est dans ton joyeux esprit. Nous as-tu fait quelques romances
nouvelles?
_Elle lui donne un verre qu'elle remplit._
SER VESPASIANO.
Hé! oui, l'ami, chante-nous donc un peu cette chanson que tu nous as
dite lŕ-bas.
MINUCCIO.
En quel endroit, magnanime seigneur?
SER VESPASIANO.
Hé, par Dieu! mon cher, au palais du roi.
MINUCCIO.
Il me semblait, vaillant chevalier, que le roi n'était pas lŕ-bas,
mais-lŕ haut.
SER VESPASIANO.
Comment cela, rusé compčre?
MINUCCIO.
N'avez-vous jamais vu les fantoccini? Et ne sait-on pas que celui qui
tient les fils est plus haut placé que ses marionnettes? Ainsi s'en
vont deçŕ delŕ les petites poupées qu'il fait mouvoir, les gros barons
vętus d'acier, les belles dames fourrées d'hermine, les courtisans en
pourpoint de velours, puis la cohue des inutiles, qui sont toujours
les plus empressés;... enfin les chevaliers de fortune ou de hasard,
si vous voulez, ceux dont la lance branle dans le manche et le pied
vacille dans l'étrier.
SER VESPASIANO.
Tu aimes, ŕ ce qu'il paraît, les énumérations, mais tu oublies les
baladins et les troubadours ambulants.
MINUCCIO.
Votre invincible Seigneurie sait bien que ces gens-lŕ ne comptent pas;
ils ne viennent jamais qu'au dessert. Le parasite doit passer avant
eux.
DAME PAQUE, _ŕ ser Vespasiano_.
Votre repartie l'a piqué au vif.
SER VESPASIANO.
Elle était juste, mais un peu verte. Je ne sais si je ne devrais pas
pousser encore plus loin les choses.
DAME PAQUE.
Vous vous moquez! qu'y a-t-il d'offensant?
SER VESPASIANO.
Il a parlé d'étriers peu solides et de lances mal emmanchées; c'est
une allusion détournée...
DAME PAQUE.
Ŕ votre chute de l'autre jour? Ce sont les hasards des combats.
SER VESPASIANO.
Vous avez raison.--Je meurs de soif.
_Il boit._
UN DOMESTIQUE, _entrant_.
On vient d'apporter cette lettre.
_Il la place devant maître Bernard et sort._
CARMOSINE.
Ŕ quoi songez-vous donc, mon pčre?
MAITRE BERNARD.
Ŕ quoi je songe?--Que me veut-on?
DAME PAQUE, _qui a pris la lettre_.
C'est un message de votre cher Antoine.
MAITRE BERNARD.
Donnez-moi cela. Peste soit des femmes et de leur fureur de bavarder!
CARMOSINE.
Si cette lettre...
MAITRE BERNARD.
Ce n'est rien, ma fille. C'est une lettre de Marc-Antoine, notre ami
de Messine. Ta mčre s'est trompée ŕ cause de la ressemblance des noms.
CARMOSINE.
Si cette lettre est de Perillo, lisez-la-moi, je vous en prie.
MAITRE BERNARD.
Tranquillise-toi; je te répčte...
CARMOSINE.
Je suis trčs tranquille, donnez-la-moi.--Il n'y a personne de trop
ici.
_Elle lit._
«Ŕ MON SECOND PČRE, MAÎTRE BERNARD.
«Je vais bientôt quitter Palerme. [Je remercie Dieu qu'il m'ait été
permis d'approcher une derničre fois des lieux oů a commencé ma vie,
et oů je la laisse tout entičre. Il est vrai que, depuis six ans,
j'avais nourri une chčre espérance, et que j'ai tâché de tirer de mon
humble travail ce qui pouvait me rendre digne de la promesse que vous
m'aviez faite.] Pardonnez-moi, j'ai vu votre chagrin, et j'ai entendu
Carmosine...» O ciel!
MAITRE BERNARD.
Je t'en supplie, rends-moi ce papier!
CARMOSINE.
Laissez-moi, j'irai jusqu'au bout.
_Elle continue._
«Et j'ai entendu Carmosine dire que mon triste amour lui faisait
horreur. [Je me doutais depuis longtemps que cette application de
ma pauvre intelligence ŕ d'arides études ne porterait que des fruits
stériles.] Ne craignez plus qu'une seule parole, échappée de mes
lčvres, tente de rappeler le passé, et de faire renaître le souvenir
d'un ręve, le plus doux, le seul que j'aie fait, le seul que je ferai
sur la terre. Il était trop beau pour ętre possible. Durant six ans,
ce ręve fut ma vie, il fut aussi tout mon courage. Maintenant le
malheur se montre ŕ moi. C'était ŕ lui que j'appartenais, il devait
ętre mon maître ici-bas.--Je le salue, et je vais le suivre. Ne songez
plus ŕ moi, monsieur; vous ętes délié de votre promesse.»
_Un silence._
Si vous le voulez bien, mon pčre, je vous demanderai une grâce.
MAITRE BERNARD.
Tout ce qui te plaira, mon enfant. Que veux-tu?
CARMOSINE.
Que vous me permettiez de rester seule un instant avec Minuccio,
s'il y consent lui-męme; j'ai quelques mots ŕ lui dire, et je vous le
renverrai au jardin.
MAITRE BERNARD.
De tout mon coeur.
_Ŕ part._
Est-ce que, par hasard, elle se confierait ŕ lui plutôt qu'ŕ moi-męme?
Dieu le veuille! [car ce garçon-lŕ ne manquerait pas de m'instruire ŕ
son tour.] Allons, dame Pâque, venez ça.
CARMOSINE.
Ser Vespasiano, j'ai lu devant vous la lettre que vous venez
d'entendre, afin que vous sachiez que je ne fais pas mystčre du
dessein oů je suis de ne me point marier, et pour vous montrer en męme
temps que les engagements pris et le mérite męme ne sauraient changer
ma résolution. Maintenant donc, excusez-moi.
SCČNE IX
MINUCCIO, CARMOSINE.
MINUCCIO.
Vous ętes émue, Carmosine, cette lettre vous a troublée.
CARMOSINE.
Oui, je me sens faible.--Écoute-moi bien, car je ne puis parler
longtemps.--Minuccio, je t'ai choisi pour te confier un secret.
J'espčre d'abord que tu ne le révéleras ŕ aucune créature vivante,
sinon ŕ celui que je te dirai; ensuite, qu'autant qu'il te sera
possible, tu m'aideras, n'est-ce pas? je t'en prie.--Tu te rappelles,
mon ami, cette journée oů notre roi Pierre fit la grande fęte de son
exaltation. Je l'ai vu ŕ cheval au tournoi, et je me suis prise pour
lui d'un amour qui m'a réduite ŕ l'état oů je suis. Je sais combien il
me convient peu d'avoir cet amour pour un roi, et j'ai essayé de m'en
guérir; mais comme je n'y saurais rien faire, j'ai résolu, pour moins
de souffrance, d'en mourir, et je le ferai. Mais je m'en irais trop
désolée s'il ne le savait auparavant, et, ne sachant comment lui faire
connaître le dessein que j'ai pris, mieux que par toi (tu le vois
souvent, Minuccio), je te supplie de le lui apprendre. Quand ce sera
fait, tu me le diras, et je mourrai moins malheureuse.
MINUCCIO.
Carmosine, je vous engage ma foi, et soyez sűre qu'en y comptant, vous
ne serez jamais trompée.--Je vous estime d'aimer un si grand roi. Je
vous offre mon aide, avec laquelle j'espčre, si vous voulez prendre
courage, faire de sorte qu'avant trois jours je vous apporterai des
nouvelles qui vous seront extręmement chčres; et, pour ne point perdre
le temps, j'y vais tâcher dčs aujourd'hui.
CARMOSINE.
Je t'en supplie encore une fois.
MINUCCIO.
Jurez-moi d'avoir du courage.
CARMOSINE.
Je te le jure. Va avec Dieu.
FIN DE L'ACTE PREMIER.
ACTE DEUXIČME
_Au palais du roi.--Une salle.--Une galerie au fond._
SCČNE PREMIČRE
PERILLO, UN OFFICIER DU PALAIS.
PERILLO.
Je puis attendre ici?
L'OFFICIER.
Oui, monsieur. En rentrant au palais, le roi va s'arręter dans cette
galerie, et toutes les personnes qui s'y trouvent peuvent approcher de
Sa Majesté.
PERILLO, _seul_.
[On ne m'avait point trompé; Pierre conserve ici cette noble coutume
que pratiquait nagučre en France le saint roi Louis, de ne point celer
la majesté royale, et de la montrer accessible ŕ tous.] Je vais
donc lui parler, et un mot de sa bouche peut tout changer dans mon
existence. N'aurais-je pas hésité hier, n'aurais-je pas été bien
troublé, bien gęné dans la cour de ce roi conquérant, qui se fait
craindre autant qu'on l'aime? Tout m'est indifférent aujourd'hui: ce
palais, oů habite la puissance, oů rčgnent toutes les passions, toutes
les vanités et toutes les haines, est plus vide pour moi qu'un désert.
Que pourrais-je redouter auprčs de ce que j'ai souffert? Le désespoir
ne vit que d'une pensée, et anéantit tout le reste.
SCČNE II
PERILLO, MINUCCIO.
MINUCCIO, _marchant ŕ grands pas_.
Va dire, Amour, ce qui cause ma peine,
S'il ne me vient...
Ce n'est pas cela,--j'avais débuté autrement.
PERILLO, _ŕ part_.
Voici un homme bien préoccupé; il n'a pas l'air de m'apercevoir.
MINUCCIO, _continuant_.
S'il ne me vient ou me veut secourir,
Craignant, hélas!...
Voilŕ qui est plaisant.--En achevant mes derniers vers, j'ai
oublié net les premiers. Faudra-t-il donc refaire mon commencement?
J'oublierai ŕ son tour ma fin pendant ce temps-lŕ, et il ne tient qu'ŕ
moi d'aller ainsi de suite jusqu'ŕ l'éternité, versant les eaux
de Castalie dans la tonne des Danaďdes! Et point de crayon! point
d'écritoire! Voyons un peu ce que chantait ce pédant... Eh bien! oů
diable l'ai-je fourré?
_Il fouille dans ses poches et en tire un papier._
PERILLO, _ŕ part_.
Ce personnage ne m'est point inconnu: est-ce l'absence ou le chagrin
qui me trouble ainsi la mémoire? Il me semble l'avoir vu quand j'étais
enfant; en vérité, cela est étrange! j'ai oublié le nom de cet homme,
et je me souviens de l'avoir aimé.
MINUCCIO, _ŕ lui-męme_.
Rien de tout cela ne peut m'ętre utile; pas un mot n'a le sens
commun. Non, je ne crois pas qu'il y ait au monde une chose plus
impatientante, plus plate, plus creuse, plus nauséabonde, plus
inutilement boursoufflée, qu'un imbécile qui vous plante un mot ŕ la
place d'une pensée, qui écrit ŕ côté de ce qu'il voudrait dire, et qui
fait de Pégase un cheval de bois comme aux courses de bagues pour s'y
essouffler l'âme ŕ accrocher ses rimes! Aussi oů avais-je la tęte,
d'aller demander ŕ ce Cipolla de me composer une chanson sur les
idées d'une jeune fille amoureuse? Mettre l'esprit d'un ange dans la
cervelle d'un cuistre! Et point de crayon, bon Dieu! point de papier!
Ah! voici un jeune homme qui porte une écritoire...
_Il s'approche de Perillo._
Pardonnez-moi, monsieur, pourrais-je-vous demander?... Je voudrais
écrire deux mots, et je ne sais comment...
PERILLO, _lui donnant l'écritoire qui est suspendue ŕ sa ceinture_.
Trčs volontiers, monsieur. Pourrais-je, ŕ mon tour, vous adresser une
question? oserais-je vous demander qui vous ętes?
MINUCCIO, _tout en écrivant_.
Je suis počte, monsieur, je fais des vers, et dans ce moment-ci je
suis furieux.
PERILLO.
Si je vous importune...
MINUCCIO.
Point du tout; c'est une chanson que je suis obligé de refaire, parce
qu'un charlatan me l'a manquée. D'ordinaire, je ne me charge que de la
musique, car je suis joueur de viole, monsieur, et de guitare, ŕ votre
service; vous semblez nouveau ŕ la cour, et vous aurez besoin de moi.
Mon métier, ŕ vrai dire, est d'ouvrir les coeurs; j'ai l'entreprise
générale des bouquets et des sérénades, je tiens magasin de flammes et
d'ardeurs, d'ivresses et de délires, de flčches et de dards, et autres
locutions amoureuses, le tout sur des airs variés; j'ai un grand fonds
de soupirs languissants, de doux reproches, de tendres bouderies,
selon les circonstances et le bon plaisir des dames; j'ai un volume
in-folio de brouilles (pour les raccommodements, ils se font sans
moi); mais les promesses surtout sont innombrables, j'en possčde une
lieue de long sur parchemin vierge, les majuscules peintes et les
oiseaux dorés; bref, on ne s'aime gučre ici que je n'y sois, et on se
marie encore moins; il n'est si mince et si leste écolier, si puissant
ni si lourd seigneur qui ne s'appuie sur l'archet de ma viole; et que
l'amour monte au son des aubades les degrés de marbre d'un palais, ou
qu'il escalade sur un brin de corde le grenier d'une toppatelle, ma
petite muse est au bas de l'échelle.
PERILLO.
Tu es Minuccio d'Arezzo?
MINUCCIO.
Vous l'avez dit; vous me connaissez donc?
PERILLO.
Et toi, tu ne me reconnais donc pas? As-tu oublié aussi Perillo?
MINUCCIO.
Antoine! vive Dieu! combien l'on a raison de dire qu'un poëte en
travail ne sait plus le nom de son meilleur ami! moi qui ne rimais que
par occasion, je ne me suis pas souvenu du tien!
_Il l'embrasse._
Et depuis quand dans cette ville?
PERILLO.
Depuis peu de temps,... et pour peu de temps.
MINUCCIO.
Qu'est-ce ŕ dire? Je supposais que tu allais me répondre: Pour
toujours! Est-ce que tu n'arrives pas de Padoue?
PERILLO.
Laissons cela.--Tu viens donc ŕ la cour?
MINUCCIO, _ŕ part_.
Sot que je suis! j'oubliais la lettre que Carmosine nous a lue! Ŕ quoi
ręve donc mon esprit? Décidément la raison m'abandonne; je suis plus
poëte que je ne croyais. [Pauvre garçon! il doit ętre bien triste, et
en conscience, je ne sais trop que lui dire...]
_Haut._
Oui, mon ami, le roi me permet de venir ici de temps en temps, ce qui
fait que j'ai l'air d'y ętre quelqu'un; mais toute ma faveur consiste
ŕ me promener en long et en large. On me croit l'ami du roi, je ne
suis qu'un de ses meubles, jusqu'ŕ ce qu'il plaise ŕ Sa Majesté de
me dire en sortant de table: Chante-moi quelque chose, que je
m'endorme.--Mais toi, qui t'amčne en ce pays?
PERILLO.
Je viens tâcher d'obtenir du service dans l'armée qui marche sur
Naples.
MINUCCIO.
Tu plaisantes! toi, te faire soldat, au sortir de l'école de droit?
PERILLO.
Je t'assure, Minuccio, que je ne plaisante pas.
MINUCCIO, _ŕ part_.
En vérité, son sang-froid me fait peur; c'est celui du désespoir. Qu'y
faire? Il l'aime, et elle ne l'aime pas.
_Haut._
Mais, mon ami, as-tu bien réfléchi ŕ cette résolution que tu prends
si vite? Songes-tu aux études que tu viens de faire, ŕ la carričre qui
s'ouvre devant toi? Songes-tu ŕ l'avenir, Perillo?
PERILLO.
Oui, et je n'y vois de certain que la mort.
MINUCCIO.
Tu souffres d'un chagrin.--Je ne t'en demande pas la cause,--je
ne cherche pas ŕ la pénétrer,--mais je me trompe fort, ou, dans ce
moment-ci, tu cčdes ŕ un conseil de ton mauvais génie.--Crois-moi,
avant de te décider, attends encore quelques jours.
PERILLO.
Celui qui n'a plus rien ŕ craindre ni ŕ espérer n'attend pas.
[MINUCCIO.
Mais si je t'en priais, si je te demandais comme une grâce de ne point
te hâter?
PERILLO.
Que t'importe?
MINUCCIO.
Tu me fais injure. Il me semblait que tout ŕ l'heure tu m'avais pris
pour un de tes amis. Écoute-moi,--le temps presse,--le roi va arriver.
Je ne puis t'expliquer clairement ni librement ce que je pense...
Encore une fois, ne fais rien aujourd'hui. Est-ce donc si long
d'attendre ŕ demain?
PERILLO.
Aujourd'hui ou demain, ou un autre jour, ou dans dix ans, dans vingt
ans, si tu veux, c'est la męme chose pour moi; j'ai cessé de compter
les heures.
MINUCCIO.
Par Dieu! tu me mettrais en colčre! Ainsi donc, moi qui t'ai bercé,
lorsque j'étais un grand enfant et que tu en étais un petit, il faut
que je te laisse aller ŕ ta perte sans essayer de t'en empęcher,
maintenant que tu es un grand garçon et moi un homme? Je ne puis rien
obtenir? Que vas-tu faire?] Tu as quelque blessure au coeur; qui n'a
la sienne? Je ne te dis pas de combattre ŕ présent ta tristesse,
mais de ne pas t'attacher ŕ elle et t'y enchaîner sans retour, car il
viendra un temps oů elle finira. Tu ne peux pas le croire, n'est-ce
pas? Soit, mais retiens ce que je vais te dire: Souffre maintenant
s'il le faut, pleure si tu veux, et ne rougis point de tes larmes;
montre-toi le plus malheureux et le plus désolé des hommes; loin
d'étouffer ce tourment qui t'oppresse, déchire ton sein pour lui
ouvrir l'issue, laisse-le éclater en sanglots, en plaintes, en
pričres, en menaces; mais, je te le répčte, n'engage pas l'avenir!
Respecte ce temps que tu ne veux plus compter, mais qui en sait plus
long que nous, et, pour une douleur qui doit ętre passagčre, ne
te prépare pas la plus durable de toutes, le regret, qui ravive la
souffrance épuisée, et qui empoisonne le souvenir!
[PERILLO.
Tu peux avoir raison. Dis-moi, vois-tu quelquefois maître Bernard?
MINUCCIO.
Mais oui,... sans doute,... comme par le passé...
PERILLO.
Quand tu le verras, Minuccio, tu lui diras...]
SCČNE III
LES PRÉCÉDENTS, SER VESPASIANO.
SER VESPASIANO, _en entrant_.
J'attendrai! c'est bon, j'attendrai! Messeigneurs, je vous annonce le
roi.
_Ŕ Minuccio._
Ah! c'est toi, bel oiseau de passage! Je t'ai amené hier un peu
rudement, ŕ souper chez cette petite; mais je ne veux pas que tu m'en
veuilles. Que diable, aussi! tu t'attaques ŕ moi, sous les regards de
la beauté!
MINUCCIO.
Je vous assure, seigneur, que je n'ai point de rancune, et que, si
vous m'aviez fâché, vous vous en seriez douté tout de suite.
SER VESPASIANO.
Je l'entends ainsi; il y a place pour tout. Si tu t'avisais, dans
ce palais, de gouailler un homme de ma sorte, on ne laisserait point
passer cela; mais tu conçois que je déroge un peu quand je vais chez
la Carmosine, et qu'on n'est plus lŕ sur ses grands chevaux.
MINUCCIO.
Vous ętes trop bon de n'y pas monter. S'il ne s'agissait que de vous
en faire descendre...
SER VESPASIANO.
Ne te fâche pas, je te pardonne. En vérité, je joue depuis hier, en
toute chose, d'un merveilleux guignon. Il faut que je t'en fasse le
récit.
PERILLO, _ŕ part_.
Quelle espčce d'homme est-ce lŕ? Il a parlé de Carmosine.
SER VESPASIANO.
Je t'ai dit combien j'aurais ŕ coeur de posséder ces champs de
Ceffalů et de Calatabellotte; tu n'ignores pas oů ils sont situés?
MINUCCIO.
Pardonnez-moi, illustrissime.
SER VESPASIANO.
Ce sont des terres ŕ fruits, prčs de mes pâturages.
MINUCCIO.
Mais vos pâturages, oů sont-ils?
SER VESPASIANO.
Hé, parbleu! prčs de Ceffalů et de Calata...
MINUCCIO.
J'entends bien, mais quand j'y ai été, autant qu'il peut m'en
souvenir, il n'y avait lŕ que des pierres et des moustiques.
SER VESPASIANO.
Calatabellotte est un lieu fertile.
MINUCCIO.
Oui, mais autour de ce lieu fertile, je dis qu'il n'y a...
SER VESPASIANO.
Tu es un badin. Je souhaitais d'avoir ces terres, non pour le bien
qu'elles rapportent, mais seulement pour m'arrondir; cela m'encadrait
singuličrement. [Le roi, ŕ qui elles appartiennent, se refusait ŕ me
les céder, se réservant, ŕ ce qu'il prétendait, de m'en faire don le
jour de mes noces. L'intention était galante.] Hier, sur un avis que
je reçus de cette bonne dame Pâque...
PERILLO.
Se pourrait-il?...
SER VESPASIANO.
Vous la connaissez? Ce sont de petites gens, mais de bonnes gens,
chez qui je vais le soir me débrider l'esprit, et me débotter
l'imagination. La fille a de beaux yeux, c'est vous en dire assez; car
si ce n'était cela...
MINUCCIO.
Et la dot?
SER VESPASIANO.
Eh bien! oui, si tu veux, la dot. Ces gens de peu, cela amasse, mais
ce n'est point ce dont je me soucie. Il suffit que l'enfant me
plaise; j'en avais touché un mot ŕ la mčre, et la bonne femme s'était
prosternée. Hier donc, on m'invite ŕ souper, et je m'attendais ŕ une
affaire conclue... Devines-tu, maintenant, beau trouvčre?
MINUCCIO.
Un peu moins qu'avant de vous entendre.
SER VESPASIANO.
Ce bouffon-lŕ goguenarde toujours. Eh, mordieu! au lieu d'un festin
et d'une joyeuse fiancée, voilŕ des visages en pleurs, une créature ŕ
demi pâmée, et on me régale d'un écrit...
MINUCCIO, _bas ŕ Vespasiano_.
Taisez-vous, pour l'amour de Dieu!
SER VESPASIANO.
Pourquoi donc en faire mystčre, quand la fillette elle-męme m'a dit
qu'elle n'en fait point! Quelle épître, bon Dieu! quelle lettre!
quatre pages de lamentations.
MINUCCIO, _bas_.
Vous oubliez que j'étais lŕ, et que j'en sais autant que vous.
SER VESPASIANO.
Mais non, pas du tout, c'est que tu ne sais rien, car tout le piquant
de l'affaire, c'est que j'avais annoncé mon mariage au roi.
MINUCCIO.
Et vous comptiez sur Ceffalů?
SER VESPASIANO.
Et Calatabellotte, cela va sans dire. Ŕ présent, que vais-je répondre,
quand le roi, rentrant au palais, va me crier d'abord du haut de
son destrier: Eh bien! chevalier Vespasiano, oů en ętes-vous de vos
épousailles? Cela est fort embarrassant. Tu me diras qu'en fin de
compte la belle ne saurait m'échapper, je le sais bien; mais pourquoi
tant de façons? Ces airs de caprice, quand je consens ŕ tout, sont
blessants et hors de propos.
PERILLO, _bas ŕ Minuccio_.
Minuccio, que veut dire tout ceci?
MINUCCIO, _bas_.
Ne vois-tu pas quel est le personnage?
SER VESPASIANO.
Du reste, ce n'est pas précisément ŕ la Carmosine que j'en veux, mais
ŕ ses sots parents; car, pour ce qui la regarde, son intention était
bien claire en me lisant cette lettre d'un rival dédaigné.
[MINUCCIO.
Son intention était claire, en effet; elle vous a dit qu'elle voulait
rester fille.
SER VESPASIANO.
Bon! ce sont de ces petits détours, de ces coquetteries aimables oů
l'amour ne se trompe point. Quand une belle vous déclare qu'elle ne
saurait s'accommoder de personne, cela signifie: Je ne veux que de
vous.]
PERILLO.
Qui avait écrit, s'il vous plaît, cette lettre dont vous parlez?
SER VESPASIANO.
Je ne sais qui, un certain Antoine, un clerc, je crois, un homme de la
basoche...
PERILLO.
J'ai l'honneur d'en ętre un, monsieur, et je vous prie de parler
autrement.
SER VESPASIANO.
Je suis gentilhomme et chevalier.--Parlez vous-męme d'autre sorte.
MINUCCIO, _ŕ ser Vespasiano_.
Et moi je vous conseille de ne pas parler du tout.
_Ŕ Perillo._
Es-tu fou, Perillo, de provoquer un fou?
PERILLO, _tandis que ser Vespasiano s'éloigne_.
O Minuccio! ma pauvre lettre! mon pauvre adieu écrit avec mes larmes,
le plus pur sanglot de mon coeur, la chose la plus sacrée du monde,
le dernier serrement de main d'un ami qui nous quitte, elle a
montré cela, elle l'a étalé aux regards de ce misérable! O ingrate!
ingénéreuse fille! elle a souillé le sceau de l'amitié, elle a
prostitué ma douleur! Ah, Dieu! je te disais tout ŕ l'heure que je ne
pouvais plus souffrir; je n'avais pas pensé ŕ cela.
MINUCCIO.
Promets-moi du moins...
PERILLO.
Ne crains rien. Je n'ai pas été maître d'un mouvement d'impatience;
mais tout est fini, je suis calme.
_Regardant ser Vespasiano qui se promčne sur la scčne._
Pourquoi en voudrais-je ŕ cet inconnu, ŕ cet automate ridicule que
Dieu fait passer sur ma route? Celui-lŕ ou tout autre, qu'importe? Je
ne vois en lui que la Destinée, dont il est l'aveugle instrument;
je crois męme qu'il en devait ętre ainsi. Oui, c'est une chose trčs
ordinaire. Quand un homme sincčre et loyal est frappé dans ce qu'il a
de plus cher, lorsqu'un malheur irréparable brise sa force et tue son
espérance, lorsqu'il est maltraité, trahi, repoussé par tout ce qui
l'entoure, presque toujours, remarque-le, presque toujours c'est un
faquin qui lui donne le coup de grâce, et qui, par hasard, sans le
savoir, rencontrant l'homme tombé ŕ terre, marche sur le poignard
qu'il a dans le coeur.
MINUCCIO.
Il faut que je te parle, viens avec moi; il faut que tu renonces ŕ ce
projet que tu as...
PERILLO.
Il est trop tard.
SCČNE IV
LES PRÉCÉDENTS, L'OFFICIER DU PALAIS.
_La salle se remplit de monde._
L'OFFICIER.
Faites place, retirez-vous.
SER VESPASIANO, _ŕ Minuccio_.
Tu es donc lié particuličrement avec ce jeune homme? Dis-moi donc,
penses-tu que je ne doive pas me considérer comme offensé?
MINUCCIO.
Vous, magnifique chevalier?
SER VESPASIANO.
Oui, il m'a voulu imposer silence.
MINUCCIO.
Eh bien! ne l'avez-vous pas gardé?
SER VESPASIANO.
C'est juste. Voici Leurs Majestés. [Le roi paraît un peu courroucé;
il faut pourtant que je lui parle ŕ tout prix; car tu comprends que je
n'attendrai pas qu'il me somme de m'expliquer.
MINUCCIO.
Et sur quoi?
SER VESPASIANO.
Sur mon mariage.]
SCČNE V
LES PRÉCÉDENTS, LE ROI, LA REINE.
LE ROI.
Que je n'entende jamais pareille chose! Ce malheureux royaume est-il
donc si maudit du ciel, si ennemi de son repos, qu'il ne puisse
conserver la paix au dedans, tandis que je fais la guerre au dehors!
Quoi! l'ennemi est ŕ peine chassé, il se montre encore sur nos
rivages, et lorsque je hasarde pour vous ma propre vie et celle de
l'infant, je ne puis revenir un instant ici sans avoir ŕ juger vos
disputes!
LA REINE.
Pardonnez-leur au nom de votre gloire et du nouveau succčs de vos
armes.
LE ROI.
Non, par le ciel! car ce sont eux précisément qui me feraient perdre
le fruit de ces combats, avec leurs discordes honteuses, avec leurs
querelles de paysans! Celui-lŕ, c'est l'orgueil qui le pousse, et
celui-ci c'est l'avarice. On se divise pour un privilčge, pour une
jalousie, pour une rancune; pendant que la Sicile tout entičre réclame
nos épées, on tire les couteaux pour un champ de blé. Est-ce pour cela
que le sang français coule encore depuis les Vępres? Quel fut alors
votre cri de guerre? La liberté, n'est-ce pas, et la patrie! et
tel est l'empire de ces deux grands mots, qu'ils ont sanctifié
la vengeance. Mais de quel droit vous ętes-vous vengés, si vous
déshonorez la victoire? Pourquoi avez-vous renversé un roi, si vous ne
savez pas ętre un peuple?
LA REINE.
Sire, ont-ils mérité cela?
LE ROI.
Ils ont mérité pis encore, ceux qui troublent le repos de l'État, ceux
qui ignorent ou feignent d'ignorer que, lorsqu'une nation s'est levée
dans sa haine et dans sa colčre, il faut qu'elle se rassoie, comme le
lion, dans son calme et sa dignité.
[LA REINE, _ŕ demi voix aux assistants_.
Ne vous effrayez pas, bonnes gens. Vous savez combien il vous aime.
LE ROI.
Nous sommes tous solidaires, nous répondons tous des hécatombes du
jour de Pâques. Il faut que nous soyons amis, sous peine d'avoir
commis un crime. Je ne suis pas venu chez vous pour ramasser sous un
échafaud la couronne de Conradin, mais pour léguer la mienne ŕ
une nouvelle Sicile.] Je vous le répčte, soyez unis; plus de
dissentiments, de rivalité, chez les grands comme chez les petits;
sinon, si vous ne voulez pas; si, au lieu de vous entr'aider, comme la
loi divine l'ordonne, vous manquez au respect de vos propres lois,
par la croix-Dieu! je vous les rappellerai, et le premier de vous
qui franchit la haie du voisin pour lui dérober un fétu, je lui fais
trancher la tęte sur la borne qui sert de limite ŕ son champ.--Jérôme,
ôte-moi cette épée.
_La foule se retire._
LA REINE.
Permettez-moi de vous aider.
LE ROI.
Vous, ma chčre! vous n'y pensez pas. Cette besogne est trop rude pour
vos mains délicates.
LA REINE.
Oh! je suis forte, quand vous ętes vainqueur. Tenez, don Pčdre, votre
épée est plus légčre que mon fuseau.--Le prince de Salerne est donc
votre prisonnier?
LE ROI.
Oui, et monseigneur d'Anjou payera cher pour la rançon de ce vilain
boiteux.--Pourquoi ces gens-lŕ s'en vont-ils?
_Il s'assoit._
LA REINE.
Mais, c'est que vous les avez grondés.
[LE ROI.
Oui, je suis bien barbare, bien tyran! n'est-ce pas, ma chčre
Constance?
LA REINE.
Ils savent que non.
LE ROI.
Je le crois bien; vous ne manquez pas de le leur dire, justement quand
je suis fâché.
LA REINE.
Aimez-vous mieux qu'ils vous haďssent? Vous n'y réussirez pas
facilement. Voyez pourtant, ils se sont tous enfuis; votre colčre doit
ętre satisfaite.] Il ne reste plus dans la galerie qu'un jeune homme
qui se promčne lŕ, d'un air bien triste et bien modeste. Il jette
de temps en temps vers nous un regard qui semble vouloir dire:
Si j'osais!--Tenez, je gagerais qu'il a quelque chose de
trčs-intéressant, de trčs-mystérieux ŕ vous confier. Voyez cette
contenance craintive et respectueuse en męme temps; je suis sűre que
celui-lŕ n'a pas de querelles avec ses voisins... Il s'en va.--Faut-il
l'appeler?
LE ROI.
Si cela vous plaît.
_La reine fait un signe ŕ l'officier du palais, qui va avertir
Perillo; celui-ci s'approche du roi et met un genou en terre. [La
reine s'assoit ŕ quelque distance.]_
As-tu quelque chose ŕ me dire?
PERILLO.
Sire, je crains qu'on ne m'ait trompé.
LE ROI.
En quoi trompé?
PERILLO.
On m'avait dit que le roi daignait permettre au plus humble de ses
sujets d'approcher de sa personne sacrée, et de lui exposer...
LE ROI.
Que demandes-tu?
PERILLO.
Une place dans votre armée.
LE ROI.
Adresse-toi ŕ mes officiers.
_Perillo se lčve et s'incline._
Pourquoi es-tu venu ŕ moi?
PERILLO.
Sire, la demande que j'ose faire peut décider de toute ma vie. Nous ne
voyons pas la Providence, mais la puissance des rois lui ressemble, et
Dieu leur parle de plus prčs qu'ŕ nous.
LE ROI.
Tu as bien fait, mais tu as un habit qui ne va gučre avec une
cuirasse.
PERILLO.
J'ai étudié pour ętre avocat, mais aujourd'hui j'ai d'autres pensées.
LE ROI.
D'oů vient cela?
PERILLO.
Je suis Sicilien, et Votre Majesté disait tout ŕ l'heure...
LE ROI.
L'homme de loi sert son pays tout aussi bien que l'homme d'épée. Tu
veux me flatter.--Ce n'est pas lŕ ta raison.
PERILLO.
Que Votre Majesté me pardonne...
LE ROI.
Allons, voyons! parle franchement. Tu as perdu au jeu, ou ta maîtresse
est morte.
PERILLO.
Non, Sire, non, vous vous trompez.
LE ROI.
Je veux connaître le motif qui t'amčne.
LA REINE.
Mais, Sire, s'il ne veut pas le dire?
PERILLO.
Madame, si j'avais un secret, je voudrais qu'il fűt ŕ moi seul, et
qu'il valűt la peine de vous ętre dit.
LA REINE.
S'il ne t'appartient pas, garde-le.--Ce n'est pas la moins rare espčce
de courage.
LE ROI.
Fort bien.--Sais-tu monter ŕ cheval?
PERILLO.
J'apprendrai, Sire.
LE ROI.
Tu t'imagines cela? Voilŕ de mes cavaliers en herbe, qui
s'embarqueraient pour la Palestine, et qu'un coup de lance jette ŕ
bas, comme ce pauvre Vespasiano!
LA REINE.
Mais, Sire, est-ce donc si difficile? Il me semble que moi, qui
ne suis qu'une femme, j'ai appris en fort peu de temps, et je ne
craindrais pas votre cheval de bataille.
LE ROI.
En vérité!
_Ŕ Perillo._
Comment t'appelles-tu?
PERILLO.
Perillo, Sire.
LE ROI.
Eh bien! Perillo, en venant ici, tu as trouvé ton étoile. Tu vois
que la reine te protčge.--Remercie-la et vends ton bonnet, afin de
t'acheter un casque.
_Perillo s'agenouille de nouveau devant la reine, qui lui donne sa
main ŕ baiser._
LA REINE.
Perillo, [tu as raison de vouloir ętre soldat plutôt qu'avocat. Laisse
d'autres que toi faire leur fortune en débitant de longs discours.]
La premičre cause de la tienne aura été (souviens-toi de cela) la
discrétion dont tu as fait preuve.[1] Fais ton profit de l'avis que
je te donne, car je suis femme et curieuse, et je puis te dire, ŕ bon
escient, que la plus curieuse des femmes, si elle s'amuse de celui qui
parle, n'estime que celui qui se tait.
LE ROI.
Je vous dis qu'il a un chagrin d'amour, et cela ne vaut rien ŕ la
guerre.
PERILLO.
Pour quelle raison, Sire?
LE ROI.
Parce que les amoureux se battent toujours trop ou trop peu, selon
qu'un regard de leur belle leur fait éviter ou chercher la mort.
PERILLO.
Celui qui cherche la mort peut aussi la donner.
LE ROI.
Commence par lŕ; c'est le plus sage.
SCČNE VI
LE ROI, LA REINE, MINUCCIO, SER VESPASIANO, PLUSIEURS DEMOISELLES,
PAGES, ETC.
_Perillo, en sortant, rencontre Minuccio et échange quelques mots avec
lui._
LE ROI.
Qui vient lŕ-bas? N'est-ce pas Minuccio, avec ce troupeau de petites
filles?
LA REINE.
C'est lui-męme, et ce sont mes caméristes qui le tourmentent sans
doute pour le faire chanter. Oh! je vous en conjure, appelez-le! je
l'aime tant! personne ŕ la cour ne me plaît autant que lui; il fait de
si jolies chansons!
LE ROI.
Je l'aime aussi, mais avec moins d'ardeur.--Holŕ! Minuccio, approche,
approche, et qu'on apporte une coupe de vin de Chypre afin de le
mettre en haleine. Il nous dira quelque chose de sa façon.
MINUCCIO, _ŕ Vespasiano_.
Retirez-vous, le roi m'a appelé.
SER VESPASIANO.
Bon, bon, la reine m'a fait signe.
[MINUCCIO, _ŕ part_.
Je ne m'en débarrasserai jamais. Il est cause que Perillo s'est
échappé tantôt dans cette foule.]
_Un valet apporte un flacon de vin; l'officier remet en męme temps un
papier au roi, qui le lit ŕ l'écart._
LA REINE.
Eh bien! petites indiscrčtes, petites bavardes, vous voilŕ encore,
selon votre habitude, importunant ce pauvre Minuccio!
PREMIČRE DEMOISELLE.
Nous voulons qu'il nous dise une romance.
DEUXIČME DEMOISELLE.
Et des tensons.
TROISIČME DEMOISELLE.
Et des jeux-partis.
LA REINE, _ŕ Minuccio_.
Sais-tu que j'ai ŕ me plaindre de toi? On te voit paraître quand le
roi arrive, mais dčs que je suis seule, tu ne te montres plus.
SER VESPASIANO, _s'avançant_.
Votre Majesté est dans une grande erreur. Il ne se passe point de jour
qu'on ne me voie en ce palais.
LA REINE.
Bonjour, Vespasiano, bonjour.
MINUCCIO, _ŕ part_.
Que va-t-il devenir maintenant? Il est soldat, il faut qu'il parte.
LE ROI, _lisant d'un air distrait, et s'adressant ŕ Minuccio_.
Je suis bien aise de te voir. Tu vas me conter les nouvelles. Allons,
bois un verre de vin.
SER VESPASIANO, _buvant_.
Votre Majesté a bien de la bonté. Mon mariage n'est point encore fait.
LE ROI.
C'est toi, Vespasiano? Eh bien! un autre jour.
SER VESPASIANO.
Certainement, Sire, certainement.
_[Ŕ part._
Il ne parle point de Calatabellotte.]
_Aux demoiselles._
Qu'avez-vous ŕ rire, vous autres?
PREMIČRE DEMOISELLE.
Ah! vous autres!
SER VESPASIANO.
Oui, vous et les autres. Le roi m'interroge, et je réponds. Qu'y
a-t-il lŕ de si plaisant?
DEUXIČME DEMOISELLE.
Beau sire chevalier, comment se porte votre cheval, depuis que nous ne
vous avons vu?
TROISIČME DEMOISELLE.
Nous avons eu grand'peur pour lui.
PREMIČRE DEMOISELLE.
Et votre casque?
DEUXIČME DEMOISELLE.
Et votre lance?
TROISIČME DEMOISELLE.
Les avez-vous fait rajuster?
SER VESPASIANO.
Je ne fais point de cas des railleries des femmes!
PREMIČRE DEMOISELLE.
Nous vous interrogeons, répondez; sinon, nous dirons que vous n'ętes
pas plus habile ŕ repartir un mot de courtoisie...
SER VESPASIANO.
Eh bien?
DEUXIČME DEMOISELLE.
Qu'ŕ parer une lance courtoise.
SER VESPASIANO, _ŕ part_.
Petites perruches mal apprises!
LA REINE.
Minuccio est si préoccupé qu'il n'entend pas ce qu'on dit prčs de lui.
MINUCCIO.
Il est vrai, madame, et j'en demande trčs humblement pardon ŕ Votre
Majesté. Je ne saurais penser depuis hier qu'ŕ cette pauvre fille,...
je veux dire ŕ ce pauvre garçon,... non, je me trompe, c'est une
romance que je tâche de me rappeler.
LA REINE.
Une romance? Tu nous la diras tout ŕ l'heure. Mes bonnes amies veulent
des jeux-partis. Fais-leur quelques demandes pour les divertir.--Ser
Vespasiano.
SER VESPASIANO.
Majesté.
LA REINE.
Savez-vous trouver de bonnes réponses?
SER VESPASIANO, _ŕ part_.
Encore la męme plaisanterie!
_Haut._
Il n'y a pas de ma faute, madame, en vérité, il n'y en a pas.
LA REINE.
De quoi parlez-vous?
SER VESPASIANO.
De mon mariage. C'est bien malgré moi, je vous le jure, qu'il n'a pas
été consommé.
LA REINE.
Une autre fois, une autre fois.
SER VESPASIANO.
Votre Majesté sera satisfaite.
_Ŕ part._
Un autre jour, a dit le roi; une autre fois, a ajouté la reine, et
quand j'ai salué, tous deux m'ont tutoyé; en sorte que je suis au
comble de la faveur, [en męme temps que je suis soulagé d'un grand
poids. Dčs que je pourrai m'esquiver, je vais voler chez cette belle.]
LE ROI, _lisant toujours_.
Voilŕ qui est bien. [Charles le Boiteux crie d'un côté, et Charles
d'Anjou de l'autre.]--Ne parliez-vous pas de jeux-partis?
LA REINE.
Oui, Sire, s'il vous plaît d'ordonner...
LE ROI.
Vous savez que je n'y entends rien; mais il n'importe. Allons,
Minuccio, fais jaser un peu ces jeunes filles.
_Tout le monde s'assoit en cercle._
MINUCCIO.
Lequel vaut mieux, mesdemoiselles, ou posséder ou espérer?
SER VESPASIANO.
Il vaut beaucoup mieux posséder.
MINUCCIO.
Pourquoi, magnifique seigneur?
SER VESPASIANO.
Mais parce que... Cela saute aux yeux.
PREMIČRE DEMOISELLE.
Et si ce qu'on possčde est une bourse vide, un nez trčs long, ou un
coup d'épée?
SER VESPASIANO.
Alors, l'espérance serait préférable.
DEUXIČME DEMOISELLE.
Et si ce qu'on espčre est la main d'une jeune fille, qui ne veut pas
de vous et qui s'en moque?
SER VESPASIANO.
Ah! diantre! dans ce cas-lŕ, je ne sais pas trop...
PREMIČRE DEMOISELLE.
Il faut posséder beaucoup de patience.
DEUXIČME DEMOISELLE.
Et espérer peu de plaisir.
MINUCCIO, _ŕ la troisičme demoiselle_.
Et vous, ma mie, vous ne dites rien?
TROISIČME DEMOISELLE.
C'est que votre question n'en est pas une, puisqu'on nous dit que
l'espérance est le seul vrai bien qu'on puisse posséder.
LA REINE.
Ser Vespasiano est vaincu. Une autre demande, Minuccio.
MINUCCIO.
Lequel vaut mieux, ou l'amant qui meurt de douleur de ne plus voir sa
maîtresse, ou l'amant qui meurt de plaisir de la revoir?
LES DEMOISELLES, _ensemble_.
Celui qui meurt! celui qui meurt!
SER VESPASIANO.
Mais puisqu'ils meurent tous les deux...
LES DEMOISELLES.
Celui qui meurt! celui qui meurt!
SER VESPASIANO.
Mais on vous dit,... on vous demande...
PREMIČRE DEMOISELLE.
Nous n'aimons que les amants qui meurent d'amour!
SER VESPASIANO.
Mais observez qu'il y a deux maničres...
DEUXIČME DEMOISELLE.
Il n'y a que ceux-lŕ qui aiment véritablement.
SER VESPASIANO.
Cependant...
TROISIČME DEMOISELLE.
Et nous n'en aurons jamais d'autres.[2]
LE ROI.
Lequel vaut mieux, ou de jeunes filles sages, réservées et
silencieuses, ou de petites écervelées qui crient et qui m'empęchent
de finir ma lecture? Voyons, Minuccio, oů est ta viole?
MINUCCIO.
Permettez, Sire, que je ne m'en serve pas. La musique de ma romance
nouvelle n'est pas encore composée; j'en sais seulement les paroles.
LE ROI.
Eh bien! soit.--Et vous, mesdemoiselles...
PREMIČRE DEMOISELLE.
Sire, nous ne dirons plus un mot.
SER VESPASIANO, _ŕ part_.
Quant ŕ moi, j'ai assez de tensons et de chansons comme cela. Leurs
Majestés m'ont ordonné de presser le jour de mes noces... Qui me
résisterait ŕ présent? Je m'esquive donc et vole chez cette belle.
SCČNE VII
LES PRÉCÉDENTS, _excepté_ SER VESPASIANO.
LA REINE, _ŕ Minuccio_.
Les paroles sont-elles de toi?
MINUCCIO.
Non, madame.
LA REINE.
Est-ce de Cipolla?
MINUCCIO.
Encore moins.
LE ROI.
Commence toujours. [Aprčs un combat, mieux encore qu'aprčs un
festin, j'aime ŕ écouter une chanson, et plus la poésie en est douce,
tranquille, plus elle repose agréablement l'oreille fatiguée; car
c'est un grand fracas qu'une bataille, et pour peu qu'un bon coup de
masse sur la tęte...
_Les demoiselles poussent un cri._
Silence! Récite d'abord ta chanson; tu nous diras ensuite quel est
l'auteur. On porte ainsi un meilleur jugement.
MINUCCIO.
Votre Majesté se rit des principes. Que deviendrait la justice
littéraire si on lui mettait un bandeau comme ŕ l'autre?] L'auteur de
ma romance est une jeune fille.
LA REINE.
En vérité!
MINUCCIO.
Une jeune fille charmante, belle et sage, aimable et modeste; et ma
romance est une plainte amoureuse.
LA REINE.
Tout aimable qu'elle est, elle n'est donc pas aimée?
MINUCCIO.
Non, madame, [et elle aime jusqu'ŕ en mourir. Le Ciel lui a donné tout
ce qu'il faut pour plaire, et en męme temps pour ętre heureuse; son
pčre, homme riche et savant, la chérit de toute son âme, ou plutôt
l'idolâtre, et sacrifierait tout ce qu'il possčde pour contenter le
moindre des désirs de sa fille; elle n'a qu'ŕ dire un mot pour voir ŕ
ses pieds une foule d'adorateurs empressés, jeunes, beaux, brillants,
gentilshommes męme, bien qu'elle ne soit pas noble. Cependant],
jusqu'ŕ dix-huit ans, son coeur n'avait pas encore parlé. De tous
ceux qu'attiraient ses charmes, un seul, fils d'un ancien ami, n'avait
pas été repoussé. Dans l'espoir de faire fortune, et de voir agréer
ses soins, il s'était exilé volontairement, et, durant de longues
années, il avait étudié pour ętre avocat.
LE ROI.
Encore un avocat!
MINUCCIO.
Oui, Sire; [et maintenant il est revenu plus heureux encore qu'il
n'est fier d'avoir conquis son nouveau titre, comptant d'ailleurs sur
la parole du pčre, et demandant pour toute récompense qu'il lui soit
permis d'espérer;] mais pendant qu'il était absent, l'indifférente et
cruelle beauté a rencontré, pour son malheur, celui qui devait venger
l'Amour. Un jour, étant ŕ sa fenętre avec quelques-unes de ses amies,
elle vit passer un cavalier qui allait aux fętes de la reine. Elle
suivit ce cavalier; elle le vit au tournoi oů il fut vainqueur... Un
regard décida de sa vie.
LE ROI.
Voilŕ un singulier roman.
MINUCCIO.
Depuis ce jour, elle est tombée dans une mélancolie profonde, car
celui qu'elle aime ne peut lui appartenir. [Il est marié ŕ une
femme... la plus belle, la meilleure, la plus séduisante qui soit
peut-ętre dans ce royaume, et il trouve une maîtresse dans une épouse
fidčle.] La pauvre dédaignée ne s'abuse pas, elle sait que sa
folle passion doit rester cachée dans son coeur; [elle s'étudie
incessamment ŕ ce que personne n'en pénčtre le secret; elle évite
toute occasion de revoir l'objet de son amour; elle se défend męme de
prononcer son nom;] mais l'infortunée a perdu le sommeil, sa raison
s'affaiblit, une langueur mortelle la fait pâlir de jour en jour;
[elle ne veut pas parler de ce qu'elle aime, et elle ne peut penser
ŕ autre chose; elle refuse toute consolation, toute distraction; elle
repousse les remčdes que lui offre un pčre désolé, elle se meurt, elle
se consume, elle se fond comme la neige au soleil.] Enfin, sur le bord
de la tombe, la douleur l'oblige ŕ rompre le silence. Son amant ne la
connaît pas, il ne lui a jamais adressé la parole, peut-ętre męme
ne l'a-t-il jamais vue; elle ne veut pas mourir sans qu'il sache
pourquoi, et elle se décide ŕ lui écrire ainsi:
_Il lit:_
Va dire, Amour, ce qui cause ma peine,
Ŕ monseigneur, que je m'en vais mourir,
Et, par pitié, venant me secourir,
Qu'il m'eűt rendu la mort moins inhumaine.
Ŕ deux genoux je demande merci.
Par grâce, Amour, va-t'en vers sa demeure.
Dis-lui comment je prie et pleure ici,
Tant et si bien qu'il faudra que je meure
Tout enflammée, et ne sachant point l'heure
Oů finira mon adoré souci.
[La mort m'attend, et s'il ne me relčve
De ce tombeau pręt ŕ me recevoir,
J'y vais dormir, emportant mon doux ręve;
Hélas! Amour, fais-lui mon mal savoir.
Depuis le jour oů, le voyant vainqueur,
D'ętre amoureuse, Amour, tu m'as forcée,
Fut-ce un instant, je n'ai pas eu le coeur
De lui montrer ma craintive pensée,
Dont je me sens ŕ tel point oppressée,
Mourant ainsi, que la mort me fait peur.]
Qui sait pourtant, sur mon pâle visage,
Si ma douleur lui déplairait ŕ voir?
De l'avouer je n'ai pas le courage.
Hélas! Amour, fais-lui mon mal savoir.
Puis donc, Amour, que tu n'as pas voulu
Ŕ ma tristesse accorder cette joie,
Que dans mon coeur mon doux seigneur ait lu,
Ni vu les pleurs oů mon chagrin se noie,
Dis-lui, du moins, et tâche qu'il le croie,
Que je vivrais si je ne l'avais vu.
Dis-lui qu'un jour une Sicilienne
Le vit combattre et faire son devoir.
Dans son pays, dis-lui qu'il s'en souvienne,
Et que j'en meurs, faisant mon mal savoir.
LA REINE.
Tu dis que cette romance est d'une jeune fille?
MINUCCIO.
Oui, madame.
LA REINE.
Si cela est vrai, tu lui diras qu'elle a une amie, et tu lui donneras
cette bague.
_Elle ôte une bague de son doigt._
LE ROI.
Mais pour qui cette chanson a-t-elle été faite? Il semble, d'aprčs les
derniers mots, que ce doive ętre pour un étranger. Le connais-tu? quel
est son nom?
MINUCCIO.
Je puis le dire ŕ Votre Majesté, mais ŕ elle seule.
LE ROI.
Bon! quel mystčre!
MINUCCIO.
Sire, j'ai engagé ma parole.
LE ROI.
Éloignez-vous donc, mesdemoiselles. Je suis curieux de savoir ce
secret. Quant ŕ la reine, tu sais que je suis seul quand il n'y a
qu'elle prčs de moi.
_Les demoiselles se retirent au fond du théâtre._
MINUCCIO.
Sire, je le sais, et je suis pręt...
LA REINE.
Non, Minuccio. Je te remercie d'avoir assez bonne opinion de moi pour
me confier ton honneur; mais puisque tu l'as engagé, je ne suis plus
ta reine en ce moment, je ne suis qu'une femme, qui ne veut pas ętre
cause qu'un galant homme puisse se faire un reproche.
_Elle sort._
LE ROI.
Eh bien! ŕ qui s'adressent ces vers?
MINUCCIO.
Votre Majesté a-t-elle oublié qui fut vainqueur au dernier tournoi?
LE ROI.
Hé, par la croix-Dieu! c'est moi-męme.
MINUCCIO.
C'est ŕ vous-męme aussi que ces vers sont adressés.
LE ROI.
Ŕ moi, dis-tu?
MINUCCIO.
Oui, Sire. Dans ce que j'ai raconté, je n'ai rien dit qui ne fűt
véritable. Cette jeune fille que je vous ai dépeinte belle, jeune,
charmante, et mourant d'amour, elle existe, elle demeure lŕ, ŕ deux
pas de votre palais; qu'un de vos officiers m'accompagne, et qu'il
vous rende compte de ce qu'il aura vu. Cette pauvre enfant attend la
mort, c'est ŕ sa pričre que je vous parle; sa beauté, sa souffrance,
sa résignation, sont aussi vraies que son amour.--Carmosine est son
nom.
LE ROI.
Cela est étrange.
MINUCCIO.
Et ce jeune homme ŕ qui son pčre l'avait promise, qui est allé étudier
ŕ Padoue, et qui comptait l'épouser au retour, Votre Majesté l'a vu
ce matin męme; c'est lui qui est venu demander du service ŕ l'armée de
Naples; celui-lŕ mourra aussi, j'en réponds, et plus tôt qu'elle, car
il se fera tuer.
LE ROI.
Je m'en suis douté. Cela ne doit pas ętre; cela ne sera pas. Je veux
voir cette jeune fille.
MINUCCIO.
L'extręme faiblesse oů elle est...
LE ROI.
J'irai. Cela semble te surprendre?
MINUCCIO.
Sire, je crains que votre présence...[3]
LE ROI.
Ne disais-tu pas, tout ŕ l'heure, que tu aurais parlé devant la reine?
MINUCCIO.
Oui, Sire.
LE ROI.
Viens chez elle avec moi.
FIN DE L'ACTE DEUXIČME.
ACTE TROISIČME
_Un jardin.--Ŕ gauche, une fontaine avec plusieurs sičges et un
banc.--Ŕ droite, la maison de maître Bernard.--Dans le fond, une
terrasse et une grille._
SCČNE PREMIČRE
CARMOSINE, _assise sur le banc_; prčs d'elle PERILLO ET MAITRE
BERNARD, MINUCCIO, _assis sur le bord de la fontaine, sa guitare ŕ la
main_.
CARMOSINE.
«Va dire, Amour, ce qui cause ma peine... » Que cette chanson me
plaît, mon cher Minuccio!
MINUCCIO.
Voulez-vous que je la recommence? Nous sommes ŕ vos ordres, moi et mon
bâton.
_Il montre le manche de sa guitare._
CARMOSINE.
Ne te montre pas si complaisant, car je te la ferais répéter cent
fois, et je voudrais l'entendre encore et toujours, jusqu'ŕ ce que mon
attention et ma force fussent épuisées, et que je pusse mourir en y
ręvant!--Comment la trouves-tu, Perillo?
PERILLO.
Charmante quand c'est vous qui la dites.
MAITRE BERNARD.
Je trouve cela trop sombre. Je ne sais ce que c'est qu'une chanson
lugubre. Il me semble qu'en général on ne chante pas ŕ moins d'ętre
gai, moi, du moins, quand cela m'arrive,... mais cela ne m'arrive
plus.
CARMOSINE.
Pourquoi donc, et que reprochez-vous ŕ cette romance de notre ami?
[Elle n'est pas bouffonne, il est vrai, comme un refrain de table;
mais qu'importe? ne saurait-on plaire autrement? Elle parle d'amour,
mais ne savez-vous pas que c'est une fiction obligée, et qu'on ne
saurait ętre počte sans faire semblant d'ętre amoureux? Elle parle
aussi de douleurs et de regrets, mais n'est-il pas aussi convenu que
les amoureux en vers sont toujours les plus heureuses gens du monde,
ou les plus désolés?] «Va dire, Amour, ce qui cause ma peine...»
Comment dit-elle donc ensuite?
MAITRE BERNARD.
Rien de bon, je n'aime point cela.
CARMOSINE.
C'est une romance espagnole, et notre roi don Pčdre l'aime beaucoup;
n'est-ce pas, Minuccio?
MINUCCIO.
Il me l'a dit, et la reine aussi l'a fort approuvée.
MAITRE BERNARD.
Grand bien leur fasse! un air d'enterrement!
CARMOSINE.
Perillo est peut-ętre, quoiqu'il ne le dise pas, de l'avis de mon
pčre, car je le vois triste.
PERILLO.
Non, je vous le jure.
CARMOSINE.
Ce serait bien mal; ce serait me faire croire que tu ne m'as pas
entičrement pardonné.
PERILLO.
Pensez-vous cela?
CARMOSINE.
J'espčre que non; cependant je me sens bien coupable. J'ai été bien
folle, bien ingrate; et toi, pauvre ami, tu venais de si loin, tu
avais été absent si longtemps! Mais que veux-tu! je souffrais hier.
MAITRE BERNARD.
Et maintenant...
CARMOSINE.
Ne craignez plus rien; cette fois mes maux vont finir.
MAITRE BERNARD.
Hier tu en disais autant.
CARMOSINE.
Oh! j'en suis bien sűre aujourd'hui. [Hier, j'ai éprouvé un moment de
bien-ętre, puis une souffrance... Ne parlons plus d'hier, ŕ moins que
ce ne soit, Perillo, pour que tu me répčtes que tu ne t'en souviens
plus.
PERILLO.
Puis-je songer un seul instant ŕ moi quand je vous vois revenir ŕ la
vie? Je n'ai rien souffert si vous souriez.
CARMOSINE.
Oublie donc tes chagrins, comme moi ma tristesse.] Minuccio, je
voulais te demander...
MINUCCIO.
Que cherchez-vous?
CARMOSINE.
Oů est donc ta romance? Il me semble que j'en ai oublié un mot.
_Minuccio lui donne sa romance écrite; elle la relit tout bas._
SCČNE II
LES PRÉCÉDENTS, SER VESPASIANO, DAME PAQUE, _sortant de la maison_.
SER VESPASIANO, _ŕ dame Pâque_.
Que vous avais-je dit? Cela ne pouvait manquer. Voyez quel délicieux
tableau de famille!
DAME PAQUE.
Vous ętes un homme incomparable pour accommoder toute chose.
SER VESPASIANO.
Ce n'était rien; un mot, belle dame, un mot a suffi. Je n'ai fait
que répéter exactement ŕ votre aimable fille ce que Leurs Majestés
m'avaient dit ŕ moi-męme.
DAME PAQUE.
Et elle a consenti?
SER VESPASIANO.
Pas précisément. Vous savez que la pudeur d'une jeune fille...
CARMOSINE, _se levant_.
Ser Vespasiano!
SER VESPASIANO.
Ma princesse.
CARMOSINE.
Vous faites la cour ŕ ma mčre, sans quoi j'allais vous demander votre
bras.
SER VESPASIANO.
Mon bras et mon épée sont ŕ votre service.
CARMOSINE.
Non, je ne veux pas ętre importune. Viens, Perillo, jusqu'ŕ la
terrasse.
_Elle s'éloigne avec Perillo._
SER VESPASIANO, _ŕ dame Pâque_.
Vous le voyez, elle me lance des oeillades bien flatteuses. Mais
qu'est-ce donc que ce petit Perillo?--Je vous avoue qu'il me chagrine
de le voir; il se donne des airs d'amoureux, et si ce n'était le
respect que je vous dois, je ne sais ŕ quoi il tiendrait...
DAME PAQUE.
Y pensez-vous? Se hasarderait-on?... Vous ętes trop bouillant,
chevalier.
SER VESPASIANO.
Il est vrai. Vous me disiez donc que pour ce qui regarde la dot...
_Ils s'éloignent on se promenant._
SCČNE III
MINUCCIO, MAITRE BERNARD.
MAITRE BERNARD.
Tu crois ŕ tout cela, Minuccio?
MINUCCIO.
Oui; je l'écoute, je l'observe, et je crois que tout va pour le mieux.
MAITRE BERNARD.
Tu crois ŕ cette espčce de gaieté? Mais toi-męme, es-tu bien sincčre?
Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce qu'elle t'a confié hier, seul ŕ
seul?
MINUCCIO.
Je vous ai déjŕ répondu que je n'avais rien ŕ vous répondre. Elle
m'avait chargé, comme vous le voyez, de lui ramener Perillo. Ŕ peine
avait-il essayé son casque, l'oiseau chaperonné est revenu au nid.
MAITRE BERNARD.
Tout cela est étrange, tout cela est obscur. Et ce refrain que tu vas
lui chanter, afin d'entretenir sa tristesse!
MINUCCIO.
Vous voyez bien qu'il ne sert qu'ŕ la chasser. Pensez-vous que je
cherche ŕ nuire?
MAITRE BERNARD.
Non, certes, mais je ne puis me défendre...
[MINUCCIO.
Tenez-vous en repos jusqu'ŕ l'heure des vępres.
MAITRE BERNARD.
Pourquoi cela? pourquoi jusqu'ŕ cette heure? C'est la troisičme fois
que tu me le répčtes, sans jamais vouloir t'expliquer.
MINUCCIO.
Je ne puis vous en dire plus long, car je n'en sais pas moi-męme
davantage. La plus belle fille ne donne que ce qu'elle a, et l'ami le
plus dévoué se tait sur ce qu'il ignore.
MAITRE BERNARD.
La peste soit de tes mystčres! Que se prépare-t-il donc pour cette
heure-lŕ? Quel événement doit nous arriver? Est-ce donc le roi en
personne qui va venir nous rendre visite?
MINUCCIO, _ŕ part_.
Il ne croit pas ętre si prčs de la vérité.
_Haut._
Mon vieil ami, ayez bon espoir. Si tout ne s'arrange pas ŕ souhait, je
casse le manche de ma guitare.
MAITRE BERNARD.
Beau profit! Enfin, nous verrons, puisqu'ŕ toute force il faut prendre
patience; mais je ne te pardonne point ces façons d'agir.
MINUCCIO.
Cela viendra plus tard, j'espčre. Encore une fois, doutez-vous de moi?
MAITRE BERNARD.
Hé non, enragé que tu es, avec ta discrétion maussade?] Écoute, il
faut que je te dise tout, bien que tu ne veuilles me rien dire. Une
chose ici me fait plus que douter, me fait frémir, entends-tu bien?
Cette nuit, poussé par l'inquiétude, je m'étais approché doucement de
la chambre de Carmosine, pour écouter si elle dormait. Ŕ travers la
fente de la porte, entre le gond et la muraille, je l'ai vue assise
dans son lit, avec un flambeau tout prčs d'elle; elle écrivait, et, de
temps en temps, elle semblait réfléchir trčs profondément, puis elle
reprenait sa plume avec une vivacité effrayante, comme si elle eűt
obéi ŕ quelque impression soudaine. Mon trouble en la voyant, ou ma
curiosité, sont devenus trop forts. Je suis entré: tout aussitôt sa
lumičre s'est éteinte, et j'ai entendu le bruit d'un papier qui se
froissait en glissant sous son chevet.
MINUCCIO.
C'est quelque adieu ŕ ce pauvre Antoine, qui s'est fait soldat, ŕ ce
qu'il croit.
MAITRE BERNARD.
Ma fille l'ignorait.
MINUCCIO.
Oh! que non. Est-ce qu'un amant s'en va en silence? Il ne se noierait
męme pas sans le dire.
MAITRE BERNARD.
Je n'en sais rien, mais je croirais presque... Voilŕ cet imbécile qui
revient avec ma femme.--Rentrons; je veux que tu saches tout.
MINUCCIO.
C'est encore votre fille qui a rappelé celui-lŕ. Vous voyez bien
qu'elle ne pense qu'ŕ rire.
_Ils rentrent dans la maison._
SCČNE IV
SER VESPASIANO ET DAME PAQUE _viennent du fond du jardin_.
SER VESPASIANO.
Pour la dot, je suis satisfait, et je vous quitte pour voler chez le
tabellion, afin de hâter le contrat.
DAME PAQUE.
Et moi, chevalier, je suis ravie que vous soyez de si bonne
composition.
SER VESPASIANO.
Comment donc! la dot est honnęte, la fille aussi; mon but principal
est de m'attacher ŕ votre famille.
DAME PAQUE.
Mon mari fera quelques difficultés; entre nous, c'est une pauvre tęte,
un homme qui calcule, un homme besoigneux.
SER VESPASIANO.
Bah! cela me regarde. Nous ferons des noces, si vous m'en croyez,
magnifiques. Le roi y viendra.
DAME PAQUE.
Est-ce possible!
SER VESPASIANO.
Il y dansera, mort-Dieu! il y dansera, et avec vous-męme, dame Pâque.
Vous serez la reine du bal.
DAME PAQUE.
Ah! ces plaisirs-lŕ ne m'appartiennent plus.
SER VESPASIANO.
Vous les verrez renaître sous vos pas. Je vole chez le tabellion.
SCČNE V
CARMOSINE ET PERILLO _viennent du fond_.
CARMOSINE.
Il faut me le promettre, Antoine. Songez ŕ ce que deviendrait mon pčre
si Dieu me retirait de ce monde.
PERILLO.
Pourquoi ces cruelles pensées? vous ne parliez pas ainsi tout ŕ
l'heure.
CARMOSINE.
Songez que je suis ce qu'il aime le mieux, presque sa seule joie sur
la terre. S'il venait ŕ me perdre, je ne sais vraiment pas comment
il supporterait ce malheur. [Votre pčre fut son dernier ami, et quand
vous ętes resté orphelin, vous vous souvenez, Perillo, que cette
maison est devenue la vôtre. En nous voyant grandir ensemble, on
disait dans le voisinage que maître Bernard avait deux enfants. S'il
devait aujourd'hui n'en avoir plus qu'un seul...
PERILLO.
Mais vous nous disiez d'espérer.
CARMOSINE.
Oui, mon ami, mais il faut me promettre de prendre soin de lui, de
ne pas l'abandonner... Je sais que vous avez fait une demande, et
que vous pensez ŕ quitter Palerme... Mais, écoutez-moi, vous pouvez
encore... Il m'a semblé entendre du bruit.
PERILLO.
Ce n'est rien; je ne vois personne.
CARMOSINE.
Vous pouvez encore revenir sur votre détermination,... j'en suis
convaincue, je le sais. Je ne vous parle pas de cette démarche, ni du
motif qui l'a dictée; mais] s'il est vrai que vous m'avez aimée, vous
prendrez ma place aprčs moi.
PERILLO.
Rien aprčs vous!
CARMOSINE.
Vous la prendrez, si vous ętes honnęte homme... Je vous lčgue mon
pčre.
PERILLO.
Carmosine!... Vous me parlez, en vérité, comme si vous aviez un pied
dans la tombe. Cette romance que, tout ŕ l'heure, vous vous plaisiez
ŕ répéter, je ne m'y suis pas trompé, j'en suis sűr, c'est votre
histoire, c'est pour vous qu'elle est faite, c'est votre secret: vous
voulez mourir.
CARMOSINE.
Prends garde! Ne parle pas si haut.
PERILLO.
[Et qu'importe que l'on m'entende si ce que je dis est la vérité! Si
vous avez dans l'âme cette affreuse idée de quitter volontairement
la vie, et de nous cacher vos souffrances, jusqu'ŕ ce qu'on vous voie
tout ŕ coup expirer au milieu de nous... Que dis-je, grand Dieu! quel
soupçon horrible! S'il se pouvait que, lassée de souffrir, fidčle
seulement ŕ votre affreux silence, vous eussiez conçu la pensée...]
Vous me recommandiez votre pčre... Vous ne voudriez pas tuer sa fille!
CARMOSINE.
Ce n'est pas la peine, mon ami; la mort n'a que faire d'une main si
faible.
PERILLO.
Mais vous souhaitez donc qu'elle vienne? Pourquoi trompez-vous votre
pčre? Pourquoi affectez-vous devant lui ce repos, cet espoir que vous
n'avez pas, cette sorte de joie qui est si loin de vous?
CARMOSINE.
Non, pas si loin que tu peux le croire. Lorsque Dieu nous appelle ŕ
lui, il nous envoie, n'en doute point, des messagers secrets qui nous
avertissent. [Je n'ai pas fait beaucoup de bien, mais je n'ai pas non
plus fait grand mal. L'idée de paraître devant le Juge supręme ne
m'a jamais inspiré de crainte; il le sait, je le lui ai dit; il me
pardonne et m'encourage.] J'espčre, j'espčre ętre heureuse. J'en ai
déjŕ de charmants présages.
PERILLO.
Vous l'aimez beaucoup, Carmosine.
CARMOSINE.
De qui parles-tu?
PERILLO.
Je n'en sais rien; mais la mort seule n'a point tant d'attraits.
CARMOSINE.
Écoute. Ne fais pas de vaines conjectures, et ne cherche pas ŕ
pénétrer un secret qui ne saurait ętre bon ŕ personne; tu l'apprendras
quand je ne serai plus. [Tu me demandes pourquoi je trompe mon pčre?
C'est précisément par cette raison que je ne ferais, en m'ouvrant ŕ
lui, qu'une chose cruelle et inutile. Je ne t'aurais point non plus
parlé comme je l'ai fait, si, en le faisant, je n'eusse rempli un
devoir. Je te demande de ne point trahir la confiance que j'ai en toi.
PERILLO.
Soyez sans crainte; mais, de votre côté, promettez-moi du moins...
CARMOSINE.
Il suffit. Songe, mon ami, qu'il y a des maux sans remčde.] Tu vas
maintenant aller dans ma chambre; voici une clef, tu ouvriras un
coffre qui est derričre le chevet de mon lit, tu y trouveras une robe
de fęte;... je ne la porterai plus, celle-lŕ, je l'ai portée aux fętes
de la reine, lorsque pour la premičre fois... Il y a dessous un papier
écrit, que tu prendras et que tu garderas; je te le confie,... ŕ toi
seul, n'est-ce pas?
PERILLO.
Votre testament, Carmosine?
CARMOSINE.
Oh! cela ne mérite pas d'ętre appelé ainsi. De quoi puis-je disposer
au monde? C'est bien peu de chose que ces adieux qu'on laisse malgré
soi ŕ la vie, et qu'on nomme derničres volontés! Tu y trouveras ta
part, Perillo.
PERILLO.
Ma part! Dieu juste, quelle horreur!... Et vous pensez qu'il est
possible...
CARMOSINE.
Épargne-moi, épargne-moi. Nous en reparlerons tout ŕ l'heure, [dans
ma chambre, car je vais rentrer;] il se fait tard, [voici l'heure des
vępres.[4]]
SCČNE VI
CARMOSINE, _seule_.
Ta part! pauvre et excellent coeur!--Elle eűt été plus douce, et tu
la méritais, si l'impitoyable hasard ne m'eűt fait rencontrer... Dieu
puissant! quel blasphčme sort donc de mes lčvres! O ma douleur, ma
chčre douleur, j'oserais me plaindre de toi? Toi mon seul bien, toi ma
vie et ma mort, toi qu'il connaît maintenant? O bon Minuccio, digne,
loyal ami! il t'a écouté, tu lui as tout dit, il a souri, il a été
touché, il m'a envoyé une bague...
_Elle la baise._
Tu reposeras avec moi! Ah! quelle joie, quel bonheur ce matin quand
j'ai entendu ces mots: Il sait tout! Qu'importent maintenant et mes
larmes, et ma souffrance, et toutes les tortures de la mort! Il
sait que je pleure, il sait que je souffre! [Oui, Perillo avait
raison;--cette joie devant mon pčre a été cruelle, mais pouvais-je la
contenir? Rien qu'en regardant Minuccio, le coeur me battait avec
tant de force! Il l'avait vu, lui, il lui avait parlé!] O mon amour! ô
charme inconcevable! délicieuse souffrance, tu es satisfaite! je
meurs tranquille, et mes voeux sont comblés.--L'a-t-il compris en
m'envoyant cette bague? A-t-il senti qu'en disant que j'aimais, je
disais que j'allais mourir? Oui, il m'a comprise, il m'a devinée. Il
m'a mis au doigt cet anneau qui restera seul dans ma tombe quand je ne
serai plus qu'un peu de poussičre... Grâces te soient rendues, ô mon
Dieu! je vais mourir, et je puis mourir!
_On entend sonner ŕ la grille du jardin._
On sonne ŕ la grille, je crois?--Holŕ! Michel! personne ici? Comment
m'a-t-on laissée toute seule?
_Elle s'approche de la maison._
[Ah! ils sont tous lŕ, dans la salle basse, ils lisent quelque
chose attentivement, et paraissent se consulter. Minuccio semble les
retenir... Perillo m'aurait-il trahie?
_On sonne une seconde fois._
Ce sont deux dames voilées qui sonnent. Michel, oů es-tu? Ouvre donc]
SCČNE VII
CARMOSINE, LA REINE, MICHEL, _ouvrant la grille. Une femme, qui
accompagne la reine, reste au fond du théâtre._
LA REINE.
N'est-ce pas ici que demeure maître Bernard, le médecin?
MICHEL.
Oui, madame.
LA REINE.
Puis-je lui parler?
MICHEL.
Je vais l'avertir.
LA REINE.
Attends un instant. Qui est cette jeune fille?
MICHEL.
C'est mademoiselle Carmosine.
LA REINE.
La fille de ton maître?
MICHEL.
Oui, madame.
LA REINE.
Cela suffit, c'est ŕ elle que j'ai affaire.
SCČNE VIII
CARMOSINE, LA REINE.
LA REINE.
Pardon, mademoiselle...
_Ŕ part._
Elle est bien jolie.
_Haut._
Vous ętes la fille de maître Bernard?
CARMOSINE.
Oui, madame.
LA REINE.
Puis-je, sans ętre indiscrčte, vous demander un moment d'entretien?
_Carmosine lui fait signe de s'asseoir._
Vous ne me connaissez pas?
CARMOSINE.
Je ne saurais dire...
LA REINE, _s'asseyant_.
Je suis parente... un peu éloignée... d'un jeune homme qui demeure
ici, je crois, et qui se nomme Perillo.
CARMOSINE.
Il est ŕ la maison, si vous voulez le voir...
LA REINE.
Tout ŕ l'heure, si vous le permettez.--Je suis étrangčre,
mademoiselle, et j'occupe ŕ la cour d'Espagne une position assez
élevée. Je porte ŕ ce jeune homme beaucoup d'intéręt, et il serait
possible qu'un jour le crédit dont je puis disposer devint utile ŕ sa
fortune.
CARMOSINE.
Il le mérite ŕ tous égards.
_Maître Bernard et Minuccio paraissent sur le seuil de la maison._
MAITRE BERNARD, _bas ŕ Minuccio_.
Qui donc est lŕ avec ma fille?
MINUCCIO.
Ne dites mot, venez avec moi.
_Il l'emmčne._
LA REINE.
C'est précisément sur ce point que je désire ętre éclairée, [et je
vous demande encore une fois pardon de ce que ma démarche peut avoir
d'étrange.
CARMOSINE.
Elle est toute simple, madame, mais mon pčre serait plus en état de
vous répondre que moi; je vais, s'il vous plaît...
LA REINE.
Non, je vous en prie, ŕ moins que je ne vous importune. Vous ętes
souffrante, m'a-t-on dit.
CARMOSINE.
Un peu, madame.
LA REINE.
On ne le croirait pas.
CARMOSINE.
Le mal dont je souffre ne se voit pas toujours, bien qu'il ne me
quitte jamais.
LA REINE.
Il ne saurait ętre bien sérieux, ŕ votre âge.
CARMOSINE.
En tout temps, Dieu fait ce qu'il veut.
LA REINE.
Je suis sűre qu'il ne veut pas vous faire grand mal.--Mais la crainte
que j'ai de vous fatiguer me force ŕ préciser mes questions, car je ne
veux point vous le cacher, c'est de vous, et de vous seulement, que
je désirerais une réponse, et je suis persuadée, si vous me la faites,
qu'elle sera sincčre.] Vous avez été élevée avec ce jeune homme; vous
le connaissez depuis son enfance.--Est-ce un honnęte homme? est-ce un
homme de coeur?
CARMOSINE.
Je le crois ainsi; mais, madame, je ne suis pas un assez bon juge...
LA REINE.
Je m'en rapporte entičrement ŕ vous.
[CARMOSINE.
D'oů me vient l'honneur que vous me faites? Je ne comprends pas bien
que, sans me connaître...
LA REINE.
Je vous connais plus que vous ne pensez, et la preuve que j'ai toute
confiance en vous, c'est la question que je vais vous faire, en vous
priant de l'excuser, mais d'y répondre avec franchise. Vous ętes
belle, jeune et riche, dit-on.] Si ce jeune homme [dont nous parlons]
demandait votre main, l'épouseriez-vous?
CARMOSINE.
Mais, madame...
LA REINE.
En supposant, bien entendu, que votre coeur fut libre, et qu'aucun
engagement ne vînt s'opposer ŕ cette alliance.
CARMOSINE.
Mais, madame, dans quel but me demandez-vous cela?
LA REINE.
C'est que j'ai pour amie une jeune fille, belle comme vous, qui
a votre âge, qui est, comme vous, un peu souffrante; c'est de la
mélancolie ou peut-ętre quelque chagrin secret qu'elle dissimule, je
ne sais trop, mais j'ai le projet, si cela se peut, de la marier, et
de la mener ŕ la cour, afin d'essayer de la distraire; car elle vit
dans la solitude, et vous savez de quel danger cela est pour une jeune
tęte qui s'exalte, se nourrit de désirs, d'illusions; [qui prend pour
l'espérance tout ce qu'elle entrevoit, pour l'avenir tout ce qu'elle
ne peut voir; qui s'attache ŕ un ręve dont elle se fait un monde,
innocemment, sans y réfléchir, par un penchant naturel du coeur,]
et qui, hélas! en cherchant l'impossible, passe bien souvent ŕ côté du
bonheur.
[CARMOSINE.
Cela est cruel.
LA REINE.
Plus qu'on ne peut dire.] Combien j'en ai vu, des plus belles, des
plus nobles et des plus sages, perdre leur jeunesse, et quelquefois la
vie, pour avoir gardé de pareils secrets!
CARMOSINE.
On peut donc en mourir, madame?
LA REINE.
Oui, on le peut, et ceux qui le nient ou qui s'en raillent, n'ont
jamais su ce que c'est que l'amour, [ni en ręve ni autrement. Un
homme, sans doute, doit s'en défendre. La réflexion, le courage, la
force, l'habitude de l'activité, le métier des armes surtout, doivent
le sauver; mais une femme!--Privée de ce qu'elle aime, oů est son
soutien? Si elle a du courage, oů est sa force? Si elle a un métier,
fűt-ce le plus dur, celui qui exige le plus d'application, qui peut
dire oů est sa pensée pendant que ses yeux suivent l'aiguille, ou que
son pied fait tourner le rouet?]
CARMOSINE.
Que vous me charmez de parler ainsi!
LA REINE.
C'est que je dis ce que je pense. C'est pour n'ętre pas obligé de les
plaindre qu'on ne veut pas croire ŕ nos chagrins. Ils sont réels,
et d'autant plus profonds, que ce monde qui en rit nous force ŕ les
cacher; notre résignation est une pudeur; nous ne voulons pas qu'on
touche ŕ ce voile, nous aimons mieux nous y ensevelir; de jour en jour
on se fait ŕ sa souffrance, on s'y livre, on s'y abandonne, on s'y
dévoue, on l'aime, on aime la mort... Voilŕ pourquoi je voudrais
tâcher d'en préserver ma jeune amie.
CARMOSINE.
Et vous songez ŕ la marier; est-ce que c'est Perillo qu'elle aime?
LA REINE.
Non, mon enfant, ce n'est pas lui; mais s'il est tel qu'on me l'a dit,
bon, brave, honnęte (savant, peu importe), sa femme ne serait-elle pas
heureuse?
CARMOSINE.
Heureuse, si elle en aime un autre!
LA REINE.
Vous ne répondez pas ŕ ma question premičre. [Je vous avais demandé
de me dire si, ŕ votre avis personnel, Perillo vous semble, en effet,
digne d'ętre chargé du bonheur d'une femme. Répondez, je vous en
conjure.]
CARMOSINE.
Mais, si elle en aime un autre, madame, il lui faudra donc l'oublier?
LA REINE, _ŕ part_.
Je n'en obtiendrai pas davantage.
_Haut._
[Pourquoi l'oublier? Qui le lui demande?
CARMOSINE.
Dčs qu'elle se marie, il me semble...
LA REINE.
Eh bien! achevez votre pensée.
CARMOSINE.
Ne commet-elle pas un crime, si elle ne peut donner tout son coeur,
toute son âme?...]
LA REINE.
Je ne vous ai pas tout dit. Mais je craindrais...
CARMOSINE.
Parlez, de grâce, je vous écoute; je m'intéresse aussi ŕ votre amie.
LA REINE.
Eh bien! supposez que celui qu'elle aime, ou croit aimer, ne puisse
ętre ŕ elle; supposez qu'il soit marié lui-męme.
CARMOSINE.
Que dites-vous?
LA REINE.
Supposez plus encore. Imaginez que c'est un trčs-grand seigneur, un
prince; que le rang qu'il occupe, que le nom seul qu'il porte, mettent
ŕ jamais entre elle et lui une barričre infranchissable... Imaginez
que c'est le roi.
CARMOSINE.
Ah! madame! qui ętes-vous?
LA REINE.
Imaginez que la soeur de ce prince, ou sa femme, si vous voulez,
soit instruite de cet amour, qui est le secret de ma jeune amie, et
que, loin de ressentir pour elle ni aversion ni jalousie, elle ait
entrepris de la consoler, de la persuader, de lui servir d'appui, de
l'arracher ŕ sa retraite, pour lui donner une place auprčs d'elle dans
le palais męme de son époux; imaginez qu'elle trouve tout simple que
cet époux victorieux, le plus vaillant chevalier de son royaume,
ait inspiré un sentiment que tout le monde comprendra sans peine;
figurez-vous qu'elle n'a aucune défiance, aucune crainte de sa jeune
rivale, non qu'elle fasse injure ŕ sa beauté, mais parce qu'elle croit
ŕ son honneur; supposez qu'elle veuille enfin que cette enfant, qui
a osé aimer un si grand prince, ose l'avouer, afin que cet amour,
tristement caché dans la solitude, s'épure en se montrant au grand
jour, et s'ennoblisse par sa cause męme.
CARMOSINE, _fléchissant le genou_.
Ah! madame, vous ętes la reine!
LA REINE.
Vous voyez donc bien, mon enfant, que je ne vous dis pas d'oublier don
Pčdre.
CARMOSINE.
Je l'oublierai, n'en doutez pas, madame, si la mort peut faire
oublier. Votre bonté est si grande, qu'elle ressemble ŕ Dieu! Elle
me pénčtre d'admiration, de respect et de reconnaissance; mais elle
m'accable, elle me confond. Elle me fait trop vivement sentir combien
je suis peu digne d'en ętre l'objet... Pardonnez-moi, je ne puis
exprimer... Permettez que je me retire, que je me cache ŕ tous les
yeux.
LA REINE.
Remettez-vous, ma belle, calmez-vous. Ai-je rien dit qui vous effraie?
CARMOSINE.
Ce n'est pas de la frayeur que je ressens. O mon Dieu! vous ici!
la reine! Comment avez-vous pu savoir?... Minuccio m'a trahie sans
doute... Comment pouvez-vous jeter les yeux sur moi?... Vous me tendez
la main, madame! Ne me croyez-vous pas insensée?... Moi, la fille de
maître Bernard, avoir osé élever mes regards!... Ne croyez-vous pas
que ma démence est un crime, et que vous devez m'en punir?... Ah! sans
nul doute, vous le voyez; mais vous avez pitié d'une infortunée dont
la raison est égarée, et vous ne voulez pas que cette pauvre folle
soit plongée au fond d'un cachot, ou livrée ŕ la risée publique!
LA REINE.
Ŕ quoi songez-vous, juste ciel!
CARMOSINE.
Ah! je mériterais d'ętre ainsi traitée, si je m'étais abusée un
moment, si mon amour avait été autre chose qu'une souffrance! Dieu
m'est témoin, Dieu qui voit tout, qu'ŕ l'instant męme oů j'ai aimé,
je me suis souvenue qu'il était le roi. Dieu sait aussi que j'ai tout
essayé pour me sauver de ma faiblesse, et pour chasser de ma mémoire
ce qui m'est plus cher que ma vie. Hélas! madame, vous le savez sans
doute, que personne ici-bas ne répond de son coeur, et qu'on ne
choisit pas ce qu'on aime. [Mais croyez-moi, je vous en supplie;
puisque vous connaissez mon secret, connaissez-le du moins tout
entier. Croyez, madame, et soyez convaincue, je vous le demande les
mains jointes, croyez qu'il n'est entré dans mon âme ni espoir, ni
orgueil, ni la moindre illusion.] C'est malgré mes efforts, malgré
ma raison, malgré mon orgueil męme, que j'ai été impitoyablement,
misérablement accablée par une puissance invincible, qui a fait de moi
son jouet et sa victime. Personne n'a compté mes nuits, personne n'a
vu toutes mes larmes, pas męme mon pčre. Ah! je ne croyais pas que
j'en viendrais jamais ŕ en parler moi-męme. J'ai souhaité, il est
vrai, quand j'ai senti la mort, de ne point partir sans un adieu;
je n'ai pas eu la force d'emporter dans la tombe ce secret qui
me dévorait. Ce secret! c'était ma vie elle-męme, et je la lui ai
envoyée. Voilŕ mon histoire, madame, je voulais qu'il la sűt, et
mourir.
LA REINE.
Eh bien! mon enfant, il la sait, car c'est lui qui me l'a racontée;
Minuccio ne vous a point trahie.
CARMOSINE.
Quoi! madame, c'est le roi lui-męme...
LA REINE.
Qui m'a tout dit. [Votre reconnaissance allait beaucoup trop loin
pour moi.] C'est le roi qui veut que vous repreniez courage, que vous
guérissiez, que vous soyez heureuse. Je ne vous demandais, moi, qu'un
peu d'amitié.
CARMOSINE, _d'une voix faible_.
C'est lui qui veut que je reprenne courage?
LA REINE.
Oui; je vous répčte ses propres paroles.
CARMOSINE.
Ses propres paroles? Et que je guérisse?
LA REINE.
Il le désire.
CARMOSINE.
Il le désire? Et que je sois heureuse, n'est-ce pas?
LA REINE.
Oui, si nous y pouvons quelque chose.
CARMOSINE.
Et que j'épouse Perillo? Vous me le proposiez tout ŕ l'heure;... car
je comprends tout ŕ présent,... votre jeune amie, c'était moi.
LA REINE.
Oui, c'était vous, c'est ŕ ce titre que je vous ai envoyé cette bague.
Minuccio ne vous l'a-t-il pas dit?
CARMOSINE.
C'était vous?... Je vous remercie,... et je suis pręte ŕ obéir.
_Elle tombe sur le banc._
LA REINE.
Qu'avez-vous, mon enfant? Grand Dieu! quelle pâleur Vous ne me
répondez pas? je vais appeler.
CARMOSINE.
Non, je vous en prie! ce n'est rien; pardonnez-moi.
[LA REINE.
Je vous ai affligée? Vous me feriez croire que j'ai eu tort de venir
ici, et de vous parler comme je l'ai fait.
CARMOSINE, _se levant_.
Tort de venir! ai-je dit cela, lorsque j'en suis encore ŕ comprendre
que la bonté humaine puisse inspirer une générosité pareille ŕ la
vôtre! Tort de venir, vous, ma souveraine, quand je devrais vous
parler ŕ genoux! lorsqu'en vous voyant devant moi, je me demande si ce
n'est point un ręve! Ah! madame, je serais plus qu'ingrate en manquant
de reconnaissance. Que puis-je faire pour vous remercier dignement?
je n'ai que la ressource d'obéir. Il veut que je l'oublie, n'est-ce
pas?... Dites-lui que je l'oublierai.
LA REINE.
Vous m'avez donc bien mal comprise, ou je me suis bien mal exprimée.
Je suis votre reine, il est vrai, mais si je ne voulais qu'ętre obéie,
enfant que vous ętes, je ne serais pas venue. Voulez-vous m'écouter
une derničre fois?
CARMOSINE.
Oui, madame;] je vois maintenant que ce secret qui était ma
souffrance, et qui était aussi mon seul bien, tout le monde le
connaît. Le roi me méprise, [et je pensais bien qu'il en devait ętre
ainsi, mais je n'en étais pas certaine.] Ma triste histoire, il l'a
racontée; ma romance, on la chante ŕ table, devant ses chevaliers et
ses barons. Cette bague, elle ne vient pas de lui; Minuccio me l'avait
laissé croire. Ŕ présent, il ne me reste rien; ma douleur męme ne
m'appartient plus. Parlez, madame, tout ce que je puis dire, c'est que
vous me voyez résignée ŕ obéir, ou ŕ mourir.
LA REINE.
Et c'est précisément ce que nous ne voulons pas, et je vais vous dire
ce que nous voulons. Écoutez donc: oui, c'est le roi qui veut d'abord
que vous guérissiez, et que vous reveniez ŕ la vie; c'est lui qui
trouve que ce serait grand dommage qu'une si belle créature vînt
ŕ mourir d'un si vaillant amour;--ce sont lŕ ses propres
paroles.--Appelez-vous cela du mépris?--Et c'est moi qui veux vous
emmener, que vous restiez prčs de moi, que vous ayez une place parmi
mes filles d'honneur, qui, elles aussi, sont mes bonnes amies; c'est
moi qui veux que, loin d'oublier don Pčdre, vous puissiez le voir tous
les jours; qu'au lieu de combattre un penchant dont vous n'avez pas ŕ
vous défendre, vous cédiez ŕ cette franche impulsion de votre âme vers
ce qui est beau, noble et généreux, car on devient meilleur avec un
tel amour; c'est moi, Carmosine, qui veux vous apprendre que l'on peut
aimer sans souffrir, lorsque l'on aime sans rougir, qu'il n'y a que la
honte ou le remords qui doivent donner de la tristesse, car elle est
faite pour le coupable, et, ŕ coup sűr, votre pensée ne l'est pas.
CARMOSINE.
Bonté du ciel!
LA REINE.
C'est encore moi qui veux qu'un époux digne de vous, qu'un homme
loyal, honnęte et brave, vous donne la main pour entrer chez moi;
qu'il sache comme moi, comme tout le monde, le secret de votre
souffrance passée; qu'il vous croie fidčle sur ma parole, que je
vous croie heureuse sur la sienne, et que votre coeur puisse guérir
ainsi, par l'amitié de votre reine, et par l'estime de votre époux...
Prętez l'oreille, n'est-ce pas le bruit du clairon?
CARMOSINE.
C'est le roi qui sort du palais.
LA REINE.
Vous savez cela, jeune fille?
CARMOSINE.
Oui, madame; nous demeurons si prčs! nous sommes habitués ŕ entendre
ce bruit.
LA REINE.
C'est le roi qui vient, en effet, et il vient ici.
CARMOSINE.
Est-ce possible?
LA REINE.
Il vient nous chercher toutes deux. Entendez-vous aussi ces cloches?
CARMOSINE.
Oui, et j'aperçois derričre la grille une foule immense qui se rend ŕ
l'église. Aujourd'hui,... je me rappelle,... n'est-ce pas un jour de
fęte? Comme ils accourent de tous côtés! Ah! mon ręve! je vois mon
ręve!
LA REINE.
C'est l'heure de la bénédiction.
CARMOSINE.
Oui, en ce moment le prętre est ŕ l'autel, et tous s'inclinent devant
lui. Il se retourne vers la foule, il tient entre ses mains l'image du
Sauveur, il l'élčve... Pardonnez-moi!
_Elle s'agenouille._
LA REINE.
Prions ensemble, mon enfant; demandons ŕ Dieu quelle réponse vous
allez faire ŕ votre roi.
_On entend de nouveau le son des clairons. Des écuyers et des hommes
d'armes s'arrętent ŕ la grille, le roi paraît bientôt aprčs._
SCČNE IX
LES PRÉCÉDENTS, LE ROI, PERILLO, _prčs de lui_, MAITRE BERNARD, DAME
PAQUE, SER VESPASIANO, MINUCCIO.
[LE ROI.
Vous avez lŕ un grand jardin, cela est commode et agréable.
MAITRE BERNARD.
Oui, Sire, cela est commode, et, en effet...]
LE ROI.
Oů est votre fille?
MAITRE BERNARD.
La voilŕ, Sire, devant Votre Majesté...
[LE ROI.
Est-elle mariée?
MAITRE BERNARD.
Non, Sire, pas encore,... c'est-ŕ-dire,... si Votre Majesté...]
LE ROI, _ŕ Carmosine_.
C'est donc vous, gentille demoiselle, qui ętes souffrante et en
danger, dit-on? [Vous n'avez pas le visage ŕ cela.
MAITRE BERNARD.
Elle a été, Sire, et elle est encore gravement malade. Il est vrai
que, depuis ce matin ŕ peu prčs, l'amélioration est notable.
LE ROI.
Je m'en réjouis. En bonne foi, il serait fâcheux que le monde fűt
sitôt privé d'une si belle enfant.]
_Ŕ Carmosine._
Approchez un peu, je vous prie.
[SER VESPASIANO, _ŕ Minuccio_.
Voyez-vous ce que je vous ai dit? Il va arranger toute l'affaire.
Calatabellotte est ŕ moi.
MINUCCIO.
Point, c'est une simple consultation, qu'ils vont faire en
particulier. Les Espagnols tiennent cela des Arabes. Le roi est un
grand médecin; c'est la méthode d'Albucassis.]
LE ROI, _ŕ Carmosine_.
Vous tremblez, je crois. Vous défiez-vous de moi?
CARMOSINE.
Non, Sire.
LE ROI.
Eh bien! donc, donnez-moi la main. Que veut dire ceci, la belle fille?
Vous qui ętes jeune et qui ętes faite pour réjouir le coeur des
autres, vous vous laissez avoir du chagrin? Nous vous prions, pour
l'amour de nous, qu'il vous plaise de prendre courage, et que vous
soyez bientôt guérie.
CARMOSINE.
Sire, c'est mon trop peu de force ŕ supporter une trop grande peine
qui est la cause de ma souffrance. Puisque vous avez pu m'en plaindre,
j'espčre que Dieu m'en délivrera.
LE ROI.
Voilŕ qui est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut m'obéir sur un
autre point. Quelqu'un vous en a-t-il parlé?
CARMOSINE.
Sire, on m'a dit toute la bonté, toute la pitié qu'on daignait
avoir...
LE ROI.
Pas autre chose?
_Ŕ la reine._
Est-ce vrai, Constance?
LA REINE.
Pas tout ŕ fait.
LE ROI.
Belle Carmosine, je parlerai en roi et en ami. Le grand amour que vous
nous avez porté vous a, prčs de nous, mise en grand honneur; et celui
qu'en retour nous voulons vous rendre, c'est de vous donner de notre
main, en vous priant de l'accepter, l'époux que nous vous avons
choisi.
_Il fait signe ŕ Perillo, qui s'avance et s'incline._
Aprčs quoi, nous voulons toujours nous appeler votre chevalier, et
porter dans nos passes d'armes votre devise et vos couleurs, sans
demander autre chose de vous, pour cette promesse, qu'un seul baiser.
LA REINE, _ŕ Carmosine_.
Donne-le, mon enfant, je ne suis pas jalouse.
CARMOSINE, _donnant son front ŕ baiser au roi_.
Sire, la reine a répondu pour moi.
FIN DE CARMOSINE.
ADDITIONS ET VARIANTES EXÉCUTÉES POUR LA REPRÉSENTATION
1.--PAGE 369.
_La premičre cause de_ ta fortune _aura été_, etc.
2.--PAGE 377.
TROISIČME DEMOISELLE.
_Et nous n'en aurons jamais d'autres._
TOUTES LES DEMOISELLES, _ensemble_.
Et nous n'en aurons jamais d'autres.
3.--PAGE 384.
_Je crains que votre présence._
LE ROI.
J'irai, te dis-je. Je la verrai, je lui parlerai. Je ne veux pas que
cette jeune fille meure; je ne le veux pas.
MINUCCIO.
Il ne sera pas facile de l'en empęcher, car elle l'a résolu, et
la besogne est ŕ moitié faite. Sire, prenez garde de l'achever en
cherchant ŕ la sauver.
LE ROI.
_Ne disais-tu pas tout ŕ l'heure_, etc.
4.--PAGE 398.
_Il se fait tard._ Va, mon ami, fais ce que je t'ai dit.
PERILLO, _en sortant_.
Ah! cela est horrible!
FIN DES ADDITIONS ET VARIANTES.
Le sujet de _Carmosine_ se trouve dans une nouvelle du _Décaméron_ (la
septičme de la dixičme journée). En voici le sommaire:
«Le roi Pierre, ayant appris le fervent amour que lui portait Lise,
et dont elle était malade, va la consoler et la marie avec un jeune
gentilhomme; aprčs quoi il lui donne un baiser sur le front et se
déclare pour toujours son chevalier.»
Cette anecdote, que Boccace raconte avec beaucoup de grandeur et de
simplicité, n'a que huit pages, et les caractčres n'y sont pas męme
indiqués, hormis pourtant celui du roi, dont la conduite fait assez
connaître la générosité chevaleresque. Le jeune gentilhomme qui, dans
la nouvelle, n'arrive qu'ŕ la fin pour épouser Lise, devient dans la
comédie un ami d'enfance et un fiancé de la jeune fille, ce qui
ajoute beaucoup ŕ l'intéręt du sujet en compliquant les situations. Le
personnage de ser Vespasiano est aussi une création nouvelle qui vient
jeter de temps ŕ autre, au milieu de cette mélopée amoureuse, une note
comique, indispensable au théâtre bien plus qu'ŕ la lecture.
En examinant les débris du manuscrit autographe, j'y remarque que
l'héroďne s'appelle Lise, pendant tout le premier acte, comme dans le
récit de Boccace. Probablement, lorsqu'il eut imaginé la belle scčne
du second acte oů Perillo entend le nom de sa maîtresse męlé aux
forfanteries de ser Vespasiano, Alfred de Musset aura pensé que ce nom
n'avait pas assez d'originalité pour frapper l'oreille du spectateur
et éveiller son attention, comme celle de Perillo. De męme, lorsque
Minuccio, seul avec le roi, lui confie le secret de la jeune malade,
l'auteur aura senti qu'il fallait ŕ cette jeune fille un nom plus
pittoresque et moins vulgaire que celui de Lise. Peut-ętre aussi
a-t-il compris, ŕ mesure qu'il avançait dans son oeuvre, que
l'esquisse légčre de Boccace allait devenir entre ses mains un type
complet. Le nom un peu bizarre, mais sicilien, de Carmosine, qu'il
substitua sur le manuscrit au nom de Lise, ŕ partir du second acte,
fut en quelque sorte une prise de possession.
Pour peu qu'on sache ce que c'est qu'une pičce de théâtre, on
reconnaît que celle-ci a été écrite avec la pensée qu'elle serait
représentée tôt ou tard. On ne voit point dans _Carmosine_ de brusques
changements de lieu; les scčnes s'enchaînent sans interruption.
L'auteur a soin de prolonger le mystčre qui rčgne sur tout le premier
acte jusqu'au moment oů cet acte va finir. Le procédé employé pour
faire entendre ŕ Perillo, de la bouche męme de Carmosine, le mot cruel
qui lui apprend qu'elle ne l'aime plus; la scčne du second acte oů
la sottise de ser Vespasiano donne le coup de grâce ŕ ce pauvre
amant déjŕ si malheureux; l'habileté avec laquelle l'auteur rapproche
Perillo de Carmosine au début du troisičme acte; ses précautions pour
dissimuler jusqu'au dernier moment le dénoűment heureux, en montrant
la mort de l'héroďne comme inévitable, tandis qu'au contraire il
prépare sa guérison et son mariage; enfin la grande scčne entre
Carmosine et la reine, qui semble conduire tout droit vers un but
opposé ŕ celui qu'on voudrait atteindre, tout cela est conçu et
traité dramatiquement, selon les rčgles de l'art et męme du métier.
Il faudrait ętre aveugle pour ne point le voir. Cependant on s'est si
bien accoutumé ŕ dire que les comédies d'Alfred de Musset n'étaient
pas destinées au théâtre qu'on l'a répété de celle-ci, comme des
précédentes, sans y regarder et contrairement ŕ l'évidence.
_Carmosine_ parut pour la premičre fois, en 1850, dans le
_Constitutionnel_. Une erreur de ponctuation, commise par les
compositeurs de ce journal et qui changeait le sens d'un vers dans la
romance de Minuccio, fut pour l'auteur un sujet de grand chagrin. Il
écrivit ŕ M. Véron, sur ce vers estropié, une lettre curieuse qu'on
trouvera dans la Correspondance.
La mise en scčne de cette comédie n'a présenté aucune difficulté
sérieuse. On n'y a éprouvé d'autre embarras que celui des richesses.
La trop grande abondance des idées, qui ajoute au charme de la
lecture, a rendu nécessaires quelques coupures ŕ la représentation.
Cette pičce a été jouée sur le théâtre de l'Odéon, le 7 novembre 1865,
et le public de Paris a témoigné ce jour-lŕ qu'il n'avait point
perdu le goűt des sentiments élevés ni du beau langage. Mademoiselle
Thuillier a donné au personnage de Carmosine un caractčre de douce
passion et de mélancolie poétique dont ses auditeurs garderont
longtemps le souvenir.
FIN DU TOME CINQUIČME.
* * * * *
TABLE GÉNÉRALE DES COMÉDIES ET PROVERBES
TOME PREMIER
AVANT-PROPOS 1
LA NUIT VÉNITIENNE 9
ANDRÉ DEL SARTO 49
Additions et Variantes exécutées par l'auteur pour
la représentation 128
LES CAPRICES DE MARIANNE 141
Additions et Variantes 201
FANTASIO 213
ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR 279
Additions et Variantes 367
BARBERINE 375
TOME DEUXIČME
LORENZACCIO 1
Traduction du fragment du livre XV des _Chroniques
florentines_ 214
LE CHANDELIER 223
Additions et Variantes 314
IL NE FAUT JURER DE RIEN 321
Additions et Variantes 406
TOME TROISIČME
UN CAPRICE 1
IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE 61
LOUISON 97
ON NE SAURAIT PENSER Ŕ TOUT 163
BETTINE 227
CARMOSINE 311
Additions et Variantes 420
End of the Project Gutenberg EBook of Oeuvres complčtes de Alfred de Musset
- Tome 5, by Alfred De Musset
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ALFRED DE MUSSET ***
***** This file should be named 23567-8.txt or 23567-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/2/3/5/6/23567/
Produced by Pierre Lacaze, Suzanne Lybarger and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothčque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

Œuvres complètes de Alfred de Musset — Tome 5
Subjects:
Download Formats:
Excerpt
The Project Gutenberg EBook of Oeuvres complčtes de Alfred de Musset -
Tome 5, by Alfred De Musset
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Oeuvres complčtes de Alfred de Musset - Tome 5
Read the Full Text
— End of Œuvres complètes de Alfred de Musset — Tome 5 —
Book Information
- Title
- Œuvres complètes de Alfred de Musset — Tome 5
- Author(s)
- Musset, Alfred de
- Language
- French
- Type
- Text
- Release Date
- November 20, 2007
- Word Count
- 71,333 words
- Library of Congress Classification
- PQ
- Bookshelves
- FR Théâtre, Browsing: Literature, Browsing: Fiction
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books
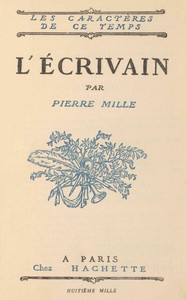
L'Écrivain
by Mille, Pierre
French
563h 6m read
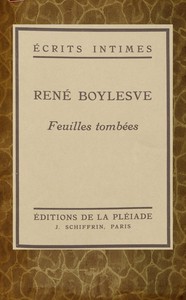
Feuilles tombées
by Boylesve, René
French
708 hours read

Images exotiques & françaises
by Mille, Pierre
French
241 hours read
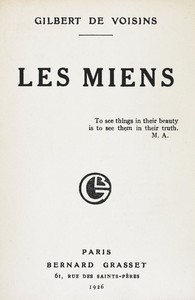
Les miens
by Gilbert de Voisins, Auguste
French
1016h 29m read
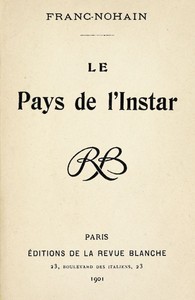
Le Pays de l'Instar
by Franc-Nohain
French
987h 49m read

Le paillasson: Mœurs de province
by Tailhade, Laurent
French
256h 47m read