Project Gutenberg's Lettres ŕ une inconnue, Tome Premier, by Prosper Mérimée
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Lettres ŕ une inconnue, Tome Premier
Précédée d'une étude sur P. Mérimée par H. Taine
Author: Prosper Mérimée
Contributor: Hippolyte Taine
Release Date: January 31, 2018 [EBook #56473]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LETTRES Ŕ UNE INCONNUE ***
Produced by Laura Natal Rodrigues and Marc D'Hooghe at
Free Literature (Images generously made available by the
Internet Archive.)
LETTRES Ă UNE INCONNUE
par
PROSPER MĂRIMĂE
De l'AcadÊmie française
PrĂŠcĂŠdĂŠs d'une ĂŠtude sur MĂŠrimĂŠe
par
H. Taine
Tome Premier
PARIS
Michel LĂŠvy Frères, Ăditeurs
3, Rue Auber, 3, Place de L'OpĂŠra
Librarie Nouvelle
Boulevard des Italiens, 15, Au coin de la Rue de Grammont
1874
PROSPER MĂRIMĂE
J'ai rencontrĂŠ plusieurs fois MĂŠrimĂŠe dans le monde. C'ĂŠtait un homme
grand, droit, pâle, et qui, sauf le sourire, avait l'apparence d'un
Anglais; du moins, il avait cet air froid, _distant_, qui ĂŠcarte
d'avance toute familiaritĂŠ. Rien qu'Ă le voir, on sentatit en lui le
flegme naturel ou acquis, l'empire de soi, la volontĂŠ et l'habitude
de ne pas donner prise. En cĂŠrĂŠmonie surtout, sa physionomie ĂŠtait
impassible. MĂŞme dans l'intimitĂŠ et lorsqu'il contait une anecdote
bouffonne, sa voix restait unie, toute calme; jamais d'ĂŠclat ni
d'ĂŠlan; il disait les dĂŠtails les plus saugrenus, en termes propres,
du ton d'un homme qui demande une tasse de thĂŠ. La sensibilitĂŠ chez
lui ĂŠtait domptĂŠe jusqu'Ă paraĂŽtre absente; non qu'elle le fĂťt: tout
au contraire; mais il y a des chevaux de race si bien mâtÊs par
leur maĂŽtre, qu'une fois sous sa main, ils ne se permettent plus un
soubresaut. Il faut dire que le dressage avait commencĂŠ de bonne heure.
Ă dix ou onze ans, je crois, ayant commis quelque faute, il fut grondĂŠ
très-sÊvèrement et renvoyÊ du salon; pleurant, bouleversÊ, il venait de
fermer la porte, lorsqu'il entendit rire; quelqu'un disait: ÂŤCe pauvre
enfant! il nous croit bien en colère!--L'idÊe d'être dupe le rÊvolta,
il se jura de rĂŠprimer une sensibilitĂŠ si humiliante, et tint parole.
ÎÎΟνΡĎÎż áźĎΚĎĎÎľáżÎ˝ (souviens-toi d'ĂŞtre en dĂŠfiance) telle fut sa devise.
Ătre en garde contre l'expansion, l'entraĂŽnement et l'enthousiasme, ne
jamais se livrer tout entier, rĂŠserver toujours une part de soi-mĂŞme,
n'ĂŞtre dupe ni d'autrui, ni de soi, agir et ĂŠcrire comme en la prĂŠsence
perpĂŠtuelle d'un spectateur indiffĂŠrent, ĂŞtre soi-mĂŞme ce spectateur,
voilà le trait de plus en plus fort qui s'est gravÊ dans son caractère,
pour laisser une empreinte dans toutes les parties de sa vie, de son
Ĺuvre et de son talent.[1]
Il a vÊcu en amateur: on ne peut guère vivre autrement quand on a
la disposition critique; Ă force de retourner la tapisserie, on
finit par la voir habituellement Ă l'envers. En ce cas, au lieu de
personnages beaux et bien posĂŠs, on contemple des bouts de ficelle;
il est difficile alors d'entrer avec abnĂŠgation et comme ouvrier
dans une Ĺuvre commune, d'appartenir mĂŞme au parti que l'on sert,
même à l'Êcole que l'on prÊfère, même à la science qu'on cultive,
mĂŞme Ă l'art oĂš on excelle; si parfois on descend en volontaire dans
la mĂŞlĂŠe, le plus souvent on se tient Ă part. Il eut de bonne heure
quelque aisance, puis un emploi commode et intĂŠressant, l'inspection
des monuments historiques, puis une place au sĂŠnat et des habitudes
Ă la cour. Aux monuments historiques, il fut compĂŠtent, actif et
utile; au sĂŠnat, il eut le bon goĂťt d'ĂŞtre le plus souvent absent
ou muet; Ă la cour, il avait son indĂŠpendance et son franc-parler.
Voyager, ĂŠtudier, regarder, se promener Ă travers les hommes et
les choses, telle a ĂŠtĂŠ son occupation; ses attaches officielles
ne le gĂŞnaient pas. D'ailleurs, un homme d'autant d'esprit se fait
respecter quand mĂŞme; son ironie transperce les mieux cuirassĂŠs. Il
faut voir avec quelle dĂŠsinvolture il la manie, jusqu'Ă la tourner
contre lui-mĂŞme, et faire coup double.--Un jour, Ă Biarritz, il avait
lu une de ses nouvelles devant l'impÊratrice. Peu après ma lecture,
je reçois la visite d'un homme de la police, se disant envoyÊ par la
grande-duchesse. ÂŤQu'y a-t-il pour votre service?--Je viens, de la
part de Son Altesse impĂŠriale, vous prier ce venir ce soir chez elle
avec votre roman.--Quel roman?--Celui que vous avez lu l'autre jour
Ă Sa MajestĂŠ.Âť Je rĂŠpondis que j'avais l'honneur d'ĂŞtre le bouffon
de Sa MajestĂŠ et que je ne pouvais aller travailler en ville sans
sa permission; et je courus tout de suite lui raconter la chose. Je
m'attendais qu'il en rĂŠsulterait au moins une guerre avec la Russie, et
je fus un peu mortifiÊ que non-seulement on m'autorisât, mais encore
qu'on me priât d'aller le soir chez la grande-duchesse, à qui on
avait donnĂŠ le policeman comme factotum. Cependant, pour me soulager,
j'ĂŠcrivis Ă la grande-duchesse une lettre d'assez bonne encre.--Cette
lettre d'assez bonne encre serait une pièce curieuse, et je suis sÝr
qu'on ne lui a plus envoyĂŠ le factotum.--Quant aux corps constituĂŠs,
il n'est guère possible de les aborder avec plus de sÊrieux extÊrieur
et moins de dĂŠfĂŠrence intime. Grave, digne, posĂŠ dans sa cravate,
quand il faisait une visite acadĂŠmique ou improvisait un discours
public, ses façons Êtaient irrÊprochables; cependant, en sourdine, la
serinette d'arrière-plan jouait un air comique qui tournait en ridicule
l'orateur et les auditeurs. ÂŤLe prĂŠsident des antiquaires s'est levĂŠ et
tout le monde avec lui. Il a pris la parole et a dit qu'il proposait
de boire Ă ma santĂŠ, attendu que j'ĂŠtais remarquable Ă trois points
de vue, c'est Ă savoir: comme sĂŠnateur, comme homme de lettres et
comme savant. Il n'y avait que la table entre nous, et j'avais une
grande envie de lui jeter Ă la tĂŞte un plat de gelĂŠe au rhum... Le
lendemain, j'ai entendu le procès-verbal de la veille, oÚ il Êtait
dit que j'avais parlÊ très-Êloquemment. J'ai fait un speech pour que
le procès-verbal fÝt purgÊ de tout adverbe, mais en vain.--Candidat
Ă l'AcadĂŠmie des inscriptions, et conduit chez des ĂŠrudits d'aspect
redoutable, il ĂŠcrivait au retour: ÂŤAvez-vous jamais vu des chiens
entrer dans le terrier d'un blaireau? Quand ils ont quelque expĂŠrience,
ils font une mine effroyable en y entrant, et souvent ils en sortent
plus vite qu'ils n'y sont entrĂŠs, car c'est une vilaine bĂŞte Ă visiter
que le blaireau. Je pense toujours au blaireau en tenant le cordon de
la sonnette d'un acadĂŠmicien, et je me vois _in the mind's eye_ tout
Ă fait semblable au chien que je vous disais. Je n'ai pas encore ĂŠtĂŠ
mordu cependant; mais j'ai fait de drôles de rencontres.--Il fut reçu
et eut, Ă cĂ´tĂŠ des autres, son terrier archĂŠologique. Mais on devine
bien qu'il n'ĂŠtait pas d'humeur Ă se confiner dans celui-ci ni dans un
autre; tous ceux qu'il habita avaient plusieurs sorties. Il y avait en
lui deux personnages: l'un qui, engagĂŠ dans la sociĂŠtĂŠ, s'y acquittait
correctement de la besogne obligĂŠe et de la parade convenable; l'autre
qui se tenait Ă cĂ´tĂŠ ou au-dessus du premier, et, d'un air narquois ou
rĂŠsignĂŠ, le regardait faire.
Pareillement il y avait en lui deux personnages dans les affaires de
cĹur. Le premier, l'homme naturel, ĂŠtait bon et mĂŞme tendre. Nul n'a
ĂŠtĂŠ plus loyal, plus sĂťr en amitiĂŠ; quand il avait une fois donnĂŠ sa
main, il ne la retirait plus. On le vit bien quand il dĂŠfendit M. Libri
contre les juges et contre l'opinion; c'ĂŠtait l'action d'un chevalier
qui, Ă lui seul, combat une armĂŠe. CondamnĂŠ Ă l'amende et mis en
prison, il ne prit point des airs de martyr, et mit autant de grâce Ă
subir sa mĂŠsaventure qu'il avait mis de bravoure Ă la provoquer. Il
n'en dit rien, sauf dans une prÊface, et encore en manière d'excuse,
allĂŠguant qu'il avait dĂť, ÂŤau mois de juillet prĂŠcĂŠdent, passer quinze
jours dans un endroit oĂš il n'ĂŠtait nullement incommodĂŠ du soleil et
oĂš il jouissait d'un profond loisir.Âť Rien de plus, c'est le sourire
discret et fin du galant homme.--Outre cela, serviable, obligeant; des
gens qui le priaient de s'employer pour eux s'en allaient dĂŠconcertĂŠs
par sa froide mine; un mois après, il arrivait chez eux ayant en poche
la faveur demandĂŠe. Dans sa correspondance, il lui ĂŠchappe un mot
frappant que tous ses amis disent très-vrai: Il m'arrive rarement
de sacrifier les autres Ă moi-mĂŞme, et, quand cela m'arrive, j'en ai
tous les remords possibles.Âť--Ă la fin de sa vie, on trouvait chez lui
deux vieilles dames anglaises auxquelles il parlait peu, et dont il
ne semblait pas se soucier beaucoup; un de mes amis le vit les larmes
aux yeux parce que l'une d'elles ĂŠtait malade. Jamais il ne disait
un mot de ses sentiments profonds; voici une correspondance d'amour,
puis d'amitiÊ, qui a durÊ trente ans; la dernière lettre est datÊe de
son dernier jour, et l'on ne sait pas le nom de sa correspondante.
Pour qui sait lire ces lettres, il y est gracieux, aimant, dĂŠlicat,
vĂŠritablement amoureux, et, qui le croirait? poète parfois, ĂŠmu jusqu'Ă
devenir superstitieux, comme un Allemand lyrique. Cela est si ĂŠtrange,
qu'il faut citer presque tout.--ÂŤVous aviez ĂŠtĂŠ si longtemps sans
m'Êcrire que je commençais à être inquiet. Et puis j'Êtais tourmentÊ
d'une idĂŠe saugrenue que je n'ai pas osĂŠ vous ĂŠcrire. Je visitais les
Arènes de NĂŽmes avec l'architecte du dĂŠpartement, lorsque je vis Ă
dix pas de moi un oiseau charmant, un peu plus gros qu'une mĂŠsange,
le corps gris de lin, avec des ailes rouges, noires et blanches.
Cet oiseau ĂŠtait perchĂŠ sur une corniche et me regardait fixement.
J'interrompis l'architecte pour lui demander le nom de cet oiseau.
C'est un grand chasseur, et il me dit qu'il n'en avait jamais vu de
semblable. Je m'approchai, et l'oiseau ne s'envola que lorsque j'ĂŠtais
assez près de lui pour le toucher. Il alla se poser à quelques pas de
lĂ , me regardant toujours. Partout oĂš j'allais, il semblait me suivre,
car je l'ai retrouvÊ à tous les Êtages de l'amphithÊâtre. Il n'avait
pas de compagnon et son vol ĂŠtait sans bruit comme celui d'un oiseau
nocturne. Le lendemain, je retournai aux Arènes et je revis encore mon
oiseau. J'avais apportĂŠ du pain que je lui jetai, mais il n'y toucha
pas. Je lui jetai ensuite une grosse sauterelle, croyant, Ă la forme
de son bec, qu'il mangeait des insectes, mais il ne parut pas en faire
cas. Le plus savant ornithologiste de la ville me dit qu'il n'existait
pas dans le pays d'oiseaux de cette espèce. Enfin, à la dernière visite
que j'ai faite aux Arènes, j'ai rencontrÊ mon oiseau toujours attachÊ
Ă mes pas, au point qu'il est entrĂŠ avec moi dans un corridor ĂŠtroit
et sombre, oĂš lui, oiseau de jour, n'aurait jamais dĂť se hasarder. Je
me souvins alors que la duchesse de Buckingham avait vu son mari sous
la forme d'un oiseau le jour de son assassinat, et l'idĂŠe me vint que
vous ĂŠtiez peut-ĂŞtre morte et que vous aviez pris cette forme pour me
voir. MalgrĂŠ moi, cette bĂŞtise me tourmentait, et je vous assure que
j'ai ĂŠtĂŠ enchantĂŠ de voir que votre lettre portait la date du jour oĂš
j'ai vu pour la première fois mon oiseau merveilleux.--Voilà comment,
mĂŞme chez un sceptique, le cĹur et l'imagination travaillent; c'est une
ÂŤbĂŞtiseÂť; il n'en est pas moins vrai qu'il ĂŠtait sur le seuil du rĂŞve
et dans le grand chemin de l'amour.[2]
Mais, Ă cĂ´tĂŠ de l'amoureux, subsistait le critique, et le conflit
des deux personnages dans le mĂŞme homme produisait des effets
singuliers. En pareil cas, il vaut peut-ĂŞtre mieux n'y pas voir
trop clair.--ÂŤSavez-vous bien, disait La Fontaine, que, pour peu que
j'aime, je ne vois les dĂŠfauts des personnes non plus qu'une taupe qui
aurait cent pieds de terre sur elle? Dès que j'ai un grain d'amour, je
ne manque pas d'y mĂŞler tout ce que j'ai d'encens dans mon magasin.Âť
C'est peut-ĂŞtre pour cela qu'il ĂŠtait si aimable.--Dans les lettres
de MĂŠrimĂŠe, les duretĂŠs pleuvent avec les douceurs: ÂŤJe vous avouerai
que vous m'avez paru fort embellie au physique, mais point au moral...
Vous avez toujours la taille d'une sylphide, et, bien que blasĂŠ sur
les yeux noirs, je n'en ai jamais vu d'aussi grands Ă Constantinople
ni Ă Smyrne. Maintenant, voici le revers de la mĂŠdaille. Vous ĂŞtes
restĂŠe enfant en beaucoup de choses, et vous ĂŞtes devenue par-dessus
le marchĂŠ hypocrite... Vous croyez que vous avez de l'orgueil, j'en
suis bien fâchÊ, mais vous n'avez qu'une petite vanitÊ bien digne
d'une dĂŠvote. La mode est au sermon aujourd'hui. Y allez-vous? Il ne
vous manquait plus que cela.Âť--Et un peu plus tard: ÂŤDans tout ce que
vous dites et tout ce que vous faites, vous substituez toujours Ă un
sentiment rĂŠel un convenu... Au reste, je respecte les convictions,
mĂŞme celles qui me paraissent le plus absurdes. Il y a en vous beaucoup
d'idĂŠes saugrenues, pardonnez-moi le mot, que je me reprocherais de
vous Ă´ter, puisque vous y tenez et que vous n'avez rien Ă mettre Ă la
place. Après deux mois de tendresses, de querelles et de rendez-vous,
il conclut ainsi: ÂŤIl me semble que tous les jours vous ĂŞtes plus
ĂŠgoĂŻste. Dans _nous_, vous ne cherchez jamais que _vous._ Plus je
retourne cette idĂŠe, plus elle me paraĂŽt triste... Nous sommes si
diffĂŠrents, qu'Ă peine pouvons-nous nous comprendre.Âť Il paraĂŽt qu'il
avait rencontrÊ un caractère aussi rÊtif et aussi indÊpendant que le
sien, _a lioness, though tame_, et il l'analyse.--ÂŤC'est dommage que
nous ne nous voyions pas le lendemain d'une querelle; je suis sĂťr que
nous serions parfaitement aimables l'un pour l'autre... AssurĂŠment
mon plus grand ennemi, ou, si vous voulez, mon rival dans votre cĹur,
c'est votre orgueil; tout ce qui froisse cet orgueil vous rĂŠvolte;
vous suivez votre idĂŠe, peut-ĂŞtre Ă votre insu, dans les plus petits
dĂŠtails. N'est-ce pas votre orgueil qui est satisfait lorsque je baise
votre main? Vous ĂŞtes heureuse alors, m'avez-vous dit, et vous vous
abandonnez Ă votre sensation parce que votre orgueil se plaĂŽt Ă une
dĂŠmonstration d'humilitĂŠ...Âť--Quatre mois plus tard, et Ă distance,
après une brouille plus forte: Vous êtes une de ces _chilly women of
the North_, vous ne vivez que par la tĂŞte... Adieu, puisque nous ne
pouvons ĂŞtre amis qu'Ă distance. Vieux l'un et l'autre, nous nous
retrouverons peut-ĂŞtre avec plaisir.Âť Puis, sur un mot affectueux, il
revient.--Mais l'opposition des caractères est toujours la même; il
ne peut souffrir qu'une femme soit femme: ÂŤRarement je vous accuse,
sinon de ce manque de franchise qui me met dans une dĂŠfiance presque
continuelle avec vous, obligĂŠ que je suis de chercher toujours votre
idÊe sous un dÊguisement... Pourquoi, après si longtemps que nous
sommes ce que nous sommes l'un Ă l'autre, ĂŞtes-vous encore Ă rĂŠflĂŠchir
plusieurs jours avant de rĂŠpondre Ă la question la plus simple?...
Entre votre tĂŞte et votre cĹur, je ne sais jamais qui l'emporte;
vous ne le savez pas vous-mĂŞme, mais vous donnez toujours raison
Ă votre tĂŞte... S'il y a un tort de votre part, c'est assurĂŠment
cette prĂŠfĂŠrence que vous donnez Ă votre orgueil sur ce qu'il y a de
tendresse en vous. Le premier sentiment est au second comme un colosse
Ă un pygmĂŠe. Et cet orgueil n'est au fond qu'une variĂŠtĂŠ de l'ĂŠgoĂŻsme.Âť
Tout cela finit par une bonne et durable amitiĂŠ.--Mais n'admirez-vous
pas cette manière agrÊable de faire sa cour? On se rencontrait au
Louvre, Ă Versailles, dans les bois des environs; on s'y promenait
tĂŞte Ă tĂŞte, en secret, longuement, mĂŞme en janvier, plusieurs fois
par semaine; il admirait ÂŤune radieuse physionomie, de fines attaches,
une blanche main, de superbes cheveux noirsÂť, une intelligence et une
instruction dignes de la sienne, les grâces d'une beautÊ originale,
les attraits d'une culture composite, les sĂŠductions d'une toilette
et d'une coquetterie savantes; il respirait le parfum exquis d'une
ĂŠducation si choisie et d'une ÂŤnature si raffinĂŠe, qu'elles rĂŠsumaient
pour lui toute une civilisationÂť; bref, il ĂŠtait sous le charme. Au
retour, l'observateur reprenait son office; il dĂŠmĂŞlait le sens d'une
rĂŠponse, d'un geste; il se dĂŠtachait de son sentiment pour juger un
caractère; il Êcrivait des vÊritÊs et des Êpigrammes que le lendemain
on lui rendait.
Tel il fut dans sa vie, tel on le retrouve dans ses livres. Il a
ĂŠcrit et ĂŠtudiĂŠ en amateur, passant d'un sujet Ă un autre, selon
l'occasion et sa fantaisie, sans se donner Ă une science, sans se
mettre au service d'une idĂŠe. Ce n'ĂŠtait pas faute d'application ou de
compĂŠtence. Au contraire, peu d'hommes ont ĂŠtĂŠ plus et mieux instruits.
Il possĂŠdait six langues, avec leur littĂŠrature et leur histoire;
l'italien, le grec, le latin, l'anglais, l'espagnol et le russe; je
crois qu'en outre il lisait l'allemand. De temps en temps, une phrase
de sa correspondance, une note montre Ă quel point il avait poussĂŠ
ces Êtudes. Il parlait _caló_, de manière à Êtonner les bohÊmiens
d'Espagne. Il entendait les divers dialectes espagnols et dĂŠchiffrait
les vieilles chartes catalanes. 11 savait la mĂŠtrique des vers anglais.
Ceux-là seuls qui ont ÊtudiÊ une littÊrature entière, dans l'imprimÊ
et dans le manuscrit, pendant les quatre ou cinq âges successifs de
la langue, du style et de l'orthographe, peuvent apprĂŠcier ce qu'il
faut de facilitĂŠ et d'efforts pour savoir l'espagnol comme l'auteur
de _Don Pèdre_, et le russe comme l'auteur des _Cosaques_ et du _Faux
DĂŠmĂŠtrius._ Il ĂŠtait naturellement douĂŠ pour les langues, et en avait
appris jusque dans l'âge mÝr: vers la fin de sa vie, il devenait
philologue et s'adonnait Ă Cannes aux minutieuses ĂŠtudes qui composent
la grammaire comparĂŠe.--Ă cette connaissance des livres, il avait
ajoutĂŠ celle des monuments; ses rapports prouvent qu'il ĂŠtait devenu
spĂŠcial pour ceux de France; il comprenait non-seulement l'effet,
mais la technique, de l'architecture. Il avait ĂŠtudiĂŠ chaque vieille
ĂŠglise sur place, avec l'aide des meilleurs architectes; sa mĂŠmoire
locale ĂŠtait excellente et exercĂŠe: nĂŠ dans une famille de peintres,
il avait maniĂŠ le pinceau et faisait bien l'aquarelle; bref, en
ceci comme en tout sujet, il ĂŠtait allĂŠ au fond des choses; ayant
l'horreur des phrases spÊcieuses, il n'Êcrivait qu'après avoir touchÊ
le dĂŠtail probant. On trouverait difficilement une tĂŞte d'historien
dans laquelle la collection prÊalable, bibliothèque et musÊe, soit si
complète.--Ajoutez-y des dons encore plus rares, ceux qui permettent
de faire revivre ces dĂŠbris morts, je veux dire l'expĂŠrience de la
vie et l'imagination lucide. Il avait beaucoup voyagĂŠ, deux fois en
Grèce et en Orient, douze ou quinze fois en Angleterre, en Espagne et
ailleurs, et partout il avait observĂŠ les mĹurs, non-seulement de la
bonne compagnie, mais de la mauvaise. ÂŤJ'ai mangĂŠ plus d'une fois Ă
la gamelle avec des gens qu'un Anglais ne regarderait pas, de peur de
perdre le respect qu'il a pour son propre Ĺil. J'ai bu Ă la mĂŞme outre
qu'un galÊrien. Il avait vÊcu familièrement avec des gitanos et des
torĂŠadors. Il faisait des contes le soir Ă une assemblĂŠe de paysans et
de paysannes de l'Ardèche. Un des endroits oÚ il se trouvait le mieux
Ă sa place, c'ĂŠtait dans une venta espagnole, avec ÂŤdes muletiers et
des paysannes d'AndalousieÂť. Il cherchait des types frustes et intacts,
par une curiositÊ inÊpuisable de toutes les variÊtÊs de l'espèce
humaine, et formait dans sa mÊmoire une galerie de caractères vivants,
la plus prĂŠcieuse de toutes; car les autres, celles des livres et des
ĂŠdifices, sont des coquilles jadis habitĂŠes, maintenant vides, dont
on ne comprend la structure qu'en se figurant, d'après les espèces
survivantes, les espèces qui ont vÊcu. Par une divination vive, exacte
et prompte, il faisait cette reconstruction mentale. On voit par la
_Chronique de Charles IX_, par les _DĂŠbuts d'un Aventurier_, par le
_ThÊâtre de Clara Cazul_, que tel est son procÊdÊ involontaire. Ses
lectures aboutissent naturellement Ă la demi-vision de l'artiste, Ă la
mise en scène, au roman qui ranime le passÊ. Avec tant d'acquis et des
facultĂŠs si belles, il eĂťt pu prendre dans l'histoire et dans l'art une
place à la fois très-grande et très-haute; il n'a pris qu'une place
moyenne dans l'histoire, et une place haute mais ĂŠtroite dans l'art.
C'est qu'il se dĂŠfiait, et que trop de dĂŠfiance est nuisible. Pour
obtenir d'une ĂŠtude tout ce qu'elle peut donner, il faut, je crois,
se donner tout entier Ă elle, l'ĂŠpouser, ne pas la traiter comme une
maĂŽtresse avec qui l'on s'enferme deux ou trois ans, sauf Ă recommencer
ensuite avec une autre. Un homme ne produit tout ce dont il est
capable que, lorsque ayant conçu quelque forme d'art, quelque mÊthode
de science, bref, quelque idĂŠe gĂŠnĂŠrale, il la trouve si belle, qu'il
la prÊfère à tout, notamment à lui-même, et l'adore comme une dÊesse
qu'il est trop heureux de servir. MĂŠrimĂŠe aussi pouvait s'ĂŠprendre et
adorer; mais, au bout d'un temps, le critique en lui se rĂŠveillait,
jugeait la dĂŠesse, trouvait qu'elle n'ĂŠtait pas assez divine. Toutes
nos mĂŠthodes de science, toutes nos formes d'art, toutes nos idĂŠes
gĂŠnĂŠrales ont quelque endroit faible; l'insuffisant, l'incertain, le
convenu, le postiche y abondent; il n'y a que l'illusion de l'amour
qui puisse les trouver parfaites, et un sceptique n'est pas longtemps
amoureux. Celui-ci mettait son lorgnon, et dans la belle statue
dĂŠmĂŞlait le manque d'aplomb, la restauration fausse et spĂŠcieuse,
l'attitude de mode: il se dĂŠgoĂťtait et s'en allait, non sans motifs.
Il les indique en passant, ces motifs; il voit ce qu'il y a de hasardĂŠ
dans notre philosophie de l'histoire, ce qu'il y a d'inutile dans
notre manie d'ĂŠrudition, ce qu'il y a d'exagĂŠrĂŠ dans notre goĂťt pour
le pittoresque, ce qu'il y a d'insipide dans notre peinture du rĂŠel.
Que les inventeurs et les badauds acceptent le système ou le style par
amour-propre, ou par niaiserie; pour lui, il s'en dĂŠfend, ou, s'il
ne s'en est pas dÊfendu, il s'en repent.--Vers l'an de grâce 1827,
j'ĂŠtais romantique. Nous disions aux classiques: ÂŤPoint de salut sans
la _couleur locale._Âť Nous entendions par couleur locale ce qu'au
XVIIe siècle on appelait les _mĹurs_; mais nous ĂŠtions très-fiers de
notre mot, et nous pensions avoir imaginĂŠ le mot et la chose.Âť Depuis,
ayant fabriquĂŠ des poĂŠsies illyriques que les savants d'outre-Rhin
traduisirent d'un grand sĂŠrieux, il put se vanter d'avoir fait de
la couleur locale. ÂŤMais le procĂŠdĂŠ ĂŠtait si simple, si facile, que
j'en vins Ă douter du mĂŠrite de la couleur locale elle-mĂŞme, et que
je pardonnai Ă Racine d'avoir policĂŠ les sauvages hĂŠros de Sophocle
et d'Euripide.Âť--Vers la fin de sa vie, il ĂŠvitait de parti pris
toutes les thĂŠories; Ă ses yeux, elles n'ĂŠtaient bonnes qu'Ă duper
des philosophes ou Ă nourrir des professeurs: il n'acceptait et
n'ĂŠchangeait que des anecdotes, de petits faits d'observation, par
exemple en philologie, la date prĂŠcise oĂš l'on cesse de rencontrer
dans le vieux français les deux cas survivants de la dÊclinaison
latine. Ă force de vouloir la certitude, il dessĂŠchait la science
et ne gardait de la plante que le bois sans les fleurs. On ne peut
expliquer autrement la froideur de ses essais historiques, _Don Pèdre,
les Cosaques, le Faux DĂŠmĂŠtrius, la Guerre sociale, la Conjuration de
Catilina_, Êtudes solides, complètes, bien appuyÊes, bien exposÊes,
mais dont les personnages ne vivent pas; très-probablement, c'est qu'il
n'a pas voulu les faire vivre. Car, dans un autre ĂŠcrit, _les DĂŠbuts
d'un Aventurier_, reprenant son faux DĂŠmĂŠtrius, il a fait rentrer la
sĂŠve dans la plante, en sorte qu'on peut la voir tour Ă tour sous les
deux formes, terne et raide dans l'herbier historique, fraĂŽche et verte
dans l'Ĺuvre d'art. Ăvidemment, quand il prĂŠparait dans cet herbier ses
Espagnols du XIVe siècle ou les contemporains de Sylla, il les voyait
par l'Ĺil intĂŠrieur aussi nettement que son aventurier; du moins, cela
ne lui ĂŠtait pas plus difficile; mais il rĂŠpugnait Ă nous les faire
voir, n'admettant dans l'histoire que des dĂŠtails prouvĂŠs, se refusant
Ă nous donner ses divinations pour des faits authentiques, critique au
dĂŠtriment de son Ĺuvre, rigoureux jusqu'Ă se retrancher la meilleure
partie de lui-mĂŞme et mettre son imagination sous l'interdit.
Dans ses Ĺuvres d'art, le critique domine encore, mais presque toujours
avec un office utile, pour restreindre et diriger son talent, comme une
source qu'on enferme dans un tuyau pour qu'elle jaillisse plus mince
et plus serrĂŠe. Il avait de naissance plusieurs de ces talents que
nul travail n'acquiert et que son maĂŽtre Stendhal ne possĂŠdait pas,
le don de la mise en scène, du dialogue, du comique, l'art de poser
face Ă face deux personnages, et de les rendre visibles au lecteur par
le seul ĂŠchange de leurs paroles. De plus, comme Stendhal, il savait
les caractères et contait bien. Il soumit ces vives facultÊs à une
discipline sÊvère, et, par un effort double, entreprit de leur faire
rendre le plus d'Ĺuvre avec le moins de matière.--Dès l'abord, il
avait beaucoup goÝtÊ le thÊâtre espagnol, qui est tout nerf et toute
action; il en reprit les procĂŠdĂŠs pour composer sous un faux nom de
petites pièces d'un sens profond et d'intention moderne; chose unique
dans l'histoire littĂŠraire, plusieurs de ces pastiches, l'_Occasion, la
PÊrichole_, valent des originaux.--Nulle part la saillie des caractères
n'est si nette et si forte que dans ses comĂŠdies. Dans _les MĂŠcontents
et dans les Deux HĂŠritages_, chaque personnage, suivant un mot de
Goethe, ressemble Ă ces montres parfaites, en cristal transparent,
sur lesquelles on voit en mĂŞme temps l'heure exacte et tout le jeu
du mĂŠcanique intĂŠrieur. Tous les dĂŠtails portent et sont chargĂŠs de
sens; c'est le propre des grands peintres de dessiner en cinq ou
six coups de crayon une figure qu'on n'oublie plus. MĂŞme dans des
pièces moins rÊussies, par exemple dans _les Espagnols en Danemark_,
il y a des personnages, le lieutenant Charles Leblanc, et sa mère
l'espionne, qui resteront Ă demeure dans la mĂŠmoire humaine.--Au fond,
si un sceptique aussi dĂŠterminĂŠ avait daignĂŠ avoir une esthĂŠtique,
il aurait expliquĂŠ, je crois, que, pour un connaisseur de l'homme,
chaque homme se rĂŠduit Ă trois ou quatre traits principaux, lesquels
s'expriment complètement par cinq ou six actions significatives; le
reste est dĂŠrivĂŠ ou indiffĂŠrent; c'est temps perdu que de le montrer.
Les lecteurs intelligents le devineront, et il ne faut ĂŠcrire que pour
les lecteurs intelligents. Laisser le bavardage aux bavards, ne prendre
que l'essentiel, ne le traduire aux yeux que par des actions probantes,
concentrer, abrĂŠger, rĂŠsumer la vie, voilĂ le but de l'art.--Du moins
tel est le sien, et il l'atteint mieux encore dans ses rĂŠcits que dans
ses comÊdies; car les exigences de la mise en scène et de l'effet
comique ne surviennent pas pour grossir les traits, charger la vĂŠritĂŠ,
mettre sur la figure vivante un masque de thÊâtre.[3] L'Êcrivain, ayant
moins d'obligations et plus de ressources, peut dessiner plus juste
et moins appuyer. La plupart de ces nouvelles sont des chefs-d'Ĺuvre,
et il est Ă croire qu'elles resteront classiques. Il y a de cela
plusieurs raisons.--D'abord, en fait, voici trente ou quarante ans
qu'elles durent, et _Carmen, l'Enlèvement de la Redoute, Colomba,
Matteo Falcone, l'AbbÊ Aubain, Arsène Guillot, la VÊnus d'Ile, la
Partie de trictrac, Tamango_, mĂŞme _le Vase ĂŠtrusque_ et _la Double
MĂŠprise_, presque tous ces petits ĂŠdifices sont aussi intacts qu'au
premier jour. C'est qu'ils sont bâtis en pierres choisies, non en stuc
et autres matĂŠriaux de mode. Point de ces descriptions qui passent
au bout de cinquante ans et qui nous ennuient tant aujourd'hui dans
les romans de Walter Scott; point de ces rĂŠflexions, dissertations,
explications, que nous trouvons si longues dans les romans de Fielding;
rien que des faits, et les faits sont toujours instructifs. D'autant
plus qu'il n'y met que des faits importants, intelligibles mĂŞme pour
des hommes d'un autre pays et d'un autre siècle; dans Balzac et dans
Dickens, qui n'ont pas cette prĂŠcaution, beaucoup de dĂŠtails minutieux,
locaux ou techniques, tomberont comme un enduit qui s'ĂŠcaille, ou ne
serviront qu'aux commentaires des commentateurs.--Autre chance de
durĂŠe; ces romans sont courts, le plus long n'a qu'un demi-volume, l'un
d'eux, six pages; tous sont clairs, bien composĂŠs, rassemblĂŠs autour
d'une action simple et d'un effet unique. Or, il faut songer que la
postÊritÊ est une sorte d'Êtrangère, qu'elle n'a pas la complaisance
des contemporains, qu'elle ne tolère pas les ennuyeux, qu'aujourd'hui
peu de personnes supportent les huit volumes de _Clarisse Harlowe_;
bref, que l'attention humaine surchargĂŠe finit toujours par faire
faillite; il est prudent, quand après un siècle on lui demande encore
audience, de lui parler un style bref, net et plein.--En outre, il est
sage de lui dire des choses intĂŠressantes et qui l'intĂŠressent. Des
choses intĂŠressantes: cela exclut les ĂŠvĂŠnements trop plats ou trop
bourgeois, les caractères trop effacÊs et trop ordinaires. Des choses
qui l'intĂŠressent: cela veut dire des situations et des passions assez
durables pour qu'après cent ans elles soient encore de circonstance.
MĂŠrimĂŠe choisit des types francs, forts, originaux, sortes de mĂŠdailles
d'un haut relief et d'un mĂŠtal dur, avec un cadre et des ĂŠvĂŠnements
appropriĂŠs: le premier combat d'un officier, une vendetta corse, le
dernier voyage d'un nĂŠgrier, une dĂŠfaillance de probitĂŠ, l'exĂŠcution
d'un fils par son père, une tragÊdie intime dans un salon moderne;
presque tous ses contes sont meurtriers, comme ceux de Baudello et
des nouvellistes italiens, et en outre poignants par le sang-froid
du rĂŠcit, par la prĂŠcision du trait, par la convergence savante des
dĂŠtails.--Bien mieux, chacun d'eux, dans sa petite taille, est un
document sur la nature humaine, un document complet et de longue
portĂŠe, qu'un philosophe, un moraliste, peut relire tous les ans sans
l'ĂŠpuiser. Plusieurs dissertations sur l'instinct primitif et sauvage,
des traitĂŠs savants, comme celui de Schopenhauer sur la mĂŠtaphysique
de l'amour et de la mort, ne valent pas les cent pages de _Carmen._ Le
cierge d'_Arsène Guillot_ rÊsume beaucoup de volumes sur la religion
du peuple et sur les vrais sentiments des courtisanes. Je ne sais
pas de plus amère prÊdication contre les mÊprises de la crÊdulitÊ ou
de l'imagination, que la Double MĂŠprise et le Vase ĂŠtrusque. Il est
probable qu'en l'an 2000 on relira la _Partie de trictrac_, pour savoir
ce qu'il en coĂťte de manquer une fois Ă l'honneur. Remarquez enfin que
l'auteur n'intervient point pour nous faire la leçon; il s'abstient,
nous laisse conclure; mĂŞme et de parti pris, il s'efface jusqu'Ă
paraĂŽtre absent; les lecteurs futurs auront des ĂŠgards pour un maĂŽtre
de maison si poli, si discret, si habile Ă faire les honneurs de son
logis. Les bonnes manières plaisent toujours, et on ne peut rencontrer
d'hĂ´te mieux ĂŠlevĂŠ. Ă la porte, il salue ses visiteurs, les introduit,
puis se retire, les laissant libres de tout examiner et critiquer
seuls; il n'est pas importun, il ne se fait pas le cicerone de ses
trĂŠsors, jamais on ne le prendra en flagrant dĂŠlit d'amour-propre. Il
cache son savoir au lieu de le montrer; il semble, Ă l'ĂŠcouter, que
chacun aurait pu faire son livre. L'un est une anecdote qu'un de ses
amis lui a contĂŠe et qu'il a aussitĂ´t ĂŠcrite. L'autre est ÂŤun extraitÂť
de BrantĂ´me et d'AubignĂŠ. S'il a fait _les DĂŠbuts d'un Aventurier_,
c'est qu'ĂŠtant au frais, malgrĂŠ lui, pendant quinze jours, il n'avait
rien de mieux Ă faire. Pour ĂŠcrire _la Guzla_, la recette est simple:
se procurer une statistique de l'Illyrie, le voyage de l'abbĂŠ Fortis,
apprendre cinq ou six mots de slave. Ce parti pris de ne pas se
surfaire va jusqu'Ă l'affectation. Il a si grand'peur de paraĂŽtre
pĂŠdant, qu'il fuit jusque dans l'autre extrĂŞme, le ton dĂŠgagĂŠ, le sans
façon de l'homme du monde. Peut-être un jour sera-ce là son endroit
vulnĂŠrable; on se demandera si cette ironie perpĂŠtuelle n'est pas
voulue, s'il a raison de plaisanter au plus fort de la tragĂŠdie, s'il
ne se montre pas insensible par crainte du ridicule, si son ton aisĂŠ
n'est pas l'effet de la contrainte, si le gentleman en lui n'a pas fait
tort Ă l'auteur, s'il aimait assez son art. Plus d'une fois, notamment
dans _la VĂŠnus d'Ille_, il s'en est servi pour mystifier le lecteur.
Ailleurs, dans _Lokis_,[4] une idĂŠe saugrenue, Ă , double entente,
ĂŠtrange de la part d'un esprit si distinguĂŠ, gĂŽt au fond du conte,
comme un crapaud dans un coffret sculptĂŠ. Il paraĂŽt qu'il trouvait
plaisir Ă voir des doigts de femme ouvrir le coffret, et qu'un joli
visage bien effarĂŠ par le dĂŠgoĂťt le faisait rire. Presque toujours, il
semble qu'il ait ĂŠcrit par occasion, pour s'amuser, pour s'occuper,
sans subir l'empire d'une idĂŠe, sans concevoir un grand ensemble, sans
se subordonner Ă une Ĺuvre.--En ceci comme dans le reste, il ĂŠtait
dĂŠsenchantĂŠ, et Ă la fin on le trouve dĂŠgoĂťtĂŠ. Le scepticisme produit
la mĂŠlancolie. Ă ce sujet, sa correspondance est triste; sa santĂŠ
dÊfaillit peu à peu; il hivernait rÊgulièrement à Cannes, sentant que
la vie le quittait; il se soignait, se conservait; c'est l'unique
souci qui suive l'homme jusqu'au bout. Il allait tirer de l'arc par
ordonnance de mĂŠdecin, et peignait, pour se distraire, des vues du
pays; tous les jours, on le rencontrait dans la campagne, marchant
en silence, avec ses deux Anglaises; l'une portait l'arc, l'autre la
boĂŽte aux aquarelles. Il tuait ainsi le temps et prenait patience. Il
allait, par bontĂŠ d'âme, nourrir un chat, dans une cabane ĂŠcartĂŠe, Ă
une demi-lieue de distance; il cherchait des mouches pour un lĂŠzard
qu'il nourrissait: c'ĂŠtaient lĂ ses favoris. Quand le chemin de fer lui
amenait un ami, il se ranimait et sa conversation redevenait charmante;
ses lettres l'ĂŠtaient toujours; il ne pouvait s'empĂŞcher d'avoir
l'esprit le plus original et le plus exquis. Mais le bonheur lui
manquait; il voyait l'avenir en noir, à peu près tel que nous l'avons
aujourd'hui; avant de clore les yeux, il eut la douleur d'assister Ă
l'ĂŠcroulement complet, et mourut le 23 septembre 1870.--Si on essaye
de rÊsumer son caractère et son talent, on trouvera, je pense, que,
nĂŠ avec un cĹur très-bon, douĂŠ d'un esprit supĂŠrieur, ayant vĂŠcu en
galant homme, beaucoup travaillĂŠ, et produit quelques Ĺuvres de premier
ordre, il n'a pas pourtant tirĂŠ de lui-mĂŞme tout le service qu'il
pouvait rendre, ni atteint tout le bonheur auquel il pouvait aspirer.
Par crainte d'ĂŞtre dupe, il s'est dĂŠfiĂŠ dans la vie, dans l'amour, dans
la science, dans l'art,[5] et il a ĂŠtĂŠ dupe de sa dĂŠfiance. On l'est
toujours de quelque chose, et peut-ĂŞtre vaut-il mieux s'y rĂŠsigner
d'avance.
H. TAINE.
Novembre 1873.
[1] On dirait qu'il s'est peint lui-mĂŞme dans Saint-Clair, personnage
du _Vase ĂŠtrusque._ ÂŤIl ĂŠtait nĂŠ avec un cĹur tendre et aimant; mais, Ă
un âge oÚ l'on prend trop facilement des impressions qui durent toute
la vie, sa sensibilitĂŠ trop expansive lui avait attirĂŠ les railleries
de ses camarades... Dès lors, il se fit une Êtude de cacher tous les
dehors de ce qu'il regardait comme une faiblesse dĂŠshonorante...
Dans le monde, il obtint la triste rĂŠputation d'insensible et
d'insouciant... Il avait beaucoup voyagĂŠ, beaucoup lu, et ne parlait de
ses voyages et de ses lectures que lorsqu'on l'exigeait.Âť--Darcy, dans
_la Double MÊprise_, est encore un caractère analogue au sien.
[2] Voici de lui une action gĂŠnĂŠreuse et dĂŠlicate; BĂŠranger, en cas
pareil, en fit une semblable: ÂŤJ'allais ĂŞtre amoureux quand je suis
parti pour l'Espagne. La personne qui a causĂŠ mon voyage n'en a jamais
rien su. Si j'ĂŠtais restĂŠ, j'aurais peut-ĂŞtre fait une grande sottise,
celle d'offrir Ă une femme digne de tout le bonheur dont on peut jouir
sur terre, de lui offrir, dis-je, en ĂŠchange de la perte de toutes les
choses qui lui Êtaient chères, une tendresse que je sentais moi-même
très-infÊrieure au sacrifice qu'elle aurait peut-être fait.
[3] Le RĂŠsident dans _les Espagnols en Danemark_, le Comte et les
autres gentilshommes dans _les MĂŠcontents_, Kermouton et le marchand
do beurre dans _les Deux HĂŠritages._ Mais, en revanche, quels rĂŠsumĂŠs
vrais que les caractères de ClÊmence, de SÊvin et de miss Jackson!
[4] Lettres Ă une Inconnue, II, 333, 335.
[5] Lettres Ă une Inconnue, I, 8. ÂŤDĂŠfaites-vous de votre optimisme, et
figurez-vous bien que nous sommes dans ce momie pour nous battre envers
et contre tous... Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de
faire le mal pour le plaisir de le faire.Âť
LETTRES
Ă
UNE INCONNUE
I
Paris, jeudi.
J'ai reçu _in due time_ votre lettre. Tout est mystÊrieux en vous,
et les mêmes causes vous font agir prÊcisÊment de la manière opposÊe
Ă celle dont se conduiraient les autres mortelles. Vous allez Ă la
campagne, bien;... c'est-Ă -dire que vous aurez tout le temps d'ĂŠcrire;
car, lĂ , les journĂŠes sont longues, et le dĂŠsĹuvrement porte Ă ĂŠcrire
des lettres. En mĂŞme temps, la surveillance et l'inquiĂŠtude de votre
dragon ĂŠtant moins gĂŞnĂŠes par les occupations rĂŠglĂŠes de la ville, vous
aurez plus de questions Ă subir quand il vous arrivera des lettres.
D'ailleurs, dans un château, l'arrivÊe d'une lettre est un ÊvÊnement.
Point du tout; vous ne pouvez pas ĂŠcrire, mais, en revanche, vous
pouvez recevoir force lettres. Je commence à me faire à vos façons
et je ne suis plus guère surpris de rien. Au reste, je vous en prie,
ĂŠpargnez-moi et ne mettez pas Ă une trop rude ĂŠpreuve cette malheureuse
disposition que j'ai prise, je ne sais comment, de trouver bien tout ce
qui est de vous.
J'ai souvenance d'avoir ĂŠtĂŠ peut-ĂŞtre un peu trop franc dans ma
dernière lettre en vous parlant de mon caractère. Un vieux diplomate de
mes amis, homme très-fin, m'a dit souvent: Ne dites jamais de mal de
vous-mĂŞme. Vos amis en diront toujours assez.Âť Je commence Ă craindre
que vous ne preniez au pied de la lettre tout le mal que je disais de
moi-mĂŞme. Figurez-vous que ma grande vertu, c'est la modestie; je la
porte à l'excès et je tremble que cela ne me nuise dans votre esprit.
Une autre fois, quand je me sentirai mieux inspirĂŠ, je vous ferai la
nomenclature exacte de toutes mes qualitĂŠs. La liste sera longue.
Aujourd'hui, je suis un peu malade, et je n'ose me lancer dans cette
ÂŤprogression Ă l'infiniÂť.
Devinez en mille oĂš j'ĂŠtais samedi soir, ce que je faisais Ă minuit.
J'ĂŠtais sur la plate-forme d'une des tours de Notre-Dame, et je buvais
de l'orangeade, et je prenais des glaces en compagnie de quatre de
mes amis et d'une lune admirable; le tout accompagnĂŠ d'un gros hibou
qui battait des ailes autour de nous. C'est, en vĂŠritĂŠ, un fort beau
spectacle que Paris au clair de lune et Ă cette heure. Cela ressemble
Ă ces villes dont on parle dans _les Mille et une Nuits_, oĂš les
habitants ont ĂŠtĂŠ enchantĂŠs pendant leur sommeil. Les Parisiens se
couchent Ă minuit en gĂŠnĂŠral, bien sots en cela. Notre _party_ ĂŠtait
assez curieuse: il y avait quatre nations reprĂŠsentĂŠes, chacun pensant
d'une manière diffÊrente. L'ennui, c'est qu'il y avait quelques-uns de
nous qui, en prĂŠsence de la lune et du hibou, se sont crus obligĂŠs de
prendre le ton poĂŠtique et de dire des lieux communs. Au fait, peu Ă
peu tout le monde s'est mis Ă dĂŠraisonner.
Je ne sais comment et par quel enchaĂŽnement d'idĂŠes cette soirĂŠe
semi-poĂŠtique me fait penser Ă une autre qui ne l'ĂŠtait pas du tout.
J'ai ĂŠtĂŠ Ă un bal donnĂŠ par des jeunes gens de mes amis, oĂš ĂŠtaient
invitĂŠes toutes les figurantes de l'OpĂŠra. Ces femmes sont bĂŞtes
pour la plupart; mais j'ai remarquĂŠ combien elles sont supĂŠrieures
en dĂŠlicatesse morale aux hommes de leur classe. Il n'y a qu'un seul
vice qui les sĂŠpare des autres femmes: c'est la pauvretĂŠ. Toutes ces
rhapsodies vont vous Êdifier singulièrement. Aussi je me hâte de
terminer, ce que j'aurais dĂť faire beaucoup plus tĂ´t.
Adieu. Ne m'en voulez pas pour la peinture peu flattĂŠe que je vous ai
faite de moi-mĂŞme.
II
Paris.
La franchise et la vÊritÊ sont rarement bonnes auprès des femmes, elles
sont presque toujours mauvaises. VoilĂ que vous me regardez comme un
Sardanapale, parce que j'ai ĂŠtĂŠ Ă un bal de figurantes d'OpĂŠra. Vous me
reprochez cette soirĂŠe comme un crime, et vous me reprochez comme un
plus grand crime encore de faire l'ĂŠloge de ces pauvres filles. Je le
rÊpète, rendez-les riches, et il ne leur restera plus que leurs bonnes
qualitÊs. Mais l'aristocratie a ÊlevÊ des barrières insurmontables
entre les diffĂŠrentes classes de la sociĂŠtĂŠ, afin qu'on ne puisse
voir combien ce qui se passe au delà de la barrière ressemble à ce
qui se passe en deçà . Je veux vous conter une histoire d'OpÊra que
j'ai apprise dans cette sociĂŠtĂŠ si perverse. Dans une maison de la
rue Saint-HonorĂŠ, il y avait une pauvre femme qui ne sortait jamais
d'une petite chambre sous les toits, qu'elle louait moyennant 3 francs
par mois. Elle avait une fille de douze ans toujours très-bien tenue,
très-rÊservÊe et qui ne parlait à personne. Cette petite sortait trois
fois la semaine dans l'après-midi, et rentrait seule à minuit. On
sut quelle ĂŠtait figurante Ă l'OpĂŠra. Un jour, elle descend chez le
portier et demande une chandelle allumÊe. On la lui donne. La portière,
surprise de ne pas la voir redescendre, monte Ă son grenier, trouve la
femme morte sur son grabat, et la petite fille occupĂŠe Ă brĂťler une
ĂŠnorme quantitĂŠ de lettres qu'elle tirait d'une fort grande malle.
Elle dit: Ma mère est morte cette nuit, et elle m'a chargÊe de brÝler
toutes ses lettres sans les lire.Âť Cette enfant n'a jamais su le
vÊritable nom de sa mère; elle se trouve maintenant absolument seule au
monde, et n'ayant d'autre ressource que celle de faire les vautours,
les singes ou les diables Ă l'OpĂŠra.
Le dernier conseil de sa mère a ÊtÊ pour l'engager à être bien sage et
Ă continuer Ă ĂŞtre figurante Ă l'OpĂŠra. Elle est d'ailleurs fort sage,
très-dÊvote et ne se soucie guère de raconter son histoire. Veuillez
me dire si cette petite fille n'a pas infiniment plus de mĂŠrite Ă
mener la vie qu'elle mène, que vous n'en avez, vous qui jouissez du
bonheur singulier d'un entourage irrĂŠprochable et d'une nature si
raffinĂŠe, quelle rĂŠsume un peu pour moi toute une civilisation. Il faut
vous dire la vĂŠritĂŠ. Je ne supporte la mauvaise sociĂŠtĂŠ qu'Ă de rares
intervalles, et par une curiositĂŠ inĂŠpuisable de toutes les variĂŠtĂŠs
de l'espèce humaine. Je n'ose jamais aborder la mauvaise sociÊtÊ en
hommes. Il y a lĂ quelque chose de trop repoussant, surtout chez nous;
car, en Espagne, j'ai toujours eu des muletiers et des toreros pour
amis. J'ai mangĂŠ plus d'une fois Ă la gamelle avec des gens qu'un
Anglais ne regarderait pas, de peur de perdre le respect qu'il a pour
son propre Ĺil. J'ai mĂŞme bu Ă la mĂŞme outre qu'un galĂŠrien. Il faut
dire aussi qu'il n'y avait que cette outre et qu'il faut boire quand
on a soif.--Ne croyez pas pour cela que j'aie une prĂŠdilection pour la
canaille. J'aime simplement Ă voir d'autres mĹurs, d'autres figures,
Ă entendre un autre langage. Les idĂŠes sont toujours les mĂŞmes, et,
si l'on fait abstraction de tout ce qui est convention ou règle, je
crois qu'il y a du savoir-vivre ailleurs que dans un salon du faubourg
Saint-Germain. Tout cela est de l'arabe pour vous, et je ne sais
pourquoi je vous le dis.
8 aoĂťt.
J'ai ÊtÊ longtemps sans finir cette lettre. Ma mère a ÊtÊ fort malade
et moi très-inquiet. Elle est maintenant hors de danger, et j'espère
que, dans quelques jours, elle sera en parfaite santĂŠ. Je ne puis
supporter l'inquiĂŠtude, et, pendant le temps du danger, j'ai ĂŠtĂŠ tout Ă
fait bĂŞte.
Adieu.
_P.-S._--L'aquarelle que je vous destinais ne tourne pas Ă bien, et je
la trouve si mauvaise, qu'il est probable que je ne vous l'enverrai
pas. Que cela ne vous empĂŞche pas de me donner la tapisserie que
vous me destinez. Tâchez de choisir un messager sÝr. Règle gÊnÊrale:
ne prenez jamais une femme pour confidente; tĂ´t ou tard, vous vous
en repentiriez. Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de
faire le mal pour le plaisir de le faire. DĂŠfaites-vous de vos idĂŠes
d'optimisme et figurez-vous bien que nous sommes dans ce monde pour
nous battre envers et contre tous. Ă ce propos, je vous dirai qu'un
savant de mes amis, qui lit les hiĂŠroglyphes, m'a dit que, sur les
cercueils Êgyptiens, on lisait très-souvent ces deux mots: _Vie;
guerre_; ce qui prouve que je n'ai pas inventĂŠ la maxime que je viens
de vous donner. Cela s'ĂŠcrit en hiĂŠroglyphe de la sorte [img]. Le
premier caractère veut dire _vie_; il reprÊsente, je crois, un de ces
vases appelĂŠs canopes. L'autre est une abrĂŠviation d'un bouclier avec
un bras tenant un lance. _There's science for you._
Adieu encore.
III
Paris.
Vos reproches me font grand plaisir. En vĂŠritĂŠ, je suis prĂŠdestinĂŠ des
fĂŠes. Je me demande souvent ce que je suis pour vous et ce que vous
êtes pour moi. à la première question, je ne puis avoir de rÊponse;
pour la seconde, je me figure que je vous aime comme une nièce de
quatorze ans que j'Êlèverais. Quant à votre parent si moral qui dit
tant de mal de moi, il me fait penser Ă Twachum, qui dit toujours: _Can
any virtue exist without religion?_ Avez-vous lu _Tom Jones_, livre
aussi immoral que tous les miens ensemble. Si on vous l'a dĂŠfendu, vous
l'aurez lu très-certainement. Quelle drôle d'Êducation vous recevez
en Angleterre! Ă quoi sert-elle? On s'essouffle Ă prĂŞcher pendant
longtemps une jeune fille, et il est arrivĂŠ ce rĂŠsultat que cette jeune
fille a dĂŠsirĂŠ prĂŠcisĂŠment connaĂŽtre l'ĂŞtre immoral pour lequel on
s'ĂŠtait flattĂŠ de lui imposer de l'aversion. Quelle admirable histoire
que celle du serpent! Je voudrais que lady M... lĂťt cette lettre.
Heureusement qu'elle s'Êvanouirait vers la dixième ligne.
En tournant la page, je relis ce que je viens de vous ĂŠcrire, et il
m'a semblĂŠ qu'il y avait en apparence peu de suite et d'enchaĂŽnement
dans les idĂŠes. Erreur! Mais j'ĂŠcris Ă mesure que je pense, et, comme
ma pensĂŠe va plus vite que ma plume, il en rĂŠsulte que je suis obligĂŠ
de supprimer toutes les transitions. Je devrais peut-ĂŞtre faire comme
vous et biffer toute la première page; mais j'aime mieux l'abandonner
Ă vos mĂŠditations et Ă vos papillotes. Il faut vous dire aussi que je
suis très-prÊoccupÊ en ce moment d'une affaire qui m'intÊresse et qui,
je l'avoue à ma honte, rÊside opiniâtrÊment dans une moitiÊ de mon
cerveau, tandis que l'autre est toute remplie de vous. J'aime assez le
portrait que vous faites de vous-mĂŞme. Il ne me paraĂŽt pas trop flattĂŠ,
et tout ce que je connais de vous me plaĂŽt prodigieusement. . . .
. . . . . . . . . . . .
Je vous ĂŠtudie avec une vive curiositĂŠ. J'ai des thĂŠories sur les plus
petites choses, sur les gants, sur les bottines, sur les boucles,
etc., et j'attache beaucoup d'importance Ă tout cela, parce que j'ai
dÊcouvert qu'il y a un rapport certain entre le caractère des femmes
et le caprice (ou la liaison d'idĂŠes et le raisonnement, pour mieux
dire) qui leur fait choisir telle ou telle ĂŠtoffe. Ainsi, par exemple,
on me doit d'avoir dĂŠmontrĂŠ qu'une femme qui porte des robes bleues
est coquette et affecte le sentiment. La dĂŠmonstration est facile,
mais elle serait trop longue. Comment voulez-vous que je vous envoie
une aquarelle dĂŠtestable plus grande que cette lettre et qu'on ne peut
rouler ni ployer? Attendez que je vous en fasse une plus petite que je
pourrai vous envoyer dans une lettre.
J'ai ĂŠtĂŠ l'autre jour faire une promenade en bateau. Il y avait sur
la rivière une grande quantitÊ de petits canots à voile portant
toute sorte de gens. Il y en avait un fort grand dans lequel ĂŠtaient
plusieurs femmes (de celles qui ont mauvais ton). Tous ces canots
avaient abordĂŠ, et du plus grand sort un homme d'une quarantaine
d'annĂŠes, qui avait un tambour et qui tambourinait pour s'amuser.
Tandis que j'admirais l'organisation musicale de cet animal, une femme
de vingt-trois ans à peu près s'approche de lui, l'appelle monstre,
lui dit qu'elle l'avait suivi depuis Paris et que, s'il ne voulait
pas l'admettre dans sa sociĂŠtĂŠ, il s'en repentirait. Tout cela se
passait sur le rivage dont notre canot ĂŠtait ĂŠloignĂŠ de vingt pas.
L'homme au tambour tambourinait toujours pendant le discours de la
femme dĂŠlaissĂŠe, et lui rĂŠpondait avec beaucoup de flegme qu'il ne
voulait pas d'elle dans son bateau. LĂ -dessus, elle court au canot
qui Êtait amarrÊ le plus loin du rivage et s'Êlance dans la rivière
en nous ĂŠclaboussant indignement. Bien qu'elle eĂťt ĂŠteint mon cigare,
l'indignation ne m'empĂŞcha pas, non plus que mes amis, de la retirer
aussitĂ´t, avant qu'elle en pĂťt avaler deux verres. Le bel objet de tant
de dĂŠsespoir n'avait pas bougĂŠ et marmottait entre ses dents: ÂŤPourquoi
la retirer, si elle avait envie de se noyer?Âť Nous avons mis la femme
dans un cabaret, et, comme il se faisait tard et que l'heure du dĂŽner
approchait, nous l'avons abandonnÊe aux soins de la cabaretière.
Comment se fait-il que les hommes les plus indiffĂŠrents soient les plus
aimĂŠs? C'est ce que je me demandais, tout en descendant la Seine, ce
que je me demande encore, et ce que je vous prie de me dire, si vous le
savez.
Adieu. Ăcrivez-moi souvent, soyons amis et excusez le dĂŠcousu de ma
lettre. Je vous expliquerai un jour pourquoi.
IV
_Mariquita de mi alma_ (c'est ainsi que je commencerais si nous ĂŠtions
à Grenade), j'ai reçu votre lettre dans un de ces moments de mÊlancolie
oĂš l'on ne voit la vie qu'au travers d'un verre noir. Comme votre
ĂŠpĂŽtre n'est pas des plus aimables (excusez ma franchise), elle n'a pas
peu contribuĂŠ Ă me maintenir dans une disposition maussade. Je voulais
vous rÊpondre dimanche, immÊdiatement et sèchement. ImmÊdiatement,
parce que vous m'aviez fait une espèce de reproche indirect, et
sèchement parce que j'Êtais furieux contre vous. J'ai ÊtÊ dÊrangÊ
au premier mot de ma lettre, et ce dĂŠrangement m'a empĂŞchĂŠ de vous
ĂŠcrire. Remerciez-en le bon Dieu, car aujourd'hui le temps est beau;
mon humeur s'est adoucie tellement, que je ne veux plus vous ĂŠcrire
que d'un style tout de miel et de sucre. Je ne vous querellerai donc
pas sur vingt ou trente passages de votre dernière lettre qui m'ont
fort choquĂŠ et que je veux bien oublier. Je vous pardonne, et cela
avec d'autant plus de plaisir qu'en vĂŠritĂŠ, je crois que, malgrĂŠ la
colère, je vous aime mieux quand vous êtes boudeuse que dans une autre
disposition d'esprit. Un passage de votre lettre m'a fait rire tout
seul comme un bienheureux pendant dix minutes. Vous me dites _short
and sweet_: Mon amour est promis, sans prĂŠparation, pour amener le
gros coup de massue par quelques petites hostilitĂŠs prĂŠalables. Vous
dites que vous ĂŞtes engagĂŠe pour la vie, comme vous diriez: ÂŤJe suis
engagĂŠe pour la contredanse.Âť Fort bien. Ă ce qu'il paraĂŽt, j'ai bien
employĂŠ mon temps Ă disputer avec vous sur l'amour, le mariage et le
reste; vous en ĂŞtes encore Ă croire ou Ă dire que, lorsqu'on vous
dit: ÂŤAimez monsieur,Âť on aime. Avez-vous promis par un engagement
signĂŠ par-devant notaire ou sur papier Ă vignettes? Quand j'ĂŠtais
ĂŠcolier, je reçus d'une couturière un billet surmontĂŠ de deux cĹurs
enflammĂŠs rĂŠunis comme il suit: [img02]; de plus, une dĂŠclaration
fort tendre. Mon maÎtre d'Êtudes commença par me prendre mon billet,
et l'on me mit en prison. Puis l'objet de cette naissante passion
se consola avec le cruel maĂŽtre d'ĂŠtudes. Il n'y a rien qui soit
plus fatal que les engagements pour ceux au profit desquels ils sont
souscrits. Savez-vous que, si votre amour ĂŠtait promis, je croirais
sĂŠrieusement qu'il vous serait impossible de ne pas m'aimer? Comment ne
m'aimeriez-vous pas, vous qui ne m'avez pas fait de promesses, puisque
la première loi de la nature, c'est de prendre en grippe tout ce qui
a l'air d'une obligation? Et, en effet, toute obligation est de sa
nature ennuyeuse. Enfin, de tout cela, si j'avais moins de modestie,
je tirerais cette dernière consÊquence, que, si vous avez promis votre
amour Ă quelqu'un, vous me le donnerez, Ă moi, Ă qui vous n'avez rien
promis. Plaisanterie Ă part et Ă propos de promesses, depuis que
vous ne voulez plus de mon aquarelle, j'ai assez grande envie de vous
l'envoyer. J'en ĂŠtais mĂŠcontent et j'avais commencĂŠ une copie d'une
infante Marguerite, d'après Velasquez, que je voulais vous donner.
Velasquez ne se copie pas facilement, surtout par des barbouilleurs
comme moi. J'ai recommencĂŠ deux fois mon infante, mais Ă la fin j'en
suis encore plus mĂŠcontent que du moine. Le moine est donc Ă vos
ordres. Je vous l'enverrai quand vous voudrez. Mais son transport
est peu commode. Ajoutez Ă cela que les invisibles qui s'amusent
quelquefois Ă intercepter nos communications pourront peut-ĂŞtre bien
garder mon aquarelle. Ce qui me rassure, c'est qu'elle est si mauvaise,
qu'il faut ĂŞtre moi pour la faire, et vous pour en vouloir. Donnez-moi
vos ordres. J'espère que vous serez à Paris vers le milieu d'octobre.
Je me trouverai maĂŽtre de quinze ou vingt jours Ă cette ĂŠpoque. Je
ne voudrais pas les passer en France, et depuis longtemps j'avais
l'intention de voir les tableaux de Rubens Ă Anvers et la galerie
d'Amsterdam. Mais, si j'avais la certitude de vous voir, je renoncerais
Ă Rubens et Ă Van Dyck avec la plus facile rĂŠsignation. Vous voyez
que les sacrifices ne me coĂťtent pas. Je ne connais pas Amsterdam.
Pourtant, dĂŠcidez. Votre vanitĂŠ va vous faire dire ici: ÂŤLe beau
sacrifice de ne me prĂŠfĂŠrer qu'Ă de grosses Flamandes bien blanches et
bien harengères, et en peinture encore! Oui, c'est un sacrifice et
un très-grand. Je sacrifie le certain, qui est le plaisir, chez moi
très-vif, de voir des tableaux de maÎtre, à la chance très-incertaine
que vous le compenserez. Observez que, sans admettre le cas impossible
oĂš vous ne me plairiez pas, si moi je vous dĂŠplaisais, j'aurais tout
lieu de regretter mes travaux et mes grosses Flamandes...
Vous me paraissez dĂŠvote, superstitieuse mĂŞme.--Je pense en ce moment
Ă une jolie petite Grenadine qui, en montant sur son mulet pour passer
dans la montagne de Ronda (route classique des voleurs), baisait
dĂŠvotement son pouce et se frappait la poitrine cinq ou six fois, bien
assurÊe après cela que les voleurs ne se montreraient pas, pourvu
que l'_Ingles_ (c'est-Ă -dire moi), tout voyageur est Anglais, ne
jurât pas trop par la Vierge et les saints. Cette mÊchante manière de
parler devient nĂŠcessaire dans les mauvais chemins pour faire aller
les chevaux. Voyez Tristram Shandy. J'aime beaucoup votre histoire du
portrait de cet enfant. Vous ĂŞtes faible et jalouse, deux qualitĂŠs dans
une femme et deux dĂŠfauts dans un homme. Je les ai tous les deux. Vous
me demandez qu'elle est l'affaire qui me prĂŠoccupe. Il faudrait vous
dire quel est mon caractère et ma vie, chose dont personne ne se doute,
parce que je n'ai pas encore trouvÊ quelqu'un qui m'inspirât assez de
confiance. Peut-ĂŞtre que, lorsque nous nous serons vus souvent, nous
deviendrons amis et vous me connaĂŽtrez; ce serait pour moi le bien le
plus grand que quelqu'un Ă qui je pourrais dire toutes mes pensĂŠes
passĂŠes et prĂŠsentes. Je deviens triste, et il ne faut pas finir ainsi.
Je suis dĂŠvorĂŠ du dĂŠsir d'une rĂŠponse de vous. Soyez assez bonne pour
ne pas me la faire attendre.
Adieu; ne nous querellons plus et soyons amis. Je baise
respectueusement la main que vous me tendez en signe de paix.
V
25 septembre.
Votre lettre m'a trouvĂŠ malade et fort triste, fort occupĂŠ des plus
ennuyeuses affaires du monde, et je n'ai pas le temps de me soigner.
J'ai, je crois, une inflammation de poitrine qui me rend extrĂŞmement
maussade. Mais, dans quelques jours, je me propose de me dorloter et de
me guĂŠrir.
Mon parti est pris. Je ne quitterai pas Paris en octobre, dans
l'espĂŠrance que vous y reviendrez. Vous me verrez ou vous ne me verrez
pas, Ă votre choix. La faute en sera Ă vous. Vous me parlez de raisons
particulières qui vous empêchent de chercher à vous trouver avec
moi. Je respecte les secrets et je ne vous demande pas vos motifs.
Seulement, je vous prie de me dire _really truly_ si vous en avez.
N'ĂŞtes-vous pas plutĂ´t prĂŠoccupĂŠe d'un enfantillage? Peut-ĂŞtre vous
a-t-on fait, Ă mon sujet, quelque sermon dont vous ĂŞtes encore toute
pĂŠnĂŠtrĂŠe. Vous auriez bien tort d'avoir peur de moi. Votre prudence
naturelle entre sans doute pour beaucoup dans votre rĂŠpugnance Ă me
voir. Rassurez-vous, je ne deviendrai pas amoureux de vous. Il y a
quelques annĂŠes, cela aurait pu arriver; maintenant, je suis trop
_vieux_ et j'ai ĂŠtĂŠ trop malheureux. Je ne pourrais plus ĂŞtre amoureux,
parce que mes illusions m'ont procurĂŠ bien des _desengaĂąos_ sur
l'amour. J'allais ĂŞtre amoureux quand je suis parti pour l'Espagne.
C'est une des belles actions de ma vie. La personne qui a causĂŠ mon
voyage n'en a jamais rien su. Si j'ĂŠtais restĂŠ, j'aurais peut-ĂŞtre fait
une grande sottise: celle d'offrir Ă une femme digne de tout le bonheur
dont on peut jouir sur terre, de lui offrir, dis-je, en ĂŠchange de la
perte de toutes les choses qui lui Êtaient chères, une tendresse que je
sentais moi-même très-infÊrieure au sacrifice qu'elle aurait peut-être
fait. Vous vous rappelez ma morale; ÂŤL'amour fait tout excuser,
mais il faut ĂŞtre bien sĂťr qu'il y a de l'amour.Âť Soyez persuadĂŠe
que ce prĂŠcepte-lĂ est plus rigoureux que ceux de vos mĂŠthodistes
amis. Conclusion: je serai charmĂŠ de vous voir. Peut-ĂŞtre ferez-vous
l'acquisition d'un vĂŠritable ami, et moi peut-ĂŞtre trouverai-je en
vous ce que je cherche depuis longtemps: une femme dont je ne sois pas
amoureux et en qui je puisse avoir de la confiance. Nous gagnerons
probablement tous deux Ă notre connaissance plus approfondie. Faites
pourtant ce que votre haute prudence vous conseillera.
Mon moine est prêt. à la première occasion, je vous enverrai donc ce
moine et sa monture. L'infante n'ĂŠtant pas achevĂŠe, et ĂŠtant trop mal
commencĂŠe pour ĂŞtre jamais terminĂŠe, restera oĂš elle est et me servira
de garde-main pour un dessin que je vous ferai quand j'aurai le temps.
Je meurs d'envie de voir la surprise que vous me destinez, mais je me
creuse la tĂŞte inutilement pour le deviner. Quand je vous ĂŠcris, je
nĂŠglige trop les transitions, artifice de style bien nĂŠcessaire. Je
crains que vous ne trouviez cette lettre terriblement dĂŠcousue. C'est
qu'Ă mesure que j'ĂŠcris une phrase, il m'en vient une autre Ă l'esprit,
laquelle donne naissance à une troisième avant que la seconde soit
terminĂŠe. Je souffre beaucoup ce soir. Si vous avez de l'influence
là -haut, tâchez de m'obtenir un peu de santÊ ou tout au moins de
rĂŠsignation; car je suis le plus mauvais malade du monde, et je fais
la mine Ă mes meilleurs amis. Quand je suis ĂŠtendu sur mon canapĂŠ, je
pense avec plaisir Ă vous, Ă notre mystĂŠrieuse connaissance, et il me
semble que je serais bien heureux de causer avec vous autant à bâtons
rompus que je vous ĂŠcris; et encore songez qu'il y a cet avantage que
les paroles volent et que les ĂŠcrits restent.
Au surplus, ce n'est pas l'idĂŠe d'ĂŞtre un jour imprimĂŠ tout vif ou
posthume qui me tourmente. Adieu; plaignez-moi. Je voudrais avoir le
courage de vous dire mille choses qui me rendent cette vie triste.
Mais comment vous les dire de si loin? Quand donc viendrez-vous? Adieu
encore une fois. Vous voyez que, si le cĹur vous en dit, vous avez tout
le temps de m'ĂŠcrire.
_P.-S._--26 septembre.--Je suis encore plus triste qu'hier. Je souffre
horriblement. Mais, si vous n'avez jamais ĂŠprouvĂŠ par vous-mĂŞme ce que
c'est qu'une gastrite, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'une
douleur vague qui est très-vive pourtant. Elle a cela de particulier
qu'elle agit sur tout le système nerveux. Je voudrais bien être à la
campagne avec vous; vous me guĂŠririez, j'en suis sĂťr. Adieu. Si je
meurs cette annÊe, vous aurez le regret de ne m'avoir guère connu.
VI
Savez-vous que vous ĂŞtes quelquefois bien aimable? Je ne dis pas
cela pour vous faire un reproche sous un froid compliment; mais je
voudrais bien recevoir souvent de vous des lettres comme la dernière.
Malheureusement, vous n'ĂŞtes pas toujours pour moi dans d'aussi
charitables dispositions. Je ne vous ai pas rĂŠpondu plus tĂ´t parce
que votre lettre ne m'a ĂŠtĂŠ remise qu'hier soir, Ă mon retour d'une
petite excursion que j'ai faite. J'ai passĂŠ quatre jours dans une
solitude absolue et ne voyant pas un homme, encore moins une femme, car
je n'appelle pas hommes ou femmes certains bipèdes qui sont dressÊs
Ă apporter Ă manger et Ă boire quand on leur en donne l'ordre. J'ai
fait, pendant cette retraite, les rĂŠflexions les plus tristes du monde,
sur moi, sur mon avenir, sur mes amis, etc. Si j'avais eu l'esprit
d'attendre votre lettre, elle aurait donnĂŠ une tout autre tournure Ă
mes idĂŠes. ÂŤJ'aurais emportĂŠ du bonheur pour une semaine au moins.Âť
J'admire beaucoup votre descente chez ce brave M. Y... Votre courage
me plaÎt singulièrement. Je ne vous aurais jamais crue capable d'un
tel _capricho_, et je vous en aime encore davantage. Il est vrai que
le souvenir de vos splendid _black eyes_ est peut-ĂŞtre pour quelque
chose dans mon admiration. Pourtant, vieux comme je suis, je suis
presque insensible à la beautÊ. Je me dis que cela ne gâte rien;
mais je vous assure qu'en entendant dire par un homme très-difficile
que vous ĂŠtiez fort jolie, je n'ai pu me dĂŠfendre d'un sentiment de
tristesse. Voici pourquoi (d'abord persuadez-vous bien que je ne suis
pas le moins du monde amoureux de vous): je suis horriblement jaloux,
jaloux de mes amis, et je m'afflige en pensant que votre beautĂŠ vous
expose aux soins et aux attentions d'un tas de gens qui ne peuvent vous
apprĂŠcier et qui ne voient en vous que ce qui m'occupe le moins. En
vĂŠritĂŠ, je suis d'une humeur affreuse en pensant Ă cette cĂŠrĂŠmonie oĂš
vous allez assister. Rien ne me rend plus mĂŠlancolique qu'un mariage.
Les Turcs, qui marchandent une femme en l'examinant comme un mouton
gras, valent bien mieux que nous qui avons mis sur ce vil marchĂŠ un
vernis d'hypocrisie, hĂŠlas! bien transparent. Je me suis demandĂŠ bien
souvent ce que je pourrais dire Ă une femme le premier jour de ma noce,
et je n'ai rien trouvĂŠ de possible, si ce n'est un compliment sur son
bonnet de nuit. Le diable, heureusement, est bien fin s'il m'attrape
Ă pareille fĂŞte. Le rĂ´le de la femme est bien plus facile que celui
de l'homme. Un jour comme celui-là , elle se modèle sur l'IphigÊnie de
Racine; mais, si elle observe un peu, que de drĂ´les de choses elle doit
voir!--Vous me direz si la fĂŞte a ĂŠtĂŠ belle. On va vous faire la cour
et vous rĂŠgaler d'allusions au bonheur domestique. Les Andalous disent,
quand ils sont en colère: _Mataria el sol à puùaladas si no fuese por
miedo de dejar el mundo a oscuras!_
Depuis le 28 septembre, jour de ma naissance, une suite non interrompue
de petits malheurs est venue m'assaillir. Ajoutez Ă cela que ma
poitrine va de mal en pis et que je souffre horriblement. Je
retarderai mon voyage en Angleterre jusqu'au milieu de novembre.
Si vous ne voulez pas me voir Ă Londres, il faut y renoncer; mais
je veux voir les ĂŠlections. Je vous rattraperai bientĂ´t après Ă
Paris, oĂš le hasard nous rapprochera si votre volontĂŠ persiste Ă
nous sĂŠparer. Toutes vos raisons sont pitoyables et ne valent pas la
peine d'ĂŞtre rĂŠfutĂŠes, d'autant plus que vous savez bien vous-mĂŞme
qu'elles n'ont aucune importance. Vous faites la railleuse quand vous
dites si agrĂŠablement que vous avez peur de moi. Vous savez que je
suis laid et très-capricieux d'humeur, toujours distrait et souvent
taquin et mĂŠchant lorsque je souffre. Qu'y a-t-il lĂ qui ne soit bien
rassurant?--Vous ne vous ĂŠprendrez jamais de moi, soyez tranquille.
Les prĂŠdictions confiantes que vous me faites ne peuvent se rĂŠaliser.
Vous n'ĂŞtes pas pythonisse. Or, en vĂŠritĂŠ, les chances de mort pour moi
sont augmentĂŠes cette annĂŠe. Rassurez-vous pour vos lettres. Tout ce
qui se trouve d'Êcrit dans ma chambre sera brÝlÊ après ma mort; mais,
pour vous faire enrager, je vous laisserai par testament une suite
manuscrite de la _guzla_ qui vous a tant fait rire. Vous participez
de l'ange et du dĂŠmon, mais beaucoup plus du dernier. Vous m'appelez
tentateur. Osez dire que ce nom ne vous convient pas beaucoup mieux
qu'à moi! N'avez-vous pas jetÊ un appât à moi, pauvre petit poisson;
puis, maintenant que vous me tenez au bout de votre hameçon, vous me
faites danser entre le ciel et l'eau jusqu'Ă ce qu'il vous plaise,
quand vous serez lasse du jeu, de couper le fil; et alors j'en serai
pour l'hameçon dans le bec et je ne pourrai plus trouver le pêcheur. Je
vous sais grĂŠ de votre franchise Ă m'avouer que vous avez lu la lettre
que M. V... m'ĂŠcrivait et dont il vous avait chargĂŠe. Je l'avais bien
devinĂŠ, car, depuis Ăve, toutes se ressemblent en ce point. J'aurais
voulu que cette lettre fĂťt plus intĂŠressante; mais je suppose que,
malgrĂŠ ses lunettes, vous trouvez M. V... homme de goĂťt. Je deviens
mĂŠchant parce que je souffre. Je pense Ă la promesse que vous m'avez
faite d'un _schizzo_,--promesse que vous m'avez faite sans que je
l'eusse sollicitĂŠe,--et je me sens radouci. J'attends le _schizzo_ avec
la plus grande dĂŠvotion.--Adieu, _niĂąa de mis ojos_; je vous promets
de n'ĂŞtre jamais amoureux de vous. Je ne veux plus ĂŞtre amoureux,
mais je voudrais avoir un ami fĂŠminin. Si je vous voyais souvent, et
si vous ĂŞtes telle que je le crois, je vous aimerais bien de vraie et
platonique amitiÊ. Tâchez donc de faire en sorte que nous puissions
nous voir quand vous serez Ă Paris. Faudra-t-il que nous attendions une
rĂŠponse pendant des jours entiers? Adieu encore une fois. Plaignez-moi,
car je suis bien triste et j'ai mille raisons pour l'ĂŞtre.
VII
Lady M... m'a annoncĂŠ hier au soir que vous alliez vous marier. Cela
ĂŠtant, brĂťlez mes lettres; je brĂťle les vĂ´tres, et adieu. Je vous ai
dĂŠjĂ parlĂŠ de mes principes. Ils ne me permettent pas de rester en
relation avec une dame que j'ai connue demoiselle, avec une veuve que
j'ai connue mariĂŠe. J'ai remarquĂŠ que, l'ĂŠtat civil d'une femme ĂŠtant
changĂŠ, les rapports changent aussi, et toujours pour le pire. Bref,
Ă tort ou Ă raison, je ne puis souffrir que mes amies se marient.
Donc, si vous vous mariez, oublions-nous. Je vous en conjure, n'ayez
point recours Ă une de vos ĂŠchappatoires ordinaires et rĂŠpondez-moi
franchement.
Je vous proteste que, depuis le 28 septembre, je n'ai eu que des
contrariÊtÊs et des chagrins de toute espèce. Votre mariage Êtait
encore dans les fatalitĂŠs qui devaient tomber sur moi. L'autre nuit,
ne pouvant dormir, je repassais dans mon esprit toutes les misères
dont j'ai ĂŠtĂŠ accablĂŠ depuis quinze jours, et je n'y trouvais qu'une
seule compensation, qui ĂŠtait votre aimable lettre et la promesse non
moins aimable que vous me faisiez d'un _schizzo._ C'est bien maintenant
que j'ai envie de poignarder le soleil, comme disent les Andalous.
_Mariquita de mi vida_ (laissez-moi vous appeler ainsi jusqu'Ă
vos noces), j'avais une pierre superbe, bien taillĂŠe, brillante,
scintillante, admirable sur tous points. Je la croyais un diamant
que je n'aurais pas troquĂŠ pour celui du Grand Mogol.--Pas du tout!
voilĂ qu'il se trouve que ce n'est qu'une pierre fausse. Un chimiste
de mes amis vient de m'en faire l'analyse. Figurez-vous un peu mon
dĂŠsappointement. J'ai passĂŠ bien du temps Ă penser Ă ce prĂŠtendu
diamant et au bonheur de l'avoir trouvĂŠ.
Maintenant, il faut que je passe autant de temps (encore plus) Ă me
persuader que ce n'ĂŠtait qu'une pierre fausse.
Tout cela n'est qu'un apologue. J'ai dĂŽnĂŠ avant-hier avec le diamant
faux et je lui ai fait une mine de chien. Quand je suis en colère,
j'ai assez en main la figure de rhĂŠtorique appelĂŠe ironie, et j'ai
fait au diamant un ĂŠloge de ses belles qualitĂŠs le plus ampoulĂŠ que
j'ai pu et avec un sang-froid bien glacial. Je ne sais, en vĂŠritĂŠ,
pourquoi je vous dis tout cela! surtout si nous allons nous oublier
prochainement. En attendant, je vous aime toujours et je me recommande
à vos prières,--_angel in thy orisons_, etc.
Vendredi prochain, votre dessin partira par un courrier et se trouvera
sans doute dimanche Ă Londres. Vous pourrez l'envoyer rĂŠclamer mardi
chez M. V..., Pall-Mall.
Excusez la dĂŠmence de cette lettre, j'ai de tristes affaires en tĂŞte.
VIII
Mon cher ami fĂŠminin,
Nous devenons fort tendres. Vous me dites: _Amigo de mi alma_; ce qui
est fort joli dans une bouche fĂŠminine. Votre lettre ne me donne pas de
nouvelles de votre santÊ. Vous me disiez dans l'avant-dernière lettre
que mon ami fĂŠminin ĂŠtait malade, et vous auriez dĂť savoir que j'en
ĂŠtais en peine. Ayez plus d'exactitude Ă l'avenir. C'est bien Ă vous
à vous plaindre de mes rÊticences, vous qui êtes le mystère incarnÊ!
Que voulez-vous de plus sur l'histoire du diamant, si ce n'est son
nom? Des dĂŠtails peut-ĂŞtre; mais ils seraient ennuyeux Ă ĂŠcrire, et
ils vous amuseront peut-ĂŞtre un jour que nous ne trouverons rien Ă
nous dire, assis face Ă face, chacun dans un fauteuil au coin du feu.
Ăcoutez le rĂŞve que j'ai fait il y a deux nuits, et, si vous ĂŞtes
sincère, interprĂŠtez-le. _Methought_ que nous ĂŠtions tous les deux Ă
Valence, dans un beau jardin avec force oranges, grenades, etc. Vous
ĂŠtiez assise sur un banc adossĂŠ Ă une haie. En face ĂŠtait un mur de
quelque six pieds qui sĂŠparait le jardin d'un jardin voisin beaucoup
plus bas. Moi, j'ĂŠtais en face de vous, et nous causions en Valencien,
Ă ce qu'il me semblait.--_Nota bene_ que je n'entends le valencien
qu'avec beaucoup de peine. Quelle diable de langue parle-t-on en rĂŞve
quand on parle une langue qu'on ne sait pas? Par dĂŠsĹuvrement, et comme
c'est mon habitude, je montai sur une pierre et je regardai dans le
jardin d'en bas. Il y avait un banc aussi adossĂŠ contre le mur, et sur
ce banc une espèce de jardinier valencien et mon diamant Êcoutant le
jardinier, qui jouait de la guitare. Cette vue me mit Ă l'instant de
très-mauvaise humeur, mais je n'en montrai rien d'abord. Le diamant
leva la tĂŞte, me vit avec surprise, mais ne bougea pas et ne parut pas
autrement dÊconcertÊ. Après quelque temps, je descendis de ma pierre et
je vous dis, de l'air du monde le plus naturel et sans vous parler du
diamant, que nous pouvions faire une excellente plaisanterie qui serait
de jeter une grosse pierre par-dessus la crĂŞte du mur. Cette pierre
Êtait fort lourde. Vous fÝtes très-empressÊe à m'aider, et, sans me
faire de questions (ce qui n'est pas naturel), Ă force de pousser, nous
parvĂŽnmes Ă poser la pierre sur le haut du mur et nous nous apprĂŞtions
Ă la prĂŠcipiter, lorsque le mur lui-mĂŞme cĂŠda, s'ĂŠcroula, et nous
tombâmes tous les deux avec la pierre et les dÊbris du mur. J'ignore la
suite, car je me rÊveillai. Pour vous faire mieux comprendre la scène,
je vous envoie un dessin. Je n'ai pu voir la figure du jardinier, dont
j'enrage.
Vous ĂŞtes bien aimable, je vous le dis souvent depuis quelque temps.
Vous ĂŞtes bien aimable d'avoir rĂŠpondu Ă la question que je vous ai
adressÊe dernièrement. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre
rĂŠponse m'a plu. Vous m'avez dit mĂŞme, et peut-ĂŞtre involontairement,
plusieurs choses qui m'ont fait plaisir, et surtout que le mari d'une
femme qui vous ressemblerait vous inspirerait une vĂŠritable compassion.
Je le crois sans beaucoup de peine, et j'ajoute qu'il n'y aurait
personne de plus malheureux, si ce n'est un homme qui vous aimerait.
Vous devez ĂŞtre froide et moqueuse dans vos mauvaises humeurs, avec une
fiertĂŠ insurmontable qui vous empĂŞche de dire: ÂŤJ'ai tort.Âť Ajoutez
à cela l'Ênergie de votre caractère qui doit vous faire mÊpriser les
larmes et les plaintes. Lorsque, par la suite du temps et la force
des choses, nous serons amis, c'est alors que l'on verra lequel de
nous deux sait le mieux tourmenter l'autre. Les cheveux m'en dressent
Ă la tĂŞte rien que d'y penser. Ai-je bien interprĂŠtĂŠ votre _mais?_
Soyez sĂťre que, malgrĂŠ vos rĂŠsolutions, nos fils sont trop mĂŞlĂŠs pour
que nous ne nous retrouvions pas dans le monde quelque jour. Je meurs
d'envie de causer avec vous. Il me semble que je serais parfaitement
heureux si je savais que je vous verrai ce soir.
Ă propos, vous avez tort de suspecter la curiositĂŠ de M. V... FĂťt-elle
ĂŠgale Ă la vĂ´tre, ce qui n'est pas possible, M. V... est un Caton, et
il mettrait bon ordre Ă ce qu'il n'y eĂťt pas de bris de scellĂŠs. Ainsi,
envoyez-lui le _schizzo_ sous cachet et ne craignez aucune indiscrĂŠtion
de sa part. Je voudrais vous voir au moment oĂš vous ĂŠcrivez: _Amigo
de mi alma._ Quand vous ferez faire votre portrait pour moi, dites
cela intĂŠrieurement, au lieu de ÂŤpetite pomme d'apiÂť, comme disent
les dames qui veulent donner Ă leur bouche un tour gracieux.--Faites
donc que nous nous voyions sans mystère et comme de bons amis. Vous
serez sans doute dĂŠsolĂŠe d'apprendre que je me porte fort mal et que
je m'ennuie horriblement. Venez bientôt à Paris, chère Mariquita, et
rendez-moi amoureux. Je ne m'ennuierai plus alors, et, pour la peine,
je vous rendrai bien malheureuse par mes humeurs. Depuis quelque temps,
votre Êcriture devient bien lâche et vos lettres bien courtes. Je suis
très-convaincu que vous n'avez d'amour pour personne et que vous n'en
aurez jamais. Cependant, vous comprenez assez bien la thĂŠorie.
Adieu; je fais tous les souhaits possibles pour votre santĂŠ, pour votre
bonheur, pour que vous ne vous mariiez pas, pour que vous veniez Ă
Paris, enfin pour que nous devenions amis.
IX
_Mariquita de mi alma_, je suis bien triste d'apprendre votre
indisposition. J'espère que, lorsque cette lettre vous parviendra,
vous serez entièrement rÊtablie et en Êtat de m'Êcrire de plus longues
lettres. Votre dernière Êtait d'une brièvetÊ dÊsespÊrante et d'une
sĂŠcheresse Ă laquelle j'ĂŠtais autrefois accoutumĂŠ de votre part,
mais qui m'est maintenant plus pĂŠnible que vous ne sauriez croire.
Ăcrivez-moi longuement et dites-moi bien des choses aimables. Qu'est-ce
que votre maladie? Avez-vous quelque contrariĂŠtĂŠ ou des chagrins de
cĹur? Il y a dans votre dernier billet quelques phrases mystĂŠrieuses
comme toutes vos phrases qui sembleraient l'annoncer. Mais, entre
nous, je ne crois pas que vous ayez encore la jouissance de ce viscère
nommĂŠ cĹur. Vous avez des peines de tĂŞte, des plaisirs de tĂŞte; mais
le viscère nommĂŠ cĹur ne se dĂŠveloppe que vers vingt-cinq ans, au 46e
degrĂŠ de latitude. Vous allez froncer vos beaux et noirs sourcils et
vous direz: ÂŤL'insolent doute que j'aie un cĹur!Âť car c'est la grande
prĂŠtention maintenant. Depuis que l'on a fait tant de romans et de
poĂŤmes passionnĂŠs ou soi-disant tels, toutes les femmes prĂŠtendent
avoir un cĹur. Attendez encore un peu. Quand vous aurez un cĹur pour
tout de bon, vous m'en direz des nouvelles. Vous regretterez ce bon
temps oĂš vous ne viviez que par la tĂŞte, et vous verrez que les maux
que vous souffrez maintenant ne sont que des piqĂťres d'ĂŠpingle en
comparaison des coups de poignard qui pleuvront sur vous quand le temps
des passions sera venu.
Je me plaignais de votre lettre, qui renferme cependant quelque
chose de fort aimable: c'est la promesse formelle et d'assez bonne
grâce de m'envoyer votre portrait. Cela me fait beaucoup de plaisir,
non-seulement parce que je vous connaĂŽtrai mieux, mais surtout parce
que vous me montrez ainsi plus de confiance. Je fais des progrès dans
votre amitiĂŠ et je m'en applaudis. Ce portrait, quand l'aurai-je?
Voulez-vous me le donner dans la main? j'irai le prendre. Voulez-vous
le donner Ă M. V..., qui me l'enverra avec la discrĂŠtion convenable?
Ne craignez rien de lui ni de sa femme. J'aimerais mieux le tenir
de votre blanche main. Je pars pour Londres au commencement du mois
prochain. J'irai voir l'ĂŠlection, je mangerai du _white-bait fish_ Ă
Blackwall; j'irai revoir les cartons de Hampton-Court, et je repartirai
pour Paris. Si je vous voyais, je serais bien heureux, mais je n'ose
l'espĂŠrer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez bien envoyer le _schizzo_
sous enveloppe Ă M. V..., ainsi que vos lettres; je l'aurai assez
promptement, car je serai Ă Londres, suivant toutes les apparences, le
8 dĂŠcembre. Je vous ai reprochĂŠ votre curiositĂŠ et votre indiscrĂŠtion
quand vous avez ouvert la lettre de M. V...; mais, pour vous dire la
vĂŠritĂŠ, il y a des dĂŠfauts en vous qui me plaisent et votre curiositĂŠ
est du nombre. J'ai bien peur que vous ne me preniez en grippe si nous
nous voyons souvent et que le contraire n'arrive pour moi. Je pense en
ce moment Ă l'expression de votre physionomie, qui est un peu dure, _a
lioness though tame._
Adieu; je baise mille fois vos pieds mystĂŠrieux.
X
Sans doute, sans doute, envoyez Ă M. V.., ce que vous me faites
espĂŠrer depuis si longtemps. Joignez-y une lettre, une longue lettre,
car, si vous m'ĂŠcriviez Ă Paris, il est probable que je me croiserais
avec elle. PrĂŠvenez M. V... qu'il garde cette lettre et le paquet et
que j'irai le chercher chez lui en personne Ă la fin de la semaine
prochaine. Ce qui serait encore plus aimable de votre part, et ce
que vous n'ĂŠcrivez pas, ce serait de me faire dire oĂš et comment je
pourrais vous voir. Au reste, je n'y compte pas et je vous connais trop
bien pour attendre de vous cette preuve de courage. Je ne compte que
sur le hasard, qui me donnera peut-ĂŞtre un talisman ou un peloton de
fil.
Je vous ĂŠcris couchĂŠ sur un canapĂŠ et fort souffrant; couleur de prĂŠ
brĂťlĂŠ par le soleil; c'est de moi et non du canapĂŠ que je vous donne
la couleur. Il faut que vous sachiez que la mer me rend fort malade,
et que _the glad waters of the dark blue sea_ ne me sont agrĂŠables
que lorsque je les vois du rivage. La première fois que je suis allÊ
en Angleterre, j'avais ĂŠtĂŠ si malade, que je fus bien quinze jours
avant de reprendre ma couleur ordinaire, qui est celle du cheval pâle
de l'Apocalypse. Un jour que je dĂŽnais en face de madame V..., elle
s'ĂŠcria tout Ă coup: _Until to day, I thought you were an Indian._ Ne
vous effrayez pas et ne me prenez pas pour un spectre.
Je vous demande pardon de vous parler toujours du diamant. Quels
doivent ĂŞtre les sentiments de quelqu'un qui n'est pas connaisseur en
pierres, Ă qui des joailliers ont dit: ÂŤCette pierre est fausse,Âť et
qui pourtant la voit briller admirablement; qui se dit quelquefois: ÂŤSi
les joailliers ne se connaissaient pas en diamants! s'ils s'ĂŠtaient
trompĂŠs ou s'ils voulaient me tromper!Âť Je regarde donc de temps en
temps (le moins que je puis) mon diamant, et, toutes les fois que
je le regarde, je le trouve un vrai diamant en tous points. C'est
dommage qu'il ne me soit pas possible de faire une expĂŠrience chimique
concluante. Qu'en dites-vous? Si je vous voyais, je vous expliquerais
ce que cette affaire a d'obscur et vous me donneriez quelque bon
conseil ou, ce qui vaudrait peut-ĂŞtre mieux, vous me feriez oublier
mon diamant vrai ou faux, car il n'y a pas de diamant qui soutienne
la comparaison avec deux beaux yeux noirs. Adieu; j'ai horriblement
mal au coude gauche, sur lequel je m'appuie pour vous ĂŠcrire; et puis
vous ne mĂŠritez pas qu'on vous ĂŠcrive trois pages petit texte. Vous ne
m'envoyez que quelques lignes d'Êcriture très-lâches, et, de vos trois
lignes, il y en a toujours deux qui me mettent en colère.
XI
Vous êtes charmante, chère marquise, trop charmante même. Je viens de
recevoir le _schizzo._ Je possède à la fois votre portrait et votre
confiance, double bonheur. Vous ĂŠtiez en veine de bontĂŠ ce jour-lĂ ,
car votre lettre ĂŠtait longue et aimable; seulement, elle a un dĂŠfaut,
c'est qu'elle ne conclut Ă rien. Vous verrai-je ou non? _That is the
question._ Je sais bien, moi, comment la rĂŠsoudre; mais vous ne voulez
pas vous dĂŠterminer. Vous ĂŞtes, comme vous le serez toute votre vie,
entre votre caractère et vos habitudes de couvent; tout le mal vient de
lĂ . Je vous jure que, si vous ne me permettez pas de vous faire visite,
j'irai vous demander de vos nouvelles de la part de madame D... Ă ce
propos, madame D... doit vous rendre un favorable tĂŠmoignage de ma
discrĂŠtion. J'ai mĂŞme rĂŠsistĂŠ Ă un dĂŠsir que je sentais au bout de mes
doigts pour ouvrir le paquet qui m'apportait le _schizzo._ Admirez-moi.
Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous voie Ă la promenade par
exemple, ou bien mieux au British Museum ou Ă la galerie Ingerstein?
J'ai un ami Ă cĂ´tĂŠ de moi qui est fort intriguĂŠ du paquet ĂŠnorme que
j'ai ĂŠtĂŠ dĂŠcacheter loin de lui, et du changement que son arrivĂŠe a
produit dans mon moral. Je ne lui ai rien dit qui pĂťt l'approcher de la
vĂŠritĂŠ, mais il me paraĂŽt pourtant sur la voie. Adieu; je voulais vous
dire que le _schizzo_ ĂŠtait arrivĂŠ Ă bon port et qu'il m'a fait le plus
grand plaisir. Ăcrivons-nous souvent Ă Londres si nous ne nous voyons
pas...
XII
Londres, 10 dĂŠcembre.
Dites-moi, au nom de Dieu, ÂŤsi vous ĂŞtes de DieuÂť, _querida Mariquita_,
pourquoi n'avez-vous pas rÊpondu à ma lettre? Votre avant-dernière,
et surtout le _schizzo_ qui l'accompagnait, m'avaient mis dans un
tel _flutter_, que ce que je vous ai ĂŠcrit tout d'abord n'avait
pas trop le sens commun. Maintenant que je suis plus rassis et que
quelques jours de sĂŠjour Ă Londres m'ont considĂŠrablement rafraĂŽchi
la cervelle, je vais essayer de raisonner avec vous. Pourquoi ne
voulez-vous pas me voir? Personne de votre entourage ne me connaĂŽt,
et ma visite serait fort vraisemblable. Votre principal motif paraĂŽt
ĂŞtre la peur de faire quelque chose d'_improper_, comme on dit ici.
Je ne prends pas au sĂŠrieux ce que vous dites de la crainte que vous
avez de perdre vos illusions sur moi en me connaissant davantage. Si
c'Êtait là votre vÊritable motif, vous seriez la première femme, le
premier ĂŞtre humain qu'une considĂŠration semblable aurait empĂŞchĂŠ de
satisfaire son dĂŠsir ou sa curiositĂŠ. Venons Ă l'_impropriĂŠtĂŠ._ La
chose est-elle _improper_ en elle-mĂŞme? Non, car il n'y a rien de plus
simple. Vous savez d'avance que je ne vous mangerai pas. La chose n'est
donc _improper_--si _improper_ elle est--que pour le monde. Remarquez
en passant que ce mot _monde_ nous rend malheureux depuis le jour oĂš
on nous met des habits incommodes, parce que le monde le veut ainsi,
jusqu'au jour de notre mort.
. . . . . . . . . . . .
En m'envoyant votre portrait, il me semble que vous m'avez donnĂŠ la
preuve que vous m'estimiez assez pour croire Ă ma discrĂŠtion. Pourquoi
n'y croiriez-vous plus? La discrĂŠtion d'un homme, et la mienne en
particulier, est d'autant plus grande qu'on lui demande davantage.
Cela posĂŠ, et vous ĂŠtant sĂťre de ma discrĂŠtion, vous pouvez me voir,
et le monde n'est pas plus avancĂŠ qu'il ne l'est maintenant, et il ne
peut par consĂŠquent crier Ă l'_impropriĂŠtĂŠ._ J'ajouterai encore, et la
main sur la conscience (c'est-Ă -dire Ă gauche), que je ne vois pas,
quant Ă moi, la moindre inconvenance lĂ -dedans. Je dirai plus. Si cette
correspondance doit se continuer sans que nous nous voyions jamais,
elle devient la chose la plus absurde qu'il y ait au monde. J'abandonne
tout cela Ă vos rĂŠflexions.
Si j'ĂŠtais plus fat, je me rĂŠjouirais de ce que vous me dites de mon
diamant. Mais nous ne pouvons jamais nous aimer d'amour. Je parle de
vous et de moi. Notre connaissance n'a pas commencÊ d'une manière qui
puisse nous mener lĂ . Elle est beaucoup trop romantique. Quant au
diamant, mon compagnon de voyage, tout en fumant son cigare, me parlait
d'elle sans savoir que je m'y intĂŠressais et me disait de bien tristes
choses. Il paraÎt ne pas douter de sa faussetÊ. Chère _Mariquita_, vous
dites que vous ne voulez jamais ĂŞtre ÂŤdiamant de la couronneÂť, et vous
avez bien raison. Vous valez mieux que cela. Je vous offre une bonne
amitiÊ qui, je l'espère, pourra être utile un jour à tous les deux.
Adieu.
XIII
Paris, fĂŠvrier 1842.
J'ai lu, il y a une heure, votre lettre qui, depuis mardi, ĂŠtait sur
ma table, mais cachĂŠe sous un tas de papiers. Puisque vous ne mĂŠprisez
pas mes dons, voici des confitures de rose, de jasmin et de bergamote.
Vous voudrez bien en offrir un pot Ă madame de C..., _with my best
respects._ Il paraĂŽt que je vous ai offert des babouches, et vous les
refusez avec tant d'insistance, que je devrais bien vous les envoyer.
Mais, depuis mon retour, on me pille. Plus de babouches, je ne les
trouve plus. Voulez-vous ceci en ĂŠchange? Peut-ĂŞtre ce miroir turc vous
sera-t-il plus agrĂŠable; car vous me faites l'effet d'ĂŞtre devenue
encore plus coquette qu'en l'an de grâce 1840. C'Êtait au mois de
dĂŠcembre, et vous aviez des bas de soie rayĂŠs; voilĂ tout ce que je me
rappelle.
C'est Ă vous Ă dĂŠcider le protocole dont vous me parlez. Vous ne croyez
pas à mes cheveux gris. Voici une pièce justificative.
Je ne donne rien pour rien. Avant d'aller Ă Naples, vous aurez la
bontĂŠ de prendre mes ordres et de me rapporter ce que je vous dirai.
Je pourrai vous donner une lettre pour le directeur des fouilles de
PompĂŠi, si ces choses-lĂ vous intĂŠressent.
Vous faites de votre _precious self_ un portrait si brillant, que je
vois ajourner aux calendes grecques le moment oĂš nous nous reverrons,
_Allah kerim!_ Je vous ĂŠcris au milieu d'un bruit infernal. Je ne sais
trop ce que je vous dis; mais j'aurais bien des choses Ă vous dire, de
vous et de moi, que j'ajourne à la première fois que j'aurai de vos
nouvelles. En attendant, adieu, et conservez ces fines attaches et
cette radieuse physionomie que j'admirais.
XIV
Paris, samedi. Mars 1842.
Je me demande depuis deux jours si je vous ĂŠcrirai, et j'aurais d'assez
bonnes raisons de fiertĂŠ pour ne pas le faire; mais, ma foi, bien que
vous ne doutiez pas, j'espère, du plaisir que m'a fait votre lettre,
j'en ai Ă vous le dire.
Vous voilĂ riche; tant mieux. Je vous fais mon compliment. Riche,
c'est-Ă -dire libre. Votre ami, qui a eu cette bonne idĂŠe, me fait
l'effet d'une manière d'Auld Robin Gray; il devait être amoureux de
vous; vous ne l'avouerez jamais, car vous aimez fort le mystère. Je
vous pardonne, nous nous ĂŠcrivons trop rarement pour nous quereller.
Pourquoi n'iriez-vous pas Ă Rome et Ă Naples voir des tableaux et du
soleil? Vous ĂŞtes digne de comprendre l'Italie, et vous en reviendrez
riche de quelques idĂŠes et de quelques sensations. Je ne vous conseille
pas la Grèce. Vous n'avez pas la peau assez dure pour rÊsister à toutes
les vilaines bêtes qui mangent le monde. à propos de Grèce, puisque
vous gardez si bien ce qu'on vous donne, voici un brin d'herbe. Je l'ai
cueilli sur la colline d'Anthela aux Thermopyles, Ă l'endroit oĂš sont
morts les derniers des trois cents. Il est probable que cette petite
fleur a dans ses atomes constitutifs un peu des atomes de feu LĂŠonidas.
En outre, Ă cet endroit-lĂ mĂŞme, je me souviens que, couchĂŠ sur un tas
de paille de maĂŻs, devant le corps de garde de gendarmerie (quelle
profanation!), je parlai de ma jeunesse à mon ami Ampère, et je lui
dis que, parmi les souvenirs tendres qui me restaient, il n'y en avait
qu'un seul qui ne fĂťt mĂŞlĂŠ d'aucune amertume. Je pensais alors Ă notre
belle jeunesse. _Pray keep my foolish flower._
Ăcoutez, voulez-vous quelque souvenir de l'Orient plus substantiel?
J'ai dĂŠjĂ donnĂŠ malheureusement tout ce que j'avais rapportĂŠ de beau.
Je vous donnerais bien des babouches, mais pour que vous les mettiez
pour d'autres, merci. Si vous voulez de la confiture de rose et de
jasmin, il m'en reste encore un peu, mais dĂŠpĂŞchez-vous, ou je la
mangerai toute. Nous nous donnons si rarement de nos nouvelles, que
nous avons bien des choses Ă nous dire pour nous mettre au courant.
Voici mon histoire:
J'ai revu ma chère Espagne pendant l'automne de 1840; j'ai passÊ deux
mois à Madrid, oÚ j'ai vu une rÊvolution très-bouffonne, de très-belles
courses de taureaux, et l'entrĂŠe triomphale d'Espartero, qui ĂŠtait la
parade la plus comique du monde. Je demeurais chez une amie intime,
qui est pour moi une sĹur dĂŠvouĂŠe; j'allais le matin Ă Madrid et je
revenais dÎner à la campagne avec six femmes, dont la plus âgÊe avait
trente-six ans. Par suite de la rĂŠvolution, j'ĂŠtais le seul homme
qui pĂťt aller et venir librement, en sorte que ces six infortunĂŠes
n'avaient pas d'autre _cortejo._ Elles m'ont prodigieusement gâtÊ.
Je n'ĂŠtais amoureux d'aucune et j'ai peut-ĂŞtre eu tort. Bien que je
ne fusse pas dupe des avantages que me donnait la rĂŠvolution, j'ai
trouvÊ qu'il Êtait très-doux d'être ainsi sultan, même _ad honores._
Ă mon retour Ă Paris, je me suis donnĂŠ l'innocent plaisir de faire
imprimer un livre sans le publier. On n'en a tirĂŠ que cent cinquante
exemplaires: papier magnifique, images, etc., et je l'ai donnĂŠ aux gens
qui m'ont plu. Je vous offrirais cette raretĂŠ si vous en ĂŠtiez digne;
mais sachez que c'est un travail historique et pĂŠdantesque si hĂŠrissĂŠ
de grec et de latin, voire mĂŞme d'osque (savez-vous seulement ce que
c'est que l'osque?), que vous ne pourriez y mordre.--L'ĂŠtĂŠ passĂŠ, je
me suis trouvĂŠ quelque argent. Mon ministre m'a donnĂŠ la clef des
champs pour trois mois, et j'en ai passĂŠ cinq Ă courir entre Malte,
Athènes, Ăphèse et Constantinople. Dans ces cinq mois, je ne me suis
pas ennuyĂŠ cinq minutes. Vous Ă qui j'ai fait si grand'-peur jadis, que
seriez-vous devenue si vous m'aviez vu dans mes courses en Asie avec
une ceinture de pistolets, un grand sabre et--le croiriez-vous?--des
moustaches qui dĂŠpassaient mes oreilles! Sans vanitĂŠ, j'aurais fait
peur au plus hardi brigand de mĂŠlodrame. Ă Constantinople, j'ai vu
le sultan en bottes vernies et redingote noire, puis tout couvert
de diamants, Ă la procession du BaĂŻram. LĂ , une belle dame, sur la
babouche de qui j'avais marchĂŠ par mĂŠgarde, m'a donnĂŠ un grandissime
coup de poing en m'appelant _giaour._ VoilĂ mes seuls rapports avec les
beautÊs turques. J'ai vu à Athènes et en Asie les plus beaux monuments
du monde et les plus beaux paysages possibles.
Le drawback consistait en puces et en cousins gros comme des alouettes;
aussi n'ai-je jamais dormi. Au milieu de tout cela, je suis devenu bien
vieux. Mon firman me donne des cheveux de tourterelle; c'est une jolie
mĂŠtaphore orientale pour dire de vilaines choses. ReprĂŠsentez-vous
votre ami tout gris. Et vous, _querida_, ĂŞtes-vous changĂŠe? J'attends
avec impatience que vous soyez moins jolie pour vous voir. Dans deux ou
trois ans, quand vous m'ĂŠcrirez, dites-moi ce que vous faites et quand
nous nous verrons. Votre ÂŤsouvenir respectueuxÂť m'a fait rire et aussi
votre prĂŠtention Ă le disputer, dans mon cĹur, aux chapiteaux ioniques
et corinthiens.
D'abord, je n'aime plus que le dorique, et il n'y a pas de chapiteaux,
sans en excepter ceux du ParthĂŠnon, qui vaillent pour moi le souvenir
d'une vieille amitiĂŠ. Adieu; allez en Italie, et soyez heureuse. Je
pars aujourd'hui pour Ăvreux pour affaires de mon mĂŠtier; je serai de
retour lundi soir. Si vous voulez manger des feuilles de rose, dites;
je vous prĂŠviens qu'il n'y en a plus qu'une cuillerĂŠe pour vous.
XV
Paris, lundi soir. Mars 1842.
Je viens de recevoir votre lettre, qui m'a mis de mauvaise humeur.
Ainsi, c'est votre orgueil satanique qui vous a empĂŞchĂŠe de me voir.
Au reste, je n'ai pas trop le droit de vous faire des reproches; car,
l'autre jour, je vous ai rencontrĂŠe, je crois, et un sentiment aussi
mesquin m'a retenu au moment oĂš j'allais vous parler. Vous dites que
vous valez mieux qu'il y a deux ans: cela vous plaĂŽt Ă dire. Vous
m'avez semblĂŠ embellie; mais vous paraissez avoir acquis, en revanche,
une assez jolie dose d'ĂŠgoĂŻsme et d'hypocrisie. Cela peut ĂŞtre
très-utile; seulement, il n'y a pas de quoi se vanter. Quant à moi,
je crois ne valoir ni plus ni moins qu'autrefois; je ne suis pas plus
hypocrite et j'ai peut-ĂŞtre tort. Il est certain qu'on ne m'en aime pas
davantage. Puisque cette bourse n'est point brodĂŠe par votre blanche
main, que voulez-vous que j'en fasse? Vous devriez bien pourtant me
donner quelque Ĺuvre de vous; mon miroir et mes confitures mĂŠritaient
cela; au moins eÝt-il ÊtÊ bien de me dire si vous les aviez reçus; mais
je n'ai plus le droit de vous gronder. Quand vous irez en Italie et que
vous passerez par Paris, il est probable que vous ne m'y trouverez pas.
OĂš serai-je? le diable le sait. Il n'est pas impossible que je vous
rencontre aux _Studij_; mais il se peut aussi que j'aille Ă Saragosse,
voir cette femme dont vous dites que vous valez autant qu'elle. En fait
de sĹur, je n'en aurai point d'autre. Dites-moi donc, et cela avant
votre dĂŠpart de Paris, Ă quelle ĂŠpoque vous irez Ă Naples, et si vous
voulez vous charger d'un volume pour M. Buonuicci, le directeur de
fouilles de PompĂŠi. Je laisserai en partant ce volume chez madame de
C... ou ailleurs.
J'ai souvenance d'avoir vu, il y a bien longtemps, une madame de C...
dans une maison oĂš se passa un mĂŠlodrame dans lequel je jouai le rĂ´le
de niais. Demandez-lui si elle se souvient de moi.
Adieu donc, et pour longtemps sans doute. Je suis fâchÊ de ne vous
avoir pas vue. Donnez-moi de temps en temps de vos nouvelles, vous me
ferez toujours grand plaisir, quand mĂŞme vous continueriez le beau
système d'hypocrisie oÚ vous êtes entrÊe si triomphalement. Pour la
lettre de Buonuicci, je vous recommanderai, vous et votre sociĂŠtĂŠ,
comme grands archĂŠologues, etc. Vous serez contente de son empressement.
XVI
Paris, samedi 14 mai 1842.
Vous saurez, pour commencer, que je ne suis point brĂťlĂŠ. ÂŤL'accident
du chemin de fer de la rive gauche! c'est ainsi que nous commençons
toutes nos lettres Ă Paris depuis quatre jours; et puis je vous dirai
que votre lettre m'a fait grand plaisir. Je l'ai trouvĂŠe au retour
d'un petit voyage que je viens de faire pour affaires de mon mĂŠtier,
voilĂ pourquoi je vous rĂŠponds si tard. S'il faut ĂŞtre franc, et vous
savez que je ne me corrige pas de ce dĂŠfaut, je vous avouerai que vous
m'avez paru fort embellie au physique, mais point du tout au moral;
vous avez de très-belles couleurs et des cheveux admirables que j'ai
regardĂŠs plus que votre bonnet, qui en valait la peine probablement,
puisque vous semblez irritĂŠe que je n'aie pas su l'apprĂŠcier. Mais je
n'ai jamais pu distinguer la dentelle du calicot. Vous avez toujours la
taille d'une sylphide, et, bien que blasĂŠ sur les yeux noirs, je n'en
ai jamais vu d'aussi grands Ă Constantinople ni Ă Smyrne.
Maintenant, voici le revers de la mĂŠdaille. Vous ĂŞtes restĂŠe enfant
en beaucoup de choses, et vous ĂŞtes devenue par-dessus le marchĂŠ
hypocrite. Vous ne savez pas cacher vos premiers mouvements; mais
vous croyez les raccommoder par une foule de petits moyens. Qu'y
gagnez-vous? Rappelez-vous cette grande et belle maxime de Jonathan
Swift: _That a lie is too good a thing to be lavished about!_ Cette
magnanime idÊe d'être dure pour vous-même vous mènera loin assurÊment,
et, dans quelques annĂŠes d'ici, vous vous trouverez aussi heureuse
qu'un trappiste qui, après s'être maintes fois donnÊ la discipline,
dĂŠcouvrirait un jour qu'il n'y a pas de paradis. Je ne sais de quel
gage vous parlez, et il y a bien d'autres obscuritĂŠs dans votre lettre.
Nous ne pouvons pas ĂŞtre ensemble comme je suis avec madame de X...;
la première condition entre frère et sĹur, c'est une confiance sans
bornes: madame de X... m'a gâtÊ sous ce rapport. J'ai la niaiserie de
regretter cette Êpingle, mais je me console en pensant qu'après tout,
vous vous en ĂŞtes repentie. VoilĂ encore un beau trait de votre part.
Comme votre stoĂŻcisme a dĂť ĂŞtre flattĂŠ de cette victoire sur vous-mĂŞme!
Vous croyez que vous avez de l'orgueil, j'en suis bien fâchÊ, mais
vous n'avez qu'une petite vanitĂŠ bien digne d'une dĂŠvote. La mode est
au sermon aujourd'hui.--Y allez-vous? Il ne vous manquait plus que
cela. Je quitte ce sujet, qui me mettrait de trop mauvaise humeur.
Je crois que je n'irai pas Ă Saragosse. Il ne serait pas impossible
que j'allasse Ă Florence; mais ce qu'il y a de certain, c'est que
je passerai deux mois dans le Midi Ă voir des ĂŠglises et des ruines
romaines. Peut-ĂŞtre nous rencontrerons-nous au coin d'un temple ou d'un
cirque. Je vous conseille fortement d'aller en droiture Ă Naples. Vous
pourriez cependant, si vous passiez cinq ou six heures Ă Livourne, les
employer mieux en allant Ă Pise voir le Campo-Santo. Je vous recommande
_la Mort_ d'Orcagna, le _Vergonzoso_, et un buste antique de Jules
CĂŠsar. Ă Civita-Vecchia, vous n'avez Ă voir que M. Bucci, chez qui
vous achèterez des pierres gravÊes antiques, et vous lui ferez mes
compliments. Puis vous irez Ă Naples, vous logerez _Ă la Victoire_,
vous passerez quelques jours Ă humer l'air et Ă voir le ciel et la mer.
De temps en temps, vous irez aux _Studj_. M. Buonuicci vous mènera Ă
PompĂŠi. Vous irez Ă PĂŚstum, et vous penserez Ă moi; dans le temple de
Neptune, vous pourrez vous dire que vous avez vu la Grèce. De Naples,
vous irez Ă Rome, oĂš vous passerez un mois en vous disant qu'il est
inutile de tout voir parce que vous y reviendrez. Puis vous irez Ă
Florence, oĂš vous resterez dix jours. Ensuite, vous ferez ce que vous
voudrez. En passant Ă Paris, vous trouverez mon livre pour M. Buonuicci
et mes dernières instructions. Probablement, je serai alors à Arles
ou Ă Orange. Si vous vous arrĂŞtez lĂ , vous me demanderez, et je vous
expliquerai un thÊâtre antique, ce qui vous intÊressera mÊdiocrement.
Vous m'avez promis quelque chose en retour de mon miroir turc. Je
compte pieusement sur votre mĂŠmoire. Ah! grande nouvelle! Le premier
acadĂŠmicien des quarante qui mourra sera cause que je ferai trente-neuf
visites; je les ferai aussi gauchement que possible et j'acquerrai sans
doute trente-neuf ennemis. Il serait trop long de vous expliquer le
pourquoi de cet accès d'ambition. Suffit que l'AcadÊmie soit maintenant
mon cachemire bleu.
Adieu; je vous ĂŠcrirai avant de partir. Soyez heureuse, mais retenez
cette maxime, qu'il ne faut jamais faire que les sottises qui vous
plaisent. Vous aimez peut-ĂŞtre mieux celle de M. de Talleyrand, qu'il
faut se garder des premiers mouvements, parce qu'ils sont presque
toujours honnĂŞtes.
XVII
Paris, 22 juin 1842.
Votre lettre est venue un peu tard, je m'impatientais. Il faut d'abord
que je rÊponde aux points capitaux de votre lettre.--1° J'ai reçu
votre bourse; elle exhalait un parfum fort aristocratique et je l'ai
trouvÊe très-jolie. Si vous l'avez brodÊe vous-même, cela vous fait
honneur. Mais j'ai reconnu votre goĂťt rĂŠcent pour le positif: d'abord,
une bourse pour y mettre de l'argent, puis vous l'estimez cent francs
Ă la diligence. Il eĂťt ĂŠtĂŠ plus poĂŠtique de dĂŠclarer qu'elle valait
une ou deux ĂŠtoiles; pour moi, je l'estime tout autant. J'y mettrai
des mĂŠdailles. Je l'aurais estimĂŠe davantage si vous aviez daignĂŠ y
joindre quelques lignes de votre blanche main.--2° Je ne veux pas de
vos faisans; vous me les offrez d'une vilaine façon, et, de plus, vous
me dites des choses dĂŠsagrĂŠables au sujet de mes confitures turques.
C'est vous qui avez le palais d'une _giaour_, si vous ne savez pas
apprĂŠcier ce que mangent les houris. Je crois avoir rĂŠpondu Ă tout
ce qu'il y a de raisonnable dans votre lettre. Je ne veux pas vous
quereller pour le reste. Je vous abandonne Ă votre conscience, qui,
j'en suis sÝr, est quelquefois plus sÊvère pour vous que moi, que vous
accusez de duretĂŠ et d'insouciance. L'hypocrisie, que vous pratiquez
assez bien, mais en vous jouant, vous jouera un tour Ă la longue: c'est
qu'elle deviendra chez vous très-rÊelle. Quant à la coquetterie, qui
est la compagne insĂŠparable du vilain vice que vous prĂ´nez, vous en
avez toujours ĂŠtĂŠ atteinte et convaincue. Cela vous allait bien lorsque
vous la tempĂŠriez par une certaine franchise, et par du cĹur et de
l'imagination. Maintenant... maintenant, que vous dirai-je? Vous avez
de très-beaux cheveux noirs et un beau cachemire bleu, et vous êtes
toujours aimable quand vous le voulez. Dites que je ne vous gâte pas!
Quant Ă cette essence dont vous me parlez, c'est votre amitiĂŠ que vous
appelez ainsi.--J'aime ce mot _essence_--oui, de la vraie essence de
rose qui est toujours gelĂŠe comme celle d'Andrinople; je vous conterai
cette histoire orientale.
Il y avait une fois un derviche qui avait paru un saint homme Ă un
boulanger. Le boulanger lui promit un jour de lui donner toute sa vie
du pain blanc. VoilĂ le derviche enchantĂŠ. Mais, au bout de quelque
temps, le boulanger lui dit: ÂŤNous sommes convenus de pain bis,
n'est-ce pas? J'ai du pain bis excellent, c'est mon fort, que le pain
bis.Âť Le derviche rĂŠpondit: ÂŤJ'ai du pain bis plus que je n'en puis
manger; mais...Âť
Ma chatte vient de monter sur ma table et j'ai eu toutes les peines du
monde Ă l'empĂŞcher de se coucher sur mon papier. Elle m'a fait oublier
la fin de mon conte; c'est dommage, car c'ĂŠtait fort beau. Savez-vous
que j'avais fait, parmi d'autres châteaux, celui-ci: c'Êtait de vous
rencontrer Ă Marseille en septembre et de vous y montrer les lions,
et de vous y faire manger des figues et de la bouillabaisse. Mais il
faut que je sois de retour Ă Paris vers le 15 aoĂťt, afin d'y faire de
la prose pour mon ministre. Mais vous mangerez de la bouillabaisse
toute seule, et vous verrez sans moi le musĂŠe et les caves de
Saint-Victor. En revanche, vous pourriez recevoir de ma main, Ă Paris,
mes instructions pour l'Italie. Puisque ce que vous dĂŠsirez arrive,
je vous prie humblement de dĂŠsirer que je sois acadĂŠmicien. Cela me
fera grand plaisir, pourvu que vous n'assistiez pas Ă ma rĂŠception.
Au reste, vous avez du temps devant vous pour souhaiter. Il faut que
la peste se dĂŠclare parmi ces messieurs pour que mes chances soient
belles; il faudrait surtout, pour les embellir, que je vous empruntasse
un peu de cette hypocrisie que vous entendez si bien aujourd'hui. Je
suis trop vieux pour me reformer. Si j'essayais, je serais encore pire
que je ne suis. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de moi;
mais comment le saurais-je? Vous ne me direz jamais ni tout le bien ni
tout le mal que vous en pensez. Autrefois, je ne pensais pas grand bien
de _my precious self._ Maintenant j'ai un peu plus d'estime pour moi,
non pas que je me croie devenu meilleur, mais c'est le monde qui est
devenu pire. Je pars dans huit jours pour Arles, oĂš je vais exproprier
force canaille qui habite le thÊâtre antique; n'est-ce pas une jolie
occupation? Vous seriez aimable de m'ĂŠcrire avant mon dĂŠpart une
lettre remplie de douceurs. J'aime beaucoup qu'on me gâte, et puis je
suis horriblement triste et dĂŠcouragĂŠ. Il faut vous dire que je passe
mes soirĂŠes Ă relire mes Ĺuvres, qu'on rĂŠimprime. Je me trouve bien
immoral et quelquefois bĂŞte. Il s'agit de diminuer l'immoralitĂŠ et la
bĂŞtise sans se donner trop de peine; d'oĂš il rĂŠsulte pour moi beaucoup
de _blue devils._ Je vous dis adieu et vous baise très-humblement les
mains. Savez-vous ce que j'ai trouvĂŠ dans mes archives? un fil bleu
très-court avec deux nĹuds. Je l'ai mis dans la bourse.
XVIII
Châlon-sur-Saône, 30 juin 1842.
Vous avez bien devinĂŠ la fin de l'histoire: le derviche fut mystifiĂŠ
par le boulanger, mais le saint homme n'aimait pas le pain bis.
Je suis dans une ville qui m'est particulièrement odieuse, seul dans
une auberge à Êcouter un vent de sud-est effroyable, qui dessèche tout
et qui produit dans les grands corridors des harmonies Ă porter le
diable en terre. Cela fait que je suis très-furieux contre la nature
entière. Je vous Êcris pour me consoler un peu, et je me rÊjouis en
pensant que, dans votre prochain voyage, vous aurez plus d'une fois
des jours semblables Ă celui-ci. J'ai vu dans l'ĂŠglise Saint-Vincent
une fort jolie demoiselle qui faisait des stations. N'appelez-vous
pas ainsi des prières ou quelque chose d'approchant que l'on dit
devant quelques gravures qui reprÊsentent les principales scènes
de la Passion? Sa mère Êtait auprès d'elle qui la surveillait fort
attentivement. Tout en prenant des notes sur de vieux chapiteaux
byzantins, je me demandais ce que pouvait avoir fait cette jeune fille
pour mĂŠriter cette pĂŠnitence. Le cas devait ĂŞtre assez grave. Ătes-vous
devenue bien dĂŠvote, suivant la mode presque gĂŠnĂŠrale maintenant? vous
devez ĂŞtre dĂŠvote par la mĂŞme raison que vous avez un cachemire bleu.
J'en serais fâchÊ cependant; notre dÊvotion en France me dÊplaÎt;
c'est une espèce de philosophie très-mÊdiocre, qui vient de l'esprit
et non du cĹur. Lorsque vous aurez vu la dĂŠvotion du peuple en Italie,
j'espère que vous trouverez, comme moi, que c'est la seule bonne;
seulement, ne l'a pas qui veut et il faut ĂŞtre nĂŠ au delĂ des Alpes ou
des PyrĂŠnĂŠes pour croire ainsi. Vous ne sauriez vous faire une idĂŠe
du dĂŠgoĂťt que m'inspire notre sociĂŠtĂŠ actuelle. On dirait qu'elle a
cherchĂŠ par toutes les combinaisons possibles Ă augmenter la masse
d'ennui nĂŠcessaire dans l'ordre du _monde._ Je vous attends Ă votre
retour d'Italie; vous aurez vu une sociĂŠtĂŠ oĂš tout tend, au contraire,
Ă rendre l'existence de chacun plus douce et plus supportable. Nous
reprendrons alors nos discussions sur l'hypocrisie, et il est possible
que nous nous entendions.
J'ai passĂŠ presque tout mon hiver Ă ĂŠtudier la mythologie dans de vieux
bouquins latins et grecs. Cela m'a extrĂŞmement amusĂŠ, et, s'il vous
vient jamais en tĂŞte l'envie de connaĂŽtre l'histoire des pensĂŠes des
hommes, ce qui est bien plus intĂŠressant que celle de leurs actions,
adressez-vous Ă moi et je vous indiquerai trois ou quatre livres Ă
lire, qui vous rendront aussi savante que moi, ce qui n'est pas peu
dire! Ă quoi passez-vous votre temps? je me demande cela quelquefois
sans pouvoir trouver une rĂŠponse raisonnable. Si j'avais Ă tirer votre
horoscope, je prĂŠdirais que vous finirez par faire un livre: c'est
la consĂŠquence inĂŠvitable de la vie que vous menez et que les femmes
mènent en France. D'abord de l'imagination et quelquefois du cĹur;
puis, de l'hypocrisie, on passe Ă la dĂŠvotion, puis on se fait auteur.
Ă Dieu ne plaise que vous en veniez jamais lĂ !
J'espère voir madame de X... à Paris cette annÊe, si cela arrivait, je
voudrais que vous la vissiez. Vous apprendriez que le pain bis est plus
difficile Ă faire que vous n'avez l'air de le croire. Rien ne sera plus
facile, si vous le voulez bien, que de faire la connaissance de cette
boulangère-là .
Adieu; le vent souffle toujours. Je dois rester un mois en province,
et, si vous avez du temps Ă perdre et l'envie de me faire grand
plaisir, vous n'avez qu'Ă m'ĂŠcrire Ă Avignon, poste restante.
XIX
Avignon, 20 juillet 1812.
Puisque vous le prenez sur ce ton, ma foi, je capitule. Donnez-moi du
pain bis, cela vaut mieux que rien du tout. Seulement, permettez-moi
de dire qu'il est bis, et ĂŠcrivez-moi encore. Vous voyez que je suis
humble et soumis.
Votre lettre est venue dans un moment de tristesse noire causĂŠe par
cette' triste nouvelle (la mort du duc d'OrlĂŠans), que je venais
d'apprendre en revenant d'une course dans les montagnes. J'avais grand
besoin d'une lettre d'un autre style; telle quelle ĂŠtait, votre lettre
a ĂŠtĂŠ du moins une diversion.
J'y rĂŠponds article par article. La figure de rhĂŠtorique dont vous
vous croyez l'inventeur est connue depuis longtemps. On pourrait avec
le grec lui donner un nom nouveau et très-baroque. En français, elle
est connue sous le nom moins pompeux de menterie. Servez-vous-en avec
moi le moins que vous pourrez. N'en abusez pas avec les autres. Il
faut garder cela pour les grandes occasions. Ne cherchez pas trop Ă
trouver le monde sot et ridicule. Il ne l'est que trop! Il faudrait,
au contraire, s'efforcer de se le reprĂŠsenter tel qu'il n'est pas. Il
vaut mieux avoir des illusions que de n'en avoir plus du tout. J'en ai
encore trois ou quatre, dont quelques-unes ne sont pas bien solides,
mais je me bats les flancs pour les conserver.
Votre histoire est connue: ÂŤIl y avait une fois une idole...Âť Lisez
Daniel; mais il s'est trompĂŠ, la tĂŞte n'ĂŠtait point d'or, elle ĂŠtait
d'argile comme les pieds. Mais l'adorateur avait une lampe Ă la main
et le reflet de cette lampe dorait la tĂŞte de l'idole. Si j'ĂŠtais
l'idole (vous voyez que je ne prends pas cette fois le beau rĂ´le),
je dirais: ÂŤEst-ce ma faute si vous avez ĂŠteint votre lampe? est-ce
une raison pour me briser?Âť Il me semble que je deviens un peu bien
oriental. _Basta!_ Vous aimeriez Ă la folie madame de X..., si vous la
connaissiez. Ce n'est pas du pain blanc qu'elle me donne, mais c'est
quelque chose qui le remplace. Ce n'est pas une boulangère, c'est un
boulanger.
Je vois avec peine que votre coquetterie va toujours croissant. Je
suis parfaitement renseignĂŠ sur votre dĂŠvotion. Je vous remercie de
vos prières, si elles ne sont point une figure de rhÊtorique. à propos
de votre cachemire bleu, je vous soupçonnais de dÊvotion, parce que la
dĂŠvotion est, en 1842, une mode comme les cachemires bleus. VoilĂ le
rapport que vous ne compreniez pas, c'ĂŠtait bien clair pourtant. Je
suis bien fâchÊ que vous lisiez Homère dans Pope. Lisez la traduction
de Dugas-Montbel, c'est la seule lisible. Si vous aviez du courage
pour braver le ridicule et du temps Ă dĂŠpenser, vous prendriez la
grammaire grecque de Planche et le dictionnaire du susdit. Vous liriez
la grammaire pendant un mois pour vous endormir. Cela ne manquerait
pas son effet. Après deux mois, vous vous amuseriez à chercher dans le
grec le mot traduit, en gĂŠnĂŠral, assez littĂŠralement par M. Montbel;
deux mois après encore, vous devineriez assez bien, par l'embarras de
sa phrase, que le grec dit autre chose que ce que le traducteur lui
fait dire. Au bout d'un an, vous liriez Homère comme vous lisez un air,
l'air et l'accompagnement; l'air, c'est le grec; l'accompagnement, la
traduction. Il serait possible que cela vous donnât l'envie d'Êtudier
sĂŠrieusement le grec, et vous auriez d'admirables choses Ă lire. Mais
je vous suppose n'ayant pas de toilettes qui vous occupent ni de gens
à qui les montrer. Tout est remarquable dans Homère. Les Êpithètes, si
Êtranges traduites en français, sont d'une justesse admirable. Je me
souviens qu'il appelle la mer _pourpre_, et jamais je n'avais compris
ce mot. L'annÊe dernière, j'Êtais dans un petit caïque sur le golfe
de LĂŠpante, allant Ă Delphes. Le soleil se couchait. AussitĂ´t qu'il
eut disparu, la mer prit pour dix minutes une teinte violet foncĂŠ
magnifique. Il faut pour cela l'air, la mer et le soleil de Grèce.
J'espère que vous ne deviendrez jamais assez artiste pour avoir du
plaisir à reconnaÎtre qu'Homère Êtait un grand peintre. Les dernières
phrases de votre lettre sont pour moi autant d'ĂŠnigmes. Vous me dites
que vous ne m'ĂŠcrirez plus jamais, ce qui serait fort mal; d'ailleurs,
je me soumets et vous n'aurez plus de moi que des compliments. Je crois
vous en avoir adressĂŠ dĂŠjĂ plusieurs. Vous m'en demandez sans doute en
me disant que vous n'avez ni cĹur ni imagination; Ă force de nier l'un
et l'autre, de parti pris, cela peut porter malheur. Il ne faut pas
jouer avec cela. Mais je crois que vous avez voulu faire un _essai_ de
votre figure de rhĂŠtorique sur moi. Heureusement, je sais Ă quoi m'en
tenir.
Si vous avez quelque bonne pensĂŠe sur mon compte, ĂŠcrivez-la-moi. Je
suis encore pour une quinzaine de jours dans ce pays. Je voudrais vous
dire un mot de la vie que je mène. Je cours les champs sans rencontrer
autre chose que des pierres. Adieu. J'espère que vous me trouvez cette
fois passablement rĂŠsignĂŠ et convenable, _signora Fornarina?_
XX
Paris, 27 aoĂťt 1842.
Je trouve, en arrivant ici, une lettre de vous moins fĂŠroce que les
prĂŠcĂŠdentes. Vous eussiez bien fait de me l'envoyer lĂ -bas. Cette
raretÊ ne se pouvait possÊder trop tôt. Je me hâte de vous fÊliciter
de vos ĂŠtudes grĂŠgeoises, et, pour commencer par quelque chose qui
vous intĂŠresse, je vous dirai comment on appelle en grec les personnes
qui ont comme vous des cheveux dont elles ressentent une juste fiertĂŠ.
C'est _efplokamos._ _Ef_, bien, _plokamos_, boucle de cheveux. Les deux
mots rÊunis forment un adjectif. Homère a dit quelque part:
ÎĎÎźĎΡ Îľá˝ĎΝοĎÎąÎźÎżáżŚĎ ÎιΝĎ
Ďáżś.
Nimfi efplokamouça Calypso.
Nymphe bien frisante Calypso.
N'est-ce pas fort joli? Ah! pour l'amour du grec, etc.
Je suis bien fâchÊ que vous partiez si tard pour l'Italie. Vous risquez
de tout voir Ă travers des pluies atroces, qui Ă´tent la moitiĂŠ de leur
mĂŠrite aux plus belles montagnes du monde, et vous serez obligĂŠe de me
croire sur parole quand je vous vanterai le beau ciel de Naples. Vous
ne mangerez plus de bons fruits, mais vous aurez des bec-figues, ainsi
nommĂŠs parce qu'ils se nourrissent de raisins.
Je n'admets point votre version de la parabole.
Il m'est arrivĂŠ Ă mon retour une aventure qui m'a quelque peu mortifiĂŠ
en me faisant connaÎtre de quelle espèce de rÊputation je jouis de par
le monde. Voici. Je faisais mon paquet Ă Avignon et me prĂŠparais Ă
partir pour Paris par la malle-poste, lorsque deux figures vĂŠnĂŠrables
entrèrent, qui s'annoncèrent comme membres du conseil municipal. Je
croyais qu'ils allaient me parler de quelque ĂŠglise, lorsqu'ils me
dirent pompeusement et prolixement qu'ils venaient recommander Ă
ma loyautĂŠ et Ă ma vertu une dame qui allait voyager avec moi. Je
leur rÊpondis de très-mauvaise humeur que je serais très-loyal et
très-vertueux, mais que j'Êtais fort mÊcontent de voyager avec une
femme, attendu que je ne pourrais pas fumer le long de la route. La
malle-poste arrivĂŠe, je trouvai dedans une femme grande et jolie,
simplement et coquettement mise, qui s'annonça comme malade en voiture
et dÊsespÊrant d'arriver vivante à Paris. Notre tête-à -tête commença.
Je fus aussi poli et aimable qu'il m'est possible de l'ĂŞtre quand je
suis obligĂŠ de rester dans la mĂŞme position. Ma compagne parlait bien,
sans accent marseillais, Êtait très-bonapartiste, très-enthousiaste,
croyait à l'immortalitÊ de l'âme, pas trop au catÊchisme, et voyait en
gĂŠnĂŠral les choses en beau. Je sentais qu'elle avait une certaine peur
de moi. Ă Saint-Ătienne, le briska Ă deux places fut ĂŠchangĂŠ pour une
voiture Ă quatre places. Nous eĂťmes les quatre places Ă nous deux, et
par consĂŠquent vingt-quatre heures de tĂŞte-Ă -tĂŞte Ă ajouter aux trente
premières. Mais, bien que nous causassions (quel joli mot!) beaucoup,
il me fut impossible de me faire une idĂŠe de ma voisine, si ce n'est
qu'elle devait ĂŞtre mariĂŠe et une personne de bonne compagnie. Pour
finir, Ă Moulins, nous primes deux compagnons assez maussades, et
nous arrivâmes à Paris, oÚ ma femme mystÊrieuse se prÊcipita dans les
bras d'un homme très-laid qui devait être son père. Je lui ôtai ma
casquette, et j'allais monter dans un fiacre quand mon inconnue, d'une
voix Êmue, me dit, ayant laissÊ le père à quelques pas: Monsieur, je
suis pĂŠnĂŠtrĂŠe des ĂŠgards que vous avez eus pour moi. Je ne puis vous
en exprimer assez toute ma reconnaissance. Jamais je n'oublierai le
bonheur que j'ai eu de voyager avec un homme aussi _illustre._Âť Je cite
le texte. Mais ce mot illustre m'expliqua les conseillers municipaux
et la peur de la dame. Il ĂŠtait ĂŠvident qu'on avait vu mon nom sur le
livre de la poste, et que la dame, qui avait lu mes Ĺuvres, s'attendait
Ă ĂŞtre avalĂŠe toute crue, et que cette opinion fort erronĂŠe doit ĂŞtre
partagĂŠe par plus d'une autre de mes lectrices. Comment avez-vous
eu l'idĂŠe de me connaĂŽtre? Cela m'a mis de mauvaise humeur pendant
deux jours, puis j'en ai pris mon parti. Ce qu'il y a de singulier
dans ma vie, c'est qu'Êtant devenu un très-grand vaurien, j'ai vÊcu
deux ans sur mon ancienne bonne rÊputation, et qu'après être redevenu
très-moral, je passe encore pour vaurien.
En vĂŠritĂŠ, je ne crois pas l'avoir ĂŠtĂŠ plus de trois ans, et je
l'ĂŠtais, non de cĹur, mais uniquement par tristesse et un peu peut-ĂŞtre
par curiositĂŠ. Cela me nuira beaucoup, je crois, pour l'AcadĂŠmie; et
puis aussi on me reproche de ne pas ĂŞtre dĂŠvot et de ne pas aller au
sermon. Je me ferais bien hypocrite, mais je ne sais pas m'ennuyer et
je n'aurais jamais la patience. Si vous vous ĂŠtonnez que toutes les
dĂŠesses soient blondes, vous vous ĂŠtonnerez bien davantage Ă Naples en
voyant des statues dont les cheveux sont peints en rouge. Il paraĂŽt que
les belles dames autrefois se poudraient avec de la poudre rouge, voire
mĂŞme avec de la poudre d'or. En revanche, vous verrez aux peintures des
_Studij_ quantitĂŠ de dĂŠesses avec des cheveux noirs. Pour moi, il me
semble difficile de dĂŠcider entre les deux couleurs. Seulement, je ne
vous conseille pas de vous poudrer. Il y a en grec un terrible mot qui
veut dire des cheveux noirs: ÎξΝιγĎÎąáźąĎÎˇĎ (_MĂŠlankhĂŠtis_); ce ĎÎą est
une aspiration diabolique.
Je serai Ă Paris tout l'automne, je pense. Je vais travailler beaucoup
Ă un livre moral, aussi amusant que la guerre sociale que vous porterez
Ă Naples. Adieu. Vous m'avez promis des douceurs, je les attends
toujours, mais je n'y compte guère.
Vous admiriez mon livre de pierres antiques. HĂŠlas! j'ai perdu la plus
belle l'autre jour, une magnifique Junon, en faisant une bonne action:
c'ĂŠtait de porter un ivrogne qui avait la cuisse cassĂŠe. Et cette
pierre ĂŠtait ĂŠtrusque, et elle tenait une faux, et il n'y a aucun autre
monument oĂš elle soit ainsi reprĂŠsentĂŠe. Plaignez moi.
XXI
Vous avez une ĂŠcriture charmante en grec et bien plus lisible qu'en
français. Mais qui est votre maÎtre de grec? Vous ne me ferez pas
croire que vous avez appris à Êcrire les caractères cursifs en
regardant dans un livre imprimĂŠ. Qui est professeur de rhĂŠtorique Ă
D...?
Je trouve votre lettre très-aimable. Je vous dis cela parce que je
sais que les compliments vous sont agrĂŠables, et puis parce que cela
est assez vrai. Pourtant, comme je ne saurai jamais me corriger du
malheureux dĂŠfaut de dire ce que je pense aux gens qui ne sont pas tout
le monde pour moi, vous saurez que je vous vois faire des progrès bien
rapides en satanisme et que je m'en afflige. Vous devenez ironique,
sarcastique et mĂŞme diabolique. Tous ces mots-lĂ sont tirĂŠs du grec,
comme trop mieux savez, et votre professeur vous dira ce que j'entends
par diabolique; δΚáźÎ˛ÎżÎťÎżĎ, c'est-Ă -dire calomniateur. Vous vous moquez
de mes plus belles qualitĂŠs, et, quand vous me louez, c'est avec des
rĂŠticences et des prĂŠcautions qui Ă´tent Ă l'ĂŠloge tout son mĂŠrite. Il
est trop vrai que j'ai frĂŠquentĂŠ, Ă une certaine ĂŠpoque de ma vie,
très-mauvaise compagnie. Mais, d'abord, j'y allais par curiositÊ
surtout et j'y suis demeurĂŠ toujours comme en pays ĂŠtranger. Quant Ă la
bonne compagnie, je l'ai trouvĂŠe bien souvent mortellement ennuyeuse.
Il y a deux endroits oĂš je suis assez bien, oĂš, du moins, j'ai la
vanitÊ de me croire à ma place: 1° avec des gens sans prÊtention que
je connais depuis longtemps; 2° dans une venta espagnole, avec des
muletiers et des paysannes d'Andalousie. Ăcrivez cela dans mon oraison
funèbre et vous aurez dit la vÊritÊ.
Si je vous parle de mon oraison funèbre, c'est que je crois qu'il est
temps de vous y prÊparer. Je suis très-souffrant depuis longtemps, et
surtout depuis quinze jours. J'ai des ĂŠblouissements, des spasmes,
des migraines horribles. Il doit y avoir quelque grand accident Ă ma
cervelle, et je pense que je puis devenir bientôt, comme dit Homère,
convive de la tĂŠnĂŠbreuse Proserpine. Je voudrais savoir ce que vous
direz alors. Je serais charmĂŠ que vous en fussiez triste pour quinze
jours. Trouvez-vous ma prĂŠtention exagĂŠrĂŠe? Je passe une partie de
mes nuits Ă ĂŠcrire, ou Ă dĂŠchirer ce que j'ai ĂŠcrit la veille; de la
sorte j'avance peu. Ce que je fais m'amuse; mais cela amusera-t-il les
autres? Je trouve que les anciens ĂŠtaient bien plus amusants que nous;
ils n'avaient pas de buts si mesquins; ils ne se prĂŠoccupaient pas
d'un tas de niaiseries comme nous. Je trouve que mon hĂŠros Jules-CĂŠsar
fit, à cinquante-trois ans, des bêtises pour ClÊopâtre et oublia tout
pour elle, ce pourquoi peu s'en fallut qu'il ne se noyât au propre
et au figurÊ. Quel homme de notre siècle, je dis parmi les hommes
d'Ătat, n'est pas complètement racorni, complètement insensible Ă l'âge
oĂš il peut prĂŠtendre Ă la dĂŠputation? Je voudrais montrer un peu la
diffĂŠrence de ce monde-lĂ avec le nĂ´tre; mais comment faire?
Ătes-vous arrivĂŠ, dans l'_OdyssĂŠe_, Ă un passage que je trouve
admirable? C'est lorsque Ulysse est chez AlcinoĂźs inconnu encore
et qu'après dÎner un poète chante devant lui la guerre de Troie.
Le peu que j'ai vu de la Grèce m'a mieux fait comprendre Homère.
On voit partout dans l'_OdyssĂŠe_ cet amour incroyable des Grecs
pour leur pays. Il y a dans le grec moderne un mot charmant: c'est
ΞξνΚĎξ៹Ώ, l'ĂŠtrangetĂŠ, le voyage. Ătre en ΞξνΚĎξ៹Ώ, c'est pour un
Grec le plus grand de tous les malheurs; mais y mourir, c'est ce
qu'il y a de plus effroyable pour leur imagination. Vous raillez ma
gastronomie: avez-vous compris les entrailles que les hĂŠros mangent
avec tant de plaisir? Les pallicares modernes en mangent encore; cela
s'appelle κονκονĎáźĎΜΚ, et cela est vraiment dĂŠlicieux. Ce sont de
petites brochettes de bois de lentisque parfumĂŠ, avec quelque chose
de croustillant et d'ĂŠpicĂŠ autour qui, fait comprendre sur-le-champ
pourquoi les prĂŞtres se rĂŠservaient ce morceau-lĂ dans les victimes.
Adieu. Si je vous en disais davantage sur ce sujet, vous me croiriez
plus gourmand que je ne suis. Je n'ai plus d'appĂŠtit et rien ne me
plaĂŽt plus en fait de petits bonheurs. Cela veut dire que je suis bon
Ă jeter aux corbeaux. Il fera un temps de chien pendant tout le mois
d'octobre, et ce sera bien fait!
XXII
Paris, 24 octobre 1842.
C'est fort aimable Ă vous de me laisser dans l'ignorance de la partie
du monde qui a l'avantage de vous possĂŠder. Adresserai-je cette lettre
à Naples ou à ***, ou bien à Paris? Vous me dites dans votre dernière
lettre que vous allez partir pour Paris, peut-ĂŞtre pour l'Italie, et,
depuis, point de nouvelles. Je soupçonne que vous êtes ici et que
vous m'en avertirez quand vous serez repartie; cela sera _highly in
character._ Depuis vous avoir ĂŠcrit, j'ai fait un voyage de quelques
jours, et, Ă mon retour, j'ai trouvĂŠ votre lettre de date dĂŠjĂ si
ancienne, que je n'ai pas cru pouvoir vous rĂŠpondre Ă ***. D'ailleurs,
j'admire beaucoup comment, en regardant de gros caractères imprimÊs,
vous avez devinĂŠ l'ĂŠcriture cursive toute seule, comme vous dites.
Si vous avez un peu de patience, avec des dispositions semblables,
vous deviendrez une madame Dacier. Pour moi, je ne m'occupe plus de
grec ni de français; je suis tombÊ à l'Êtat de fossile, et, lorsque
je lis ou Êcris, je vois les caractères danser d'une façon très-peu
agrĂŠable. Vous me demandez s'il y a des romans grecs. Sans doute il y
en a, mais bien ennuyeux, selon moi. Il n'est pas que vous ne puissiez
vous procurer une traduction de _ThÊagène et ChariclÊe_, qui plaisait
tant Ă feu Racine. Essayez si vous pouvez y mordre; il y a encore
_Daphnis et ChloĂŠ_, traduit par Courier. Cela est fort prĂŠtentieusement
naĂŻf et pas trop exemplaire. Enfin, il y a une nouvelle admirable,
mais immorale et très-immorale: c'est l'_Ane de Lucius_, traduit
encore par Courier. On ne se vante pas de l'avoir lue, mais c'est son
chef-d'Ĺuvre! DĂŠcidez-vous d'après cela, je m'en lave les mains. Le
mal des Grecs, c'est que leurs idĂŠes de dĂŠcence et mĂŞme de moralitĂŠ
ĂŠtaient fort diffĂŠrentes des nĂ´tres. Il y a bien des choses dans leur
littĂŠrature qui pourraient vous choquer, voire mĂŞme vous dĂŠgoĂťter, si
vous les compreniez. Après Homère, vous pouvez lire en toute assurance
les tragiques, qui vous amuseront et que vous aimerez parce que vous
avez le goĂťt du beau, Ďὸ κιΝĎν, ce sentiment que les Grecs avaient au
plus haut degrĂŠ et que nous tenons d'eux, nous autres, _happy few._ Si
vous avez le courage de lire l'histoire, vous serez charmĂŠe d'HĂŠrodote,
de Polybe et de XĂŠnophon. HĂŠrodote m'enchante. Je ne connais rien de
plus amusant. Commencez par l'_Anabase ou la Retraite des Dix Mille_;
prenez une carte de l'Asie et suivez ces dix mille coquins dans leur
voyage; c'est Froissard gigantesque. Puis vous lirez HĂŠrodote, enfin
Polybe et Thucydide; les deux derniers sont bien sĂŠrieux. Procurez-vous
encore ThĂŠocrite et lisez _les Syracusaines._ Je vous recommande
bien aussi Lucien, qui est le Grec qui a le plus d'esprit, ou plutĂ´t
de notre esprit; mais il est bien mauvais sujet, et je n'ose. VoilĂ
trois pages de grec. Quant Ă la prononciation, si vous voulez, je vous
enverrai une page de ma main que j'avais prĂŠparĂŠe Ă votre intention,
qui vous apprendra la meilleure, c'est-Ă -dire la prononciation des
Grecs modernes. Celle des ĂŠcoles est plus facile, mais absurde.
Nous avons commencĂŠ Ă nous ĂŠcrire en faisant de l'esprit, puis nous
avons fait quoi? je ne vous le rappellerai pas. VoilĂ que nous faisons
de l'ĂŠrudition. Il y a un proverbe latin qui fait l'ĂŠloge du juste
milieu; j'avais l'intention de vous dire des duretÊs en commençant
ma lettre, et c'est au grec que vous devez sans doute sa parfaite
douceur. Je ne vous en garde pas moins rancune de la persistance de
vos habitudes hypocrites; mais, en ĂŠcrivant, j'ai perdu un peu de ma
mauvaise humeur. Ne regrettez pas le voyage d'Italie, si vous n'y ĂŞtes
pas. Il y a fait un temps effroyable, froid, pluie, etc. Rien de plus
laid qu'un pays qui n'est pas habituĂŠ Ă ces deux flĂŠaux. Adieu. Je
voudrais bien savoir oĂš vous ĂŞtes.--áźáż¤áż¤ĎĎÎż (Fortifie-toi).
C'est la fin d'une lettre grecque.
_P.-S._--En ouvrant un livre, je trouve ces deux petites fleurs
cueillies aux Thermopyles, sur la colline oĂš LĂŠonidas est mort. C'est
une relique, comme vous voyez.
XXIII
Jeudi, octobre 1842.
Voulez-vous entendre un opĂŠra italien avec moi aujourd'hui? Je suis
le propriĂŠtaire d'une loge les jeudis, avec mon cousin et sa femme.
Ils sont en voyage et je suis seul maĂŽtre; il faudrait que vous
eussiez sous la main ou votre frère ou l'un de vos parents qui ne
me connaĂŽtrait pas. Enfin, vous me feriez grand plaisir en venant.
RĂŠpondez-moi un mot avant six heures et je vous ferai dire le numĂŠro de
la loge; je crois qu'on donne _la Cenerentola._ Inventez quelque jolie
histoire que vous me direz Ă l'avance pour expliquer ma prĂŠsence; mais
que l'histoire soit telle que je puisse causer avec vous.
XXIV
Vendredi matin, octobre 1842.
Je vous remercie bien d'ĂŞtre venue hier, vous m'avez fait grand
plaisir. J'espère que votre frère n'a rien trouvÊ d'extraordinaire à la
rencontre. J'ai un cachet ĂŠtrusque pour vous; je ne puis souffrir celui
dont vous vous servez. Je vous donnerai l'autre la première fois que je
vous verrai. Voici la page de grec que je vous avais prĂŠparĂŠe; quand
vous retomberez dans l'ĂŠrudition, elle pourra vous servir.
XXV
Mardi soir, octobre 1842.
Je n'ai rien perdu, comme il semble, Ă attendre votre rĂŠponse; elle
est très-laborieusement mÊchante. Mais la mÊchancetÊ ne vous va pas,
croyez-moi; abandonnez ce style et reprenez votre ton de coquetterie
ordinaire, qui vous sied Ă merveille. Il y aurait de la cruautĂŠ de ma
part Ă vouloir vous voir, puisque cela vous rendrait si malade qu'il
faudrait une quantitÊ extraordinaire de gâteaux pour vous guÊrir. Je
ne sais oĂš vous avez pris que j'ai des amis dans les quatre coins
du monde. Vous savez bien que je n'en ai qu'un ou qu'une Ă Madrid.
Croyez que je suis très-reconnaissant de la magnanimitÊ que vous avez
montrĂŠe Ă mon ĂŠgard, l'autre soir aux Italiens. J'apprĂŠcie comme je le
dois la condescendance avec laquelle vous m'avez montrĂŠ votre figure
pendant deux heures, et je dois Ă la vĂŠritĂŠ de dire que je l'ai fort
admirĂŠe, comme aussi vos cheveux, que je n'avais jamais vus d'aussi
près; quant à cette assertion que vous ne m'avez rien refusÊ de ce
que je vous avais demandĂŠ, vous aurez quelques millions d'annĂŠes de
purgatoire pour cette belle menterie. Je vois bien que vous avez envie
de ma pierre ĂŠtrusque, et, comme je suis encore plus magnanime que
vous, je ne vous dirai pas, comme LĂŠonidas: ÂŤViens et prends!Âť mais
je vous demanderai encore comment vous voulez que je vous l'envoie.
Je ne me rappelle pas vous avoir comparÊe à Cerbère; mais vous avez
bien quelques rapports, non-seulement parce que vous aimez beaucoup,
comme lui, les gâteaux, mais aussi parce que vous avez trois têtes, je
veux dire trois cerveaux: l'un d'une coquetterie effroyable, l'autre
d'un vieux diplomate; le troisième, je ne vous le dirai pas, parce
qu'aujourd'hui je ne veux vous dire rien d'aimable. Je suis très-malade
et très-tourmentÊ de plusieurs tuiles qui me sont tombÊes sur la tête.
Si vous avez quelque crĂŠdit sur le Destin, priez-le qu'il me traite
bien d'ici Ă deux ou trois mois. Je viens de voir _FrĂŠdĂŠgonde_, qui m'a
ennuyÊ fort, malgrÊ mademoiselle Rachel, qui a de très-beaux yeux noirs
sans blanc, comme le diable, dit-on.
XXVI
Paris, mardi soir.
Je ne vous comprends pas et je suis tentĂŠ de vous prendre pour la
pire de toutes les coquettes. Votre première lettre, oÚ vous me dites
que vous ne me connaissez plus, m'avait mis de mauvaise humeur et je
n'y ai pas rĂŠpondu tout de suite. Aussi vous me dites, avec beaucoup
d'amabilitĂŠ, que vous ne voulez pas me voir, de peur de vous ennuyer de
moi. Si je ne me trompe, nous nous sommes vus six ou sept fois en six
ans, et, en additionnant les minutes, nous pouvons avoir passĂŠ trois ou
quatre heures ensemble, dont la moitiĂŠ Ă ne nous rien dire. Cependant,
nous nous connaissons assez pour que vous ayez pris quelque estime de
moi, et vous m'en avez donnĂŠ la preuve jeudi. Nous nous connaissons
mĂŞme plus que ne font des gens qui se seraient vus dans le monde,
depuis le temps que nous causons ensemble assez librement par lettres.
Convenez qu'il est peu flatteur pour mon amour-propre que vous me
traitiez ainsi après six ans. Au reste, comme je n'ai pas de moyen de
combattre vos rĂŠsolutions, il en sera de celle-ci ce que vous voudrez,
mais je trouve un peu niais de ne pas nous voir. Je vous demande pardon
de ce mot, qui n'est ni poli ni amical, mais qui est malheureusement
vrai, Ă mon sens du moins. Je ne me suis nullement moquĂŠ de vous
l'autre soir. Je vous ai mĂŞme trouvĂŠ beaucoup d'aplomb. Quant au
cachet antique, vous en verrez une empreinte sur cette lettre, et il
est Ă vos ordres, lorsque vous m'aurez dit oĂš je dois vous le donner;
non, comment je dois l'envoyer. N'offensons pas l'_eternal fitness of
things._ Je ne vous demande rien en ĂŠchange, par la raison que tout ce
que je vous ai demandĂŠ, vous me l'avez refusĂŠ. Si vous croyez faire mal
en me voyant, ne faites-vous point mal en m'ĂŠcrivant? Comme je ne suis
pas très-fort sur votre catÊchisme, cette question demeure embrouillÊe
pour moi. Je vous parle trop durement, peut-ĂŞtre; mais vous m'avez fait
de la peine, et les choses que j'ai sur le cĹur, je ne m'en dĂŠlivre
pas comme vous, en mangeant des gâteaux. En vÊritÊ, cela est digne de
Cerbère.
XXVII
Paris, samedi, novembre 1842.
_Das Lied des CLĂRCHENS gefällt mir zu gar; aber warum haben Sie
nicht das Ende geschrieben?_--C'est vraiment admirable de voir Ă
quel point cette pierre Êtrusque vous plaÎt! Combien de gâteaux
l'estimez-vous? Vous n'avez pas seulement cherchĂŠ Ă savoir ce qu'il y
a dessus. C'est un homme qui tourne un pot. Il faut dire une hydrie,
c'est plus grec et plus noble. C'ĂŠtait peut-ĂŞtre le cachet d'un potier
autrefois, ou bien il y a lĂ une allusion mythologique que je pourrais
vous expliquer, si je voulais. Quant Ă l'autre cachet, son histoire
est ĂŠtrange. Je l'ai trouvĂŠ dans le feu d'une cheminĂŠe, rue d'Alger,
en tisonnant; c'est une très-grosse et très-lourde bague en bronze;
les caractères en sont cabalistiques; on croit quelle a servi à un
magicien ou bien Ă des gnostiques. Vous y avez vu un petit homme,
un soleil, une lune, etc. N'est-ce pas fort curieux de trouver cela
rue d'Alger dans les cendres? Qui sait si ce n'est pas au pouvoir
mystĂŠrieux de cet anneau que je dois votre chanson de _Claire?_ Je
suis très-rÊellement malade, mais ce n'est pas une raison pour ne pas
sortir. Par exemple, si vous vouliez recevoir le cachet ĂŠtrusque de ma
main, je vous le donnerais avec grand plaisir; tandis que cela ferait
scandale dans une lettre chez votre portier. Mais je ne veux plus rien
vous demander, car vous devenez tous les jours plus impĂŠrieuse, et
vous avez des raffinements de coquetterie scandaleux. Il paraĂŽt que
vous n'apprĂŠciez pas les yeux sans blanc et que vous estimez beaucoup
les blancs-bleus. Vous prenez aussi soin de me rappeler vos yeux, que
je n'ai pas oubliĂŠs, bien que je les aie peu vus. Celui qui vous a
appris cette particularitĂŠ, que vous osez me dire ignorĂŠe de vous,
est-ce votre maĂŽtre de grec ou votre maĂŽtre d'allemand? ou bien dois-je
croire que vous avez appris toute seule l'ĂŠcriture cursive allemande
comme la grecque? Autre article de foi Ă ajouter Ă l'aversion que vous
avez pour les miroirs. Vous devriez bien cultiver une fleur germanique
nommĂŠe _die Aufrichtigkeit._ Je viens d'ĂŠcrire le mot _Fin_ au bas
de quelque chose de très-savant, que j'ai fait avec toute la mauvaise
humeur possible; reste Ă savoir s'il n'y a pas des longueurs dans ce
mot. Cependant, je me sens plus lĂŠger depuis que j'ai fini, et plus
heureux; c'est pourquoi je suis si doux et si aimable Ă votre ĂŠgard;
sans cela, je vous aurais dit plus vertement vos vĂŠritĂŠs. Vous devriez
me voir, ne fÝt-ce que pour sortir de l'atmosphère de flatterie oÚ
vous vivez. Il faut qu'un jour nous allions ensemble au MusĂŠe voir des
tableaux italiens; ce sera une compensation pour le voyage manquĂŠ, et
l'avantage de m'avoir pour cicerone est inapprĂŠciable. Ce n'est pas une
condition pour que je vous donne ma pierre ĂŠtrusque; dites comment, et
vous l'aurez.
XXVIII
Paris, novembre 1842.
M. de Montrond dit qu'il faut se garder des premiers mouvements,
parce qu'ils sont presque toujours honnĂŞtes. On dirait que vous avez
beaucoup mĂŠditĂŠ sur ce beau prĂŠcepte, car vous le pratiquez avec
une rare constance: lorsqu'il vous vient une bonne rĂŠsolution, vous
l'ajournez toujours indĂŠfiniment. Si j'ĂŠtais Ă Civita-Vecchia, je
chercherais, parmi les pierres de mon ami Bucci, quelque Minerve
ĂŠtrusque; ce serait pour vous le meilleur cachet. En attendant, mon
potier est tout prĂŞt, et je dis toujours comme LĂŠonidas: ÎοΝὥν Νιβáź.
Je pense le garder encore quelque temps, jusqu'Ă la veille de votre
dĂŠpart. Vous saurez que je suis beaucoup mieux et moins en proie aux
_blue devils._ J'ai travaillĂŠ mĂŞme avec plaisir, ce qui ne m'ĂŠtait pas
arrivĂŠ depuis longtemps. Je fais de grands projets pour mon hiver, et
c'est bon signe pour mon moral. Tout cela me rend de bonne humeur;
car, si je vous ĂŠcrivais sous le coup de votre lettre allemande, je
vous dirais vos vĂŠritĂŠs le plus durement qu'il me serait possible.
Vous n'y perdrez rien, car, si je vois aujourd'hui en couleur de rose,
c'est une raison pour que mes lunettes prennent bientĂ´t une teinte plus
sombre. Je voudrais bien savoir ce que vous faites et comment vous
passez votre temps. En vous voyant si savante en grec et en allemand,
etc., je conclus que vous vous ennuyiez fort Ă ***, et que vous passez
votre vie avec des livres et quelques savants professeurs pour vous
les commenter. Mais je me demande si cela n'a pas changĂŠ Ă Paris, et
je m'imagine que votre temps se passe de tout autre manière. Si je
ne vivais pas depuis longtemps dans la solitude la plus rigoureuse,
je saurais vos faits et gestes, et probablement les rapports qu'on
me ferait me donneraient une toute autre idĂŠe de vous que vos
lettres ne le font; bien que vous vous vantiez extrĂŞmement, j'ai la
faiblesse de croire que vous ĂŞtes avec moi plus franche, je veux dire
moins hypocrite que dans le monde. Il y a en vous des contraires si
nombreux, que j'en suis fort dĂŠrangĂŠ pour arriver Ă une conclusion
exacte, c'est-Ă -dire Ă la somme totale: + tant de bonnes qualitĂŠs, -
tant de mauvaises = X. Cet X-lĂ m'embarrasse. Lorsque je vous vis, Ă
votre dĂŠpart de Paris, chez madame de V..., notre amie, votre extrĂŞme
ÊlÊgance me surprit fort. Les gâteaux, que vous mangez de si bon
appĂŠtit pour vous remettre des courbatures que vous gagnez Ă l'OpĂŠra,
m'ont encore plus ĂŠtonnĂŠ. Ce n'est pas que, parmi vos dĂŠfauts, je ne
compte en première ligne la coquetterie et la gourmandise; mais je
croyais que la forme de ces dĂŠfauts-lĂ ĂŠtait une forme toute morale; je
croyais que vous ne songiez pas trop Ă votre toilette et que vous ĂŠtiez
femme Ă manger par distraction; que vous aimiez Ă faire de l'impression
sur les gens par vos yeux et ÂŤvos beaux motsÂť, non pas par vos robes.
Voyez comme je m'ĂŠtais trompĂŠ! Mais, cette fois, vous ne me reprocherez
pas de voir en mal: tandis que vous vous pervertissez tous les jours,
il me semble que je m'amĂŠliore. Il est une heure tout Ă fait indue et
j'ai quittÊ une très-docte compagnie de Grecs et de Romains pour vous
ĂŠcrire. L'idĂŠe que je dois me lever de bonne heure demain, c'est-Ă -dire
aujourd'hui, vient de me passer par la tĂŞte et m'empĂŞche de vous
expliquer comme quoi je vaux mieux que je ne valais, lorsque vous vous
amusiez Ă me mystifier avec madame ***. Ă une autre fois mon ĂŠloge;
aussi bien je n'ai plus de place.
XXIX
Paris, 2 dĂŠcembre 1842.
Il y a dans je ne sais quel vieux roman espagnol un conte assez
gracieux. Un barbier avait sa boutique Ă l'angle de deux rues, et
la boutique avait deux portes. Par une de ces portes, il sortait et
donnait un coup de poignard au passant, et, rentrant aussitĂ´t, il
ressortait par l'autre porte et pansait le blessĂŠ. _Gelehrten ist gut
predigen._ Je n'en yeux pas autrement Ă votre cachemire bleu ni Ă vos
gâteaux; tout cela me semble fort naturel; j'estime la coquetterie
et la gourmandise, mais quand on les avoue franchement. Et vous qui
aspirez Ă bon droit Ă ĂŞtre quelque chose de plus qu'une femme du monde,
pourquoi en auriez-vous les dĂŠfauts? pourquoi n'ĂŞtes-vous jamais
franche avec moi? Et, pour vous en donner l'exemple, voulez-vous ou
ne voulez-vous pas venir avec moi, mardi prochain, au MusĂŠe? Si vous
ne voulez pas, ou si cela vous contrarie ou vous inquiète, vous aurez
votre pierre ĂŠtrusque mardi soir dans une petite boĂŽte qui vous sera
apportÊe de la manière la plus simple. Vous êtes assez amusante avec
votre disposition Ă la coquetterie. Vous me reprochez mon insouciance,
et, si je n'ĂŠtais pas, ou si je ne paraissais pas insouciant, vous me
feriez enrager. Pourquoi porte-t-on un parapluie? C'est parce qu'il
pleut. Madame de M. *** viendra Ă Paris malgrĂŠ vos souhaits. Elle doit
acheter le trousseau de sa fille, qui se marie au printemps; et, Ă
moins d'une rĂŠvolution extraordinaire, ledit trousseau se fera Ă Paris,
et peut-ĂŞtre la noce aussi. Je ne connais pas le futur; mais, Ă force
d'intrigues, j'ai contribuĂŠ Ă en ĂŠcarter un autre qui me dĂŠplaisait,
quoique très-exceptionnable sous beaucoup de rapports. Il n'Êtait pas
assez grand de taille; il avait, d'ailleurs, cinq ou six grandesses
accumulĂŠes sur un petit corps. Cette action-lĂ est une preuve de
mon amĂŠlioration. Autrefois, les ridicules des autres m'amusaient;
maintenant, je voudrais les ĂŠpargner Ă presque tout le monde. Je
suis aussi devenu plus humain, et, lorsque j'ai revu des courses de
taureaux, Ă Madrid, je n'ai pas retrouvĂŠ mes ĂŠmotions de plaisir de
dix ans plus tĂ´t; et puis j'ai horreur de toutes les souffrances et je
crois aux souffrances morales depuis quelque temps. Enfin, je tâche
d'oublier mon _moi_ le plus possible. VoilĂ , en peu de mots, la liste
de mes perfections.
Ce n'est pas par _vanagloria_ que je voudrais ĂŞtre acadĂŠmicien. Je
me prÊsenterai un de ces jours, et je serai black-boulÊ. J'espère
avoir assez de constance et de fermetĂŠ pour prendre bien la chose
et pour persister. Si le cholĂŠra revient, j'arriverai peut-ĂŞtre au
fauteuil. Non, je n'ai nulle _vanagloria._ Je vois les choses peut-ĂŞtre
trop positivement, mais j'ai ĂŠtĂŠ _escarmentado_ pour avoir vu trop
poĂŠtiquement. Au reste, croyez que vous ne saurez jamais ni tout le
bien ni tout le mal qui est en moi. J'ai passĂŠ ma vie Ă ĂŞtre louĂŠ pour
des qualitĂŠs que je n'ai pas et calomniĂŠ pour des dĂŠfauts qui ne sont
pas les miens. Je me reprĂŠsente maintenant vos soirĂŠes passĂŠes entre
vos deux frères. Adieu.
XXX
DĂŠcembre, lundi matin.
VoilĂ ce qui s'appelle parler. Demain Ă deux heures, lĂ oĂš vous dites.
J'espère vous voir demain dÊlivrÊe de votre migraine, malgrÊ laquelle
vous ĂŞtes plus aimable qu'Ă votre ordinaire. Adieu; je serai heureux de
regarder la _Joconde_ avec vous. Je suis obligĂŠ de courir les quatre
coins de Paris et je n'ai que le temps de vous remercier de votre
gracieusetĂŠ presque inattendue.
XXXI
Mercredi.
N'est-ce pas qu'on fait le diable plus noir qu'il n'est? Je me rĂŠjouis
d'apprendre que vous n'ĂŞtes pas enrhumĂŠe et que vous avez bien dormi.
C'est plus que je ne puis dire. Veuillez seulement rĂŠflĂŠchir que le
MusĂŠe sera fermĂŠ le 20 janvier pour l'exposition des tableaux, et que
ce serait pitiĂŠ de ne pas lui dire adieu. Vous allez trouver Ă cette
proposition mille et un _mais_ sans doute. Craignez de vous repentir,
le 21 janvier, de n'avoir pas retrouvĂŠ le _courage_ que vous avez eu
hier.
XXXII
Paris, dimanche soir. DĂŠcembre.
Votre lettre ne m'a pas surpris un moment, je m'y attendais. Je vous
connais assez maintenant pour ĂŞtre sĂťr que, lorsque vous avez eu
quelque bonne pensÊe, vous vous en repentez, et vous tâchez de la faire
oublier bien vite. Vous vous entendez fort bien, d'ailleurs, Ă dorer
les pilules les plus amères, c'est une justice que je vous dois. Comme
je ne suis pas le plus fort, je n'ai rien Ă dire pour combattre votre
hĂŠroĂŻque rĂŠsolution de ne pas retourner au MusĂŠe. Je sais fort bien que
vous n'en ferez qu'à votre tête; seulement, j'espère que, d'ici à un
mois, vous pourrez avoir quelque pensĂŠe plus charitable en ma faveur;
peut-ĂŞtre avez-vous raison. Il y a un proverbe espagnol qui dit: _Entre
santa y santo, pared de cal y canto._ Vous me comparez au diable. Je
me suis aperçu que, mardi soir, je ne pensais pas assez à mes bouquins
et trop Ă vos gants et Ă vos brodequins. Mais, malgrĂŠ tout ce que vous
me dites avec votre diabolique coquetterie, je ne crois pas que vous
ayez peur de retrouver au MusĂŠe nos folies d'autrefois. Franchement,
voici ce que je pense de vous, et comment je m'explique votre refus:
vous aimez Ă avoir un but vague Ă votre coquetterie, et ce but, c'est
moi. Vous ne le voudriez pas trop près, d'abord: parce que, si vous
manquiez Ă le toucher, votre vanitĂŠ en souffrirait trop, et puis parce
que, en le voyant de trop près, vous trouveriez qu'il ne vaut pas la
peine qu'on le vise; ai-je devinĂŠ? J'avais envie, l'autre jour, de
vous demander quand je vous reverrais, et peut-ĂŞtre m'auriez-vous dit
un jour si je vous en avais bien pressÊe; et puis j'ai pensÊ qu'après
m'avoir dit oui, vous m'ĂŠcririez non; que cela me ferait de la peine et
me mettrait en colère.
Je vous parle toujours avec la plus niaise franchise, mais l'exemple ne
vous touche point.
XXXIII
Dimanche, 19 dĂŠcembre 1842.
On voit bien que vous avez eu des professeurs d'allemand et de grec;
mais il est permis de douter que vous en ayez eu de logique. En effet,
vit-on jamais raisonner de la sorte! par exemple, lorsque vous me
dites que vous ne voulez pas me voir, parce que, quand vous me voyez,
vous craignez de ne plus me revoir, etc. Ă ces causes, je tiens votre
lettre pour non avenue. La seule chose qui m'ait paru claire, c'est
que vous avez un mouchoir Ă me donner. Envoyez-le-moi ou dites-moi de
le recevoir de votre main, ce qui me conviendrait beaucoup mieux. Je
hais les surprises qu'on m'annonce, parce que je me les reprĂŠsente
beaucoup plus belles qu'elles ne sont en effet. Croyez-moi, revoyons
le MusĂŠe ensemble; si je vous ennuie, tout sera dit, je ne vous y
reprendrai plus; sinon, qui empĂŞche que nous nous voyions de temps en
temps? Ă moins que vous ne me donniez quelque raison intelligible, je
persisterai Ă croire ce qui vous irrite tant.--Je vous aurais rĂŠpondu
tout de suite, mais j'avais perdu votre lettre et je voulais la relire.
J'ai bouleversĂŠ ma table, je l'ai rangĂŠe, ce qui n'est pas une petite
affaire; enfin, après avoir brÝlÊ quelques rames de vieux papiers
destinÊs à ramasser la poussière sur mon bureau, j'ai cru que votre
lettre s'ĂŠtait anĂŠantie par quelque sortilège. Je l'ai retrouvĂŠe tout Ă
l'heure dans mon XĂŠnophon, oĂš elle ĂŠtait entrĂŠe, je ne sais comment; je
l'ai relue avec admiration. Il faut assurÊment que vous n'ayez guère de
cette vĂŠnĂŠration dont vous me parlez quelquefois, pour me dire tant de
_sinrazones_; mais je vous les pardonnerai si nous nous voyons bientĂ´t;
car, lorsque vous parlez, vous ĂŞtes bien plus aimable que lorsque vous
ĂŠcrivez.
Je suis très-souffrant, je tousse à fendre les rochers, et cependant
je vais lundi soir entendre mademoiselle Rachel dire des tirades de
_Phèdre_ devant cinq ou six grands hommes. Elle croira que ma toux est
une cabale contre elle. Ăcrivez-moi bientĂ´t. Je m'ennuie horriblement,
et vous feriez une Ĺuvre de charitĂŠ en me disant quelque chose
d'aimable, comme vous faites quelquefois.
XXXIV
DĂŠcembre 1842.
Il y a longtemps que je veux vous ĂŠcrire. Mes nuits se passent Ă
faire de la prose pour la postĂŠritĂŠ; c'est que je n'ĂŠtais content
ni de vous, ni de moi, ce qui est plus extraordinaire. Je me trouve
aujourd'hui plus indulgent. J'ai entendu ce soir madame Persiani, qui
m'a raccommodĂŠ avec la nature humaine. Si j'ĂŠtais comme le roi SaĂźl,
je la prendrais en place d'un David. On me dit que M. de Pongerville,
l'acadĂŠmicien, va mourir: cela me dĂŠsole, car je ne le remplacerai pas,
et je voudrais qu'il attendĂŽt jusqu'Ă ce que mon temps fĂťt venu. Ce
Pongerville-là a traduit en vers un poète latin nommÊ Lucrèce, lequel
mourut Ă quarante-trois ans pour avoir pris un philtre Ă l'effet de se
faire aimer ou de se rendre aimable. Mais, auparavant, il avait fait un
grand poème sur _la Nature des choses_, poème athÊe, impie, abominable,
etc.
La santĂŠ de M. de Pongerville me tracasse plus que de droit, et puis
je vais être obligÊ de me lever à dix heures après-demain pour les
ennuis du jour de l'an. Comment tout le monde ne s'entend-il pas pour
voyager ou aller Ă tous les diables, ce jour-lĂ ? J'ai encore d'autres
ennuis qui vous feraient rire et que je ne vous dirai pas. Savez-vous
que, si nous continuons Ă nous ĂŠcrire sur ce ton d'aimable confiance,
chacun gardant pour soi ses pensÊes secrètes, nous n'avons qu'une
ressource, c'est de soigner notre style, puis de publier un jour notre
correspondance, comme on a fait pour celle de Voiture et de Balzac?
Vous avez surtout une manière de considÊrer comme non avenues les
choses dont vous ne voulez pas parler qui fait le plus grand honneur Ă
votre diplomatie. Il me semble que vous embellissez. Cela me paraissait
impossible, car la mer ne peut acquĂŠrir de nouvelles eaux. Cela prouve
que ce que vous perdez d'un cĂ´tĂŠ, vous le gagnez de l'autre. On
embellit quand on se porte bien; on se porte bien quand on a un mauvais
cĹur et un bon estomac. Mangez-vous toujours des gâteaux?
Adieu; je vous souhaite une bonne fin d'annĂŠe et un bon commencement de
l'autre. Vos amis useront vos joues ce jour-lĂ . Lorsque j'aurai fini la
prose dont je vous parlais tout Ă l'heure, j'irai pour ma peine passer
une dizaine de jours à Londres. Ce sera vers Pâques.
XXXV
DĂŠcembre 1842.
Vous saurez que j'ai ÊtÊ très-malade depuis que nous ne nous sommes
vus. J'ai eu tous les chats du monde dans la gorge, tous les feux de
l'enfer dans la poitrine et j'ai passĂŠ quelques jours dans mon lit Ă
mĂŠditer sur les choses de ce monde. J'ai trouvĂŠ que j'ĂŠtais sur la
pente d'une montagne dont j'avais Ă peine, avec beaucoup de fatigue et
peu d'amusement, dĂŠpassĂŠ le sommet, que cette pente ĂŠtait bien roide
et bien ennuyeuse Ă dĂŠgringoler, et qu'il serait assez avantageux de
rencontrer un trou avant d'arriver au bas. Le seul motif de consolation
que j'aie dĂŠcouvert le long de cette pente, c'est un peu de soleil bien
loin, quelques mois passÊs en Italie, en Espagne ou en Grèce à oublier
le monde entier, le prĂŠsent et surtout l'avenir. Tout cela n'ĂŠtait
pas gai; mais l'on m'a apportĂŠ quatre volumes du docteur Strauss, la
_Vie de JÊsus._ On appelle cela de l'_exÊgèse_ en Allemagne; c'est un
mot tout grec qu'ils ont trouvĂŠ pour dire discussion sur la pointe
d'une aiguille; mais c'est fort amusant. J'ai remarquĂŠ que plus une
chose est dĂŠpourvue d'une conclusion utile, plus elle est amusante. Ne
pensez-vous pas un peu de la sorte, _seĂąora caprichosa?_...
XXXVI
Mardi soir. DĂŠcembre 1842.
Ce n'est plus du Jean-Paul, c'est du français, et du français du temps
de Louis XV. Belle argumentation, toute fondĂŠe sur l'intĂŠrĂŞt. Il y a
des gens qui achètent un meuble dont la couleur leur plaisait; comme
ils ont peur de le gâter, ils y mettent des housses de toile qu'ils
n'Ă´teront que lorsque le meuble sera usĂŠ. Dans tout ce que vous dites
et tout ce que vous faites, vous substituez toujours Ă un sentiment
rĂŠel un convenu. C'est peut-ĂŞtre une _convenance._ La question est
de savoir ce que c'est pour vous auprès d'autre chose qu'il serait
presque bête et ridicule de lui comparer dans ma manière de voir.
Vous savez que, bien que je n'aie pas beaucoup d'admiration pour les
mauvais raisonnements, je respecte les convictions, mĂŞme celles qui
me paraissent les plus absurdes. Il y a en vous beaucoup d'idĂŠes
saugrenues, pardonnez-moi le mot, que je me reprocherais de chercher
Ă vous Ă´ter, puisque vous y tenez et parce que vous n'avez rien Ă
mettre en place. Mais nous rĂŞvons. N'y a-t-il pas l'appareil de _cal
y canto_ qui nous rĂŠveille sans cesse? Devons-nous chercher encore Ă
fermer la crevasse par laquelle nous voyons des choses de fĂŠerie? Que
craignez-vous? Il y a dans votre lettre d'aujourd'hui, au milieu d'un
tas de duretĂŠs et de sombres pensĂŠes bien froides, quelque chose qui
est vrai. ÂŤJe crois que je ne vous ai jamais tant aimĂŠ qu'hier.Âť Vous
auriez pu ajouter: ÂŤJe vous aime moins aujourd'hui.Âť Je suis sĂťre que,
si vous ĂŠtiez aujourd'hui telle que vous ĂŠtiez hier, vous auriez eu les
remords que je vous prÊdisais et qui ne vous tourmentent guère, à ce
qu'il me semble. Mes remords Ă moi sont d'un autre genre.
Je me repens souvent d'ĂŞtre trop loyal dans mon mĂŠtier de statue.
Vous me donniez votre âme hier, j'aurais voulu vous donner la mienne;
mais vous ne voulez pas. Toujours la housse de toile! VoilĂ un sujet
sur lequel vous me feriez vous dire toutes les injures possibles;
et pourtant jamais je n'en ai eu moins d'envie avant d'avoir reçu
votre lettre. Après tout, je suis comme vous: les bons souvenirs me
font oublier les mauvais. Ă propos, voyez quelle tendresse! vous me
gardez une surprise pour mon dĂŠpart. Croyez-vous que je sois bien
impatient? Hier, en revenant de dÎner en ville, je me suis aperçu que
je savais par cĹur le discours de Temessa que vous aviez admirĂŠ; et,
comme j'ĂŠtais un peu rĂŞveur, je l'ai traduit en vers; en vers anglais
s'entend, car j'abhorre les vers français. Je vous les destinais, mais
vous ne les aurez pas. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait une
horrible faute de quantitĂŠ dans le mot _Äjax._ C'est _Ăjax_ qu'il faut,
n'est-ce pas?
Quand vous verrai-je, pour vous dire ce que vous ne me dites jamais?
Vous voyez que nous commandons au temps. Il se transforme pour nous.
Entre deux tempĂŞtes, nous avons toujours un jour d'alcyon. Dites-moi
seulement deux jours, car je suis Ă l'attache maintenant.
XXXVII
Paris, 3 janvier 1813.
Ă la bonne heure, voilĂ ce qui s'appelle parler. Vous ĂŞtes si aimable
quand vous le voulez! pourquoi donc vous faites-vous souvent si
mauvaise? Non, bien entendu, les remercĂŽments par ĂŠcrit ne valent
rien, et toute la diplomatie que j'ai mise Ă vous procurer les lettres
de recommandation si chaleureuses pour votre frère mÊrite que vous
me disiez quelque chose d'aimable. Je vous pardonnerai de très-grand
cĹur tout ce que vous me dites de moqueur au sujet des ballons et
de l'AcadĂŠmie, Ă laquelle je pense bien moins que vous ne dites. Si
je suis jamais acadĂŠmicien, je ne serai pas plus dur qu'un rocher.
Peut-ĂŞtre serai-je alors un peu racorni et momifiĂŠ, mais assez bon
diable au fond. Pour la Persiani, je n'ai pas d'autre moyen d'en faire
mon David que d'aller l'entendre tous les jeudis. Quant Ă mademoiselle
Rachel, je n'ai pas la facultĂŠ de jouir des vers aussi souvent que de
la musique; et elle--Rachel, non la musique--me remet en mĂŠmoire que
je vous ai promis une histoire. Vous la conterai-je ici, ou vous la
garderai-je pour quand je vous verrai? Je vais vous l'ĂŠcrire, j'aurai
sans doute autre chose Ă vous dire. Donc, j'ai dĂŽnĂŠ, il y a une
douzaine de jours, avec elle, chez un acadĂŠmicien. C'ĂŠtait pour lui
prĂŠsenter BĂŠranger. Il y avait lĂ quantitĂŠ de grands hommes. Elle vint
tard, et son entrĂŠe me dĂŠplut. Les hommes lui dirent tant de bĂŞtises
et les femmes en firent tant, en la voyant, que je restai dans mon
coin. D'ailleurs, il y avait un an que je ne lui avais parlÊ. Après
le dĂŽner, BĂŠranger, avec sa bonne foi et son bon sens ordinaires, lui
dit quelle avait tort de gaspiller son talent dans les salons, qu'il
n'y avait pour elle qu'un vÊritable public, celui du ThÊâtre-Français,
etc. Mademoiselle Rachel parut approuver beaucoup la morale, et, pour
montrer qu'elle en avait profitĂŠ, joua le premier acte d'_Esther._ Il
fallait quelqu'un pour lui donner la rĂŠplique et elle me fit apporter
un Racine en cĂŠrĂŠmonie par un acadĂŠmicien qui faisait les fonctions
de sigisbĂŠe. Moi, je rĂŠpondis brutalement que je n'entendais rien
aux vers et qu'il y avait dans le salon des gens qui, ĂŠtant dans
cette partie-lĂ , les scanderaient bien mieux. Hugo s'excusa sur ses
yeux, un autre sur autre chose. Le maĂŽtre de la maison s'exĂŠcuta.
ReprĂŠsentez-vous Rachel en noir, entre un piano et une table Ă thĂŠ, une
porte derrière elle et se composant une figure thÊâtrale. Ce changement
à vue a ÊtÊ fort amusant et très-beau; cela a durÊ environ deux
minutes, puis elle commença:
Est-ce toi, chère Ălise?...
La confidente, au milieu de sa rĂŠplique, laisse tomber ses lunettes
et son livre; dix minutes se passent avant qu'elle ait retrouvĂŠ sa
page et ses yeux. L'auditoire voit qu'Esther enrage quelque peu. Elle
continue. La porte s'ouvre derrière: c'est un domestique qui entre. On
lui fait signe de se retirer. Il s'enfuit et ne peut parvenir Ă fermer
la porte. La porte susdite, ĂŠbranlĂŠe, oscillait, accompagnant Rachel
d'un mÊlodieux cric crac très-divertissant. Comme cela ne finissait
pas, mademoiselle Rachel porta la main sur son cĹur et se trouva mal,
mais en personne habituÊe à mourir sur la scène, donnant au monde le
temps d'arriver à l'aide. Pendant l'intermède, Hugo et M. Thiers se
prirent de bec au sujet de Racine. Hugo disait que Racine ĂŠtait un
petit esprit et Corneille un grand. ÂŤVous dites cela, rĂŠpondit Thiers,
parce que vous ĂŞtes un grand esprit; vous ĂŞtes le Corneille (Hugo
prenait des airs de tête très-modestes) d'une Êpoque dont le Racine
est Casimir Delavigne.Âť Je vous laisse Ă penser si la modestie ĂŠtait
de mise. Cependant, l'Êvanouissement passe et l'acte s'achève, mais
_fiascheggiando._ Quelqu'un qui connaĂŽt bien mademoiselle Rachel dit en
sortant: ÂŤComme elle a dĂť jurer ce soir, en s'en allant!Âť Le mot m'a
donnÊ à penser. Voilà mon histoire; ne me compromettez pas auprès des
acadĂŠmiciens, c'est tout ce que je vous demande.
Dimanche, je ne vous ai reconnue que lorsque j'Êtais tout près de vous.
Mon premier mouvement a ĂŠtĂŠ d'aller vers vous; mais, en vous voyant
très-accompagnÊe, j'ai passÊ mon chemin. J'ai bien fait, je pense.
Il me semble que je vous ai connu les joues pâles, d'oÚ j'ai conclu
qu'elles ĂŠtaient roses par la solennitĂŠ de ce jour.
Bonsoir ou plutĂ´t bonjour. Lundi ou plutĂ´t mardi. Il est trois heures
du matin.
XXXVIII
Jeudi, janvier 1843.
Profitons du beau temps dès aujourd'hui.
One homme n'eut les dieux tant Ă la main,
Qu'asseurĂŠ fut de vivre au lendemain.
Donc, oĂš vous dites ÂŤĂ deux heures, demain jeudiÂť, je dis
ÂŤaujourd'huiÂť, car il est une heure du matin. Les ĂŠtoiles brillent,
et, en revenant tout Ă l'heure du raout ministĂŠriel, j'ai trouvĂŠ le
pavÊ aussi tolÊrable que la dernière fois. Mettez cependant vos bottes
de sept lieues, c'est le plus sĂťr. Si, par extraordinaire, vous ĂŠtiez
sortie quand cette lettre vous arrivera, je vous attendrai jusqu'Ă
deux heures et demie; puis samedi, si vous ne pouvez aujourd'hui. A
une autre que vous, je dirais autre chose. Je voulais vous ĂŠcrire
aujourd'hui, mais je me suis arrĂŞtĂŠ en pensant Ă ma promesse. J'ai
mal fait. Vous auriez dĂť me dire votre heure et votre jour; cela nous
eÝt ÊpargnÊ l'inconvÊnient de nous manquer. J'espère qu'il n'en sera
rien. Je suppose surtout que vous avez rĂŠellement envie de faire cette
promenade, car votre lettre est plus froide que les prĂŠcĂŠdentes. Il y
a dans votre manière un Êquilibre admirable. Vous ne voulez jamais que
je sois parfaitement content, et vous prenez d'avance vos mesures pour
me faire enrager. Cela vous sera peut-ĂŞtre plus difficile que vous ne
pensez, car, bien que je sois malade depuis deux jours, je vois tout
couleur de rose. Hier, j'ai dĂŽnĂŠ dans une maison oĂš, entrant tard au
milieu d'un cercle de femmes, j'ai cru d'abord vous reconnaĂŽtre, et
j'en suis devenu stupide pendant un quart d'heure. Je ne tournais pas
les yeux vers cette personne qui vous ressemblait, et je rĂŠflĂŠchissais
fort mal, comme lorsqu'on est troublĂŠ, sur ce que je devais faire: vous
reconnaĂŽtre ou non.
Enfin, par un effort dĂŠsespĂŠrĂŠ, je me suis avancĂŠ vers ladite femme,
qui s'est trouvĂŠe ĂŞtre une Espagnole que j'ai cependant vue trois ou
quatre fois. Il ne tient qu'Ă elle de croire _che ha fatto colpo._
Je vous envoie les _Sketches_ de Dickens, qui m'ont amusĂŠ autrefois.
Peut-ĂŞtre les avez-vous lues dĂŠjĂ , mais peu importe! Ainsi, Ă deux
heures, aujourd'hui jeudi.
XXXIX
Paris, dimanche 16 janvier 1843.
Je vous remercie d'avoir pensĂŠ Ă me rassurer, mais je crains cette
chaleur aux joues dont vous parlez si lÊgèrement. Je regrette bien, je
vous assure, d'avoir insistĂŠ tant pour vous procurer cette affreuse
averse. Il m'arrive rarement de sacrifier les autres Ă moi-mĂŞme,
et, quand cela m'arrive, j'en ai tous les remords possibles. Enfin,
vous n'êtes pas malade et vous n'êtes pas fâchÊe; c'est là le plus
important. Il est bien qu'un petit malheur survienne de temps en
temps pour en dĂŠtourner de plus grands. VoilĂ la part du diable faite.
Il me semble que nous ĂŠtions tristes et sombres tous les deux; assez
contents pourtant au fond du cĹur. Il y a des gaietĂŠs intimes qu'on ne
peut rĂŠpandre au dehors. Je dĂŠsire que vous ayez senti un peu de ce
que j'ai senti moi-mĂŞme. Je le croirai jusqu'Ă ce que vous me disiez
le contraire. Vous me dites deux fois: ÂŤAu revoir!Âť C'est pour de
bon, n'est-ce pas? Mais oĂš et comment? J'ai ĂŠtĂŠ si malheureux dans
ma dernière invention, que je suis tout à fait dÊcouragÊ. Je ne m'en
lierai plus qu'Ă vos inspirations.
Je suis très-enrhumÊ ce soir, mais la pluie n'y est pour rien, je
pense. J'ai passĂŠ toute la matinĂŠe Ă voir des talismans et des bagues
chaldĂŠennes, persanes, etc., dans une galerie sans feu, chez un
antiquaire qui mourait de peur que je ne les lui volasse. Pour le
tourmenter, je suis restĂŠ au froid plus longtemps que mon inclination
ne m'y portait.
Bonsoir et au revoir bientĂ´t. C'est Ă vous Ă commander maintenant.
Ne fĂťt-ce que pour m'assurer que cette pluie ne vous a pas enrhumĂŠe,
dĂŠcouragĂŠe ni irritĂŠe, je voudrais bien vous voir.
XL
Dimanche soir, janvier 1843.
Pour moi, je n'ĂŠtais pas trop fatiguĂŠ, et cependant, en regardant sur
la carte nos pĂŠrĂŠgrinations, je vois que nous aurions dĂť l'ĂŞtre tous
les deux. C'est que le bonheur me donne des forces; Ă vous, il vous
les Ă´te. _Wer besser liebt?_ J'ai dĂŽnĂŠ en ville et je suis allĂŠ Ă
un raout après. Je ne me suis endormi que très-tard, pensant à notre
promenade.
Vous avez raison de dire que c'ĂŠtait un rĂŞve. Mais n'est-ce pas un
grand bonheur de pouvoir rĂŞver quand on le veut bien? Puisque vous
ĂŞtes dictatrice, c'est Ă vous de dire quand vous voudrez recommencer.
Vous dites que nous n'avons pas eu de procĂŠdĂŠs l'un pour l'autre. Je
ne comprends pas. Est-ce parce que je vous ai trop fait marcher? Mais
comment pouvions-nous faire autrement? Moi, je suis très-content de
vos procĂŠdĂŠs, et je les louerais davantage si je n'avais peur que
les ĂŠloges ne vous rendissent moins aimable Ă l'avenir. Quant aux
_follies_, n'y songez plus, c'est devenu une charte. Lorsque vous
trouvez Ă redire Ă quelque chose, demandez-vous si vous prĂŠfĂŠreriez
_really truly_ le contraire? J'aimerais que vous me rĂŠpondissiez
franchement Ă cette question. Mais la franchise n'est pas trop parmi
vos qualitĂŠs les plus apparentes. Vous vous ĂŞtes moquĂŠe de moi, et vous
avez pris pour un mauvais compliment ce que je vous ai dit un jour
de cette envie de dormir, ou plutĂ´t de cette torpeur qu'on ĂŠprouve
quelquefois lorsqu'on se sent trop heureux pour trouver des mots qui
puissent exprimer ce que l'on ĂŠprouve. J'ai bien remarquĂŠ hier que
vous ĂŠtiez sous l'influence de ce sommeil-lĂ , qui vaut bien toutes les
veilles. J'aurais pu vous reprocher Ă mon tour vos reproches; mais
j'ĂŠtais trop content intĂŠrieurement pour troubler mon bonheur.
Adieu, chère amie; à bientôt, j'espère.
XLI
Mercredi soir, janvier 1843.
J'ai attendu toute la journĂŠe une lettre de vous. Je trouvais le pavĂŠ
sec et le ciel tolĂŠrable. Mais il paraĂŽt qu'il vous faut maintenant
un soleil comme celui de jeudi dernier. Je crois, en outre, que vous
aviez besoin d'Êlaborer la lettre que j'ai reçue tout à l'heure. Elle
contient des reproches et des menaces, le tout très-gracieusement
arrangĂŠ comme vous savez faire. D'abord, je dois vous remercier de
votre franchise, et j'y rĂŠpondrai par une franchise ĂŠgale. Pour
commencer par les reproches, je trouve que vous faites une grosse
affaire pour pas grand'chose. C'est en rĂŠflĂŠchissant sur les faits et
en les grossissant par vos rĂŠflexions que vous ĂŞtes parvenue Ă faire de
ce que vous appelez vous-mĂŞme des _frivolitĂŠs, a star chamber matter._
Il n'y a qu'un point qui vaille la peine d'une explication. Vous me
parlez de _prĂŠcĂŠdents_, et vous avez l'air de croire que je travaille
Ă ĂŠtablir des prĂŠcĂŠdents avec la patience et le machiavĂŠlisme d'un
vieux ministre. Ayez un peu de mĂŠmoire et vous verrez que rien n'est
plus faux. S'il fallait argumenter d'après les prÊcÊdents, j'aurais
citÊ celui du salon de la rue Saint-HonorÊ la première fois que je vous
revis; puis notre première visite au Louvre, qui faillit me coÝter un
Ĺil. Tout cela vous paraissait assez simple alors; maintenant, c'est
autre chose. Vous avez dĂť voir que je fais quelquefois ce qui me vient
en tête, que j'y renonce dès que j'ai la conviction que cela vous
dĂŠplaĂŽt, et que beaucoup plus souvent je me borne Ă penser au lieu de
faire. En voilĂ assez sur les reproches et les prĂŠcĂŠdents.
Quant aux menaces, croyez qu'elles me sont très-sensibles. Cependant,
bien que je les craigne fort, je ne puis m'empĂŞcher de vous dire
encore tout ce que je pense. Rien ne me serait plus facile que de vous
faire des promesses, mais je sens qu'il me serait impossible de les
tenir. Contentez-vous donc de notre manière d'être passÊe, ou bien ne
nous voyons plus. Je dois même vous dire que l'insistance et l'espèce
d'acharnement que vous mettez Ă me contrarier pour ces _frivolitĂŠs_ me
les rendent plus chères et m'y font attacher une importance nouvelle.
C'est la seule preuve que vous puissiez me donner des sentiments que
vous pouvez avoir pour moi. S'il faut vous voir pour rĂŠsister aux
tentations les plus innocentes, c'est un travail de saint qui dĂŠpasse
mes forces. J'aurais sans doute beaucoup de plaisir Ă vous voir, mais
la condition de me transformer en statue, comme ce roi des _Mille et
une Nuits_, m'est insupportable.
Nous venons de nous expliquer très-clairement l'un et l'autre. Vous
dÊciderez suivant votre sagesse si nous devons ajourner notre première
promenade Ă quelques annĂŠes ou au premier soleil. Vous voyez que je
n'accepte pas le conseil d'hypocrisie que vous me donnez. Vous saviez
d'avance que cela m'ĂŠtait impossible. La seule hypocrisie dont je sois
capable, c'est de cacher aux gens que j'aime tout le mal qu'ils me
font. Je puis soutenir cet effort quelque temps, mais toujours, non.
Quand vous recevrez cette lettre, il y aura huit jours que nous ne nous
serons vus. Si vous persistez dans vos menaces, ĂŠcrivez-moi tout de
suite. Ce sera de votre part une attention de bontĂŠ dont je vous saurai
grĂŠ.
XLII
Janvier 1843.
Je ne m'ĂŠtonne plus que vous ayez appris l'allemand si bien et si
vite: c'est que vous possĂŠdez le gĂŠnie de cette langue, car vous
faites en français des phrases dignes de Jean-Paul; par exemple,
lorsque vous dites: ÂŤMa maladie est une impression de bonheur qui est
presque une souffrance! prosaïquement, j'espère que cela veut dire:
ÂŤJe suis, guĂŠrie et je n'ĂŠtais pas bien malade.Âť Vous avez raison de
me gronder de n'avoir pas assez d'ĂŠgards pour les malades; je me suis
bien reprochĂŠ de vous avoir fait marcher, de vous avoir permis de vous
asseoir longtemps Ă l'ombre. Quant au reste, je n'ai pas de remords,
ni vous non plus, j'espère. Moi, je n'ai pas de souvenirs distincts,
contre mon habitude. Je suis comme un chat qui se lèche longtemps la
moustache quand il a bu du lait. Convenez que le repas dont vous parlez
quelquefois avec admiration, que le _kĂŞf_ mĂŞme, qui est supĂŠrieur
Ă ce qu'il y a de mieux en ce genre, n'est rien en comparaison du
bonheur ÂŤqui est presque une souffranceÂť. Il n'y a rien de pire que
la vie d'une huĂŽtre, voire mĂŞme d'une huĂŽtre qui n'est jamais mangĂŠe.
Vous prÊtendez me gâter, vous avez ÊtÊ tellement gâtÊe vous-même, que
vous vous entendez mal à gâter les autres. Votre triomphe, c'est de
les faire enrager; mais, en fait de compliments, vous m'en devriez,
je pense, pour la magnanimitĂŠ dont j'ai fait preuve en me laissant
rassurer par vous. Je m'admire moi-mĂŞme. Ainsi, au lieu de votre
sermon, dites-moi quelque chose de terrible Ă cette occasion, ou plutĂ´t
dites-moi toutes ces folies couleur de rose que vous dites si bien.
Vous m'avez fait recommencer mon voyage en Asie mieux que je ne l'ai
fait. La machine plus rapide que le chemin de fer est toute trouvĂŠe,
nous la portons tous les deux dans nos tĂŞtes. J'ai pris le ÂŤhintÂť,
et, depuis que j'ai reçu votre lettre, je suis allÊ avec vous à Tyr et
Ă Ăphèse; nous avons grimpĂŠ ensemble dans la belle grotte d'Ăphèse.
Nous nous sommes assis sur de vieux sarcophages et nous nous sommes dit
toute sorte de choses. Nous nous sommes querellĂŠs et raccommodĂŠs; tout
a ĂŠtĂŠ comme dans cette prairie l'autre jour. Seulement, il n'y avait
pour nous voir que de grands lÊzards très-inoffensifs quoique forts
laids. Je ne puis pas mĂŞme, _in the mind's eye_, vous voir aussi tendre
que je voudrais; mĂŞme Ă Ăphèse, je vous vois un peu boudeuse et abusant
de ma patience.
Vous me parliez l'autre jour de surprise que vous me feriez;
franchement, comment voulez-vous que j'y croie? Tout ce que vous pouvez
faire c'est de cĂŠder quand vous ĂŞtes Ă bout de mauvaises raisons. Mais
comment inventerez-vous de vous-mĂŞme de donner, quand vous avez le
gĂŠnie du refus? Je suis bien sĂťr, par exemple, que vous n'imaginerez
jamais de me proposer un jour pour nous promener. Voulez-vous lundi ou
mardi? Le ciel me donne des inquiĂŠtudes; cependant, je compte sur votre
bon dĂŠmon, comme disaient les Grecs. Ă ce propos, je veux vous apporter
un passage d'une tragĂŠdie grecque que je vous traduirai littĂŠralement,
et vous m'en direz votre avis. Je crois que la comĂŠdie espagnole
est restĂŠe quelque part, entre l'endroit de la Tamise oĂš nous avons
dĂŠbarquĂŠ et celui oĂš nous nous sommes rembarquĂŠs. Je vous en apporterai
une autre. Mais, comme je tiens Ă ce que vous lisiez l'histoire du
comte de Villa-Mediana, je vous chercherai le petit poème du duc de
Biron. Adieu; n'ayez pas de secondes pensĂŠes et donnez-moi une place
dans les premières. Vous savez pour moi quelles sont les unes et les
autres. Faites-moi penser Ă vous conter une histoire de somnambule que
je voulais vous dire l'autre jour.
XLIII
Paris, 21 janvier 1843.
Vous êtes bien aimable et je vous remercie de votre première lettre,
qui m'a fait encore plus de plaisir que la seconde, laquelle sent un
peu les seconds mouvements. Elle a du bon cependant. Mais ĂŠcrivez donc
plus lisiblement l'allemand. J'ai bien besoin des commentaires que
vous m'offrez, commentaires verbaux s'entend, ce sont les meilleurs.
D'abord, j'ai lu _heilige Empfindung_, puis je crois qu'il faut lire
_selige._ Mais il y a deux sens. Est-ce sentiment de bonheur ou
sentiment passĂŠ, mort; feu sentiment? Si je vous avais vue ĂŠcrivant,
j'aurais probablement devinĂŠ Ă votre expression ce que vous vouliez
dire. Double coquetterie de votre part, coquetterie d'ĂŠcriture,
coquetterie d'obscuritĂŠ. HĂŠlas! vous me croyez plus savant que je ne
suis en matière de toilette. J'ai cependant mes idÊes très-arrêtÊes
sur ce point; je vous les soumettrai, si bon vous semble; mais je ne
comprends pas la plupart des belles choses qu'il faut admirer, Ă moins
qu'on ne me les dĂŠmontre; vous m'expliquerez et je comprendrai tout
de suite, je vous assure. Mais quand et comment? ces deux questions
me prĂŠoccupent autant que votre pourquoi et pour qui! N'avez-vous pas
regrettĂŠ un peu les beaux jours passĂŠs au soleil de printemps? Aucun
danger pour les merveilles de bottines! Si vous me dites que vous y
avez pensĂŠ et que vous y pensez, vous me ferez prendre patience; mais
il faudra plus que penser, il faudra rĂŠsoudre. Je n'ai nulle envie de
vous rappeler vos promesses; car j'espère que vous ajouterez à votre
bonne foi à les remplir de bonne grâce, de ne pas les faire trop
attendre. J'ai ĂŠtĂŠ tellement consternĂŠ par cette averse et ce qui
s'ensuit, que je suis devenu tout confit en douceur et en abnĂŠgation de
moi-mĂŞme. J'ai maintenant assez de confiance en vous pour croire que
vous ne vous en prĂŠvaudrez pas pour devenir tyrannique. Vous y avez,
je crains, de grandes dispositions; ç'a ÊtÊ mon dÊfaut autrefois: je
dis la tyrannie, mais j'en suis corrigĂŠ, je m'en flatte. Adieu donc,
_dearest!_ Pensez donc un peu Ă moi.
XLIV
27 janvier 1843.
Voici ce qui m'est arrivÊ. J'Êtais très-souffrant ce matin, et j'ai ÊtÊ
obligĂŠ de sortir pour affaires de mon commerce; je suis rentrĂŠ vers
cinq heures assez furieux, et je me suis endormi devant mon feu en
fumant un cigare et en lisant le docteur Strauss. Or, il me semblait
que j'ĂŠtais dans le mĂŞme fauteuil, mais lisant ĂŠveillĂŠ, lorsque vous
êtes entrÊe et m'avez dit: N'est-ce pas que c'est la manière la plus
simple de nous voir?--Pas trop bonne,Âť disais-je, car il me semblait
qu'il y avait deux ou trois personnes dans la chambre. Cependant, nous
causions comme si de rien n'ĂŠtait; sur quoi, je me suis ĂŠveillĂŠ, et
j'ai trouvĂŠ qu'on m'apportait une lettre de vous. Voyez comme il fait
bon dormir! Je ne crois pas vous avoir ĂŠcrit rien de mĂŠchant, et, par
consĂŠquent, je n'ai pas de pardon Ă vous demander. Ce serait plutĂ´t
Ă vous de le faire, et vous le faites avec si peu de contrition et
tant d'ironie, que je vois bien que vous avez perdu cette vĂŠnĂŠration
dont autrefois vous m'honoriez. Je ne puis rester cependant en colère
contre vous, malgrĂŠ mes rĂŠsolutions, et je me rĂŠsigne Ă ĂŞtre encore
votre victime; mais n'abusez pas de ma magnanimitĂŠ. Cela ne serait ni
beau ni gĂŠnĂŠreux. Vous parlez de soleil et vous m'y renvoyez, c'est
presque comme aux kalendes grecques; probablement nous en aurons des
nouvelles au mois de juin; mais faut-il attendre jusque-lĂ ? Il est vrai
que vous ĂŞtes _escarmentada_ du temps nĂŠbuleux. Mais, en prenant nos
prĂŠcautions, ne pourrions-nous pas profiter du premier temps tolĂŠrable?
Je ne voudrais pas que vous vous enrhumassiez Ă mon occasion. Mettez
vos bottes de sept lieues. Vous voir n'importe en quel costume, c'est
ce qui me fera toujours assez de plaisir. Quel est ce mal de cĂ´tĂŠ dont
vous parlez si lÊgèrement? Savez-vous que les fluxions de poitrine
commencent ainsi? Vous serez allĂŠe au bal et vous aurez eu froid en
sortant. Rassurez-moi bien vite, je vous prie. J'aimerais mieux vous
savoir _cross_ que malade. Si vous vous portez tout Ă fait bien, si
vous ĂŞtes en belle humeur, et qu'il fasse tant soit peu beau samedi,
pourquoi ne ferions-nous pas cette promenade? Nous pourrions nous faire
mener quelque part, loin des hommes, et marcher ensemble en causant.
Si vous ne pouvez ou ne voulez samedi, je ne me fâcherai pas; mais
tâchez au moins que ce soit bientôt. Quand je vous demande quelque
chose, vous ne le faites qu'après m'avoir fait enrager pendant si
longtemps, que vous m'empĂŞchez d'avoir autant de reconnaissance que je
devrais peut-ĂŞtre; et vous, en outre, vous vous Ă´tez tout le mĂŠrite
que vous auriez en ĂŠtant promptement gĂŠnĂŠreuse. Causer ensemble, et,
ce qui nous est arrivĂŠ quelquefois, penser ensemble, est-ce donc un
plaisir dont vous vous lassiez si vite? Il est vrai qu'on ne rĂŠpond
que pour soi, mais chacune de nos promenades a ĂŠtĂŠ pour moi plus
heureuse que la prĂŠcĂŠdente, par les souvenirs qu'elle m'a laissĂŠs.
J'en excepte la dernière, et celle-là , je voudrais l'effacer au plus
vite, pour la remplacer par une autre oĂš vous ne couriez pas le risque
d'ĂŞtre malade. Ainsi la paix est faite; j'attends vos ordres pour les
ratifications jeudi soir.
XLV
Paris, 3 fĂŠvrier 1843.
Ce beau temps ne vous fait-il donc pas penser Ă Versailles, et, par
consĂŠquent, ne vous donne-t-il pas envie de rire? Si vous aviez un peu
de logique, vous n'auriez point ri. En effet, vous n'ignorez pas que
Versailles est le chef-lieu du dĂŠpartement de Seine-et-Oise, qu'il
y a des autoritĂŠs chargĂŠes de protĂŠger le faible et qu'on y parle
français. En un tel pays, vous seriez aussi en sÝretÊ qu'à Paris.
De plus, le but que vous vous proposez, c'est de vous promener sans
rencontrer des badauds de votre connaissance. Ă Versailles, un jour que
le musĂŠe n'est pas ouvert, vous ĂŞtes sĂťre de ne trouver personne. Je
ne parle ni de l'air ni de la beautĂŠ des lieux, qui ont leur mĂŠrite et
qui influent toujours sur la nature des idĂŠes. Je suis persuadĂŠ, par
exemple, qu'à Versailles, vous n'auriez point eu cette colère rentrÊe
de l'autre jour; je vous en crois parfaitement guĂŠrie, car la fin de
votre lettre m'a paru de votre bon gĂŠnie. Le commencement sentait un
peu votre diable. Je vous Êcris en hâte. Je suis accablÊ de commissions
et je vais bien m'ennuyer. Pensez un peu à moi, et ne vous fâchez pas.
Ne riez pas trop en y pensant.
XLVI
Paris, 7 fĂŠvrier 1843.
Veuillez me permettre un calcul très-simple, et tout sera dit sur
Versailles. C'est donc très-difficile, une promenade d'une heure dans
un si beau jardin? Or, ce jour de grand brouillard, n'avons-nous pas
passĂŠ deux heures au musĂŠe ensemble? J'ai dit.
Vous me faites rire avec les commissions qu'on me donne, Ă ce que vous
supposez. Bien que celles-ci ne me manquent pas, les commissions dont
je vous parlais sont des rĂŠunions oĂš plusieurs personnes ne font pas
la besogne que ferait un seul beaucoup mieux. Ne croyez pas ĂŞtre la
seule qui fasse des commissions. J'ai couru tout Paris pour acheter des
robes et des chapeaux, et, mercredi, j'ai rendez-vous pour commander
un costume de bergère rococo. Tout cela pour les deux filles de madame
de M ***. Conseillez-moi. Quel costume doivent-elles avoir pour un bal
travesti? Une Ăcossaise et une Cracovienne sont en route. J'ai une
bergère; il me faut encore un autre dÊguisement. Voici le signalement:
l'aÎnÊe est brune, pâle, un peu moins grande que vous, très-jolie,
expression gaie. L'autre est très-grande, très-blanche, prodigieusement
belle, avec les cheveux qu'aimait le Titien. J'en voudrais faire une
bergère avec de la poudre. Conseillez-moi pour l'autre.
Je me demande pourquoi vous me semblez si embellie, et je ne puis
trouver de rĂŠponse satisfaisante. Est-ce parce que vous avez l'air
moins effarouchÊ? Cependant, la dernière fois, vous me faisiez penser
Ă un oiseau qu'on vient de mettre en cage. Vous m'avez vu trois mines,
je ne vous en connais que deux. L'effarouchement est une sorte de dĂŠpit
radieux que je n'ai vu qu'Ă vous.
Vous m'accusez Ă tort d'ĂŞtre mondain; depuis quinze jours, je ne suis
sorti qu'une fois le soir pour faire une visite Ă mon ministre. J'ai
trouvĂŠ toutes les femmes en deuil, plusieurs avec des mantilles; non,
des barbes noires qui les font ressembler Ă des Espagnoles; cela m'a
paru fort joli. Je suis d'une tristesse et d'une maussaderie ĂŠtranges.
Je voudrais bien vous chercher querelle, mais je ne sais sur quoi. Vous
devriez m'Êcrire des choses très-aimables et très-senties, je tâcherais
de me figurer votre mine en les ĂŠcrivant, et cela me consolerait.
Mon roman vous amuse-t-il? Lisez la fin du deuxième volume: _M.
Yellowplush._--C'est une assez bonne charge, Ă ce qu'il me semble.
Adieu, ĂŠcrivez-moi bientĂ´t.
Je rouvre ma lettre pour vous prier de remarquer que le temps a l'air
de se rassĂŠrĂŠner.
XLVII
Paris, dimanche 11 fĂŠvrier 1843.
Je ne sais trop si je dois croire pieusement tout ce que vous me dites,
dans votre lettre, de votre indisposition et des affaires qui vous
retiennent. Au milieu de toutes les choses aimables que vous me dites,
je crois que vous n'avez guère envie de me voir. Me trompÊ-je, ou bien
est-ce que je suis si peu habituĂŠ Ă vos douceurs, que je ne puis les
croire vraies? Mardi, serez-vous guĂŠrie? serez-vous libre? serez-vous
d'aussi bonne humeur que mercredi passÊ? Hier, dans l'après-midi, il
a fait un temps superbe; peut-ĂŞtre serons-nous autant favorisĂŠs mardi
prochain, si mon baromètre ne m'abuse. J'ai quelque chose pour vous qui
vous paraĂŽtra fort bĂŞte peut-ĂŞtre. Depuis que je ne vous ai vue, j'ai
beaucoup couru le monde, et fait quantitĂŠ de bassesses acadĂŠmiques.
J'en avais perdu l'habitude, et cela m'a fort coĂťtĂŠ; mais je crois
que je m'y referai assez vite. Aujourd'hui, j'ai vu cinq illustres
poètes ou prosateurs, et, si la nuit ne m'eÝt surpris, je ne sais si je
n'aurais pas achevĂŠ tout d'un trait mes trente-six visites. Le drĂ´le,
c'est quand on rencontre des rivaux. Plusieurs vous font des yeux Ă
vous manger tout cru. Je suis, au fond, excĂŠdĂŠ de toutes ces corvĂŠes,
et je serais heureux de tout oublier pendant une heure avec vous.
XLVIII
11 fĂŠvrier 1843.
Cette neige ne se charge-t-elle pas toute seule de dire non, sans
que vous vous en mĂŞliez? Cela devrait vous guĂŠrir de cette mauvaise
habitude de nĂŠgation. Le diable est bien assez mĂŠchant sans que vous
alliez sur ses brisĂŠes. J'ai beaucoup souffert la nuit passĂŠe. J'ai eu
la fièvre et des Êlancements très-douloureux. Ce soir, je vais assez
bien. Il me semble que, dans votre billet, vous cherchez le moyen de
me faire quelque querelle sur notre promenade. Qu'a-t-elle eu de si
malheureux, si vous ne vous ĂŞtes pas enrhumĂŠe? et je vous ai fait
marcher si vite, que je n'en ai guère d'inquiÊtude. Vous aviez un air
de santĂŠ et de force qui faisait plaisir Ă voir. Et puis vous perdez
peu Ă peu quelque chose de votre contrainte. Vous gagnez de tout
point Ă ces promenades, sans parler de la variĂŠtĂŠ de connaissances
archĂŠologiques que vous acquĂŠrez, sans vous en donner la peine. Vous
voilà dÊjà passÊe maÎtresse en matière de vases et de statues. Chaque
fois que nous nous rencontrons, il y a une croĂťte de glace Ă rompre
entre nous. Je trouve qu'au bout d'un quart d'heure seulement nous
reprenons notre dernière causerie au point oÚ nous l'avions laissÊe.
Mais, si nous nous voyions plus souvent, sans doute il n'y aurait plus
de glace du tout. Que prĂŠfĂŠrez-vous, la fin ou le commencement de nos
rencontres?
Vous ne m'avez pas remerciĂŠ de ne pas vous avoir dit un mot de
Versailles. J'y ai pensĂŠ souvent, je vous jure. J'avais quelque chose
Ă vous montrer que j'ai oubliĂŠ. C'est de l'_auld langsyne._ Voyons,
devinez si vous pouvez. J'oublie en vous voyant ce que je voulais dire;
j'ai notĂŠ un sermon Ă vous faire Ă l'endroit de vos jalousies de votre
frère: de la façon dont je conçois votre rĂ´le de sĹur, vous devriez
souhaiter à votre frère quelque belle et bonne passion. Remarquez que
vous ne pourrez jamais rien empĂŞcher, et que, si vous ne devenez pas
confidente heureuse, ou du moins rĂŠsignĂŠe, vous ĂŞtes prĂŠdestinĂŠe Ă
devenir Êtrangère. Adieu. Mon doigt me fait un mal de chien, mais on me
dit que c'est bon signe. Je vais penser Ă vos pieds et Ă vos mains pour
faire diversion. Vous n'y pensez guère, je crois.
XLIX
17 fĂŠvrier 1843.
Que j'aie ĂŠtĂŠ injuste envers vous, cela est possible et je vous
en demande pardon; mais vous ne vous mettez pas assez Ă ma place;
et, parce que vous ne sentez pas comme moi, vous voudriez, ce qui
est impossible, que je ne sentisse qu'à votre manière. Peut-être
devriez-vous me savoir plus de grĂŠ que vous ne faites de tous mes
efforts pour vous ressembler. Je ne comprends rien Ă la mine que vous
m'avez faite aujourd'hui. Au reste, Ă ne s'attacher qu'Ă la lettre,
il y a longtemps que je vois que vous m'aimez mieux de loin que de
près. Mais ne parlons plus de cela maintenant. Je veux seulement vous
dire que je ne vous fais aucun reproche, que je ne suis pas mĂŠcontent
de vous, et que, si je suis triste quelquefois, vous ne devez pas
croire que je suis en colère. J'ai de vous une promesse, vous pensez
bien que je ne l'oublierai pas. Je ne sais si je vous la rappellerai.
Il n'y a rien que je dĂŠteste tant que les querelles, et assurĂŠment
il en faudrait une pour vous redonner de la mĂŠmoire. Rien de ce qui
vous fait de la peine ne me donnera de plaisir; ainsi, j'accepte le
programme que vous m'annoncez. Nous avons eu, en effet, une heureuse
inspiration l'autre jour. Quelle neige et quelle pluie! Quel chagrin si
vous m'aviez remis Ă aujourd'hui! Vous craignez toujours les premiers
mouvements; ne voyez-vous pas que ce sont les seuls qui vaillent
quelque chose et qui rĂŠussissent toujours? Le diable est lent, je
crois, de son naturel et se dĂŠcide toujours pour le plus long chemin.
Ce soir, je suis allĂŠ aux Italiens, oĂš je me suis assez amusĂŠ, bien
qu'on ait fait un succès de claqueurs à mon ennemie madame Viardot.
J'ai reçu des livres d'Espagne que j'attendais pour travailler Ă
quelque chose; en sorte que je suis assez in _high spirits_ pour le
moment. Je souhaite que vous pensiez un peu Ă moi, et surtout que
nous pensions ensemble. Adieu; je suis charmĂŠ que ces ĂŠpingles vous
plaisent. J'avais craint qu'elles ne vous eussent inspirĂŠ du mĂŠpris;
mais, malgrĂŠ le plaisir que j'aurais Ă vous les voir porter, ne mettez
pas le châle bleu la première fois. Vous avez dit avec beaucoup de
raison qu'il ĂŠtait trop voyant.
L
Paris, lundi soir, fĂŠvrier 1843.
Si je ne craignais de vous gâter, je vous dirais tout le plaisir que
m'ont causĂŠ votre lettre, la toute gracieuse promesse que vous me
faites, et surtout cette impatience de voir revenir le temps sec.
N'est-ce pas une grande folie de votre part de vouloir prendre des
termes fixes pour nos promenades, comme si nous pouvions jamais ĂŞtre
assurĂŠs d'un jour? N'avais-je pas bien raison de dire: le plus souvent
que vous pourrez? Il faut toujours supposer, quand il y aura du beau
temps pendant deux jours, qu'il pleuvra deux mois de suite après.
Qu'importe, si, au bout de l'annĂŠe, nous nous trouvons en avance de
quelques jours de promenade? Votre lettre est, en effet, toute de
premier mouvement; c'est pour cela que je l'aime tant. Je crains
seulement que vous n'ayez de si bonnes dispositions que parce que nous
ne pouvons en profiter. Cependant, vos bonnes promesses me rassurent
un peu, et vous auriez trop de reproches Ă vous faire si vous ne les
teniez pas. Vous m'avez fait venir toute sorte de pensĂŠes, l'autre
soir aux Italiens, avec votre costume couleur d'arc-en-ciel. Mais vous
n'avez pas besoin de coquetterie avec moi. Je ne vous aime pas mieux en
arc-en-ciel qu'en noir...
En vĂŠritĂŠ, avez-vous ĂŠtĂŠ furieuse contre moi par rĂŠflexion? Alors, ce
serait un premier mouvement qui aurait ĂŠtĂŠ mauvais pour moi l'autre
jour, et cela me ferait peine et plaisir. Je saurai lequel des deux en
vous voyant.
Je connais la superstition des couteaux et des instruments tranchants,
mais point celle des piquants. J'aurais cru, au contraire, que cela
signifiait attachement, et c'est cela peut-ĂŞtre qui m'a fait choisir
les ĂŠpingles. Vous rappelez-vous que vous n'avez pas voulu me laisser
ramasser les vĂ´tres chez madame de P...? J'ai cela encore sur le cĹur
avec bien d'autres griefs contre vous. Je vous les pardonne tous
aujourd'hui, mais je les retrouverai aussi rĂŠvoltants lorsque vous y
en aurez ajoutĂŠ d'autres. C'est un grand malheur que de ne pouvoir
oublier. J'ĂŠcris aujourd'hui comme un chat, je ne puis encore tailler
ma plume, et je ne sais si vous pourrez lire mon griffonnage. Il est
presque aussi intelligible que ce que vous ĂŠcrivez en blanc. Je suppose
que vous allez fort dans le monde ce carnaval. En rangeant ma table,
je m'aperçois que je ne suis point allÊ à un bal chez le directeur de
l'OpĂŠra. OĂš est le bon temps oĂš j'y prenais plaisir? Maintenant, tout
cela m'ennuie horriblement. Ne vous semblĂŠ-je pas bien vieux?
Le temps a l'air de vouloir se remettre, mais je n'ose rien dire. J'ai
jurĂŠ de vous laisser toute libertĂŠ.--ThĂŠodore Hook est mort. Avez-vous
lu _Ernest Maltravers_ et _Alice_, de Bulwer? Il y a des tableaux
charmants d'amour jeune et d'amour vieux. Je les ai tous les deux Ă
votre service.
LI
Jeudi soir, fĂŠvrier 1843.
Je cherche vainement dans vos dernières paroles quelque chose qui me
soulage en m'irritant contre vous, car la colère serait un soulagement
pour moi. J'ai brĂťlĂŠ votre lettre, mais je me la rappelle trop bien.
Elle Êtait très-sensÊe, peut-être trop, mais très-tendre aussi.
Depuis huit jours, j'ai tant d'envie de vous revoir, que j'en viens
Ă regretter nos querelles mĂŞmes. Je vous ĂŠcris, savez-vous pourquoi?
C'est que vous ne me rÊpondrez pas et que cela me mettra en colère, et
tout vaut mieux que le dĂŠcouragement oĂš vous m'avez laissĂŠ. Rien n'est
plus absurde, nous avons eu parfaitement raison de nous dire adieu.
Nous comprenons si bien l'un et l'antre les choses raisonnables, que
nous devrions agir le plus raisonnablement du monde. Mais il n'y a de
bonheur, Ă ce qu'il paraĂŽt, que dans les folies et surtout dans les
rĂŞves. Ce qu'il y a d'ĂŠtrange, c'est que je n'ai jamais cru, sinon
cette fois, Ă la persistance de nos querelles. Mais il y a dix jours
que nous nous sommes sÊparÊs d'une manière presque solennelle qui m'a
effrayĂŠ. Ătions-nous plus irritĂŠs que d'ordinaire, plus clairvoyants?
nous aimions-nous moins? Il y avait certainement entre nous, ce
jour-lĂ , quelque chose que je ne me rappelle pas distinctement, mais
qui n'avait jamais existÊ. Les petits accidents viennent après les
grands. En mĂŞme temps que je vous disais adieu, mon cousin changeait
son jour aux Italiens, et je pense que je ne vous y rencontrerai plus
le jeudi. Je me rappelle aussi que vous avez dit prophĂŠtiquement que je
vous oublierais pour l'AcadĂŠmie, et c'est devant l'AcadĂŠmie que nous
nous sommes quittÊs. Tout cela est fort bête, mais cela m'obsède, et je
meurs d'envie de vous revoir, ne fĂťt-ce que pour nous quereller.
Vous enverrai-je cette lettre? je ne sais trop. Hier, je suis allĂŠ, sur
la foi d'un vers grec, Ă Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous rappelez-vous
quand nous nous devinions toujours?
Adieu; rĂŠpondez-moi. Je me sens un peu soulagĂŠ pour vous avoir ĂŠcrit.
LII
Jeudi matin, fĂŠvrier 1843.
HĂŠlas! oui, c'est ce pauvre Sharpe[1] qui vient d'ĂŞtre frappĂŠ d'une
façon si soudaine et si cruelle. Je suis sans nouvelles de lui depuis
le 5; si vous connaissez quelqu'un Ă Londres qui puisse m'en donner de
certaines, veuillez lui ĂŠcrire, et savoir quel est son ĂŠtat, quelles
espĂŠrances restent encore. Peut-ĂŞtre connaĂŽtriez-vous sa sĹur. Je
suppose que c'est chez elle que vous l'avez vu. MalgrĂŠ vous-mĂŞme, les
seconds mouvements ne paraissent que trop dans votre lettre. Il y a
cependant de ces petites phrases tout aimables qui vous ĂŠchappent Ă
votre insu. Vous vous donnez beaucoup de peine pour ĂŞtre mauvaise, et
vous n'y parvenez qu'Ă force d'application.
Avez-vous rĂŠflĂŠchi quelquefois comme c'est une invention admirable,
de mettre dans un beau palais des tableaux et des statues, et d'y
laisser promener le monde? Malheureusement, on va fermer ce beau lieu
pour y mettre de vilaines croĂťtes modernes. Cela ne vous fait-il
pas de la peine? Croyez-moi, allons faire nos adieux Ă toutes ces
vieilles statues. Le samedi est un jour admirable, car il n'y vient
que des Anglais peu gênants pour ceux qui aiment à regarder de près
les tableaux. Que vous semble de samedi, c'est-à -dire après-demain? Ce
sera le dernier samedi. Ce mot de dernier me fait de la peine. Ainsi
donc, Ă samedi. Vous me parlez de vos remords pour mon Ĺil. De quelle
espèce sont vos remords? l'accident pouvait s'Êviter de deux manières:
je pouvais ne pas compromettre mon Ĺil, vous pouviez le mĂŠnager.
C'est, je pense, pour le dernier fait que vous avez des remords, du
moins que vous devez en avoir eu avant les seconds mouvements. Si vous
ne m'ĂŠcrivez pas, je vous attendrai samedi Ă deux heures devant la
_Joconde_, à moins d'un temps horrible; mais il fera beau, je l'espère,
et, s'il survenait quelque contre-temps, ce serait assurĂŠment votre
faute.
Pourquoi vous servez-vous de papier si petit, et pourquoi
m'ĂŠcrivez-vous trois lignes seulement, dont deux pour me quereller?
Qu'importe que l'on vive plus vite, pourvu que l'on soit plus heureux!
N'est-ce pas quelque chose que d'avoir des souvenirs au lieu d'annĂŠes
de chrysalide dont on ne se souvient plus?
[1] M. Sutton Sharpe, avocat anglais très-distinguÊ.
LIII
Paris, fĂŠvrier 1843.
Il m'est arrivĂŠ bien souvent dans ma vie de faire en rechignant des
choses que j'ai ĂŠtĂŠ bien aise ensuite d'avoir faites. Je dĂŠsire
qu'il vous arrive comme Ă moi. Supposez que le contraire fĂťt arrivĂŠ:
n'auriez-vous pas ĂŠprouvĂŠ un peu d'impatience d'ĂŞtre venue seule?
N'auriez-vous pas eu, laissez-moi le croire, quelque inquiĂŠtude
de m'avoir fait de la peine? ConsidĂŠrez maintenant avec quelque
orgueil cette ĂŠtrange influence que deux fois vous avez eue sur ma
pensĂŠe et sur mes rĂŠsolutions. Tout le mal, c'est d'avoir eu un peu
d'incertitude. N'admirez-vous pas comme moi cette ĂŠtrange coĂŻncidence
(je ne dirai pas sympathie, pour ne pas vous dĂŠplaire) de nos pensĂŠes?
Vous rappelez-vous qu'autrefois nous fĂŽmes une expĂŠrience presque aussi
miraculeuse? et dernièrement encore, près d'un poêle dans le musÊe
espagnol, vous avez lu dans ma pensĂŠe aussi vite que je pensais. Il y a
longtemps que je soupçonne quelque chose de diabolique en vous. Je me
rassure un peu en pensant que j'ai vu vos deux pieds et que vous n'avez
pas le _cloven foot._ Pourtant, il se pourrait que, sous ces bottines,
vous m'eussiez cachÊ une petite griffe. Tâchez donc de me rassurer.
Adieu. Voici le livre dont je vous ai parlĂŠ.
LIV
Paris, 9 fĂŠvrier 1843.
J'ĂŠtais inquiet de ne pas recevoir un mot de vous, non que je
craignisse _un second mouvement_, mais je vous croyais souffrante et je
me reprochais cette longue promenade et notre retour par le vent et la
pluie. Heureusement, c'est la poste qui a fait son dimanche et m'a fait
attendre votre lettre. Bien que je souffrisse beaucoup de ce retard,
je ne vous ai pas accusĂŠe un seul moment. Je suis bien aise de vous le
dire, pour que vous sachiez que je me corrige de mes dĂŠfauts en mĂŞme
temps que vous des vĂ´tres. Au revoir donc et Ă bientĂ´t. Je n'ai plus
mal Ă l'Ĺil. Le vĂ´tre, je pense, est toujours aussi brillant. Comme on
se fait des monstres de tout! N'aurions-nous pas eu tort de ne pas nous
ĂŞtre revus?
Je suis bien triste et tourmentĂŠ. Un de mes amis intimes, que je
voulais aller voir Ă Londres, vient d'ĂŞtre atteint de paralysie. Je ne
sais encore s'il vivra, ou, ce qui serait pire que la mort, s'il ne
demeurera pas longtemps dans cet affreux ĂŠtat d'insensibilitĂŠ oĂš cette
maladie rĂŠduit les esprits les plus distinguĂŠs. Je me demande si je ne
devrais pas aller le voir tout de suite.
Ăcrivez-moi, je vous prie, et dites-moi quelque chose de tendre qui me
fasse oublier ces tristes pensĂŠes.
LV
Paris, 27 fĂŠvrier 1843.
Nos lettres se sont croisĂŠes et j'ai ĂŠtĂŠ tranquillisĂŠ plus tĂ´t que je
n'espĂŠrais. Je vous en remercie. Votre lettre m'a fait grand plaisir
par ce qu'elle me dit, quoique en style fort ĂŠnigmatique. Ce verbe que
vous redoutez si fort a toujours un son bien doux, mĂŞme quand il est
accompagnĂŠ de tous ces adverbes dont vous savez si bien l'entortiller.
Moquez-vous de ma tristesse et de la mine que je faisais sur les
ruines de Carthage. Marius, assis comme nous, rĂŞvait peut-ĂŞtre qu'il
rentrerait dans Rome, et moi, je ne voyais guère d'espÊrance dans mon
avenir. Vous m'effrayez, chère amie, en me disant que vous n'osez plus
ĂŠcrire et que vous aurez plus de courage pour parler. Lorsque nous
sommes ensemble, c'est le contraire que vous dites. N'en rĂŠsultera-t-il
pas que vous ne me parlerez plus et que vous ne m'ĂŠcrirez plus? Vous
ĂŠtiez fâchĂŠe contre moi, m'avez-vous dit. Ătait-ce bien juste de votre
part et l'avais-je mĂŠritĂŠ? N'avais-je pas votre promesse et aussi un
peu votre exemple? En ĂŞtes-vous restĂŠe aveugle? Avez-vous conservĂŠ un
souvenir dĂŠsagrĂŠable? Ătes-vous encore fâchĂŠe? VoilĂ ce que je voudrais
savoir et ce que vous ne me direz sans doute pas.
Je commence Ă vous savoir par cĹur, et je crois que c'est ce qui
m'attriste souvent. Il y a en vous un mĂŠlange d'oppositions et de
contradictions si ĂŠtrange, qu'il y a pour faire enrager un saint. . .
. . . . . . . . . . . .
J'ai appris hier une bien triste nouvelle. Le pauvre Sharpe est mort
mercredi dernier. J'ai reçu la nouvelle de sa mort au moment oÚ je
le croyais non-seulement hors de tout danger, mais sur le point de
reprendre ses occupations ordinaires. Je ne m'accoutume pas Ă l'idĂŠe
de ne plus le voir. Ilme semble que, si j'allais Ă Londres, je le
retrouverais. . . . . . .
LVI
Jeudi soir, 1er mars 1843.
J'avais bien peur de ne pouvoir vous voir samedi, et je me promettais
de vous bien gronder pour n'avoir pas voulu l'autre jour. Mais je suis
parvenu Ă me dĂŠbarrasser de tous les empĂŞchements. Ă samedi donc. Il y
a bien longtemps que nous n'avons eu de querelle. Ne trouvez-vous pas
que cela est bien doux et bien prÊfÊrable à nos colères d'autrefois,
qui n'avaient de bon que les raccommodements? Je vous trouve toujours
cependant un dĂŠfaut: c'est de vous rendre si rare. Ă peine nous
voyons-nous une fois en quinze jours. Chaque fois, il semble qu'il
y ait une glace nouvelle Ă rompre. Pourquoi ne vous retrouvĂŠ-je pas
telle que je vous ai quittĂŠe? Si nous nous voyions plus souvent, cela
n'arriverait pas. Je suis pour vous comme un vieil opĂŠra que vous
avez besoin d'oublier pour le revoir avec quelque plaisir. Moi, au
contraire, il me semble que je vous aimerais davantage vous voyant
tous les jours. Montrez-moi que j'ai tort, et dites-moi un jour bien
proche pour nous revoir. C'est le 14 mars que mon sort se dĂŠcide Ă
l'AcadĂŠmie. Le raisonnement me dit d'espĂŠrer, mais je ne sais quel
sentiment de seconde vue me dit tout le contraire.--En attendant, je
fais des visites fort consciencieusement. Je trouve des gens fort
polis, fort accoutumÊs à leurs rôles et les prenant très au sÊrieux; je
fais de mon mieux pour prendre le mien aussi gravement, mais cela m'est
difficile. Ne trouvez-vous pas drĂ´le qu'on dise Ă un homme: ÂŤMonsieur,
je me crois un des quarante hommes de France les plus spirituels, je
vous vaux bien,Âť et autres facĂŠties? Il faut traduire cela en termes
honnĂŞtes et variĂŠs, suivant les personnes. VoilĂ le mĂŠtier que je fais
et qui m'ennuierait fort s'il se prolongeait. Le lĂ correspond aux ides
de mars, jour de la mort de mon hĂŠros, feu CĂŠsar. Cela est _ominous_,
n'est-ce pas?
LVII
Paris, vendredi matin, 13 mars 1843.
Voici votre cravate. Elle s'est retrouvĂŠe samedi dernier dans
l'antichambre de Son Altesse royale monseigneur le duc de Nemours.
Personne ne m'a demandĂŠ d'explications de sa prĂŠsence dans ma poche.
Je vous l'aurais envoyĂŠe plus tĂ´t si je n'avais voulu ajouter le dĂŠsir
de retrouver votre propriĂŠtĂŠ Ă celui de me donner de vos nouvelles. Je
constate que, bien que le premier soit très-vif, il n'a pu triompher de
l'indiffĂŠrence que vous avez sur le second point. Pourquoi avez-vous si
grand'peur du froid? Il me semble que nous avons fait une fois un essai
de neige qui n'a pas trop mal rĂŠussi. Voici le dĂŠgel qui va rendre les
rues impraticables pour je ne sais combien de temps. RĂŠpondez-moi vite.
Je vois avec peine que vous aimez Ă tourmenter. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
LVIII
Paris, 11 mars 1843.
C'est une grosse faute et presque un crime que de ne pas profiter du
temps admirable qu'il fait. Que diriez-vous d'une grande promenade pour
demain jeudi? Vous deviez m'avertir la première, mais vous vous en
gardez bien. Il faut absolument que nous allions saluer les premières
feuilles. Elles poussent Ă vue d'Ĺil. Je pense aussi Ă l'influence
que le soleil exerce sur votre humeur, Ă ce que vous m'avez dit. Je
voudrais en faire l'ĂŠpreuve. Moi, je vous aime dans tous les temps;
mais je crois que le bonheur de vous voir est plus bonheur avec du
soleil. Adieu.
LIX
Paris, samedi soir, mars 1843.
Pas la moindre trace de repentir dans votre lettre. Je regrette la
pipe ambrĂŠe que vous aviez choisie. Il y avait quelque chose de
particulièrement agrÊable à porter souvent à ma bouche un don de vous.
Mais soit fait ainsi que vous voulez; c'est ce que je dis fort souvent,
et toujours sans que ma rĂŠsignation me profite.
Je suis complètement abruti par le mÊtier que je fais. La cathÊdrale
me pèse de tout son poids sur les Êpaules, sans compter l'espèce de
responsabilitÊ que j'ai acceptÊe dans un moment de zèle dont je me
repens fort aujourd'hui. J'envie beaucoup le sort des femmes, qui
n'ont rien à faire qu'à tâcher de se faire belles, et prÊparer l'effet
qu'elles veulent produire sur les autres. Les autres, cela me semble
un vilain mot, mais je crois qu'il vous prĂŠoccupe plus que moi. Je
suis très en colère contre vous, sans bien en savoir la cause; mais il
doit y en avoir une très-rÊelle, car je ne saurais avoir tort. Il me
semble que tous les jours vous ĂŞtes plus ĂŠgoĂŻste. Dans _nous_, vous ne
cherchez jamais que vous. Plus je retourne cette idĂŠe, plus elle me
paraĂŽt triste.
Si vous n'avez pas ĂŠcrit pour ce livre Ă Londres, n'ĂŠcrivez pas; il
est absurde de charger une femme de semblable commission. Bien que je
tienne beaucoup Ă un livre rare, je ne voudrais pas que vous pussiez
causer l'ombre d'un ĂŠtonnement en le demandant. L'ĂŠditeur du livre
est un quaker très-vertueux, dit-on, lequel aurait eu un peu tard des
preuves que les catholiques espagnols du XVe siècle Êtaient des gens
sans moralitĂŠ, malgrĂŠ l'Inquisition, et peut-ĂŞtre Ă cause d'elle.
L'exemplaire original et unique a coĂťtĂŠ quinze cents livres sterling.
Il a cent et quelques pages. J'ai eu tort de vous en parler et plus
tort de rĂŠflĂŠchir si tard Ă l'ĂŠnormitĂŠ de la chose. Adieu . . .
. . . . . . . . . . . .
Voici la lettre que j'allais vous faire porter quand j'ai reçu la
vĂ´tre. J'ai ĂŠtĂŠ tellement occupĂŠ par mes rapports et mes enquĂŞtes, que
je n'ai pu vous ĂŠcrire plus tĂ´t. Je vous proposais une promenade mardi,
Ă condition que nous aurions une heure de plus. Dites-moi si vous
ĂŞtes libre mardi. Votre distraction est fort jolie, mais y suis-je pour
quelque chose? _That is the question._ Quels pardons avez-vous Ă me
demander? vous ne sentez pas ce que je sens. Nous sommes si diffĂŠrents,
qu'Ă peine pouvons-nous nous comprendre. Tout cela n'empĂŞche pas que
j'aurai grand plaisir Ă vous voir et que je vous remercie de votre
dernière lettre, qui est très-aimable. Vous ne m'avez pas dit oÚ vous
alliez Ă la campagne, ni quand vous partiez. J'irai Ă Rouen dans
quelques jours.
Adieu encore; j'espère vous voir mardi, j'espère que vous serez en
belle humeur et moi moins triste que je ne suis aujourd'hui.
LX
Jeudi soir, 15 mars 1843.
Cela m'a fait un sensible plaisir[1], d'autant plus que je m'attendais
Ă une dĂŠfaite. On m'apportait les bulletins Ă mesure qu'ils
s'Êlaboraient. Il me semblait impossible de rÊussir; ma mère, qui
souffrait depuis quelques jours d'un rhumatisme aigu, a ĂŠtĂŠ guĂŠrie du
coup.--J'en ai d'autant plus envie de vous voir. Essayez si je vous en
aime mieux ou moins, et cela le plus tĂ´t possible. Je suis harassĂŠ des
courses que j'ai faites, car il faut maintenant remercier, et remercier
amis et ennemis, pour montrer qu'on a de la grandeur d'âme. J'ai le
bonheur d'avoir ĂŠtĂŠ black-boulĂŠ par des gens que je dĂŠteste, car c'est
un bonheur que de n'avoir pas le fardeau de la reconnaissance Ă l'ĂŠgard
des personnes qu'on estime peu. Ăcrivez-moi, je vous prie, quand vous
voulez que nous nous voyions.
J'ai bien envie que nous fassions quelque longue promenade.
Vous êtes sorcière, en effet, d'avoir si bien devinÊ l'ÊvÊnement. Mon
Homère m'avait trompÊ, ou bien c'est à M. Vatout que s'adressait sa
prÊdiction menaçante.
Adieu, _dearest friend!_ Entre mes ĂŠpreuves Ă corriger, mon rapport
Ă faire, et un peu aussi le tracas que j'ai eu depuis trois jours,
je n'ai guère trouvÊ le temps de dormir. Je vais essayer.--J'aurais
d'assez drĂ´les d'histoires Ă vous conter des hommes et des choses.
[1] Sa nomination comme membre de l'AcadÊmie française.
LXI
17 mars 1843.
Je vous remercie bien de vos compliments, mais je veux mieux encore. Je
veux vous voir et faire une longue promenade. Je trouve cependant que
vous avez pris la chose trop au tragique. Pourquoi pleurez-vous? les
quarante fauteuils ne valaient pas une petite larme. Je suis excĂŠdĂŠ,
ÊreintÊ, dÊmoralisÊ et complètement _out of my wits._ Puis Arsène
Guillot fait un fiasco Êclatant et soulève contre moi l'indignation
de tous les gens soi-disant vertueux, et particulièrement des femmes
Ă la mode qui dansent la polka et suivent les sermons du P. Ravignan;
tant il y a que l'on dit que je fais comme les singes, qui grimpent au
haut des arbres et qui, arrivĂŠs sur la plus haute branche, font des
grimaces au monde. Je crois avoir perdu des voix par cette scandaleuse
histoire; d'un autre cĂ´tĂŠ, j'en gagne. Il se trouve des gens qui m'ont
black-boulĂŠ sept fois et qui me disent qu'ils ont ĂŠtĂŠ mes plus chauds
partisans. Ne trouvez-vous pas que cela vaut bien la peine de faire
ainsi le pĂŠchĂŠ de mensonge, surtout pour le grĂŠ que j'en sais aux gens?
Tout ce monde oĂš j'ai vĂŠcu presque uniquement depuis quinze jours me
fait dĂŠsirer avidement de vous voir. Au moins, nous sommes sĂťrs l'un
de l'autre, et, quand vous me faites des mensonges, je puis vous les
reprocher et vous savez vous les faire pardonner. Aimez-moi, quelque
vĂŠnĂŠrable que je sois devenu depuis bientĂ´t trois jours.
LXII
Lundi soir, 21 mars 1843.
Je suis très-triste et j'ai des remords de ma fureur d'aujourd'hui. La
seule excuse que j'y trouve, c'est que la transition entre notre halte
dÊlicieuse dans cette espèce d'oasis si Êtrange et notre promenade
a ĂŠtĂŠ trop brusquĂŠe, c'est tomber du ciel en enfer. Si je vous ai
affligÊe, j'en suis aussi repentant que possible, mais j'espère que
je ne vous ai pas fait autant de peine que j'en ressentais. Vous
m'avez souvent reprochĂŠ d'ĂŞtre indiffĂŠrent Ă tous; je suppose que vous
vouliez dire seulement que j'ĂŠtais peu dĂŠmonstratif. Lorsque je sors
de ma nature, c'est que je souffre beaucoup. Convenez aussi qu'il est
bien triste, après tant de temps passÊ ensemble, après être devenus
l'un pour l'autre ce que nous sommes, de vous voir toujours dĂŠfiante
pour moi. Le temps a ĂŠtĂŠ aujourd'hui comme notre humeur. Ce soir, le
voilĂ rĂŠtabli, je pense. Les ĂŠtoiles sont plus brillantes que jamais.
Organisons quelque course moins orageuse. Adieu, plus de querelles; je
tâcherai d'être plus raisonnable, tâchez d'être plus à vos premiers
mouvements.
LXIII
Mars 1843.
Moi, j'ĂŠtais fatiguĂŠ comme si j'avais fait quatre ou cinq lieues
Ă pied, mais d'une fatigue si agrĂŠable, que je voudrais la sentir
encore; tout nous a si bien rĂŠussi, que, bien que je sois accoutumĂŠ
Ă voir rĂŠussir un plan bien combinĂŠ, je partage votre ĂŠtonnement.
Ătre si libre et si loin du monde, et cela par les bienfaits de la
civilisation, n'est-ce pas amusant? Savez-vous pourquoi je n'ai pris
qu'une fleur de ces jacinthes si jolies et si blanches, c'est que je
voulais en garder pour une autre fois; qu'en dites-vous? D'ailleurs,
en regardant sur ma carte, j'ai vu que nous avions fait une faute de
gĂŠographie. Nous nous sommes trompĂŠs d'environ un quart de lieue; nous
devions aller plus loin; mais ne regrettons rien, une autre fois nous
ferons mieux. Pour une reconnaissance, tout n'a pas ĂŠtĂŠ mal. Vous avez
ĂŠtĂŠ surtout excellente. Vous ne m'apprenez rien en me disant que
vous m'avez rendu ce que je vous ai donnĂŠ; mais vous me faites presque
autant de plaisir en me le disant, car cela me prouve que vous ne
pensiez pas les cruelles choses que vous m'avez dites dans un de nos
jours nĂŠfastes. Je les oublie tout Ă fait aujourd'hui; oubliez aussi
mes colères et mes injures. Vous me demandez si je crois à l'âme.
Pas trop. Cependant, en rĂŠflĂŠchissant Ă certaines choses, je trouve
un argument en faveur de cette hypothèse, le voici: Comment deux
substances inanimĂŠes pourraient-elles donner et recevoir une sensation
par une rĂŠunion qui serait insipide sans l'idĂŠe qu'on y attache? VoilĂ
une phrase bien pĂŠdantesque pour dire que, lorsque deux gens qui
s'aiment s'embrassent, ils sentent autre chose que lorsqu'on baise
le satin le plus doux. Mais l'argument a sa valeur. Nous parlerons
mÊtaphysique, si vous voulez, la première fois. C'est un sujet que
j'aime beaucoup, car on ne peut jamais l'ĂŠpuiser. Vous m'ĂŠcrirez,
n'est-ce pas, avant lundi, en me disant oĂš nous nous trouverons? Il
faut ĂŞtre lĂ -bas Ă une heure, non Ă une demi-heure. Vous vous en
souviendrez; par consĂŠquent, il faut nous mettre en marche Ă une
demi-heure. Tout cela n'est-il pas clair?
Il est quatre heures et demie, et il faut que je me lève avant dix
heures.
LXIV
Lundi soir. Mars 1843.
Je commence, je crois, Ă comprendre votre ĂŠnigme. En rĂŠflĂŠchissant Ă ce
que vous m'avez dit aujourd'hui, j'arrive oĂš m'avait dĂŠjĂ conduit une
espèce de divination instinctive; assurÊment, mon plus grand ennemi ou,
si vous voulez, mon rival dans votre cĹur, c'est votre orgueil; tout ce
qui le froisse vous rĂŠvolte. Vous suivez votre idĂŠe, peut-ĂŞtre Ă votre
insu, dans les plus petits dĂŠtails. N'est-ce pas votre orgueil qui
est satisfait lorsque je baise votre main? Vous ĂŞtes heureuse alors,
m'avez-vous dit, et vous vous abandonnez Ă votre sensation parce que
votre orgueil se plaĂŽt Ă une dĂŠmonstration d'humilitĂŠ. Vous voulez que
je sois statue parce qu'alors vous ĂŞtes ma vie. Mais vous ne voulez pas
ĂŞtre statue Ă votre tour; surtout, vous ne voulez pas cette ĂŠgalitĂŠ de
bonheur donnÊ et reçu, parce que tout ce qui est ÊgalitÊ vous dÊplaÎt.
Que vous dirai-je Ă cela? que, si cet orgueil voulait se contenter
de ma soumission et de mon humilitĂŠ, il devrait ĂŞtre content; je lui
cĂŠderai toujours, pourvu qu'il laisse votre cĹur suivre ses bons
mouvements. Pour moi, je ne mettrai jamais sur une mĂŞme ligne mon
bonheur et mon orgueil, et, si vous vouliez me suggĂŠrer des formules
d'humilitĂŠ nouvelles, je les adopterais sans hĂŠsiter. Mais pourquoi
de l'orgueil, c'est-Ă -dire de l'ĂŠgoĂŻsme, entre nous? ĂŞtes-vous donc
insensible au plaisir de s'oublier l'un pour l'autre? Ce sentiment
d'amitiĂŠ si ĂŠtrange que nous ĂŠprouvons tous les deux quelquefois,
qui, ce matin par exemple, nous a amenĂŠs lĂ oĂš nous n'avions aucune
_raison_ d'aller, n'est-ce pas une puissance plus douce et plus vive
que toutes celles que vous pourrait donner votre dĂŠmon d'orgueil? Vous
avez ĂŠtĂŠ si aimable ce matin, que je ne veux ni ne peux vous quereller.
Je suis cependant d'une humeur affreuse. Je vous disais que j'allais
m'ennuyer Ă un dĂŽner. Figurez-vous que je me suis trompĂŠ de jour, que
j'ai mortellement contrariĂŠ des gens qui ne m'attendaient pas et qui
me l'ont bien rendu. J'ai passĂŠ ma soirĂŠe Ă regretter de n'ĂŞtre pas
seul chez moi avec mes souvenirs. Je m'attends Ă une mauvaise lettre
de vous. J'ai voulu vous ĂŠcrire le premier, car je serai furieux sans
doute après-demain. Vous me rendrez doux comme un mouton si vous
voulez. VoilĂ l'hiver revenu tout Ă fait. Comment avez-vous supportĂŠ le
froid de l'autre jour? celui-ci ne vous effraye-t-il pas? Je ne sais
si vous ferez bien de sortir demain; je crains la responsabilitĂŠ du
conseil, et j'aime mieux que vous dĂŠcidiez. VoilĂ encore de l'humilitĂŠ.
LXV
Vendredi, 29 mars 1843.
Je sens, par une de ces intuitions _of the mind's eye_, que le temps
sera beau encore pour quelques jours, mais qu'il se gâtera pour
longtemps. D'un autre cĂ´tĂŠ, notre promenade de l'_autre_ jour, ayant
ÊtÊ à peu près manquÊe, doit être considÊrÊe comme non avenue. Les ours
seuls en ont profitĂŠ. Je leur envie l'intĂŠrĂŞt que vous leur portez,
et j'ai le dessein de me faire faire un costume qui me donne une
partie de leurs charmes. Jusqu'Ă prĂŠsent, nous avons toujours marchĂŠ
de l'est au sud. Il me semble que nous pourrions essayer de la marche
contraire. Nous irions chercher d'abord notre barrière et le ruisseau
peu limpide qui coule auprès. Nous finirions par oÚ nous commençons
ordinairement. Le diable, c'est que j'ai Ă travailler dans ce moment
plus que d'ordinaire. Cependant, si vous pouviez samedi, Ă trois
heures, nous ferions notre voyage de dĂŠcouverte jusqu'Ă cinq heures et
demie; sinon, il faudrait ajourner Ă lundi, ce qui serait bien long. Si
vous saviez comme vous ĂŠtiez gentille l'autre jour, vous ne voudriez
jamais ĂŞtre taquine comme vous l'ĂŞtes quelquefois. J'aurais voulu vous
voir encore plus franche; mais il me semblait pourtant que vos pensĂŠes
ĂŠtaient toutes rĂŠvĂŠlĂŠes pour moi, bien que vos paroles fussent plus
entortillÊes que l'Apocalypse. Je voudrais que vous eussiez la centième
partie du plaisir que j'ai Ă vous voir penser. Pour moi, c'ĂŠtait un
bonheur si grand, que je crains trop qu'il ne soit pas partagĂŠ. Il y
a deux personnes en vous. Vous n'êtes plus comme Cerbère, vous voyez.
De trois, vous voilĂ rĂŠduite Ă deux. L'une, qui est la meilleure,
est tout cĹur et toute âme. L'autre est une jolie statue bien polie
par le monde, bien drapĂŠe de soie et de cachemire; c'est un charmant
automate dont les ressorts sont le plus habilement arrangĂŠs qui se
puissent voir. Lorsqu'on croit parler à la première, on trouve la
statue. Pourquoi faut-il que cette statue soit si gentille! Autrement,
j'espĂŠrerais que, comme les vieux chĂŞnes d'Espagne, vous perdriez votre
ĂŠcorce en vieillissant.
Il vaut mieux que vous restiez telle que vous ĂŞtes, mais que la
première personne commande davantage à son automate. Voilà bien des
mĂŠtaphores oĂš je m'embrouille.
Je pense en ce moment Ă une main blanche. Il me semblait que j'avais
envie de vous gronder. Mais je ne me rappelle plus bien le pourquoi.
C'est moi maintenant qui ai des courbatures. J'ĂŠtais accablĂŠ en
rentrant l'autre jour, et je n'ai pas, comme vous, la ressource de
dormir douze heures. Il est vrai que je tiens moins que vous Ă ne
pas m'user. J'espère avoir une lettre de vous demain, mais vous
m'en Êcrirez une autre pour me dire si samedi ou lundi... Troisième
combinaison: samedi jusqu'Ă quatre heures, et lundi de deux heures Ă
cinq, Ce serait une perfection, ce me semble. Il faudrait que j'eusse
votre rĂŠponse samedi avant midi.
LXVI
Vendredi soir, 8 avril.
J'ai depuis deux jours une horrible migraine, et vous m'ĂŠcrivez toute
sorte de mĂŠchancetĂŠs. Le pire, c'est que vous n'avez pas de remords,
et j'avais quelque espoir que vous en auriez. Je suis si accablĂŠ,
que je n'ai pas mĂŞme la force de vous dire des injures. Quel est
donc ce miracle dont vous parlez? Le miracle serait de vous rendre
moins entĂŞtĂŠe, et je ne le ferai jamais. Cela est trop au-dessus de
mon pouvoir. Il faudra donc attendre Ă lundi pour savoir le mot de
l'ĂŠnigme, puisque vous ne pouvez demain. Savez-vous qu'il y aura
huit jours que nous ne nous sommes vus? Il y avait longtemps que
nous n'avions tant attendu. En revanche, il faudra faire une longue
promenade et tâcher quelle se passe sans disputes. à deux heures, si
vous voulez bien. Je compte prĂŠcisĂŠment sur le soleil. Votre pensĂŠe de
Wilhelm Meister est assez jolie, mais ce n'est qu'un sophisme, après
tout.
On pourrait dire avec presque autant d'exactitude que le souvenir
d'un plaisir est une espèce de peine. Cela est vrai surtout des
demi-plaisirs, je veux dire de ceux qui ne sont pas partagĂŠs. Vous
aurez ces vers si vous y tenez. Vous aurez mĂŞme votre portrait en
Turquesse, que j'ai un peu arrangĂŠ. Je vous ai mis un narghilĂŠ Ă la
main pour plus de couleur locale. Quand je dis vous aurez tout cela,
je veux dire en payant. Si vous ne vous exÊcutez pas de bonne grâce,
songez que j'ai une terrible vengeance. On m'a demandĂŠ aujourd'hui un
dessin pour un album qui se vendra au profit du tremblement de terre.
Je donnerai votre portrait. Qu'en dites-vous? Je me demande quelquefois
comment je ferai dans cinq ou six semaines d'ici, quand nous ne nous
verrons plus. Je ne m'accoutume pas Ă cette idĂŠe-lĂ .
LXVII
Paris, 15 avril 1843.
J'avais si grand mal aux yeux ce matin et hier, que je n'ai pu vous
Êcrire. Je suis un peu mieux ce soir et je ne pleure plus guère. Votre
lettre est assez aimable, contre votre ordinaire. Il y a mĂŞme une ou
deux phrases tendres, sans _mais_ et sans secondes pensĂŠes. Nous avons
des idÊes très-diffÊrentes sur une foule de choses. Vous ne comprenez
pas ma gĂŠnĂŠrositĂŠ de me sacrifier pour vous. Vous devriez me remercier
pour m'encourager. Mais vous croyez que tout vous est dĂť. Pourquoi
faut-il que nous nous rencontrions si rarement dans nos manières de
sentir! Vous avez fort bien fait de ne pas parler de Catulle. Ce n'est
pas un auteur Ă lire pendant la semaine sainte, et il y a dans ses
Ĺuvres plus d'un passage impossible Ă traduire en français. On voit
très-bien ce qu'Êtait l'amour à Rome vers l'an 50 avant J.-C, C'Êtait
un peu mieux cependant que l'amour Ă Athènes au temps de PĂŠriclès. DĂŠjĂ
les femmes ĂŠtaient quelque chose. Elles faisaient faire des bĂŞtises aux
hommes. Leur pouvoir est venu, non du christianisme, comme on le dit
ordinairement, mais je pense par l'influence qu'exercèrent les barbares
du Nord sur la sociĂŠtĂŠ romaine. Les Germains avaient de l'exaltation.
Ils aimaient l'âme. Les Romains n'aimaient guère que le corps. Il est
vrai que longtemps les femmes n'eurent pas d'âme. Elles n'en ont point
encore en Orient, et c'est grand dommage. Vous savez comment deux âmes
se parlent. Mais la vôtre n'Êcoute guère la mienne.
Je suis content que vous fassiez cas des vers de Musset, et vous avez
raison de le comparer Ă Catulle. Catulle ĂŠcrivait mieux sa langue, je
crois, et Musset a le tort de ne pas croire à l'âme plus que Catulle,
que son temps excusait. Il est une heure tout Ă fait indue. Je vous dis
adieu pour bassiner mon Ĺil. Je pleure en vous ĂŠcrivant. Ă lundi. Priez
pour que nous ayons un beau soleil. Je vous apporterai un livre. Mettez
vos bottes de sept lieues.
LXVIII
Paris, 4 mai 1843.
Je ne dors plus du tout et je suis d'une humeur de chien. J'aurais
bien des choses Ă dire Ă votre lettre. Je ne commencerai pas, Ă cause
de cette humeur, ou plutôt je tâcherai de la modÊrer un peu. Votre
distinction entre les deux moi est fort jolie. Elle prouve votre
profond ĂŠgoĂŻsme. Vous n'aimez que vous, et c'est pour cela que vous
aimez un peu le moi qui ressemble au vĂ´tre. Plusieurs fois avant-hier,
j'en ai ĂŠtĂŠ scandalisĂŠ. J'y pensais assez tristement pendant que vous
n'Êtiez occupÊe qu'à contempler les arbres à votre manière. Vous
avez bien raison d'aimer les chemins de fer. Dans quelques jours, on
ira en trois heures Ă Rouen et Ă OrlĂŠans. Pourquoi n'irions-nous pas
voir Saint-Ouen? Mais qu'y avait-il de plus beau que nos bois l'autre
jour? Il me semble seulement que vous auriez dĂť rester plus longtemps.
Lorsqu'on a assez d'imagination pour expliquer naturellement cette
branche de lierre, on doit ne pas ĂŞtre en peine de trouver l'emploi de
quelques heures. Vous avez donc portĂŠ ce lierre dans vos cheveux le
soir? Je ne me doutais guère que celui-ci devait servir à favoriser vos
coquetteries.
Je suis tellement mĂŠcontent de vous, que vous trouverez peut-ĂŞtre que
j'ai trop du _moi_ que vous aimez. En vĂŠritĂŠ, je crois que je mettrai Ă
exĂŠcution la menace que je vous ai faite un jour.
Comment avez-vous trouvĂŠ le feu d'artifice? J'ĂŠtais chez une Excellence
qui a un beau jardin d'oĂš nous l'avons bien vu. Le bouquet m'a paru
bien. Ce doit ĂŞtre fort supĂŠrieur Ă un volcan, car l'art est toujours
plus beau que la nature. Adieu, Tâchez de penser un peu à moi.
Nos promenades sont maintenant une partie de ma vie, et je ne comprends
guère comment je vivais auparavant. Il me semble que vous en prenez
votre parti très-philosophiquement. Mais comment serons-nous quand nous
nous reverrons? Il y a six mois, nous reprenions notre conversation
interrompue presque au mĂŞme mot oĂš nous en ĂŠtions restĂŠs. En sera-t-il
de mĂŞme? Je ne sais quelle crainte j'ai que je vous retrouverai
toute autre. Chaque fois que nous nous voyons, vous ĂŞtes armĂŠe d'une
enveloppe de glace qui ne fond qu'au bout d'un quart d'heure. Vous
aurez amassĂŠ Ă mon retour un vĂŠritable _iceberg._ Allons, il vaut mieux
ne pas penser au mal avant qu'il arrive. RĂŞvons toujours. Croiriez-vous
qu'un Romain pĂťt dire de jolies choses et qu'il pĂťt ĂŞtre tendre? Je
veux vous montrer lundi des vers latins, que vous traduirez vous-mĂŞme
et qui viennent comme de cire Ă propos de nos disputes ordinaires. Vous
verrez que l'antiquitĂŠ vaut mieux que votre Wilhelm Meister.
LXIX
Mercredi, juin 1843.
Votre lettre ĂŠtait si bonne et si aimable, qu'elle a enlevĂŠ jusqu'au
dernier nuage qui pouvait rester après l'orage de l'autre jour. Mais
il me semble que nous ne serons sĂťrs tous les deux d'avoir oubliĂŠ que
lorsque nous aurons mis d'autres souvenirs entre notre querelle.
Pourquoi ne nous verrions-nous pas vendredi? Si cela ne vous dĂŠrange
pas, vous me ferez le plus grand plaisir. J'espère qu'il fera beau
temps. Vous me promettez, d'ailleurs, de me dire quelque chose qui doit
ĂŞtre trop important pour pouvoir ĂŞtre diffĂŠrĂŠ. J'apporterai un livre
espagnol et nous lirons, si vous voulez. Vous ne m'avez pas dit si vous
me payeriez mes leçons. Le temps qui ne se passe pas à dire ce que
vous appelez des folies me semble si mal employĂŠ, qu'il faut du moins
que j'y gagne quelque chose. En fait d'impossibilitĂŠs, ne pourrais-je
aller vous voir et vous donner des leçons d'espagnol à domicile? Je
m'appellerais don Furlano, etc., et vous serais adressĂŠ par madame
de P***, comme une victime de la tyrannie d'Espartero. Je commence Ă
trouver un peu dure cette dĂŠpendance oĂš nous sommes du soleil et de
la pluie. Je voudrais bien aussi faire votre portrait. Vous promettez
souvent d'inventer quelque chose. Vous prĂŠtendez gouverner, mais en
vĂŠritĂŠ vous vous acquittez assez mal de votre charge. Je ne puis
juger que très-imparfaitement de vos possibles et de vos impossibles.
Si vous mÊditiez sur le joli problème de se voir le plus souvent
possible, ne feriez-vous pas une bonne action? J'aurais encore bien des
choses Ă vous dire, mais il faudrait vous reparler de notre querelle
et je voudrais en anĂŠantir le souvenir. Je ne veux penser qu'au
raccommodement qui s'en est suivi et que vous avez l'air de regretter.
Ce serait cruel. Je suis bien assez fâchÊ de devoir à un si mauvais
motif tant de bonheur.
Adieu. Pensez Ă votre statue et animez-la sans la tourmenter d'abord.
LXX
Paris, 14 juin 1843.
Je suis bien heureux d'apprendre que vous allez mieux et bien fâchÊ
que vous ayez pleurĂŠ. Vous vous mĂŠprenez toujours sur le sens de mes
paroles. Vous voyez de la colère ou de la mÊchancetÊ oÚ il n'y a
que de la tristesse. Je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit
cette fois, mais je suis sĂťr que je n'ai voulu dire qu'une chose,
c'est que vous m'avez fait beaucoup de peine. Tous ces querelles qui
surviennent entre nous me prouvent que nous sommes très-diffÊrents,
et, comme, malgrĂŠ cette diffĂŠrence-lĂ , il y a entre nous une affinitĂŠ
grande,--c'est le _Wahlverwandschaft_ de Goethe,--il rĂŠsulte
nĂŠcessairement un combat qui me fait souffrir. Lorsque je dis que je
souffre, ce ne sont pas des reproches que je vous adresse. Je vois
en noir ce qu'un instant auparavant j'avais vu en couleur de rose.
Vous savez très-bien effacer ce noir avec deux paroles, et, ce soir,
en lisant votre lettre, je pense avec bonheur que le soleil n'est
peut-être pas perdu. Mais votre système de gouvernement est toujours le
même; vous me ferez toujours enrager après m'avoir rendu par moments
très-heureux. Quelqu'un plus philosophe que moi prendrait le bonheur
quand il vient et ne se fâcherait pas du mal. C'est le dÊfaut de ma
nature de me rappeler tout le mal passĂŠ quand je souffre; mais aussi
je me rappelle tout le bonheur quand je suis heureux. J'ai beaucoup
travaillĂŠ Ă vous oublier depuis tantĂ´t trois semaines, mais je n'y
ai pas trop bien rĂŠussi. L'odeur de vos lettres a ĂŠtĂŠ une difficultĂŠ
très-grande à la tâche que je m'Êtais imposÊe. Vous souvenez-vous que
j'ai senti cette odeur indienne un jour que nous nous sommes fait
beaucoup de peine et aussi, je crois, beaucoup de plaisir?
Je suis accablĂŠ d'affaires.
Ăcrivez-moi vite. J'ai travaillĂŠ beaucoup et Ă de drĂ´les de choses. Je
vous en parlerai quand nous nous verrons.
LXXI
Paris, samedi soir, 23 juin 1843.
Je commençais à être fort en peine de vous. Je craignais que l'humiditÊ
ne vous eĂťt fait mal et je me reprochais de vous avoir racontĂŠ si
longuement cette sotte histoire. Puisque vous ne vous ĂŞtes pas
enrhumĂŠe et que vous n'avez pas eu de colères rentrĂŠes, je puis Ă
mon tour me rappeler avec bonheur tous les moments que nous avons
passĂŠs ensemble. Je trouve comme vous que, ce jour-lĂ , nous avons
ĂŠtĂŠ plus parfaitement--si parfaitement peut comporter du plus ou du
moins--heureux que jamais. Ă quoi cela tient-il? Nous n'avons rien dit
ni fait d'extraordinaire, si ce n'est de ne pas nous quereller. Et
remarquez, s'il vous plaĂŽt, que c'est de vous que les disputes viennent
toujours. Je vous ai cĂŠdĂŠ sur une infinitĂŠ de points, et je n'ai pas
ĂŠtĂŠ de mauvaise humeur pour cela. Je voudrais bien que le bon souvenir
que vous gardez de cette journÊe vous profitât pour l'avenir. Pourquoi
ne me dites-vous pas tout de suite ce que vous expliquez dans votre
lettre tellement quellement, mais avec une certaine franchise qui me
plaĂŽt? . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Je suis flattĂŠ que mon conte vous ait amusĂŠe; mon amour-propre d'auteur
s'est offensĂŠ pourtant que vous vous soyez contentĂŠe de l'analyse,
assez dĂŠcousue que je vous en ai faite. J'espĂŠrais que vous auriez
demandĂŠ Ă le lire ou Ă l'entendre. Mais, puisque vous ne voulez pas, il
faut en prendre son parti. NĂŠanmoins, s'il faisait beau mardi, qui nous
empêcherait de nous asseoir tous les deux sur nos sièges rustiques,
et moi de vous faire la lecture? Il y en a pour une heure. Le mieux,
c'est de nous promener tout bonnement. Le voulez-vous? Le programme
sera de ne pas se disputer. Ăcrivez-moi vos intentions suprĂŞmes. J'ai
reçu madame de M*** et ses filles, florissantes toutes les trois. Rien
de fixĂŠ pour mon dĂŠpart. Il est fort prochain suivant toute apparence,
mais pourtant ce n'est pas Ă un adieu dĂŠfinitif qu'il faut vous
attendre.
LXXII
Paris, 9 juillet 1843.
Vous avez raison d'oublier les querelles si vous pouvez en venir Ă
bout. Elles se grossissent, comme vous le dites fort bien, lorsqu'on
les examine de près. Le mieux est de rêver toujours le plus longtemps
possible, et, comme nous pouvons faire toujours le mĂŞme rĂŞve, cela
ressemble fort Ă une rĂŠalitĂŠ. Je vais assez bien depuis hier. J'ai
dormi, ce qui ne m'ĂŠtait pas arrivĂŠ depuis longtemps. Il me semble
mĂŞme que je suis en meilleure humeur depuis que je me suis soulagĂŠ
en exhalant mes vapeurs l'autre jour. C'est dommage que nous ne
nous voyions pas le lendemain d'une querelle. Je suis sĂťr que nous
serions parfaitement aimables l'un pour l'autre. Vous m'aviez promis
de m'indiquer un jour; mais vous n'y avez pas pensĂŠ, ou, ce qui
serait plus mal, vous avez cru _indecorous_ de le faire. C'est cette
prĂŠoccupation que vous avez sans cesse qui nous est bien souvent un
sujet de brouillerie. Ă mesure que le moment de ne plus vous voir
approche, je me sens plus mĂŠcontent de moi, et, pour le rĂŠsultat,
c'est comme si j'ĂŠtais mĂŠcontent de vous. J'ai bien pu dire que vous
vous contraignez beaucoup pour me plaire; je me prends sans cesse Ă me
mettre en fureur contre cette contrainte mĂŞme qui, dans ce qu'elle a de
plus agrĂŠable, cache toujours un fond horriblement triste; mais rĂŞver,
c'est le plus sage. Ă quand? voilĂ toute la question.
Vous devriez bien me traduire un livre allemand qui me met au supplice.
Rien n'est plus enrageant qu'un professeur allemand qui croit avoir une
idĂŠe. Le titre est tentant: _das Provocationsverfahren der RĂśmer._
LXXIII
Paris, juillet 1843.
VoilĂ une lettre de vous bien aimable et presque tendre. Je voudrais
être en disposition moins mÊlancolique pour en jouir entièrement. Tout
ce que je puis faire de mieux, c'est de vous remercier de tout ce
qu'il y a de bon dans cette lettre et de ne pas vous parler des idĂŠes
plus ou moins tristes qui me viennent Ă son sujet. Le malheur, c'est
que je ne rêve pas aussi complètement que vous. Mais laissons cela et
parlons d'autre chose. Je partirai dans dix jours. J'ai ĂŠtĂŠ hier Ă la
campagne faire une visite et j'en suis revenu très-las et très-triste.
Las, parce que je me suis ennuyĂŠ, et triste, parce que je songeais
que c'ĂŠtait un beau jour perdu. Ne vous faites-vous jamais un pareil
reproche? J'espère que non. Quelquefois, je crois que vous sentez tout
ce que je sens, puis viennent des drawbacks, et alors je doute de tout.
Adieu; si je continuais Ă vous ĂŠcrire, je dirais des choses que vous ne
comprendriez pas comme je les dirais. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
LXXIV
Jeudi soir, 28 juillet 1843.
J'ai lu votre lettre (je parle de la première) une vingtaine de fois au
moins depuis que je l'ai reçue, et, chaque fois, elle m'a fait Êprouver
une impression nouvelle et en gĂŠnĂŠral fort triste, mais jamais elle ne
m'a mis en colère. J'ai cherchÊ très-inutilement à y rÊpondre. J'ai
pris très-inutilement un grand nombre de partis, et je reste ce soir
aussi incertain et aussi triste que la première fois. Vous avez assez
bien devinÊ mes pensÊes, peut-être pas entièrement. Vous ne pourriez
jamais les deviner toutes. J'en change d'ailleurs si souvent, que ce
qui est vrai dans un moment cesse de l'être quelque moments après. Vous
avez tort de vous accuser. Vous n'avez, je pense, pas d'autre reproche
Ă vous faire que ceux que je me fais. Nous nous laissons rĂŞver sans
vouloir ĂŞtre ĂŠveillĂŠs. Peut-ĂŞtre sommes-nous trop vieux pour rĂŞver
ainsi de propos dĂŠlibĂŠrĂŠ. Pour ma part, j'approuve le mot de ce Turc;
mais _rien_, ne serait-ce pas le pire? J'ai beaucoup variĂŠ sur ce
point. Plusieurs fois, il m'est venu en tĂŞte de ne pas vous rĂŠpondre et
de ne plus vous voir. Cela est fort raisonnable et peut très-bien se
soutenir. L'exĂŠcution est plus difficile. Ă ce propos, vous avez tort
de m'accuser de ne plus vouloir nous voir. Je n'en ai pas dit un mot.
Est-ce encore une pensĂŠe que vous avez surprise? Vous, au contraire,
vous me la dites très-nettement. Il y aurait encore autre chose à faire
ce serait de ne pas s'ĂŠcrire un mot pendant le voyage que je vais
faire, de penser Ă nous ou Ă toute autre chose, et de se revoir ou de
ne pas se revoir au retour, suivant que la rĂŠflexion le conseillerait.
Cela est encore assez raisonnable, mais d'exĂŠcution embarrassante.
Quand je ne pense plus Ă votre lettre et seulement Ă votre amabilitĂŠ,
savez-vous ce que je voudrais? c'est nous revoir encore une fois.
Cette affaire de l'hĂ´tel de Cluny m'a forcĂŠ Ă retarder mon dĂŠpart.
Je devrais ĂŞtre en route. Je crains de ne pouvoir pas signer un
maudit procès-verbal oÚ il faut que mon nom soit avant lundi. Puisque
vous aviez envie de me parler lundi, peut-ĂŞtre n'auriez-vous pas
d'objections Ă me dire dĂŠfinitivement adieu samedi.
En vous parlant de cela, j'ai peut-ĂŞtre tort. Dieu sait en quelle
disposition vous êtes! Après tout, vous pouvez fort bien dire non. Je
vous promets de ne m'en pas fâcher.
LXXV
Paris, jeudi soir, 2 aoĂťt 1843.
Je suis moins poĂŠtique que vous. La Ďθὥν Îľá˝ĎĎ
οδξ៹Ρ, c'est-à -dire la
large terre, malgrĂŠ le mackintosh, ĂŠtait encore plus froide que vous,
et j'en suis enrhumĂŠ, mais sans rancune. J'en aurais Ă lire tout ce
que vous me dites et que vous croyez agrĂŠable. Combien de _mais_
toujours! que vous ĂŞtes ingĂŠnieuse Ă Ă´ter aux autres et Ă vous-mĂŞme
l'enchantement qu'ils peuvent avoir! Je dis enchantement, et j'ai tort
sans doute; car je ne crois pas que les marmottes en aient. Vous ĂŠtiez
un de ces jolis animaux-là avant que Brahma envoyât votre âme dans
un corps de femme. Ă la vĂŠritĂŠ, vous vous rĂŠveillez quelquefois, et,
comme vous dites fort bien, c'est pour quereller. Soyez donc bonne et
gracieuse comme vous savez l'ĂŞtre. MalgrĂŠ ma mauvaise humeur, j'aime
mieux vous voir avec vos grands airs indiffĂŠrents que de ne pas vous
voir du tout. Je vous disais bien que toute cette botanique ne valait
rien; mais vous voulez toujours faire Ă votre tĂŞte. J'ai dĂŠcouvert des
choses encore plus curieuses que des courses champĂŞtres sur des indices
moins ĂŠvidents. Croyez-moi, jetez au feu toutes ces fleurs fanĂŠes, et
venez en chercher de nouvelles.
Adieu.
LXXVI
Paris, 5 aoĂťt 1843.
J'attendais une lettre de vous avec bien de l'impatience, et plus elle
tardait, plus je m'attendais Ă des seconds mouvements et Ă toutes leurs
vilaines consĂŠquences. Comme j'ĂŠtais prĂŠparĂŠ Ă toutes les injures de
votre part, votre lettre m'a paru meilleure qu'en un autre moment. Vous
me dites que vous avez ĂŠtĂŠ heureuse aussi, et ce mot efface tous les
autres qui prÊcèdent et qui suivent pour l'affaiblir. C'est ce que vous
m'avez dit de mieux depuis longtemps, c'est presque la seule fois oĂš je
vous ai senti un cĹur fait comme un autre. Quelle radieuse promenade!
Je ne suis nullement malade et j'ĂŠtais l'autre jour assez heureux pour
en garder de la santĂŠ et de la bonne humeur pour longtemps. Si le
bonheur passe vite, il peut se renouveler. Malheureusement, le temps se
gâte, puis vous parlez de voyage. Peut-être cette pluie vous a-t-elle
Ă´tĂŠ l'envie de courir. Pour moi, elle m'Ă´te jusqu'Ă la force de faire
des projets. Pourtant, s'il y avait un bon jour avant votre dĂŠpart, ne
ferions-nous pas bien d'en profiter et de dire adieu pour longtemps Ă
notre parc et Ă nos bois? Je ne reverrai plus leurs feuilles de cette
annÊe du moins, et cette idÊe-là m'attriste. J'espère que vous les
regretterez aussi. Quand vous verrez un rayon de soleil, prĂŠvenez-moi,
et allons retrouver nos châtaignes et notre montagne. Vous avez pensÊ
Ă moi et Ă nous pendant un moment bien court, mais le souvenir n'en
reste-t-il pas bien longtemps?
LXXVII
VĂŠzelay, 8 aoĂťt 1843, au soir.
Je vous remercie de m'avoir ĂŠcrit un mot avant mon dĂŠpart. C'est
l'intention qui m'a fait plaisir et non l'expression de votre lettre.
Vous me dites des choses fort extraordinaires. Si vous pensez la moitiĂŠ
de ce que vous dites, le plus sage serait de ne plus nous revoir.
L'affection que vous avez pour moi n'est chez vous qu'une espèce de jeu
d'esprit. Vous ĂŞtes toute esprit. Vous ĂŞtes une de ces _chilly women
of the North_, vous ne vivez que par la tĂŞte. Ce que je pourrais vous
dire, vous ne le comprendriez pas. J'aime mieux vous rĂŠpĂŠter encore que
je suis fâchÊ de vous avoir fait de la peine, que ç'a ÊtÊ indÊpendant
de ma volontÊ et que je vous en demande pardon. Nos caractères sont
aussi diffĂŠrents que nos _stamina._ Que voulez-vous! vous pouvez
quelquefois deviner mes pensĂŠes, mais vous ne me comprendrez jamais.
Je suis ici dans une horrible petite ville perchĂŠe sur une haute
montagne, assassinĂŠ par les provinciaux, et fort prĂŠoccupĂŠ d'un speech
que je dois faire demain. Je reprĂŠsente, et vous me connaissez assez
pour savoir combien le mĂŠtier d'homme public m'est odieux. J'ai pour me
consoler un compagnon de voyage très-aimable et une admirable Êglise
qui me doit de ne pas ĂŞtre par terre Ă l'heure qu'il est. Lorsque j'ai
vu cette Êglise pour la première fois, c'Êtait fort peu de temps après
vous avoir vue Ă ***. Je me demandais aujourd'hui si nous ĂŠtions plus
fous alors que maintenant.
Ce qu'il y a de certain, c'est que nous nous faisions l'un de l'autre
une idÊe probablement très-diffÊrente de celle que nous avons
maintenant. Si nous avions su alors combien nous nous ferions enrager
l'un l'autre, croyez-vous que nous nous serions revus? Il fait un
froid affreux, de la pluie, et des ĂŠclairs au milieu de tout cela.
J'ai une rame de prose officielle Ă ĂŠcrire, et je vous quitte d'autant
plus facilement que ce ne sont pas des tendresses que j'aurais Ă vous
dire. Je suis aussi mĂŠcontent de moi-mĂŞme que de vous. C'est cependant
la force des choses Ă qui j'en veux le plus. Je serai Ă Dijon dans
quelques jours. Si vous vouliez m'ĂŠcrire lĂ , vous me feriez plaisir,
surtout si vous trouviez sous votre plume quelque chose de moins brutal
que votre dernière lettre. Vous ne pouvez vous faire une idÊe d'une de
nos soirĂŠes d'auberge. Parmi les idĂŠes les plus riantes qui me viennent
Ă l'esprit, je pense Ă aller passer quelque part en Italie le temps qui
doit s'ĂŠcouler entre ma tournĂŠe et le voyage d'Alger. Je me figure que,
de votre cĂ´tĂŠ, vous avisez aux moyens d'ĂŞtre Ă la campagne lorsque je
reviendrai Ă Paris. Que deviendront tous ces projets-lĂ ? En partant,
j'ai vu M. de Saulcy, qui venait de recevoir une lettre de Metz. On
lui faisait un grand Êloge de votre frère, qui plaÎt beaucoup aux gens
Ă qui on l'a recommandĂŠ. Je vous aurais ĂŠcrit cela plus tĂ´t sans les
mille et un tracas du dĂŠpart.
Adieu. Il me semble que je me trouve mieux pour avoir un peu causĂŠ avec
vous. Si j'avais plus de papier et moins de rapports Ă faire, je serais
capable, je crois, de vous dire maintenant quelque chose de tendre.
Vous savez que mes colères finissent ordinairement de la sorte.
Ă Dijon, poste restante, et n'oubliez pas mes titres et qualitĂŠs!
LXXVIII
Avallon, 14 aoĂťt 1843.
Je croyais ĂŞtre le 10 Ă Lyon, j'en suis encore Ă plus de soixante
lieues. Il faut que je m'arrĂŞte Ă Autun ayant d'avoir de vos nouvelles.
Si vous ĂŞtes aimable, vous m'ĂŠcrirez encore Ă Lyon. Je suis de plus
en plus content de VĂŠzelay. La vue en est admirable, et puis j'ai
quelquefois du plaisir Ă ĂŞtre seul. En gĂŠnĂŠral, je me trouve assez
mauvaise compagnie; mais, quand je suis triste sans avoir de grands
motifs pour l'être, quand cette tristesse n'est pas de la colère
rentrÊe, alors je me plais dans une solitude complète; J'Êtais dans
cette disposition les derniers jours que j'ai passĂŠs Ă VĂŠzelay. Je me
promenais ou je me couchais au bord d'une certaine terrasse naturelle
qu'un poète pourrait bien appeler un prÊcipice, et, là , je philosophais
sur le _moi_, sur la Providence, dans l'hypothèse qu'elle existe. Je
pensais Ă vous aussi, et plus agrĂŠablement qu'Ă moi. Mais cette
pensĂŠe-lĂ n'ĂŠtait pas la plus gaie, parce que, aussitĂ´t quelle venait,
je me reprÊsentais combien je serais heureux de vous voir auprès de
moi dans ce coin ignorĂŠ. Et puis, et puis tout cela se terminait par
cette autre pensĂŠe plus dĂŠsolante, que vous ĂŠtiez bien loin, qu'il
n'ĂŠtait pas facile de se voir et pas sĂťr mĂŞme que vous le voulussiez
bien. Ma prĂŠsence Ă VĂŠzelay a beaucoup intriguĂŠ la population. Lorsque
je dessinais, surtout lorsque je me servais d'une chambre claire, un
rassemblement considĂŠrable se formait autour de moi, et c'ĂŠtait Ă qui
bâtirait des conjectures sur mon genre d'occupation. Cette cÊlÊbritÊ ne
laissait pas d'ĂŞtre fort ennuyeuse, et j'aurais bien voulu avoir avec
moi un janissaire pour contenir les curieux. Ici, je suis rentrĂŠ dans
la foule. Je suis venu pour voir un vieil oncle que je ne connaissais
guère. Il a fallu rester deux jours avec lui. Pour ma peine, il m'a
menĂŠ voir quelques tĂŞtes sans nez qui proviennent d'une fouille faite
aux environs. Je n'aime pas les parents. On est obligĂŠ d'ĂŞtre familier
avec des gens qu'on n'a jamais vus parce qu'ils se trouvent fils du
même père que votre père. Mon oncle est cependant un très-brave homme,
point trop provincial, et peut-ĂŞtre je le trouverais aimable si nous
avions deux idĂŠes communes. Les femmes sont ici aussi laides qu'Ă
Paris. En outre, elles ont des chevilles grosses comme des poteaux. Ă
Nevers, il y avait d'assez jolis yeux. Point de costumes nationaux.
Outre nos perfections morales, nous avons l'avantage d'ĂŞtre le peuple
le plus rabougri et le plus laid de l'Europe. Je vous envoie un bout de
plume de chouette que j'ai trouvĂŠe dans un trou de l'ĂŠglise abbatiale
de la Madeleine de VĂŠzelay. L'ex-propriĂŠtaire de la plume et moi, nous
nous sommes trouvĂŠs un instant nez Ă nez, presque aussi inquiets l'un
que l'autre de notre rencontre imprĂŠvue. La chouette a ĂŠtĂŠ moins brave
que moi et s'est envolĂŠe. Elle avait un bec formidable et des yeux
effroyables, outre deux plumes en manière de cornes. Je vous envoie
cette plume pour que vous en admiriez la douceur, et puis parce que
j'ai lu dans un livre de magie que, lorsqu'on donne Ă une femme une
plume de chouette et quelle la met sous son oreiller, elle rĂŞve de son
ami. Vous me direz votre rĂŞve.
Adieu.
LXXIX
Saint-Lupicin, 15 aoĂťt 1843, au soir.
à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Au milieu d'un ocÊan de puces très-agiles
et très-affamÊes.
Votre lettre est diplomatique. Vous pratiquez l'axiome que la parole
a ĂŠtĂŠ donnĂŠe Ă l'homme pour dĂŠguiser sa pensĂŠe. Heureusement pour
vous, le post-scriptum m'a dĂŠsarmĂŠ. Pourquoi dites-vous en allemand
ce que vous pensez en français? Serait-ce que vous ne le pensez qu'en
allemand, c'est-à -dire que vous ne le pensez guère? Je ne veux pas
le croire. Mais il y a en vous des choses qui m'irritent au dernier
point. Comment ĂŞtes-vous encore timide avec moi? Pourquoi n'avez-vous
jamais voulu me dire quelque chose qui m'aurait fait tant dĂŠplaisir?
Croyez-vous qu'il y ait des Êquivalents dans une langue Êtrangère?
Vous ne vous figurez pas le lieu oĂš je suis.
Saint-Lupicin est dans les montagnes du Jura. C'est laid au dernier
point, sale et peuplĂŠ de puces. Je vais ĂŞtre obligĂŠ de me coucher
tout Ă l'heure et je vais passer une nuit comme mes nuits d'Ăphèse.
Malheureusement, Ă mon rĂŠveil, je ne trouverai ni lauriers, ni ruines
grecques. Quel vilain pays! Je pense souvent que, si les chemins de
fer se perfectionnaient, nous pourrions aller ensemble dans un lieu
semblable et qu'alors il s'embellirait. Il y a ici une immense quantitĂŠ
de fleurs, un air singulièrement pur et vif; on entend la voix humaine
Ă une lieue de distance. Pour vous prouver que je pense Ă vous, voici
une petite fleur cueillie dans ma promenade au coucher du soleil. C'est
la seule qui se puisse envoyer. Toutes les autres sont colossales.--Que
faites-vous? Ă quoi pensez-vous? Vous ne me diriez jamais Ă quoi vous
pensez rĂŠellement, et c'est folie Ă moi de vous le demander. Depuis
mon dĂŠpart, j'ai eu peu de bons moments. Un ciel d'un gris de plomb,
tous les accidents et toutes les misères possibles. Une roue cassÊe,
un Ĺil en compote; tout cela est raccommodĂŠ tant bien que mal. Mais
ce Ă quoi je ne m'habitue pas, c'est Ă la solitude. Il me semble que,
cette annĂŠe, elle m'est plus pĂŠnible qu'Ă l'ordinaire. Je veux dire la
solitude avec le mouvement. Il n'y a rien de plus triste. Il me semble
que, si j'ĂŠtais en prison, je serais plus Ă mon aise qu'Ă courir ainsi
le pays. Je regrette surtout nos promenades. Vous me faites plaisir
en me disant que vous aimez toujours nos bois. J'espère que nous les
reverrons, et cependant mon malheureux voyage s'allonge dĂŠmesurĂŠment.
Le dĂŠpartement du Jura, avec ses montagnes et ses chemins de traverse,
me retarde de plus de dix jours. Je vais de dĂŠsappointement en
dÊsappointement. Encore si c'Êtaient les premières montagnes que je
visse. Je n'ai nulle envie d'aller en Italie. C'est une invention de
votre part. Votre lettre m'a fait tantĂ´t plaisir et tantĂ´t m'a fait
enrager. J'y vois quelquefois entre les lignes les choses les plus
tendres du monde. D'autres fois, vous me paraissez encore plus _chilly_
que de coutume. Il n'y a que le post-scriptum qui me satisfasse. Je
ne l'ai vu que tard. Il est Ă une si grande distance du reste de la
lettre! Si vous m'Êcrivez tout de suite, Êcrivez-moi à Besançon; sinon,
adressez votre lettre chez moi Ă Paris. Je ne sais pas oĂš je serai dans
huit jours d'ici.
LXXX
Paris, lundi, septembre 1843.
Nous nous sommes sĂŠparĂŠs l'autre jour ĂŠgalement mĂŠcontents l'un de
l'autre. Nous avions tort tous les deux, car c'est la force des choses
qu'il fallait seulement accuser. Le mieux eĂťt ĂŠtĂŠ de ne pas nous revoir
de longtemps. Il est ĂŠvident que nous ne pouvons plus maintenant nous
trouver ensemble sans nous quereller horriblement. Tous les deux, nous
voulons l'impossible: vous, que je sois une statue; moi, que vous
n'en soyez pas une. Chaque nouvelle preuve de cette impossibilitĂŠ,
dont au fond nous n'avons jamais doutĂŠ, est cruelle pour l'un et pour
l'autre. Pour ma part, je regrette toute la peine que j'ai pu vous
donner. Je cède trop souvent à des mouvements de colère absurde. Autant
vaudrait-il se fâcher de ce que la glace est froide.
J'espère que vous me pardonnerez maintenant; il ne me reste nulle
colère, seulement une grande tristesse. Elle serait moindre si nous ne
nous ĂŠtions pas quittĂŠs de la sorte. Adieu, puisque nous ne pouvons
ĂŞtre amis qu'Ă distance. Vieux l'un et l'autre, nous nous retrouverons
peut-ĂŞtre avec plaisir. En attendant, dans le malheur ou dans le
bonheur, souvenez-vous de moi. Je vous ai demandĂŠ cela il y a je ne
sais combien d'annÊes. Nous ne pensions guère alors à nous quereller.
Adieu encore, pendant que j'ai du courage.
LXXXI
Paris, jeudi, 6 septembre 1843.
Il me semble que je vous ai vue en rĂŞve. Nous sommes demeurĂŠs si peu de
temps ensemble, que je ne vous ai rien dit de ce que je voulais vous
dire. Vous-mĂŞme, vous aviez l'air de ne pas trop savoir si j'ĂŠtais
une rĂŠalitĂŠ. Quand nous verrons-nous? Je fais en ce moment le mĂŠtier
le plus bas et le plus ennuyeux: je sollicite pour l'AcadĂŠmie des
inscriptions. Il m'arrive les scènes les plus ridicules, et souvent il
me prend des envies de rire de moi-mĂŞme, que je comprime pour ne pas
choquer la gravitĂŠ des acadĂŠmiciens que je vais voir. C'est un peu Ă
l'aveugle que je me suis embarquĂŠ, ou plutĂ´t qu'on m'a embarquĂŠ dans
cette affaire. Mes chances ne sont point mauvaises, mais le mĂŠtier est
des plus rudes, et le pire de tout, c'est que le dĂŠnoĂťment se fera
longtemps attendre: vraisemblablement jusqu'Ă la fin d'octobre, et
peut-ĂŞtre plus. Je ne sais si je pourrai aller en AlgĂŠrie cette annĂŠe.
La seule rĂŠflexion qui me console, c'est que je resterai ici et que,
par consĂŠquent, je vous verrai. Cela vous fera-t-il plaisir? Dites-moi
que oui et gâtez-moi bien. Je suis tellement abruti par ces ennuyeuses
visites, que j'ai besoin de toutes vos câlineries, et des plus tendres,
pour me donner un peu de courage et de vie.
Vous avez tort d'ĂŞtre jalouse des inscriptions. J'y mets quelque
amour-propre, comme Ă une partie d'ĂŠchecs engagĂŠe avec un adversaire
habile; mais je ne crois pas que la perte ou le gain m'affecte le quart
autant qu'une de nos querelles. Mais quel vilain mĂŠtier que celui de
solliciteur! Avez-vous jamais vu des chiens entrer dans le terrier
d'un blaireau? Quand ils ont quelque expĂŠrience, ils font une mine
effroyable en y entrant, et souvent ils en sortent plus vite qu'ils
n'y sont entrĂŠs, car c'est une vilaine bĂŞte Ă visiter que le blaireau.
Je pense toujours au blaireau en tenant le cordon de la sonnette d'un
acadĂŠmicien, et je me vois _in the mind's eye_ tout Ă fait semblable au
chien que je vous disais. Je n'ai pas encore ĂŠtĂŠ mordu cependant. Mais
j'ai fait de drĂ´les de rencontres.
Adieu.
LXXXII
Septembre 1843.
Je _m'ennuie_ beaucoup de vous, pour me servir d'une ellipse que vous
affectionnez. Je ne me reprĂŠsentais pas l'autre jour, clairement du
moins, que nous nous disions adieu pour bien longtemps. Est-ce vrai
maintenant que nous ne nous verrons plus? Nous nous sommes quittĂŠs sans
nous parler, sans nous regarder presque. C'ĂŠtait comme l'autre jour,
à la cause près. Je sentais une espèce de bonheur calme qui ne m'est
pas ordinaire. Il m'a semblĂŠ pour quelques instants que je ne dĂŠsirais
rien de plus. Maintenant, si nous pouvons retrouver ce bonheur-lĂ ,
pourquoi nous le refuserions-nous? Il est vrai que nous pouvons encore
nous quereller, comme cela nous est arrivĂŠ tant de fois. Mais qu'est-ce
que le souvenir d'une querelle auprès de celui d'un raccommodement!
Si vous pensez la moitiĂŠ de tout cela, vous devez avoir envie de
refaire encore une de nos promenades. Je vais faire un petit voyage
la semaine prochaine. Samedi, si vous voulez, ou bien mardi prochain,
nous pourrions nous voir. Je ne vous ai pas ĂŠcrit plus tĂ´t parce que
je m'Êtais persuadÊ que vous seriez la première à me parler de revoir
nos bois. Je me suis trompĂŠ, mais je ne vous en veux pas beaucoup. Vous
avez le secret de me faire oublier bien des choses, de substituer chez
moi une impression Ă la raison. Encore une fois, je ne vous le reproche
pas. On est heureux de pouvoir rĂŞver ainsi.
LXXXIII
Paris, septembre 1843.
Nos lettres se sont croisÊes. Vous aurez vu, j'espère, que ma colère,
que je regrette beaucoup, n'a pas eu la cause que vous lui supposez.
Mais votre lettre me prouve qu'il nous est impossible de ne pas nous
quereller. Nous sommes trop diffĂŠrents. Vous avez tort de vous repentir
de ce que vous avez fait: c'est moi qui ai eu tort de vouloir que vous
fussiez autre que vous n'ĂŞtes. Croyez que je n'ai nullement changĂŠ Ă
votre ĂŠgard. Je regrette par-dessus tout de vous avoir quittĂŠe de la
sorte, mais il y a des moments oĂš l'on ne peut ĂŞtre de sang-froid. Je
dÊsirerais vous revoir maintenant pour retrouver auprès de vous un de
nos beaux rĂŞves de cet ĂŠtĂŠ, et vous dire adieu alors pour longtemps
en demeurant sur une impression douce et tendre. Vous trouverez cette
idĂŠe-lĂ fort absurde. Cependant, elle me poursuit, et je ne puis
m'empĂŞcher de vous la dire. Refusez, vous ferez peut-ĂŞtre bien. Je
crois que maintenant j'aurai assez d'empire sur moi pour ne pas me
mettre en colère. Je n'en rÊpondrais pas cependant. Le parti que vous
prendrez sera le bon. Je ne puis vous promettre que les meilleures
intentions du monde d'ĂŞtre calme et rĂŠsignĂŠ.
LXXXIV
Avignon, 29 septembre.
Il y a bien des jours que je n'ai reçu de vos nouvelles et presque
aussi longtemps que je ne vous ai ĂŠcrit. Mais, moi, je suis excusable.
En vĂŠritĂŠ, le mĂŠtier que je fais est des plus fatigants. Tout le jour,
il faut ou marcher ou courir la poste, et, le soir, malgrĂŠ la fatigue,
il faut brocher une douzaine de pages de prose. Je ne parle que des
ĂŠcritures ordinaires, car, de temps en temps, j'ai Ă faire la chouette
Ă mon ministre. Mais, comme ils ne lisent pas, je puis impunĂŠment dire
toutes les bĂŞtises possibles.
Le pays que je parcours est admirable, mais les gens y sont bĂŞtes Ă
outrance. Personne n'ouvre la bouche si ce n'est pour faire son ĂŠloge,
et cela depuis l'homme qui porte un habit noir jusqu'au portefaix.
Aucune apparence de ce tact qui fait le gentleman et que j'ai retrouvĂŠ
avec tant de plaisir parmi les gens du peuple en Espagne. à cela près,
il est impossible de voir un pays qui ressemble plus Ă l'Espagne.
L'aspect du paysage et de la ville est le mĂŞme. Les ouvriers se
couchent Ă l'ombre ou se drapent de leurs manteaux d'un air aussi
tragique que les Andalous. Partout l'odeur d'ail et d'huile se marie
Ă celle des oranges et du jasmin. Les rues sont couvertes de toiles
pendant le jour, et les femmes ont de petits pieds bien chaussĂŠs. Il
n'y a pas jusqu'au patois qui n'ait de loin le son de l'espagnol.
Un plus grand rapport se trouve encore produit par l'abondance des
cousins, puces, punaises, qui ne permettent pas de dormir. J'ai encore
deux mois Ă mener cette vie avant de revoir des ĂŞtres humains! Je pense
sans cesse Ă mon retour Ă Paris, et mon imagination me peint je ne sais
combien de dĂŠlicieux moments passĂŠs avec vous. Peut-ĂŞtre ce que je puis
espĂŠrer de mieux, c'est de vous voir une minute de loin et d'obtenir un
petit signe de tête en manière de reconnaissance. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Vous me demandez un dessin de chapiteau roman. Je n'en ai plus un
seul. J'ai envoyĂŠ tous mes croquis Ă Paris. Ensuite, un chapiteau vous
intĂŠresserait peu. Ce sont ou des diables, ou des dragons, ou des
saints qui en font la dÊcoration. Les diables des premiers siècles
du christianisme n'ont rien de bien sĂŠduisant. Pour les dragons et
les saints, je suis sĂťr que vous en faites peu de cas. J'ai commencĂŠ
à dessiner pour vous un costume maçonnais. C'est le seul que j'aie
rencontrÊ qui ait quelque grâce; encore la ceinture est-elle si
drĂ´lement placĂŠe, que la taille la plus fine ne paraĂŽt pas diffĂŠrente
de la plus grosse. Il faut une organisation physique particulière pour
porter ce costume. Lebon marchĂŠ des cotonnades et la facilitĂŠ des
communications avec Paris ont fait disparaĂŽtre les costumes nationaux.
_10 septembre._--Je me suis donnÊ une espèce d'entorse hier au soir.
Je vous ĂŠcris un pied sur une chaise, dans un ĂŠtat de fureur difficile
Ă dĂŠcrire. Quand mon pied dĂŠsenflera-t-il? _That is the question._
Si j'ĂŠtais obligĂŠ de passer cinq Ă six jours de plus ici, je ne sais
ce que je deviendrais. Je crois que j'aimerais mieux ĂŞtre sĂŠrieusement
malade que d'être ainsi arrêtÊ par une petite misère. Pourtant, cela me
fait assez souffrir.
Avignon est rempli d'ĂŠglises et de palais, tous munis de hautes tours
avec crÊneaux et mâchicoulis. Le palais des papes est un modèle de
fortification pour le moyen âge. Cela prouve quelle aimable sÊcuritÊ
rÊgnait dans ce pays vers le XIIIe ou XIVe siècle. Dans le palais des
papes, on monte une centaine de marches d'un escalier tortueux, puis
tout Ă coup on se trouve vis-Ă -vis une muraille. En tournant la tĂŞte,
on voit, Ă quinze pieds plus haut, la continuation de l'escalier, oĂš
l'on ne peut parvenir que par une ĂŠchelle. Il y a aussi des chambres
souterraines qui servaient Ă l'inquisition. On montre les fourneaux
oĂš l'on chauffait les ferrements pour torturer les hĂŠrĂŠtiques, et
les dÊbris d'une machine très-compliquÊe pour donner la question.
Les Aviguonnais sont aussi fiers de leur inquisition que les Anglais
de leur _Magna Charta._ ÂŤNous aussi, disent-ils, nous avons eu des
auto-da-fÊ, et les Espagnols n'en ont eu qu'après nous!
J'ai vu Ă Vienne, il y a quelques jours, une statue antique qui a
bouleversĂŠ toutes mes idĂŠes sur la statuaire romaine. J'avais toujours
vu le beau idĂŠal de convention intervenir dans l'imitation de la
nature. LĂ , c'est tout diffĂŠrent. Cette statue reprĂŠsente une grosse
maman bien grasse, avec une gorge ĂŠnorme un peu pendante et des plis
de graisse le long des cĂ´tes, comme Rubens en donnait Ă ses nymphes.
Tout Cela est copiĂŠ avec une fidĂŠlitĂŠ surprenante Ă voir. Qu'en disent
Messieurs de l'AcadĂŠmie?
Adieu, voici l'heure de la poste. Ăcrivez-moi Ă Montpellier, puis Ă
Carcassonne. J'espère que je ne serai pas trop longtemps sans aller
chercher votre lettre, qui me rend toujours si heureux.
Adieu encore.
LXXXV
Toulon, 2 octobre.
J'ai ÊtÊ longtemps sans vous Êcrire, chère amie. Aussitôt que mon
pied a ĂŠtĂŠ rendu Ă ses proportions ordinaires, j'ai voulu rĂŠparer le
temps perdu en faisant des courses dans le Comtat. J'ai ĂŠtĂŠ Ă mĂŞme
d'apprĂŠcier la diffĂŠrence qui existe entre les cousins de Carpentras,
d'Orange, Cavaillon, Apt et autres lieux. Ils possèdent presque
tous la propriĂŠtĂŠ d'empĂŞcher un honnĂŞte-homme de dormir. Je ne vous
parlerai pas des belles choses que j'ai vues ni des _humbugs_ que j'ai
dĂŠcouverts. Mais savez-vous ce que c'est qu'un _draquet?_ C'est la mĂŞme
chose qu'un _fantasty._ Voici l'explication de ces deux mots barbares:
vous saurez d'abord que la richesse du dĂŠpartement de Vaucluse consiste
surtout en soies. Dans chaque maisonnette de paysan, on Êlève des vers
et on file la soie, d'oĂš rĂŠsulte d'abord une odeur infecte, ensuite que
très-souvent on trouve des Êcheveaux de soie accrochÊs aux buissons.
Vers le soir, il y a des paysannes assez imprudentes pour ramasser
ces ĂŠcheveaux et les mettre dans leur panier. Le panier s'alourdit
peu Ă peu, toujours augmentant de poids, si bien que l'on est tout
en nage à le porter. Lorsque, après une longue et pÊnible marche, on
arrive aux abords d'un ruisseau, alors le panier devient rĂŠellement
insupportable et on est obligĂŠ de le mettre Ă terre. AussitĂ´t il en
sort un petit ĂŞtre Ă grosse tĂŞte, ricanant toujours, emmanchĂŠ d'une
espèce de queue de lÊzard, qui se plonge dans le ruisseau en disant:
M'as ben pourta! ce qui veut dire en provençal ou dans l'idiome des
draquets: ÂŤTu m'as bien portĂŠ!Âť J'ai vu dĂŠjĂ plus d'une femme qui avait
ÊtÊ ainsi mystifiÊe par ces dÊmons espiègles, et je suis dÊsolÊ de n'en
pas avoir rencontrĂŠ moi-mĂŞme. J'aurais eu le plus grand plaisir Ă faire
connaissance avec eux.
Ma tournĂŠe s'allonge Ă mesure que les jours accourcissent. Je vais
demain Ă FrĂŠjus pour aller de lĂ aux ĂŽles de LĂŠrins, oĂš je trouverai
peut-être les ruines de la première Êglise chrÊtienne d'Occident. Je
suis plus qu'Ă demi persuadĂŠ que je ne trouverai rien du tout. Mais
il faut faire son mĂŠtier en conscience et inspecter tout ce qu'il y a
d'historique.
Il est impossible de voir rien de plus sale et de plus joli que
Marseille. Sale et joli convient parfaitement aux Marseillaises. Elles
ont toutes de la physionomie, de beaux yeux noirs, de belles dents,
un très-petit pied et des chevilles imperceptibles. Ces petits pieds
sont chaussĂŠs de bas cannelle, couleur de la boue de Marseille, gros
et raccommodĂŠs avec vingt cotons de nuances diffĂŠrentes. Leurs robes
sont mal faites, toujours fripĂŠes et couvertes de taches. Leurs beaux
cheveux noirs doivent la plus grande partie de leur lustre au suif de
chandelle. Ajoutez à cela une atmosphère d'ail mêlÊe de vapeur d'huile
rance, et vous pouvez vous reprĂŠsenter la beautĂŠ marseillaise. Quel
dommage que rien ne soit complet dans le monde! Eh bien, elles sont
ravissantes malgrĂŠ tout. VoilĂ un vrai triomphe.
Mes soirĂŠes, qui sont bien longues maintenant, commencent Ă m'ennuyer
horriblement. Il est vrai que j'ai, en gĂŠnĂŠral, des volumes de lettres
Ă ĂŠcrire et des rapports Ă faire pour mes deux ou trois ministres. Ces
douces occupations ne m'empĂŞchent pas d'avoir le spleen depuis trois
semaines. Je fais les rĂŞves les plus noirs du monde, et mes pensĂŠes ne
sont pas d'une couleur plus gaie. Pas un mot de vous! J'en aurais bien
besoin pourtant. Si vous m'ĂŠcrivez tout de suite, adressez votre lettre
Ă Carcassonne. Il me faut une lettre de vous pour me ranimer. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Après Carcassonne, j'irai à Perpignan, à Toulouse et à Bordeaux.
J'espère bien y trouver un souvenir de vous. Je n'ai pas achevÊ le
croquis que je vous destine. Je vous l'apporterai Ă Paris. Dites-moi ce
que je pourrai vous apporter encore qui vous fasse plaisir. Voici une
fleur d'un arbrisseau ĂŠpineux qui croĂŽt aux environs de Marseille et
qui a une odeur de violette très-suave.
Adieu.
LXXXVI
Paris, vendredi matin, 3 novembre 1813.
Est-il possible que vous ne puissiez me dire tout ce que vous ĂŠcrivez?
Quelle est donc cette timiditĂŠ bizarre qui vous empĂŞche d'ĂŞtre franche
et qui vous fait chercher les mensonges les plus extraordinaires,
plutĂ´t que de laisser ĂŠchapper un mot de vĂŠritĂŠ qui me ferait tant
de plaisir? Parmi les bons sentiments dont vous me parlez, il y en
a un que je ne comprends pas, dites-vous; et vous ne cherchez pas
Ă me le faire comprendre, je ne le devine mĂŞme pas. Quant aux deux
autres, je vous avoue que je ne suis guère plus habile. Croyez-vous au
diable? Suivant moi, toute la question est lĂ . S'il vous fait peur,
arrangez-vous pour qu'il ne vous emporte pas. Si le diable est hors de
cause en cette affaire, comme je le suppose, reste Ă se demander si
l'on fait du mal ou du tort Ă quelqu'un. Je vous dis mon catĂŠchisme.
C'est, je crois, le meilleur, mais je ne vous le garantis pas. Je n'ai
jamais cherchĂŠ Ă faire des conversions, mais, jusqu'Ă prĂŠsent, on n'a
pu faire la mienne. Vous vous adressez, d'ailleurs, des reproches plus
sÊvères que je ne vous en adresse. Quelquefois, je cède à la tristesse
et Ă l'impatience. Rarement je vous accuse, sinon parfois de ce manque
de franchise qui me met dans une dĂŠfiance presque continuelle avec
vous, obligĂŠ que je suis de chercher toujours votre idĂŠe sous un
dĂŠguisement. Si j'avais ĂŠtĂŠ bien convaincu de ce que vous m'avez dit
l'autre jour, j'en serais très-malheureux, car je ne pourrais souffrir
de vous faire de la peine. Voyez pourtant qu'Ă force de dire tantĂ´t
blanc, tantĂ´t noir, vous me faites douter de tout. Je ne sais plus
ce que vous pensez, ce que vous sentez. Parlons donc une fois Ă cĹur
ouvert.
LXXXVII
Perpignan, 14 novembre.
. . . . . . . . . . . .
Vous aviez ÊtÊ si longtemps sans m'Êcrire, que je commençais à être
inquiet. Et puis j'ĂŠtais tourmentĂŠ d'une idĂŠe saugrenue que je n'ai pas
osÊ vous dire. Je visitais les arènes de NÎmes avec l'architecte du
dĂŠpartement, qui m'expliquait longuement les rĂŠparations qu'il avait
fait faire, lorsque je vis, Ă dix pas de moi, un oiseau charmant, un
peu plus gros qu'une mĂŠsange, le corps gris de lin, avec les ailes
rouges, noires et blanches. Cet oiseau ĂŠtait perchĂŠ sur une corniche
et me regardait fixement. J'interrompis l'architecte pour lui demander
le nom de cet oiseau. C'est un grand chasseur, et il me dit qu'il
n'en avait jamais vu de semblable. Je m'approchai, et l'oiseau ne
s'envola que lorsque j'Êtais assez près de lui pour le toucher. Il
alla se poser Ă quelques pas de lĂ , me regardant toujours. Partout oĂš
j'allais, il semblait me suivre, car je l'ai retrouvĂŠ Ă tous les ĂŠtages
de l'amphithÊâtre. Il n'avait pas de compagnon et son vol Êtait sans
bruit, comme celui d'un oiseau nocturne.
Le lendemain, je retournai aux arènes et je revis encore mon oiseau.
J'avais apportĂŠ du pain, que je lui jetai. Il le regarda, mais n'y
toucha pas. Je lui jetai ensuite une grosse sauterelle, croyant Ă la
forme de son bec qu'il mangeait des insectes, mais il ne parut pas
en faire cas. Le plus savant ornithologiste de la ville me dit qu'il
n'existait pas dans le pays d'oiseau de cette espèce.
Enfin, à la dernière visite que j'ai faite aux arènes, j'ai rencontrÊ
mon oiseau toujours attachĂŠ Ă mes pas, au point qu'il est entrĂŠ avec
moi dans un corridor ĂŠtroit et sombre oĂš lui, oiseau de jour, n'aurait
jamais dĂť se hasarder.
Je me souvins alors que la duchesse de Buckingham avait vu son mari
sous la forme d'un oiseau le jour de son assassinat, et l'idĂŠe me vint
que vous ĂŠtiez peut-ĂŞtre morte et que vous aviez pris cette forme pour
me voir. MalgrĂŠ moi, cette bĂŞtise me tourmentait, et je vous assure que
j'ai ĂŠtĂŠ enchantĂŠ de voir que votre lettre portait la date du jour oĂš
j'ai vu pour la première fois mon oiseau merveilleux.
Je suis arrivĂŠ ici avec un temps affreux. Une pluie comme on n'en voit
jamais dans le Nord a inondĂŠ toute la campagne, coupĂŠ les routes,
changÊ tous les ruisseaux en grosses rivières. Il m'est impossible de
sortir de la ville pour aller Ă Serrabonne, oĂš j'ai affaire. Je ne sais
combien de temps cela durera.
Il y a une foire Ă Perpignan, et de plus les Espagnols qui fuient
l'ĂŠpidĂŠmie encombrent la ville, si bien que je n'ai pu trouver Ă
me loger dans une auberge. Si je n'ĂŠtais parvenu Ă ĂŠmouvoir la
commisĂŠration d'un chapelier, j'aurais ĂŠtĂŠ rĂŠduit Ă coucher dans la
rue. Je vous ĂŠcris dans une petite chambre bien froide, Ă cĂ´tĂŠ d'une
cheminĂŠe qui fume, maudissant la pluie qui bat mes vitres. La servante
qui me sert ne parle que catalan et ne me comprend que lorsque je lui
parle espagnol. Je n'ai pas un livre et je ne connais personne ici.
Enfin, le pire de tout, c'est que, si le vent du nord ne s'Êlève pas,
je resterai ici je ne sais combien de jours, sans mĂŞme la ressource de
retourner Ă Narbonne, car le pont qui pouvait assurer ma retraite ne
tient plus Ă rien, et, si l'eau grossit, il sera emportĂŠ. Admirable
situation pour faire des rĂŠflexions et pour ĂŠcrire ses pensĂŠes. Mais
des pensÊes, je n'en ai guère maintenant. Je ne sais que m'impatienter.
J'ai Ă peine la force de vous ĂŠcrire. Vous ne me parlez pas d'une
lettre que je vous ai ĂŠcrite d'Arles. Peut-ĂŞtre s'est-elle croisĂŠe avec
la vĂ´tre?
J'ai ĂŠtĂŠ Ă la fontaine de Vaucluse, oĂš j'ai eu quelque envie d'ĂŠcrire
votre nom; mais il y avait tant de mauvais vers, de Sophies, de
Carolines, etc., que je n'ai pas voulu profaner votre nom en le mettant
en si mauvaise compagnie. C'est l'endroit le plus sauvage du monde. Il
n'y a que de l'eau et des rochers. Toute la vĂŠgĂŠtation se rĂŠduit Ă un
figuier qui a poussĂŠ je ne sais comment au milieu des pierres, et Ă des
capillaires très-ÊlÊgantes dont je vous envoie un Êchantillon. Lorsque
vous avez bu du sirop de capillaire pour un rhume, vous ne saviez
peut-ĂŞtre pas que cette plante avait une forme aussi jolie.
Je serai Ă Paris vers le 15 du mois prochain. Je ne sais pas du tout
quelle route je prendrai. Il est possible que je revienne par Bordeaux.
Mais, si le temps ne s'amĂŠliore pas, je reviendrai par Toulouse.
Je serai alors à Paris quinze jours plus tôt. J'espère trouver une
lettre de vous Ă Toulouse. S'il n'y en avait pas, je vous en voudrais
mortellement.
Adieu.
LXXXVIII
Paris, 17 novembre 1843.
Il me semble vous voir d'ici avec la mine que vous me faites
quelquefois; j'entends votre mine des mauvais jours; je crains, outre
votre mauvaise humeur, que vous ne vous soyez enrhumĂŠe. Rassurez-moi
bien vite sur ces deux points. Vous avez ĂŠtĂŠ si bonne et si gracieuse,
que je vous pardonnerais, je crois, un retour Ă la mauvaise humeur,
pourvu que vous me disiez que notre promenade ne vous a pas fait de
mal. J'ai dormi presque toute la journĂŠe, de ce demi-sommeil que vous
aimez. Le froid qu'il fait me dÊsespère. Il y avait autrefois un ÊtÊ
de la Saint-Martin, qui consolait un peu de la chute des feuilles.
Je crains que cela n'ait passĂŠ comme bien des choses de ma jeunesse.
Ăcrivez-moi, chère amie; dites-moi que vous vous portez bien, que
vous ne m'en voulez pas de mes reproches. Vous ne me corrigerez pas
de ce dĂŠfaut-lĂ . Si je n'ĂŠtais habituĂŠ Ă penser tout haut avec vous,
je serais presque tentÊ d'être toujours en colère, car vous êtes si
aimable alors, qu'on ne peut se repentir du chagrin qu'on a dĂť vous
causer; cependant, je me souviens seulement des moments oĂš nous avons
l'un et l'autre les mĂŞmes pensĂŠes, et oĂš il me semblait que vous
oubliez et mon importunitĂŠ et votre orgueil. On m'apporte votre lettre.
Je vous en remercie de cĹur. Vous ĂŞtes aussi bonne, aussi charmante que
vous l'ĂŠtiez avant-hier; de votre part, c'est doublement beau, car les
choses aimables que vous me dites, vous les sentez encore et ce n'est
pas la peur de mes colères qui vous les dicte. Si vous saviez tout le
plaisir que me fait un mot de vous qui vient de vous-mĂŞme, vous en
seriez moins avare. J'espère que vous ne changerez pas de situation
d'âme.
Je suppose que vous vous ĂŞtes fort amusĂŠe Ă votre bal d'hier. Moi, je
suis allĂŠ aux Italiens, d'oĂš l'on nous a proposĂŠ de nous mettre Ă la
porte, Ronconi ĂŠtant ivre ou en prison pour dettes. Enfin, Ă force de
crier, nous avons eu l'_Elisir d'amore_; puis je suis rentrĂŠ chez moi
et j'ai corrigĂŠ des ĂŠpreuves jusqu'Ă trois heures du matin. Vous croyez
que l'AcadÊmie m'occupe fort? Je m'aperçois que j'y pense aujourd'hui
pour la première fois. Je n ai guère de chances de rÊussir. Savez-vous
quelque sortilège pour que mon nom sorte de la boÎte de sapin nommÊe
urne?
LXXXIX
Paris, mardi soir, 22 novembre 1843.
J'ai eu une bonne part de votre courbature. C'est la rĂŠaction d'une
contrariĂŠtĂŠ morale sur le physique. J'ai quelque peine Ă croire que
votre entĂŞtement soit bien involontaire. Le fĂťt-il en effet, vous
auriez toujours tort, ce me semble. Qu'en rĂŠsulte-t-il? Vous parvenez,
en donnant de mauvaise grâce, à ôter du mÊrite à un sacrifice que vous
faites. Vous n'en sentez que plus vivement la peine de ce sacrifice,
puisque vous n'avez plus la consolation qu'on en apprĂŠcie le mĂŠrite.
Pour parler votre langue, vous vous donnez de doubles remords. Je
vous ai dit cela plus d'une fois. Vous m'accusez d'injustice et je ne
crois pas avoir mÊritÊ ce reproche. Si j'ai ÊtÊ injuste, ça n'a pas
ÊtÊ souvent. Vous me jugez très-mal. Il est vrai que nous avons des
caractères si diffÊrents, et surtout des points de vue si diffÊrents,
que nous ne pouvons jamais juger les choses de même. J'ai tâchÊ de ne
pas me mettre en colère. Je crains de n'avoir rÊussi qu'imparfaitement
et je vous en demande pardon. Toutefois, il y a eu quelque amĂŠlioration
de ma part, convenez-en. Comment voulez-vous disputer sur le sujet que
vous dites: Qui aime le mieux? La première chose à faire serait de
s'entendre sur le sens du verbe, et c'est ce que nous ne ferons jamais.
Nous sommes trop ignorants l'un et l'autre pour ĂŞtre jamais d'accord,
et surtout trop ignorants l'un de l'autre. Pour moi, j'ai cru vous
connaĂŽtre plus d'une fois, et vous m'ĂŠchappez toujours. J'avais raison
de dire que vous Êtiez comme Cerbère: _Three gentlemen at once._
Entre votre tĂŞte et votre cĹur, je ne sais jamais qui l'emporte; vous
ne le savez pas vous-mĂŞme, mais vous donnez toujours raison Ă la tĂŞte.
Il vaut mieux se quereller que de ne pas se voir. VoilĂ la seule chose
qui me paraisse dĂŠmontrĂŠe. Ă quand nous querellerons-nous? N'oubliez
pas que vendredi est mon jour de rĂŠception. J'ai embrassĂŠ une trentaine
de confrères depuis quatre jours[1], principalement ceux qui, m'ayant
promis, m'ont manquĂŠ de parole.
[1] Ă l'occasion de sa nomination comme membre de l'AcadĂŠmie des
inscriptions et belles-lettres.
XC
Paris, 13 dĂŠcembre 1843.
Nous nous sommes quittÊs sur un mouvement de colère; mais, ce soir, en
rĂŠflĂŠchissant avec calme, je ne regrette rien de ce que j'ai dit, si
ce n'est peut-ĂŞtre la vivacitĂŠ de quelques mots dont je vous demande
pardon. Oui, nous sommes de grands fous. Nous aurions dĂť le sentir plus
tĂ´t. Nous aurions dĂť voir plus tĂ´t combien nos idĂŠes, nos sentiments
ĂŠtaient contraires en tout et sur tout. Les concessions que nous nous
faisions l'un Ă l'autre n'avaient d'autre rĂŠsultat que de nous rendre
plus malheureux. Plus clairvoyant que vous, j'ai sur ce point de grands
reproches Ă me faire. Je vous ai fait beaucoup souffrir pour prolonger
une illusion que je n'aurais pas dĂť concevoir.
Pardonnez-moi, je vous en prie, car j'en ai souffert comme vous. Je
voudrais vous laisser de meilleurs souvenirs de moi. J'espère que
vous attribuerez Ă la force des choses le chagrin que j'ai pu vous
occasionner. Jamais je n'ai ĂŠtĂŠ avec vous tel que j'aurais voulu ĂŞtre,
ou plutĂ´t tel que j'avais le projet de paraĂŽtre Ă vos yeux. J'ai eu
trop de confiance en moi. J'ai cherchĂŠ dans mon cĹur Ă combattre ce que
ma raison me dĂŠmontrait. Ă tout prendre, peut-ĂŞtre vous en viendrez Ă
ne voir dans notre folie que son beau cĂ´tĂŠ, Ă ne vous rappeler que des
moments heureux que nous avons trouvÊs l'un auprès de l'autre. Quant
Ă moi, je n'ai pas le moindre reproche Ă vous faire. Vous avez voulu
concilier deux choses incompatibles et vous n'avez pas rĂŠussi. Ne
dois-je 'pas vous savoir grĂŠ d'avoir essayĂŠ pour moi l'impossible?
XCI
Paris, mardi soir, 1844.
J'ai attendu toute la journĂŠe une lettre de vous, Ce n'est pas ce
qui m'a empĂŞchĂŠ de vous ĂŠcrire, mais j'ai ĂŠtĂŠ horriblement occupĂŠ.
Je crois que le beau temps d'aujourd'hui m'a un peu soulagĂŠ le cĹur.
Je n'ai plus de colère, si j'en avais, et j'ai moins de tristesse
en me rappelant vos discours d'hier. Les nuages sont peut-ĂŞtre pour
beaucoup dans ce qui s'est passĂŠ entre nous. DĂŠjĂ une fois nous nous
sommes querellĂŠs par un temps d'orage; c'est que nos nerfs sont plus
forts que nous. J'ai grande envie de vous voir et de savoir comment
vous ĂŞtes au moral. Si nous essayions de faire demain cette promenade
si malencontreusement manquĂŠe hier? Que vous en semble? Votre orgueil
ne sera sans doute pas de cet avis. Mais c'est Ă votre cĹur que j'en
appelle.
Vous serez bien aimable de me rĂŠpondre un mot demain avant midi, si
vous ne pouvez ou si vous ne voulez pas. Mais ne venez pas si vous ĂŞtes
de mauvaise humeur, si vous avez quelque autre arrangement; enfin,
si vous avez la moindre idĂŠe que notre promenade n'effacera pas les
vilaines impressions d'hier.
XCII
Paris, samedi soir 15 janvier 1844.
Je suis bien fâchÊ de vous savoir souffrante. Mais vous me permettrez
de ne croire que ce que je pourrai de la manière dont vous avez
attrapĂŠ ce rhume. Il est rare que cet accident arrive Ă garder des
malades; il est encore plus rare de les garder avec la constance que
vous avez mise Ă le faire. Toutes les maladies autour de vous sont
arrivĂŠes beaucoup trop Ă point pour ne m'ĂŞtre pas un peu suspectes.
Autrefois, vous ĂŠtiez plus franche. Vous m'ĂŠcriviez tout simplement
une page de reproches, et vous vous disiez fort en colère. Maintenant,
vous avez un autre système.--Vous m'Êcrivez de petits billets fort
jolis et coquets, et il vous survient des malades et des rhumes. Je
crois que j'aimais mieux l'autre procĂŠdĂŠ. Heureusement, les bouderies
passent et les malades guÊrissent. J'espère vous voir en belle humeur
mardi, si vous l'avez pour agrĂŠable. Vous me traitez comme le soleil,
qui ne paraĂŽt qu'une fois par mois. Si j'ĂŠtais de meilleure humeur,
je pourrais pousser plus loin la comparaison; mais je suis moi-mĂŞme
très-souffrant, et je n'ai pas comme vous le bonheur d'être gâtÊ par
tout ce qui m'entoure et d'aimer la tisane de dattes et de figues.
Vous me demandez de vous faire un dessin de nos bois. Cela me serait
bien difficile sans les revoir. Vous ne croyez plus Ă Bellevue,
dites-voys; vous devez comprendre par lĂ qu'il n'est pas aisĂŠ de les
inventer. D'ailleurs, je ne les regarde pas avec l'attention que vous
mettez Ă tout observer.--Moi, je ne vois que vous. Oui, ces bois sont
invraisemblables, si près de Paris et si loin.--Si vous y tenez bien
fort, j'essayerai; mais vous me direz d'abord ce que vous voulez que je
fasse, je veux dire quelle partie de nos bois. Adieu; je ne suis pas
très-content de vous. Un mois passÊ sans se voir est un peu trop. J'ai,
demain et après, deux corvÊes bien ennuyeuses que je vous conterai.
Adieu.
XCIII
Paris, 5 fĂŠvrier 1844.
Vous me reprochez ma duretĂŠ, et peut-ĂŞtre avez-vous quelque raison.
Il me semble cependant que vous seriez plus juste en disant colère ou
impatience. Il serait encore assez bien de votre part de rĂŠflĂŠchir si
cette colère ou cette duretÊ est motivÊe ou si elle ne l'est pas.
Examinez s'il n'est pas bien triste pour moi de me trouver sans cesse
aux prises avec votre orgueil, et de voir que votre orgueil a la
prĂŠfĂŠrence. J'avoue que je ne comprends nullement ce que vous me dites
quand vous parlez de votre obĂŠissance qui vous donne le tort de tout,
et ne vous donne le mĂŠrite de rien. Le contraire pourrait se soutenir
mieux, ce me semble; mais il n'y a de votre part ni tort ni mĂŠrite.
Rappelez-vous un moment et avec franchise ce que vous ĂŞtes pour moi.
Vous acceptez ces promenades qui sont ma vie; mais cette glace sans
cesse renaissante qui me dÊsespère chaque fois davantage, ce plaisir
de calcul ou, j'aime mieux le croire, d'instinct, que vous avez Ă me
faire dĂŠsirer ce que vous refusez obstinĂŠment: tout cela peut excuser
ma duretĂŠ; mais, s'il y a un tort de votre part, c'est assurĂŠment
cette prĂŠfĂŠrence que vous donnez Ă votre orgueil sur ce qu'il y a de
tendresse en vous. Le premier sentiment est au second comme un colosse
Ă un pygmĂŠe.--Cet orgueil n'est au fond qu'une variĂŠtĂŠ de l'ĂŠgoĂŻsme.
Voulez-vous un jour mettre de cĂ´tĂŠ ce grand dĂŠfaut, et ĂŞtre pour moi
aussi aimable que vous le pourrez? J'accepterais très-volontiers ce
parti si vous me promettiez d'ĂŞtre tout Ă fait franche, et si vous
aviez le courage de tenir cet engagement, ce serait une expĂŠrience
peut-ĂŞtre bien triste pour moi. Cependant, je l'accepterais avec joie,
puisque vous n'auriez, dites-vous, que du bonheur dans ce cas.--Adieu,
Ă bientĂ´t. Mettez vos bottes de sept lieues, nous ferons une belle
promenade; si le temps n'ĂŠtait pas plus mauvais qu'il y a quelques
jours, vous n'auriez pas de risques de vous enrhumer. Je suis bien
souffrant de migraine et d'Êtourdissement, mais j'espère que vous me
guĂŠrirez.
XCIV
Paris, 12 mars 1844.
C'est fort bien. Comme si je n'avais pas assez d'ennuis de toute
espèce! Cent visites à faire! Un libraire qui me fait envoyer un
rapport de quarante pages Ă faire et Ă discuter! Des ĂŠpreuves Ă
corriger! Il me semble que vous devriez bien, sachant tout cela,
m'ĂŠcrire au moins quelques lignes d'encouragement. Je suis Ă peu près Ă
bout de mon courage et de ma patience. Heureusement, cela finit jeudi
prochain[1].--Jeudi à une heure, je serai redevenu un bipède ordinaire;
d'ici lĂ , est-ce trop vous demander que quelques mots tendres comme
vous en avez trouvÊ la dernière fois que nous nous sommes vus? Il est
trois heures, et je vous quitte pour mes ĂŠpreuves de _Mademoiselle
Arsène Guillot._--Lundi ou plutôt mardi.
[1] Sa rĂŠception Ă l'AcadĂŠmie des inscriptions et belles-lettres.
XCV
Jeudi soir, 15 mars 1844.
Cela m'a fait un sensible plaisir[1], d'autant plus que je m'attendais
Ă une dĂŠfaite. On m'apportait les bulletins Ă mesure qu'ils
s'Êlaboraient. Il me semblait impossible de rÊussir; ma mère, qui
souffrait depuis quelques jours d'un rhumatisme aigu, a ĂŠtĂŠ guĂŠrie du
coup.--J'en ai d'autant plus envie de vous voir. Essayez si je vous en
aime mieux ou moins, et cela le plus tĂ´t possible. Je suis harassĂŠ des
courses que j'ai faites, car il faut maintenant remercier, et remercier
amis et ennemis, pour montrer qu'on a de la grandeur d'âme. J'ai le
bonheur d'avoir ĂŠtĂŠ black-boulĂŠ par des gens que je dĂŠteste, car c'est
un bonheur que de n'avoir pas le fardeau de la reconnaissance Ă l'ĂŠgard
des personnes qu'on estime peu. Ăcrivez-moi, je vous prie, quand vous
voulez que nous nous voyions.
J'ai bien envie que nous fassions quelque longue promenade.
Vous êtes sorcière, en effet, d'avoir si bien devinÊ l'ÊvÊnement. Mon
Homère m'avait trompÊ, ou bien c'est à M. Vatout que s'adressait sa
prÊdiction menaçante.
Adieu, _dearest friend_! Entre mes ĂŠpreuves Ă corriger, mon rapport
Ă faire, et un peu aussi le tracas que j'ai eu depuis trois jours,
je n'ai guère trouvÊ le temps de dormir. Je vais essayer.--J'aurais
d'assez drĂ´les d'histoires Ă vous conter des hommes et des choses.
[1] Sa nomination comme membre de l'AcadÊmie française.
XCVI
17 mars 1844.
Je vous remercie bien de vos compliments, mais je veux mieux encore. Je
veux vous voir et faire une longue promenade. Je trouve cependant que
vous avez pris la chose trop au tragique. Pourquoi pleurez-vous? les
quarante fauteuils ne valaient pas une petite larme. Je suis excĂŠdĂŠ,
ÊreintÊ, dÊmoralisÊ et complÊtement _out of my wits_. Puis Arsène
Guillot fait un _fiasco_ Êclatant et soulève contre moi l'indignation
de tous les gens soi-disant vertueux, et particulièrement des femmes
Ă la mode qui dansent la polka et suivent les sermons du P. Ravignan;
tant il y a que l'on dit que je fais comme les singes, qui grimpent au
haut des arbres et qui, arrivĂŠs sur la plus haute branche, font des
grimaces au monde. Je crois avoir perdu des voix par cette scandaleuse
histoire; d'un autre cĂ´tĂŠ, j'en gagne. Il se trouve des gens qui m'ont
black-boulĂŠ sept fois et qui me disent qu'ils ont ĂŠtĂŠ mes plus chauds
partisans. Ne trouvez-vous pas que cela vaut bien la peine de faire
ainsi le pĂŠchĂŠ de mensonge, surtout pour le grĂŠ que j'en sais aux gens?
Tout ce monde oĂš j'ai vĂŠcu presque uniquement depuis quinze jours me
fait dĂŠsirer ardemment de vous voir. Au moins nous sommes sĂťrs l'un
de l'autre, et, quand vous me faites des mensonges, je puis vous les
reprocher et vous savez vous les faire pardonner. Aimez-moi, quelque
vĂŠnĂŠrable que je sois devenu depuis bientĂ´t trois jours.
XCVII
Paris, 26 mars 1844.
Je crains que le discours ne vous ait paru un peu long. J'espère qu'il
ne faisait pas aussi froid de votre cĂ´tĂŠ que du mien. Je suis encore Ă
grelotter. Nous aurions dÝ faire une courte promenade ensemble après
la cĂŠrĂŠmonie. Vous avez pu voir quelle horrible toux j'ai. Cela aurait
presque pu passer pour de la cabale. Avant la sĂŠance, l'orateur m'a
fort priĂŠ de lui dire dans quelle partie de la salle se trouvait la
personne Ă qui il avait envoyĂŠ des billets. L'avez-vous trouvĂŠ mieux
en costume qu'en frac? Vous pourrez me persuader bien des choses,
mais jamais que vous parliez autrement que sÊrieusement de gâteaux
quand vous avez faim. Je maintiens mon adjectif, et vous mĂŞme en avez
reconnu la justesse. Cela est facile Ă voir par le courroux que vous
en montrez. Vous dites que vous ne savez que rĂŞver et jouer.--Vous
savez, en outre, cacher vos pensĂŠes, et c'est ce qui me dĂŠsole.
Pourquoi, après si longtemps que nous sommes ce que nous sommes l'un Ă
l'autre, ĂŞtes-vous encore Ă rĂŠflĂŠchir plusieurs jours avant de rĂŠpondre
franchement à la question la plus simple? On dirait que vous soupçonnez
des pièges partout. Adieu; j'ai ÊtÊ bien content de vous voir. J'ai eu
de la peine Ă vous trouver cachĂŠe sous le chapeau de votre voisine.
Autre enfantillage. Avez-vous vu ce que je vous ai envoyĂŠ? en pleine
AcadĂŠmie? Mais vous ne voulez jamais rien voir.
XCVIII
Lundi soir. Mars 1844.
Je commence, je crois, Ă comprendre votre ĂŠnigme. En rĂŠflĂŠchissant Ă ce
que vous m'avez dit aujourd'hui, j'arrive oĂš m'avait dĂŠjĂ conduit une
espèce de divination instinctive; assurÊment, mon plus grand ennemi ou,
si vous voulez, mon rival dans votre cĹur, c'est votre orgueil; tout ce
qui le froisse vous rĂŠvolte. Vous suivez votre idĂŠe, peut-ĂŞtre Ă votre
insu, dans les plus petits dĂŠtails. N'est-ce pas votre orgueil qui
est satisfait lorsque je baise votre main? Vous ĂŞtes heureuse alors,
m'avez-vous dit, et vous vous abandonnez Ă votre sensation parce que
votre orgueil se plaĂŽt Ă une dĂŠmonstration d'humilitĂŠ. Vous voulez que
je sois statue parce qu'alors vous ĂŞtes ma vie. Mais vous ne voulez pas
ĂŞtre statue Ă votre tour; surtout, vous ne voulez pas cette ĂŠgalitĂŠ de
bonheur donnÊ et reçu, parce que tout ce qui est ÊgalitÊ vous dÊplaÎt.
Que vous dirai-je Ă cela? que, si cet orgueil voulait se contenter
de ma soumission et de mon humilitĂŠ, il devrait ĂŞtre content; je lui
cĂŠderai toujours, pourvu qu'il laisse votre cĹur suivre ses bons
mouvements. Pour moi, je ne mettrai jamais sur une mĂŞme ligne mon
bonheur et mon orgueil, et, si vous vouliez me suggĂŠrer des formules
d'humilitĂŠ nouvelles, je les adopterais sans hĂŠsiter. Mais pourquoi
de l'orgueil, c'est-Ă -dire de l'ĂŠgoĂŻsme, entre nous? ĂŞtes-vous donc
insensible au plaisir de s'oublier l'un pour l'autre? Ce sentiment
d'amitiĂŠ si ĂŠtrange que nous ĂŠprouvons tous les deux quelquefois,
qui, ce matin, par exemple, nous a amenĂŠs lĂ oĂš nous n'avions aucune
_raison_ d'aller, n'est-ce pas une puissance plus douce et plus vive
que toutes celles que vous pourrait donner votre dĂŠmon d'orgueil? Vous
avez ĂŠtĂŠ si aimable ce matin, que je ne veux ni ne peux vous quereller.
Je suis cependant d'une humeur affreuse. Je vous disais que j'allais
m'ennuyer Ă un dĂŽner. Figurez-vous que je me suis trompĂŠ de jour, que
j'ai mortellement contrariĂŠ des gens qui ne m'attendaient pas et qui
me l'ont bien rendu. J'ai passĂŠ ma soirĂŠe Ă regretter de n'ĂŞtre pas
seul chez moi avec mes souvenirs. Je m'attends Ă une mauvaise lettre
de vous. J'ai voulu vous ĂŠcrire le premier, car je serai furieux sans
doute après-demain. Vous me rendrez doux comme un mouton si vous
voulez. VoilĂ l'hiver revenu tout Ă fait. Comment avez-vous supportĂŠ le
froid de l'autre jour? celui-ci ne vous effiaye-t-il pas? Je ne sais
si vous ferez bien de sortir demain; je crains la responsabilitĂŠ du
conseil, et j'aime mieux que vous dĂŠcidiez. VoilĂ encore de l'humilitĂŠ.
XCIX
Strasbourg, 30 avril 1844.
Je suis encore ici, grâce aux lenteurs du conseil municipal. Il m'a
fallu passer un jour Ă faire de l'ĂŠloquence la plus sublime pour les
exhorter Ă restaurer une vieille ĂŠglise. Ils rĂŠpondent qu'ils ont plus
besoin de tabac que de monuments, et qu'ils feront un magasin de mon
Êglise. Je partirai demain pour Colmar, et je pense être à Besançon le
lendemain, c'est-à -dire jeudi. Je n'y demeurerai guère que le temps
de jeter quelques fleurs sur la tombe de Nodier, et je tâcherai de
revenir bien vite voir nos bois. La saison me semble ici plus avancĂŠe
qu'Ă Paris. La campagne est admirable et d'un vert qu'aucun pinceau ne
saurait imiter.
Je suis bien content de vous trouver si gaie; pour moi, je ne puis
vous en dire autant. Il me semble que j'ai la fièvre tous les soirs
et je suis d'une humeur horrible. La cathĂŠdrale, que j'aimais fort
autrefois, m'a semblĂŠ laide, et c'est Ă peine si les vierges sages et
les folles de Sabine, de Steinbach, ont trouvÊ grâce devant moi. Vous
avez bien raison d'aimer Paris. C'est, après tout, la seule ville oÚ
l'on puisse vivre. OĂš trouveriez-vous ailleurs ces promenades, ces
musĂŠes oĂš nous avions tant de choses Ă nous dire et tant de tendresses
aussi? Je voudrais croire Ă ce que vous me promettez, c'est-Ă -dire que
nous reprendrons notre causerie interrompue, comme si nous n'avions
pas ĂŠtĂŠ sĂŠparĂŠs. Je suis sĂťr de ce qui m'attend. Une ĂŠpaisse glace se
sera formĂŠe. Vous ne me reconnaĂŽtrez mĂŞme pas. DussĂŠ-je vous quereller
encore, cela vaut mieux que de ne pas vous voir.
Adieu.
C
Paris, samedi 3 aoĂťt 1844.
Je suppose que vous ĂŞtes partie pour la campagne en prenant contre
vos promesses un _french leave._ C'est fort aimable Ă vous. J'ai eu
la naĂŻvetĂŠ d'attendre quelque signifiance de vous tous les jours. On
se corrige difficilement. Dans le cas, très-peu probable, oÚ vous
seriez Ă Paris, et dans celui, encore plus improbable, oĂš vous seriez
curieuse d'assister Ă une sĂŠance de l'AcadĂŠmie des inscriptions, j'ai
deux billets Ă vos ordres. Cela est fort ennuyeux. En attendant,
j'ai travaillĂŠ de mon mieux Ă ma difficile besogne, qui sera bientĂ´t
terminĂŠe. Puis je partirai pour un mois ou deux. Si cela pouvait vous
donner des remords ou, ce que j'aimerais bien mieux, l'envie de me
voir, vous me feriez vite oublier ma mauvaise humeur.
CI
Paris, 19 aoĂťt 1844.
. . . . . . . . . . . .
Il est tout Ă fait dĂŠcidĂŠ que je partirai pour l'AlgĂŠrie du 8 au 10 du
mois prochain. Je resterai ou plutôt je courrai ça et là , jusqu'à ce
que la fièvre ou les pluies viennent m'interrompre. De toute façon, je
ne vous reverrai qu'en janvier. Vous auriez dĂť songer Ă cela avant de
partir. Quand je dis que vous ne me reverrez que l'annĂŠe prochaine,
cela dĂŠpend de vous. Pendant que vous apprenez le grec, j'ĂŠtudie
l'arabe. Mais cela me semble une langue diabolique, et jamais je
ne pourrai en savoir deux mots. Ă propos de Syra, cette chaĂŽne que
vous aimez est allÊe en Grèce et dans bien d'autres lieux. Je l'ai
choisie parce qu'elle est d'un ancien travail antivulgaire. J'ai
supposĂŠ qu'elle vous plairait. Vous rappelle-t-elle nos promenades et
nos causeries sans fin? Je suis allĂŠ dimanche dĂŽner chez le gĂŠnĂŠral
Narvaez, qui donnait son raout et pour la fĂŞte de sa femme. Il n'y
avait guère que des Espagnoles. On m'en a montrÊ une qui a voulu se
laisser mourir de faim par amour, et qui s'ĂŠteint tout doucement. Ce
genre de mort doit vous sembler bien cruel. Il y en avait une autre,
mademoiselle de ***, que le gĂŠnĂŠral Serrano a plantĂŠe lĂ pour Sa grosse
MajestĂŠ Catholique; mais elle n'en est pas morte, et a mĂŞme l'air de
se porter très-bien. Il y avait encore madame Gonzalez Bravo, sĹur de
l'acteur Romea et belle-sĹur de la mĂŞme MajestĂŠ, qui, Ă ce qu'on dit,
se fait un grand nombre de belles-sĹurs. Celle-ci est très-jolie et
très-spirituelle. Adieu. . . . . .
CII
Paris, lundi, septembre 1844
Nous nous sommes sĂŠparĂŠs l'autre jour ĂŠgalement mĂŠcontents l'un de
l'autre. Nous avions tort tous les deux, car c'est la force des choses
qu'il fallait seulement accuser. Le mieux eĂťt ĂŠtĂŠ de ne pas nous revoir
de longtemps. Il est ĂŠvident que nous ne pouvons plus maintenant nous
trouver ensemble sans nous quereller horriblement. Tous les deux, nous
voulons l'impossible: vous, que je sois une statue; moi, que vous
n'en soyez pas une. Chaque nouvelle preuve de cette impossibilitĂŠ,
dont au fond nous n'avons jamais doutĂŠ, est cruelle pour l'un et pour
l'autre. Pour ma part, je regrette toute la peine que j'ai pu vous
donner. Je cède trop souvent à des mouvements de colère absurde. Autant
vaudrait-il se fâcher de ce que la glace est froide.
J'espère que vous me pardonnerez maintenant; il ne me reste nulle
colère, seulement une grande tristesse. Elle serait moindre si nous ne
nous ĂŠtions pas quittĂŠs de la sorte. Adieu, puisque nous ne pouvons
ĂŞtre amis qu'Ă distance. Vieux l'un et l'autre, nous nous retrouverons
peut-ĂŞtre avec plaisir. En attendant, dans le malheur ou dans le
bonheur, souvenez-vous de moi. Je vous ai demandĂŠ cela il y a je ne
sais combien d'annÊes. Nous ne pensions guère alors à nous quereller.
Adieu encore, pendant que j'ai du courage.
CIII
Paris, jeudi, 6 septembre 1844.
Il me semble que je vous ai vue en rĂŞve. Nous sommes demeurĂŠs si peu de
temps ensemble, que je ne vous ai rien dit de ce que je voulais vous
dire. Vous-mĂŞme, vous aviez l'air de ne pas trop savoir si j'ĂŠtais
une rĂŠalitĂŠ. Quand nous verrons-nous? Je fais en ce moment le mĂŠtier
le plus bas et le plus ennuyeux: je sollicite pour l'AcadĂŠmie des
inscriptions. Il m'arrive les scènes les plus ridicules, et souvent il
me prend des envies de rire de moi-mĂŞme, que je comprime pour ne pas
choquer la gravitĂŠ des acadĂŠmiciens que je vais voir. C'est un peu Ă
l'aveugle que je me suis embarquĂŠ, ou plutĂ´t qu'on m'a embarquĂŠ dans
cette affaire. Mes chances ne sont point mauvaises, mais le mĂŠtier est
des plus rudes, et le pire de tout, c'est que le dĂŠnoĂťment se fera
longtemps attendre: vraisemblablement jusqu'Ă la fin d'octobre, et
peut-ĂŞtre plus. Je ne sais si je pourrai aller en AlgĂŠrie cette annĂŠe.
La seule rĂŠflexion qui me console, c'est que je resterai ici et que,
par consĂŠquent, je vous verrai. Cela vous fera-t-il plaisir? Dites-moi
que oui et gâtez-moi bien. Je suis tellement abruti par ces ennuyeuses
visites, que j'ai besoin de toutes vos câlineries, et des plus tendres,
pour me donner un peu de courage et de vie.
Vous avez tort d'ĂŞtre jalouse des inscriptions. J'y mets quelque
amour-propre, comme Ă une partie d'ĂŠchecs engagĂŠe avec un adversaire
habile; mais je ne crois pas que la perte ou le gain m'affecte le quart
autant qu'une de nos querelles. Mais quel vilain mĂŠtier que celui de
solliciteur! Avez-vous jamais vu des chiens entrer dans le terrier
d'un blaireau? Quand ils ont quelque expĂŠrience, ils font une mine
effroyable en y entrant, et souvent ils en sortent plus vite qu'ils
n'y sont entrĂŠs, car c'est une vilaine bĂŞte Ă visiter que le blaireau.
Je pense toujours au blaireau en tenant le cordon de la sonnette d'un
acadĂŠmicien, et je me vois _in the mind's eye_ tout Ă fait semblable au
chien que je vous disais. Je n'ai pas encore ĂŠtĂŠ mordu cependant. Mais
j'ai fait de drĂ´les de rencontres.
Adieu.
CIV
Paris, 14 septembre 1844.
Tout ĂŠtait prĂŞt et nous allions partir aujourd'hui, quand est venue
une bourrasque qui a jetĂŠ nos projets au vent. Il y a conflit entre la
guerre et l'intĂŠrieur. La guerre ne veut point de nous. Nous restons,
ou, pour mieux dire, je ne vais pas en Afrique. Je vais passer une
quinzaine de jours en courses et je reviendrai Ă Paris. Ă part la
vexation qui accompagne tout projet avortÊ, et le regret très-vif
d'avoir employĂŠ deux mois Ă apprendre un tas de choses inutiles,
j'ai pris mon parti avec la plus grande impassibilitĂŠ. Peut-ĂŞtre
devinerez-vous pourquoi.
J'ai trouvÊ dans votre dernière lettre quelques phrases malsonnantes
pour lesquelles je pourrais bien vous faire la guerre, si je ne
trouvais, comme vous, qu'il est inutile et, qui plus est, dangereux
et triste de se disputer Ă distance.--Je ne me reprĂŠsente pas trop
comment vous passez les vingt-quatre heures de la journĂŠe. Je trouve
bien l'emploi de seize, mais il y en a dix sur lesquelles je voudrais
des dĂŠtails. Lisez-vous toujours HĂŠrodote? Mais quel dommage que vous
n'essayiez pas un peu de l'original avec la traduction de Lanher,
que vous avez, je pense! vous n'aurez guère d'autre difficultÊ que
l'excès des ὾ ioniens. Si vous avez à votre disposition l'_Anabase_
de XĂŠnophon, vous pourrez y prendre plaisir, surtout si vous avez une
carte d'Asie sous les yeux. Je ne me rappelle guère les dialogues
marins. Lisez plutĂ´t _Jupiter confondu_, ou bien _Jupiter tragique_, ou
bien _le Festin_ ou _les Lapithes_, Ă moins que vous ne m'en gardiez
l'ĂŠtrenne.
Je suis sĂťr que vous ĂŞtes florissante, toute robes et fleurs, et j'ose
vous conseiller des lectures grecques! Adieu; ĂŠcrivez-moi vite et ne
vous moquez pas de moi. Je partirai lundi pour aller je ne sais oĂš,
mais pas trop loin, selon tous mes calculs.
CV
Poitiers, 15 septembre 1844.
Si je rĂŠponds tard Ă votre lettre du mois dernier, que je trouve
ici, ce n'est pas, comme votre mauvaise conscience vous le dirait,
par reprĂŠsailles pour la lenteur que vous avez mise Ă me donner de
vos nouvelles. Vous avez passĂŠ dix jours entiers sans que l'idĂŠe de
m'ĂŠcrire une ligne vous vĂŽnt entĂŞte, et c'est bien mal. Vous me parlez
de vos contemplations Ă D... Je crois que vous vous y ĂŞtes fort amusĂŠe,
et je ne puis m'empĂŞcher de croire que vous ne vous amusez que quand
vous trouvez occasion de faire des coquetteries. Pour moi, j'ai menĂŠ
une vie maussade au dernier point depuis mon dĂŠpart de Paris. Comme
Ulysse, j'ai vu beaucoup de mĹurs, d'hommes et de villes. J'ai trouvĂŠ
les unes et les autres très-laides. Puis j'ai eu quelques accès de
fièvre, qui m'ont ÊtonnÊ et chagrinÊ en me montrant comme je dÊcline.
J'ai trouvĂŠ le pays le plus plat et le plus insignifiant de la France;
mais il y a beaucoup de bois et de grands arbres et des solitudes oĂš
j'aurais bien aimĂŠ Ă vous rencontrer. Votre souvenir se reprĂŠsente Ă
moi maintenant dans une foule de lieux, mais je le lie surtout aux bois
et aux musĂŠes. Si vous avez quelque plaisir Ă occuper une place dans ma
mĂŠmoire, et une grande place, vous devez penser qu'avec la vie que je
mène, je ne vous oublie pas. Tel arbre me rappelle telle conversation.
Je passe mon temps Ă mĂŠditer sur nos promenades. J'admire beaucoup
Scribe d'avoir fait rire un public vertueux et nĂŠo-catholique avec les
prix de vertu. Je suis ĂŠgalement surpris de ce que vous me dites de
son dĂŠbit. Autrefois, il lisait comme un fiacre. Il faut croire que
c'est l'habit acadĂŠmique qui donne cet aplomb, et cela me rend un peu
d'espoir.
Depuis mon dĂŠpart, je n'ai pas dĂŠballĂŠ deux fois mon discours, et,
si cela continue, je ne crois pas, en vĂŠritĂŠ, que j'y puisse changer
une ligne. Je m'attends qu'au dernier moment je serai ĂŠpouvantĂŠ de la
quantitĂŠ de sottises que j'aurai laissĂŠes. Tant que je n'aurai pas
tournĂŠ mon timon vers Paris, je ne saurai pas l'ĂŠpoque de mon retour
avec quelque certitude. Si mon gouvernement ne me force pas Ă aller
plus loin que Saintes, je crois que nous arriverons à peu près en même
temps. Quel bonheur si nous pouvions nous voir dès le lendemain! Adieu;
ĂŠcrivez-moi Ă Saintes, je pense y ĂŞtre bientĂ´t et m'y arrĂŞter quelques
jours.
CVI
Parthenay, 17 septembre 1844.
Votre lettre, que j'ai reçue à Saintes, a fait un peu diversion aux
tribulations que j'y ĂŠprouvais. J'ĂŠtais fort empĂŞchĂŠ Ă plonger dans
le dĂŠsespoir quatre mille de mes concitoyens qui m'envoyaient des
dĂŠputations et me faisaient des discours fabuleux.
Entre mon devoir et ma sensibilitĂŠ naturelle, j'ĂŠtais fort malheureux.
Enfin, j'ai pris le parti le plus sage, et j'ai tranchĂŠ du proconsul.
D'ici Ă un an, je n'oserais pas repasser Ă Saintes. Je vois avec
plaisir que vous vous souvenez de Paris Ă D... J'avais craint que
vous n'eussiez oubliĂŠ nos bois et nos gazons ĂŠmaillĂŠs. Pour moi, j'y
pense toujours plus vivement, surtout Ă prĂŠsent que je viens de faire
un pas vers Paris. Suivant toute apparence, je vous y prĂŠcĂŠderai. J'y
serai dans dix jours au plus tard, Ă moins d'accidents que je ne puis
prĂŠvoir. Et vous? voilĂ le plus important. Ătre Ă Paris sans vous
me semblera bien plus dur que de courir les champs comme je fais Ă
prĂŠsent. J'ai une soif de vous voir que vous ne pouvez comprendre.
Pourrez-vous, voudrez-vous revenir pour dire adieu Ă vos domaines de
la rive gauche? je cherche Ă n'y pas penser, mais je n'y puis rĂŠussir.
Pour me prĂŠparer aux dĂŠceptions comme Scapin quand il revenait de
voyage, je cherche Ă me reprĂŠsenter _Your Ladyship_, statue cuirassĂŠe
aussi mĂŠchante quelle m'est apparue quelquefois. J'ai beau faire, je
vous vois toujours telle que vous avez ÊtÊ la dernière fois que nous
nous assĂŽmes si commodĂŠment sur un quartier de roc. Vraiment, je le
crois un peu, d'abord parce que vous me l'avez promis, et puis je ne
me persuaderai jamais que nous ayons pu changer tous les deux après
avoir ĂŠtĂŠ aussi unis de pensĂŠe. Si vous songez Ă revenir, ĂŠcrivez-moi
à Blois, j'y serai bientôt, ou bien après le 25 à Paris, et dites-moi
quand je pourrai vous voir et le plus tĂ´t possible. Je vous ĂŠcris d'une
horrible ville de chouans et d'une auberge abominable, oĂš l'on fait un
bruit infernal. On met tant de cheveux dans tout ce qu'on me donne Ă
dĂŽner, que je mange Ă peine. J'ai trouvĂŠ aujourd'hui Ă Saint-Maixent
des femmes avec la coiffure du XIVe siècle, et des corsages presque
du mĂŞme temps qui laissent voir la chemise, laquelle est en toile Ă
torchon, boutonnĂŠe sous le cou et fendue comme celle des hommes. MalgrĂŠ
le pain d'Êpice qui est dessous, cela me semble très-joli. Je me suis
presque foulĂŠ la main aujourd'hui et je n'ai plus la force d'ĂŠcrire.
Adieu.
CVII
Perpignan, 14 novembre.
. . . . . . . . . . . .
Vous aviez ÊtÊ si longtemps sans m'Êcrire, que je commençais à être
inquiet. Et puis j'ĂŠtais tourmentĂŠ d'une idĂŠe saugrenue que je n'ai pas
osÊ vous dire. Je visitais les arènes de NÎmes avec l'architecte du
dĂŠpartement, qui m'expliquait longuement les rĂŠparations qu'il avait
fait faire, lorsque je vis, Ă dix pas de moi, un oiseau charmant, un
peu plus gros qu'une mĂŠsange, le corps gris de lin, avec les ailes
rouges, noires et blanches. Cet oiseau ĂŠtait perchĂŠ sur une corniche
et me regardait fixement. J'interrompis l'architecte pour lui demander
le nom de cet oiseau. C'est un grand chasseur, et il me dit qu'il
n'en avait jamais vu de semblable. Je m'approchai, et l'oiseau ne
s'envola que lorsque j'Êtais assez près de lui pour le toucher. Il
alla se poser Ă quelques pas de lĂ , me regardant toujours. Partout oĂš
j'allais, il semblait me suivre, car je l'ai retrouvĂŠ Ă tous les ĂŠtages
de l'amphithÊâtre. Il n'avait pas de compagnon et son vol Êtait sans
bruit, comme celui d'un oiseau nocturne.
Le lendemain, je retournai aux arènes et je revis encore mon oiseau.
J'avais apportĂŠ du pain, que je lui jetai. Il le regarda, mais n'y
toucha pas. Je lui jetai ensuite une grosse sauterelle, croyant Ă la
forme de son bec qu'il mangeait des insectes, mais il ne parut pas
en faire cas. Le plus savant ornithologiste de la ville me dit qu'il
n'existait pas dans le pays d'oiseau de cette espèce.
Enfin, à la dernière visite que j'ai faite aux arènes, j'ai rencontrÊ
mon oiseau toujours attachĂŠ Ă mes pas, au point qu'il est entrĂŠ avec
moi dans un corridor ĂŠtroit et sombre oĂš lui, oiseau de jour, n'aurait
jamais dĂť se hasarder.
Je me souvins alors que la duchesse de Buckingham avait vu son mari
sous la forme d'un oiseau le jour de son assassinat, et l'idĂŠe me vint
que vous ĂŠtiez peut-ĂŞtre morte et que vous aviez pris cette forme pour
me voir. MalgrĂŠ moi, cette bĂŞtise me tourmentait, et je vous assure que
j'ai ĂŠtĂŠ enchantĂŠ de voir que votre lettre portait la date du jour oĂš
j'ai vu pour la première fois mon oiseau merveilleux.
Je suis arrivĂŠ ici avec un temps affreux. Une pluie comme on n'en voit
jamais dans le Nord a inondĂŠ toute la campagne, coupĂŠ les routes,
changÊ tous les ruisseaux en grosses rivières. 11 m'est impossible de
sortir de la ville pour aller Ă Serrabonne, oĂš j'ai affaire. Je ne sais
combien de temps cela durera.
Il y a une foire Ă Perpignan, et de plus les Espagnols qui fuient
l'ĂŠpidĂŠmie encombrent la ville, si bien que je n'ai pu trouver Ă
me loger dans une auberge. Si je n'ĂŠtais parvenu Ă ĂŠmouvoir la
commisĂŠration d'un chapelier, j'aurais ĂŠtĂŠ rĂŠduit Ă coucher dans la
rue. Je vous ĂŠcris dans une petite chambre bien froide, Ă cĂ´tĂŠ d'une
cheminĂŠe qui fume, maudissant la pluie qui bat mes vitres. La servante
qui me sert ne parle que catalan et ne me comprend que lorsque je lui
parle espagnol. Je n'ai pas un livre et je ne connais personne ici.
Enfin, le pire de tout, c'est que, si le vent du nord ne s'Êlève pas,
je resterai ici je ne sais combien de jours, sans mĂŞme la ressource de
retourner Ă Narbonne, car le pont qui pouvait assurer ma retraite ne
tient plus Ă rien, et, si l'eau grossit, il sera emportĂŠ. Admirable
situation pour faire des rĂŠflexions et pour ĂŠcrire ses pensĂŠes. Mais
des pensÊes, je n'en ai guère maintenant. Je ne sais que m'impatienter.
J'ai Ă peine la force de vous ĂŠcrire. Vous ne me parlez pas d'une
lettre que je vous ai ĂŠcrite d'Arles. Peut-ĂŞtre s'est-elle croisĂŠe avec
la vĂ´tre?
J'ai ĂŠtĂŠ Ă la fontaine de Vaucluse, oĂš j'ai eu quelque envie d'ĂŠcrire
votre nom; mais il y avait tant de mauvais vers, de Sophies,de
Carolines, etc., que je n'ai pas voulu profaner votre nom en le mettant
en si mauvaise compagnie. C'est l'endroit le plus sauvage du monde. Il
n'y a que de l'eau et des rochers. Toute la vĂŠgĂŠtation se rĂŠduit Ă un
figuier qui a poussĂŠ je ne sais comment au milieu des pierres, et Ă des
capillaires très-ÊlÊgantes dont je vous envoie un Êchantillon. Lorsque
vous avez bu du sirop de capillaire pour un rhume, vous ne saviez
peut-ĂŞtre pas que cette plante avait une forme aussi jolie.
Je serai Ă Paris vers le 15 du mois prochain. Je ne sais pas du tout
quelle route je prendrai. Il est possible que je revienne par Bordeaux.
Mais, si le temps ne s'amĂŠliore pas, je reviendrai par Toulouse.
Je serai alors à Paris quinze jours plus tôt. J'espère trouver une
lettre de vous Ă Toulouse. S'il n'y en avait pas, je vous en voudrais
mortellement.
Adieu.
CVIII
Paris, 5 dĂŠcembre 1844.
J'avais jurĂŠ de ne pas vous ĂŠcrire, mais je ne sais pas si j'aurais pu
tenir mon serment encore longtemps. Pourtant, je ne pensais pas que
vous fussiez souffrante. Notre promenade avait ĂŠtĂŠ si heureuse! Je ne
croyais pas possible que vous pussiez en garder un mauvais souvenir.
Il paraĂŽt que ce qui vous irrite, c'est que je suis plus entĂŞtĂŠ que
vous. VoilĂ une belle raison et dont vous devez bien vous faire gloire.
Ne devriez-vous pas plutĂ´t avoir honte de m'avoir rendu tel! Et puis
vous dites que je suis dur, et vous me demandez si je m'en aperçois.
Franchement, non. Pourquoi ne m'avertissez-vous pas? Si je l'ai ĂŠtĂŠ,
je vous en demande pardon. Il me semble qu'en nous en allant, vous
n'aviez pas un seul grain de colère contre moi. Je vous croyais aussi
confiante, aussi intime que je l'ĂŠtais pour vous. Vous dirai-je que
c'est le souvenir le plus doux que j'ai conservĂŠ de notre promenade?
Quand je vous vois ainsi, vous me rendez bien heureux. Si vous aviez
alors de la colère, cela fait honneur à votre dissimulation. Mais
j'aime mieux croire aux secondes pensĂŠes que de croire que vous n'ĂŠtiez
pas sincère alors. Dites-moi si je me trompe.
J'ai commencĂŠ ce soir le dessin que vous commandez. C'est difficile
Ă faire. Je voudrais vos instructions. Vous tenez donc Ă ce champ de
chardons? Vous dites qu'il vous paraĂŽt l'un des plus beaux lieux du
monde. Je vous apporterai mon esquisse et aussi votre portrait. Je vous
ai donnĂŠ vos yeux mauvais. Ne croyez pas que telle est leur expression
ordinaire. J'en connais une meilleure, d'autant plus prĂŠcieuse qu'elle
est plus rare. Vous verrez tout cela et vous donnerez vos ordres. Vous
voudrez bien, pour le payement, vous rappeler que je ne suis pas un
peintre ordinaire, ce n'est pas l'Ĺuvre que vous devrez payer, c'est la
peine et le temps. Enfin, il est toujours bien de se montrer gĂŠnĂŠreux
avec les artistes.
Pendant que vous vous guÊrissiez de votre colère, j'en avais presque
contre vous. Je m'ĂŠtais figurĂŠ que vous m'ĂŠcririez plus tĂ´t. C'est en
partie pour avoir attendu votre lettre, en partie par mauvais sentiment
d'orgueil, que je ne vous ai pas prĂŠvenue. Vous voyez que je m'accuse
aussi de mes mĂŠfaits. Pardonnez-moi celui-lĂ . Au moins ce n'ĂŠtait pas
le passĂŠ qui me rendait injuste.
Depuis que je vous ai vue, j'ai ÊtÊ presque toujours très-souffrant;
je croyais que c'Êtait la leçon d'espagnol sur la large terre, comme
dit Homère. Votre lettre m'a remis. Je crois maintenant que c'est la
mine que vous aviez en nous quittant qui en ĂŠtait cause. Vous n'avez
pas daignĂŠ tourner la tĂŞte pour me dire adieu.--Nous aurons bien des
pardons Ă nous demander tous les deux pour toutes nos mauvaises pensĂŠes!
Il est une heure indue, mon feu est ĂŠteint et je grelotte. Je vous dis
encore adieu et vous remercie de cĹur de m'avoir ĂŠcrit. Il y a huit
jours que j'attends cette lettre. N'ĂŞtes-vous pas entĂŞtĂŠe aussi!
CIX
Paris, jeudi 7 fĂŠvrier 1845.
Tout s'est passĂŠ mieux que je ne l'espĂŠrais[1]. Je me suis trouvĂŠ un
aplomb rare. Je ne sais si le public a ĂŠtĂŠ content de moi, je le suis
de lui.
[1] Sa rÊception à l'AcadÊmie française.
CX
Vendredi, 8 fĂŠvrier 1845.
Puisque vous ne m'avez pas trouvĂŠ trop ridicule, tout est bien. Je
n'aurais pas ĂŠtĂŠ content de vous savoir lĂ , voyant mon habit couleur
d'estragon et ma figure idem.--Pourquoi pas demain? autrement, il
faudrait attendre Ă mercredi prochain, et je n'en aurais pas le
courage. Nous en aurons long Ă nous raconter. J'aurais perdu tout mon
aplomb si je vous avais sue lĂ .
CXI
Toulouse, 18 aoĂťt 1845.
Je viens de trouver ici votre lettre; c'est fort heureux, car j'ĂŠtais
furieux de n'avoir pas eu de vos nouvelles Ă Poitiers comme je m'y
attendais. Vous me direz que j'avais tort de m'attendre Ă ce que vous
penseriez Ă moi plus tĂ´t que vous n'avez fait. Que voulez-vous! je ne
puis m'habituer à vos façons. Vous n'êtes jamais plus près de m'oublier
que lorsque vous m'avez persuadĂŠ que vous pensiez Ă moi. Heureusement
qu'entre tous ces oublis il y a des souvenirs, et j'y pense sans cesse.
Je ne vois pas de ces belles grottes dont vous me parlez et je n'en ai
pas besoin pour que bien des idĂŠes tristes et gaies me viennent par
la tête. Je ne suis pas difficile en matière de paysage, comme vous
le savez. Je n'y fais pas attention quand je me promène avec vous. Je
voudrais bien vous gâter comme vous me le demandez. Mais je suis de
trop mauvaise humeur. Je viens de passer quinze jours sans dĂŠcolĂŠrer,
d'abord contre le temps, puis contre les architectes, puis contre
vous et contre moi-mĂŞme. Le temps, qui avait ĂŠtĂŠ des plus affreux
ces jours passĂŠs, s'est remis subitement au beau hier, mais avec une
chaleur accablante, accompagnĂŠe d'un vent de sirocco qui m'Ă´te toutes
mes forces. J'ai passĂŠ vingt-quatre heures chez un dĂŠputĂŠ, et, si
j'avais l'ambition d'ĂŞtre un homme politique, cette visite-lĂ m'aurait
complètement fait changer d'avis. Quel mÊtier! quels gens il faut voir,
mĂŠnager, flatter! Je dirai comme Hotspur: _I had rather be a kitten and
cry mew._ Esclavage pour esclavage, j'aime mieux la cour d'un despote;
au moins, la plupart des despotes se lavent les mains. Je suis fâchÊ
d'apprendre que vous partiez si tard pour D...; c'est-Ă -dire je crains
que vous n'en reveniez bien tard. Ce qui me fait prendre patience dans
mon mĂŠtier, c'est de penser que, lorsque je serai de retour, je vous
retrouverai en face de ces lions de l'Institut, et qu'après m'avoir
fait grise mine pendant un quart d'heure, vous me ferez oublier tous
mes ennuis. Combien de temps passerez-vous Ă D...? VoilĂ ce que je me
demande à prÊsent; très-probablement, vous irez en Angleterre, et lady
M... vous exposera encore ses belles thĂŠories _about the baseness of
being in love._ Je voudrais bien que vous fussiez la première figure
amie qui se prÊsentât à moi aussitôt après mon retour. Malheureusement,
cela ne sera pas et vous attendrez qu'il n'y ait plus une feuille aux
arbres pour revenir Ă Paris. Dieu sait si vous n'y reviendrez point
Anglaise aux trois quarts? Dites-moi bien que cela ne sera pas, que
vous tâcherez de ne pas rester trop longtemps, et que vous ne serez pas
pire que vous n'ĂŞtes. C'est dĂŠjĂ bien assez comme cela. Ăcrivez-moi Ă
Montpellier, d'oĂš je vous rapporterai un sachet, puis Ă Avignon. Je
calcule mes heures de façon à être de retour le 20 septembre. Ce sera
difficile, mais j'espère bien y parvenir.
Adieu; votre lettre finit bien, mais pourquoi ne me parlez-vous pas
comme vous ĂŠcrivez quelquefois?
CXII
Avignon, 5 septembre 1845.
Je remercie ces gens malades qui vous retiennent Ă Paris. Je vous
remercie encore plus vous-mĂŞme, si vous pensez moins Ă leurs
rhumatismes qu'au plaisir que vous me ferez en restant. Suivant toute
apparence, je serai de retour dans une quinzaine de jours, ou plutĂ´t
je ferai une halte dans mes foyers, entre mon voyage du Midi et celui
du Nord; le second sera, j'espère, des plus courts et vous ne vous en
apercevrez sans doute pas. Je me rĂŠjouis de vous savoir en si bonne
santĂŠ. Pour moi, je n'en puis dire autant. Je suis souffrant depuis mon
dĂŠpart; j'avais comptĂŠ sur le beau temps et sur le soleil du Languedoc
pour me remettre; mais il est demeurĂŠ sans effet. Aujourd'hui, je
reviens accablÊ de fatigue d'une très-longue course, oÚ j'ai fait plus
de mauvais sang que je n'en fais ordinairement quand vous ne vous en
mĂŞlez pas. Je suis tout ĂŠtourdi et je vois presque double; pendant que
vous mangez des pêches fondantes, j'en mange de jaunes très-acides et
d'un goĂťt singulier qui n'est pas trop dĂŠplaisant et que je voudrais
vous faire connaĂŽtre. Je mange des figues de toutes couleurs; mais je
n'ai nul appĂŠtit Ă tout cela. Je m'ennuie horriblement le soir, et je
commence à regretter la sociÊtÊ des bipèdes de mon espèce. Je ne compte
point les provinciaux pour quoi que ce soit. Ce sont des choses Ă mes
yeux souvent fatigantes, mais tout à fait Êtrangères au cercle de mes
idĂŠes. Ces MĂŠridionaux sont d'ĂŠtranges gens: tantĂ´t je leur trouve
de l'esprit, tantĂ´t il me semble qu'ils n'ont que de la vivacitĂŠ. Ce
voyage me les fait voir un peu plus en laid qu'Ă l'ordinaire. Mon seul
plaisir, dans le pays assez beau que je parcours, serait de rĂŞvasser Ă
mon aise, et je n'en ai pas le temps. Vous devinez Ă quoi j'aimerais
rĂŞver, et avec qui? Je voudrais vous raconter quelques histoires dignes
d'ĂŞtre envoyĂŠes Ă deux cents lieues: malheureusement, je n'en apprends
pas qui se puissent raconter. J'ai vu l'autre jour les ravages d'un
torrent qui a noyÊ cent vingt chèvres, rasÊ des maisons, et vous avez
eu mieux que cela Ă Paris; mais ce que vous n'y trouverez jamais, c'est
une vue comme celle qu'on rencontre Ă chaque pas quand on parcourt le
Comtat. Venez-y, ou plutĂ´t atlendez-moi Ă Paris et promenons-nous dans
nos bois, que je trouverai alors admirables. Ăcrivez-moi Ă VĂŠzelay
(Yonne).
CXIII
Barcelone, 10 novembre 1845.
Me voici arrivĂŠ au terme de mon long voyage sans rencontrer de
trabucayres ni de rivières dÊbordÊes, ce qui est encore plus rare. J'ai
ÊtÊ admirablement reçu par mon archiviste, qui avait dÊjà prÊparÊ ma
table et mes bouquins, oĂš je vais assurĂŠment perdre le peu d'yeux qui
me restent. Il faut, pour arriver Ă son _despacho_; traverser une salle
gothique du XIVe siècle et une cour de marbre plantÊe d'orangers hauts
comme nos tilleuls, et couverts de fruits mĂťrs. Cela est fort poĂŠtique,
comme, aussi mon appartement, qui me rappelle les caravansĂŠrails de
l'Asie pour le luxe et les conforts. On est cependant mieux ici qu'en
Andalousie, mais les natifs sont infĂŠrieurs en tout aux Andalous. Ils
ont de plus un dĂŠfaut majeur Ă mes yeux ou plutĂ´t Ă mes oreilles: c'est
que je n'entends rien Ă leur baragouin. J'ai trouvĂŠ Ă Perpignan deux
bohĂŠmiens superbes qui tondaient des mules. Je leur ai parlĂŠ _calĂł_, Ă
la grande horreur d'un colonel d'artillerie qui m'accompagnait, et il
s'est trouvĂŠ que j'ĂŠtais bien plus fort qu'eux et qu'ils ont rendu Ă ma
science un ĂŠclatant tĂŠmoignage dont je n'ai pas ĂŠtĂŠ peu fier. Le rĂŠsumĂŠ
de mes impressions de voyage, c'est que ce n'ĂŠtait pas la peine d'aller
si loin et que j'aurais peut-ĂŞtre achevĂŠ mon histoire aussi bien sans
aller secouer la vÊnÊrable poussière des archives d'Aragon. C'est un
trait d'honnêtetÊ de ma part dont mon biographe, j'espère, me tiendra
compte. En route, quand je ne dormais pas, c'est-Ă -dire pendant presque
toute la route, j'ai fait mille châteaux en Espagne auxquels il manque
votre approbation. RĂŠpondez-moi sur-le-champ et mettez l'adresse en
très-gros et lisibles caractères.
CXIV
Madrid, 18 novembre 1845.
Me voici installĂŠ ici depuis une semaine et plus, avec un grand
froid, quelquefois de la pluie, un temps tout semblable Ă celui de
Paris. Seulement, je vois tous les jours des montagnes dont la cime
est couverte de neige, et je vis familièrement avec de très-beaux
Velasquez. Grâce à la lenteur ineffable des gens de ce pays-ci, je
n'ai commencĂŠ que d'aujourd'hui seulement Ă mettre le nez dans les
manuscrits que j'ĂŠtais venu consulter. Il a fallu une dĂŠlibĂŠration
acadĂŠmique pour me permettre de les examiner, et je ne sais combien
d'intrigues pour obtenir des renseignements sur leur existence.
D'ailleurs, cela me semble peu de chose et ne valait pas la peine de
faire un si long voyage. Je pense que j'aurai fini mes perquisitions
assez promptement, c'est-Ă -dire avant la fin du mois.
J'ai trouvÊ ce pays-ci fort changÊ depuis ma dernière visite. Les
gens que j'avais laissĂŠs amis sont ennemis mortels. Plusieurs de
mes anciennes connaissances sont devenues de grands seigneurs, et
très-insolents. Somme toute, je me plais moins à Madrid en 1845 qu'en
1840. Ici, l'on pense tout haut et l'on ne se gêne guère pour personne.
On a une franchise qui nous surprend fort, nous autres Français, et
qui m'ĂŠtonne d'autant plus que vous m'avez habituĂŠ Ă tout autre chose.
Vous devriez aller faire un tour de l'autre cĂ´tĂŠ des PyrĂŠnĂŠes pour
prendre une leçon de vÊracitÊ. Vous ne sauriez vous faire une idÊe
des figures qu'on a quand l'objet aimĂŠ n'arrive pas Ă l'heure oĂš on
l'attend, ni du bruit des soupirs qu'on laissĂŠ ĂŠchapper librement;
on est tellement habituÊ à des scènes semblables, qu'il n'y a pas de
scandale ni de cancans. Chacun et chacune savent qu'ils seront de
mĂŞme dimanche. Est-ce bien? est-ce mal? je me demande cela tous les
jours sans conclure. Je vois les amants heureux et je trouve qu'ils
abusent de l'intimitĂŠ et de la confiance. L'un raconte ce qu'il a
mangĂŠ Ă son dĂŽner, l'autre donne des dĂŠtails peu ragoĂťtants sur un
rhume qui le tient. Le plus romanesque des amants n'a pas la moindre
idĂŠe de ce que nous nommons galanterie. Les amants ne sont, Ă vrai
dire, ici que des maris non autorisĂŠs par l'Ăglise. Ils sont les
souffre-douleur des maris vĂŠritables, font les commissions et gardent
madame quand elle prend mĂŠdecine. Il fait si froid, que je n'irai pas
à Tolède comme je me l'Êtais proposÊ. Il n'y a pas de taureaux par la
mĂŞme raison. En revanche, on annonce force bals qui m'ennuient fort.
J'irai après-demain chez Narvaez, ou je verrai probablement Sa MajestÊ
Catholique. Vous pouvez m'ĂŠcrire ici, si vous me rĂŠpondez courrier
par courrier; sinon, Ă Bayonne, poste restante. Je pense quand je
m'ennuie, c'est-Ă -dire tous les jours, que vous viendrez peut-ĂŞtre
me voir Ă mon dĂŠbarquement, et cette idĂŠe me ranime. MalgrĂŠ votre
infernale coquetterie et votre aversion pour la vĂŠritĂŠ, je vous aime
mieux que toutes ces personnes si franches. N'abusez pas de cet aveu.
Adieu.
CXV
Paris, lundi 19 janvier 1846.
Je suis bien fâchÊ que vous n'ayez pas plus de courage. Il ne faut
jamais attendre les douleurs en matière de dents, et c'est parce qu'on
n'ose pas aller chez le dentiste qu'on se prĂŠpare des souffrances
abominables. Allez donc chez Brewster ou chez tout autre plus tĂ´t que
plus tard. Si vous le dĂŠsirez, j'irai avec vous et je vous tiendrai,
s'il le faut. Croyez, du reste, que c'est l'homme le plus habile en son
genre et qui est, en outre, conservateur par système.--Vous êtes bien
bonne de vous reprocher le rĂŠcit pathĂŠtique que vous m'avez fait. Vous
auriez dĂť, au contraire, vous rĂŠjouir de m'avoir fait faire une bonne
action. Il n'y a rien que je mĂŠprise et mĂŞme que je dĂŠteste autant que
l'humanitĂŠ en gĂŠnĂŠral; mais je voudrais ĂŞtre assez riche pour ĂŠcarter
de moi toutes les souffrances des individus. Vous ne me dites pas ce
qui m'intĂŠresserait le plus, c'est-Ă -dire quand je pourrai vous voir.
Cela me prouve que vous n'en avez nulle envie. Voulez-vous faire une
promenade mercredi? Si vous ĂŠtiez prise parles dents, ne venez pas. Si
vous aviez toute autre maladie je n'admettrais pas d'excuse, parce que
je n'y croirais pas.
CXVI
Paris, 10 juin 1846.
En ouvrant le paquet de livres, j'ai eu la bĂŞtise de croire que je
trouverais un mot de vous, et que le beau soleil vous aurait inspirĂŠe.
Pas une ligne! Je me suis mis Ă relire votre lettre de ce matin, que
j'ai trouvÊe un peu bien sèche à la seconde lecture. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que je remarque l'espèce de bascule très-impartiale de
votre correspondance et, en gĂŠnĂŠral, de toute votre conduite Ă mon
Êgard. Vous n'êtes jamais plus près de me faire quelque mÊchancetÊ que
lorsque vous venez d'ĂŞtre bonne et gracieuse pour moi. Vous m'aviez
promis de me donner un jour bientĂ´t. Mais, si j'attendais l'exĂŠcution
de vos promesses, la patience que le ciel m'a dĂŠpartie ne suffirait
pas. L'autre jour, vous ĂŠtiez aussi insouciante en me disant adieu
qu'en me disant bonjour. Ce n'Êtait pas cela l'avant-dernière fois.
C'est un phÊnomène très-curieux que l'eau qui a bouilli se gèle plus
facilement que l'eau froide. Vous illustrez cette chimie-lĂ . En me
quittant, vous aviez votre air de bouderie; aussi je m'attends que
vous serez charmante mercredi. Il faudra revoir nos jolies promenades
sablĂŠes pour nous. Vous me ferez grand plaisir en acceptant. Mais c'est
ce qui ne vous touche que mĂŠdiocrement. Si vous avez quelque curiositĂŠ,
elle sera rĂŠcompensĂŠe par un monument d'_auld lang syne_ que je vous
montrerai. Et puis je vous donnerai quelque chose. Du moins, j'ai eu
envie de vous donner quelque chose, mais vous avez ĂŠtĂŠ si mal pour moi,
d'abord en m'ĂŠcrivant votre lettre de ce matin, puis en n'ĂŠcrivant rien
avec les livres, que je ne sais trop si je vous offrirai ce prĂŠsent
projetĂŠ. Pourtant, si vous le demandez, il est probable que je cĂŠderai.
Je suis devenu, comme vous savez, grand observateur du temps. Le vent
est magnifique au nord-est. Cela nous promet quelques beaux jours. Je
voudrais que vous fissiez autant que moi attention au soleil et Ă la
pluie.
CXVII
Dijon, 29 juillet 1846.
J'espĂŠrais trouver ici une lettre de vous, mais je suppose que vous
vous amusez trop pour penser Ă m'ĂŠcrire. Je n'ai rien trouvĂŠ Ă Bar non
plus, ce qui m'ĂŠtonne et m'indigne fort. Est-ce la faute de la poste ou
la vĂ´tre? J'avais toujours cru la poste infaillible. Que faites-vous,
oĂš ĂŞtes-vous en ce moment? Je ne sais en vĂŠritĂŠ oĂš vous adresser cette
lettre, et je vous l'envoie Ă tout hasard Ă Paris. Ăcrivez-moi donc Ă
Privas et puis Ă Clermont-Ferrand. J'ai beaucoup vu de mĹurs, d'hommes
et de villes depuis vous avoir quittĂŠe il y a quinze jours, et, comme
Ulysse, j'ai eu toute sorte de contrariĂŠtĂŠs dans mes pĂŠrĂŠgrinations.
Chaque annĂŠe, je trouve la province plus sotte et plus insupportable.
Cette fois-ci, j'ai le spleen et je vois tout en noir, peut-ĂŞtre parce
que vous m'avez oubliĂŠ si indignement. Je n'ai eu de bons moments qu'en
traversant toute sorte de bois très-Êpais dans les Ardennes, qui me
faisaient penser Ă d'autres bois bien plus agrĂŠables. Je crains que
vous n'y pensiez guère. Pour m'achever, j'ai trouvÊ ici d'horribles
bêtises qu'on a faites avec notre argent. Ce sont des pères de famille
vertueux et niais qui les ont faites, et contre lesquels je dois lancer
les rapports les plus fulminants, tendant Ă les faire crever de faim.
Ce mĂŠtier de fĂŠrocitĂŠ m'afllige. J'aurais besoin d'ĂŞtre adouci par
une lettre de vous. J'en reviens toujours Ă mes moutons. Pourquoi ne
m'avez-vous pas ĂŠcrit? Je vais ĂŞtre je ne sais combien de temps sans
nouvelles, car je n'ai pas d'itinĂŠraire assez arrĂŞtĂŠ pour vous indiquer
mes ĂŠtapes. En somme, je ne trouve que des raisons d'ĂŞtre furieux.
Il est vraisemblable que vous vous trouvez bien oĂš vous ĂŞtes, et je
m'attends Ă ne vous revoir que cet hiver, quand l'OpĂŠra vous rappellera
Ă Paris.
Adieu; quand vous penserez Ă moi, vous verrez si je sais ĂŞtre
magnanime. Ne m'ĂŠcrivez pas Ă Privas, mais Ă Clermont-Ferrand. Je viens
de m'apercevoir que je n'avais que faire à Privas. Après Clermont,
j'irai probablement Ă Lyon, mais vous aurez de mes nouvelles auparavant.
CXIX
10 aoĂťt 1846.
Ă bord d'un bateau Ă vapeur
dont je ne sais le nom.
Je suis allÊ dans les montagnes de l'Ardèche chercher un lieu ÊcartÊ
oĂš il n'y eĂťt ni ĂŠlecteurs ni candidats. J'y ai trouvĂŠ une si grande
quantitĂŠ de puces et de mouches, que je ne sais pas si les ĂŠlections
ne valaient pas mieux. Avant de quitter Lyon, j'avais reçu une lettre
de vous qui m'avait fait beaucoup de plaisir, car j'ĂŠtais vraiment
un peu inquiet. J'ai beau avoir l'habitude de votre nĂŠgligence Ă mon
endroit, je ne puis m'empĂŞcher, quand je suis sans nouvelles de vous,
de penser qu'il vous est arrivĂŠ quelque chose d'extraordinaire. Ce
qu'il y aurait de vraiment extraordinaire, c'est que vous daignassiez
penser Ă moi aussi souvent que je pense Ă vous. J'apprends avec
beaucoup de peine que vous ĂŞtes partie pour D... plus tard que vous ne
l'aviez prĂŠvu, et que par consĂŠquent vous reviendrez plus tard. Je ne
doute pas que vous ne vous amusiez fort Ă D...; mais, si, au milieu des
gâteries que vous aimez tant, il vous prenait quelque souvenir de nos
promenades, vous feriez une Ĺuvre mĂŠritoire en hâtant votre retour.
J'ai eu hier un grand succès dans ma veillÊe avec des paysans et des
paysannes Ă qui j'ai fait dresser les cheveux sur la tĂŞte, en leur
racontant des histoires de revenants. Il y avait une lune magnifique
qui ĂŠclairait parfaitement les traits rĂŠguliers et montrait les beaux
yeux noirs de ces demoiselles, sans laisser apercevoir leurs bas sales
et la crasse de leurs mains. Je suis allÊ me coucher très-fier de mon
succès auprès d'un auditoire tout nouveau pour moi. Le lendemain,
quand j'ai vu au soleil mes ArdĂŠchoises, _con villanos manos y pies_,
j'ai presque regrettĂŠ mon ĂŠloquence. Ce diable de bateau fait sauter
ma plume de çà et de là , de la façon la plus ridicule! Il faut une
Êducation particulière pour pouvoir Êcrire sur une table qui danse
perpĂŠtuellement. Je n'en peux plus de sommeil et de fatigue. Je vous
dis adieu. Vous m'ĂŠcrirez Ă Paris le jour de votre arrivĂŠe, et, le
lendemain, nous irons revoir nos bois. Je serai Ă Paris le 18 au plus
tard; plus probablement, j'arriverai le 15.
Adieu encore.
CXIX
Paris, 18 aoĂťt 1846.
Je suis arrivĂŠ ici aujourd'hui en mĂŠdiocre ĂŠtat de conservation, la
tête toute Êtourdie de quatre cents kilomètres parcourus tout d'un
trait. Pour me remettre, il faudrait votre prĂŠsence rĂŠelle. Mais quand
reviendrez-vous? _That is the question._ Je vous suppose beaucoup trop
ĂŠprise de la mer et des monstres marins pour songer Ă retourner ici de
sitĂ´t. J'en aurais grand besoin pourtant, je vous assure. Je ne saurais
vous dire combien d'ennuis et de chagrins se sont amoncelĂŠs sur moi
dans ce petit voyage. Il me rappelle le rĂŞve de Gloster: _I would
not sleep another such a night though I were to live a world of happy
days._ En rentrant ici, je m'y sens encore plus isolĂŠ qu'Ă l'ordinaire,
plus triste que dans aucune des villes que je viens de quitter: quelque
chose comme un ĂŠmigrĂŠ qui rentre dans sa patrie et qui y trouve une
nouvelle gĂŠnĂŠration. Vous allez croire que j'ai horriblement vieilli
dans ce voyage. Cela est vrai, et je ne serais pas ĂŠtonnĂŠ que quelque
chose comme l'aventure d'ĂpimĂŠnide me fĂťt arrivĂŠ. Tout cela, c'est
pour vous dire que je suis horriblement triste et de mauvaise humeur
et que j'ai grande envie de vous voir. HĂŠlas! vous n'avancerez pas
d'une heure l'ĂŠpoque de votre retour. Le plus sage, c'est de me
rĂŠsigner. Lorsque vos robes se seront fanĂŠes Ă l'air de la mer, ou
qu'il en viendra de plus fraĂŽches de Paris, peut-ĂŞtre penserez-vous Ă
moi. Mais alors je serai Ă Cologne, ou peut-ĂŞtre Ă Barcelone. J'irai
Ă Cologne au commencement de septembre, et Ă Barcelone en octobre. On
me dit des merveilles des manuscrits qui s'y trouvent. On dit que,
pour une femme, il n'y a rien de plus agrĂŠable au monde que de montrer
de jolies robes.--Je ne puis vous offrir d'ĂŠquivalent Ă ces joies-lĂ .
Mais je souffrirais trop de vous croire ainsi faite.--Dieu est grand!
quelle que soit la nouvelle que vous avez Ă m'annoncer, ĂŠcrivez-moi
promptement. Nous verrons-nous pendant qu'il y a des feuilles? Me
ferez-vous manger des pĂŞches de Montreuil, cette annĂŠe? Vous savez
comme je les aime. Si vous avez quelque tendre souvenir, j'espère qu'il
vous inspirera une rÊsolution gÊnÊreuse. J'ai la fièvre et je tremble
horriblement en ĂŠcrivant.
CXX
Paris, 22 aoĂťt 1846.
Nos lettres se sont croisĂŠes. J'espĂŠrais que la vĂ´tre m'apporterait
de meilleurs nouvelles, je veux dire l'annonce de votre prochain
retour. Avant de partir, vous paraissiez plus pressĂŠe de nous revoir.
Il y a longtemps que je me plains de la trop grande diffĂŠrence entre
le dire et le faire pour vous. Ă ce qu'il paraĂŽt, vous passez le
temps si heureusement, si agrĂŠablement, que vous ne pensez pas mĂŞme
Ă l'ĂŠpoque de votre retour Ă Paris. Vous me demandez si cela me
ferait bien plaisir, ce qui est une dĂŠrision assez mĂŠchante. Pour moi,
je m'ennuie fort ici, encore plus qu'en voyage, et cependant je suis
assez occupĂŠ pour ne plus avoir le loisir de regretter le monde absent
de Paris; mais ce n'est pas Ă cela que je tiens. C'est vous, ce sont
nos promenades qui me font faute. Si vous les aimiez la moitiĂŠ autant
que vous le dites, elles ne se feraient guère attendre. J'y ai pensÊ
pendant tout le temps de mon voyage, et j'y pense maintenant plus que
jamais. Pour vous, vous les avez oubliĂŠes.
Paris est absolument dĂŠpourvu d'habitants intelligents. Il n'y reste
plus que des bonnetiers ou des dÊputÊs, ce qui revient à peu près au
mĂŞme. Je crois que je partirai pour Cologne dans les premiers jours
de septembre. Sera-ce avant de vous avoir revue? J'ai bien peur que
vous ne me disiez que, pour si peu, ce n'est pas la peine de revenir.
Ainsi la moitiĂŠ de notre annĂŠe se sera passĂŠe vous absente ou malade.
Il me prend des envies d'aller vous voir Ă ***, et j'y cĂŠderais
probablement si vous trouviez des possibilitĂŠs que je ne prĂŠvois pas.
Pourtant, voyez. Adieu; je suis de trop mauvaise humeur pour vous
ĂŠcrire longuement. Je finis comme j'ai commencĂŠ, en vous rĂŠpĂŠtant que
rien ne pourra me faire plus de plaisir que de vous revoir, surtout si
ce plaisir est partagĂŠ par vous. Sinon, restez lĂ -bas tant que vous
voudrez.
CXXI
Paris, 3 septembre 1846.
Je m'ĂŠtais figurĂŠ, tant j'ĂŠtais de mon village, que vous prĂŠfĂŠreriez
une ou deux promenades avec moi Ă huit jours de _white bait_; mais,
puisque vous n'ĂŞtes pas de cet avis, votre volontĂŠ soit faite! Je n'ai
pas mĂŞme le courage de ne pas vous ĂŠcrire, ce que je m'ĂŠtais promis, et
ce que je devrais faire si j'ĂŠtais moins bĂŞte. Mon voyage de Cologne
est un peu dĂŠsorganisĂŠ depuis deux jours. Un de mes compagnons de route
me manque de parole, un autre ne pourra peut-ĂŞtre pas. En sorte que
je cours grand risque de me trouver seul sur le Rhin bleu. Ce sera un
petit malheur. Mais je ne sais plus si je repasserai par ici. Ainsi,
nous courons grand risque, je veux dire que je cours grand risque de
ne nous revoir qu'en novembre. Ă vous la responsabilitĂŠ. Je sais que
vous la porterez lÊgèrement. Je ne me mettrai pas en route avant le 12
septembre. D'ici là , j'espère que vous voudrez bien me donner de vos
nouvelles et vos commissions. Probablement encore, je serai Ă Paris
vers le commencement d'octobre; mais, si j'ai le moindre courage,
j'irai Ă Strasbourg, Ă Lyon, et de Lyon Ă Marseille. Je crains de
n'avoir pas ce courage, surtout si vous parlez de retour. Pendant
votre absence, en recueillant mes souvenirs, j'ai fait de vous deux
dessins en pied. Je les trouve assez ressemblants; cependant, ils ont
besoin d'ĂŞtre retouchĂŠs. Nous verrons s'ils vous plaisent. Je m'ennuie
extraordinairement et je voudrais voir tomber des torrents de pluie
pour me consoler. Mais le temps est toujours au très-sec. Il n'y a
que les feuilles qui tombent. Il n'en restera plus la queue d'une en
octobre.
Vous apprendrez avec plaisir que vous avez Ă l'OpĂŠra italien les mĂŞmes
enrouements que la saison passĂŠe, plus une autre Brambilla. Il n'en
reste plus que cinq inconnues, et une mademoiselle Albini qui n'avait
pas de voix en 1839, mais qui en a peut-ĂŞtre trouvĂŠ depuis quelque part.
Adieu, je ne dis pas sans rancune. Ce qui m'a particulièrement piquÊ,
c'est que vous n'avez rĂŠpondu que par le silence le plus dĂŠdaigneux Ă
ma proposition d'aller vous voir Ă ***; mais n'y pensons plus.
CXXII
Metz, 12 septembre 1846.
Il est fort heureux que vous ayez bien voulu penser Ă m'ĂŠcrire avant
mon dÊpart, car j'allais en Allemagne sans nouvelles de vous. J'ai reçu
votre lettre au moment de me mettre en route. D'après les promesses
que vous me faites et dont j'attends avec trop de confiance peut-ĂŞtre
l'entier accomplissement, je serai de retour vers le commencement
d'octobre, peut-être le 1er. J'espère qu'il restera encore quelques
feuilles. Nous verrons si vous serez _as good as your word._ Je vais
demain Ă TrĂŞves et de lĂ soit Ă Mayence, soit Ă Cologne, selon que
le temps sera ou non invitant. De toute façon, vous feriez bien de
m'ĂŠcrire très-vite Ă Aix-la-Chapelle, et puis assez vite après Ă
Bruxelles. Je n'ai pas besoin de vous dire de m'ĂŠcrire des choses
aimables et qui me tentent au retour. Quand je suis lancĂŠ, une
fois en route, j'ai toutes les peines du monde Ă m'arrĂŞter, et il
faudra les promesses les plus sĂŠduisantes pour m'empĂŞcher de pousser
jusqu'en Laponie. Je crois vous avoir parlĂŠ de deux portraits. J'en ai
maintenant au moins trois, et, Ă chaque tentative infructueuse, j'ai
recommencĂŠ sans dĂŠtruire le premier essai et sans mieux rĂŠussir; enfin,
vous verrez si ma mĂŠmoire m'a bien ou mal servi. Vous me demandez
quelle robe? En vÊritÊ, je ne m'en suis guère prÊoccupÊ; mais ce
n'est pas là que gÎt la ressemblance. Je dÊsespère de saisir jamais
l'expression indĂŠfinissable de votre physionomie. Je viens d'arriver
ici après une nuit passÊe en malle-poste sans dormir, et j'ai la tête
excessivement _giddy._ Il me semble que mes bougies tournent sur ma
table. On m'annonce pour demain une navigation entremĂŞlĂŠe d'ĂŠchouages,
car la Moselle n'a que fort peu d'eau, mais ce n'est pas cela qui
m'empĂŞchera de dormir. Je vous ĂŠcrirai probablement de quelque auberge
allemande et très-assurÊment de Lille, oÚ je m'arrêterai. De là , sans
doute, je pourrai vous annoncer le jour de mon arrivĂŠe. J'apprends
avec beaucoup de plaisir que vous vous ennuyez Ă ***; je vous l'avais
prĂŠdit. Quand on habite Paris, on ne peut plus retourner en province.
On dit et on fait quantitĂŠ d'ĂŠnormitĂŠs qui passeraient Ă Paris et qui
sont grosses comme des maisons Ă ***. Cela vous est peut-ĂŞtre aussi
arrivÊ, du caractère dont je vous connais. Je vous pardonnerai tout si,
le 1er ou 2 octobre, vous m'annoncez votre retour.
CXXIII
Bonn, 18 septembre 1846.
Je suis depuis six jours dans ce beau pays, non pas Bonn, mais je dis
la Prusse rhÊnane, oÚ la civilisation est très-avancÊe, sauf pour les
lits, qui ont toujours quatre pieds de long et les draps trois. Je
mène tout à fait une vie allemande, c'est-à -dire que je me lève à cinq
heures et me couche Ă neuf, après avoir fait quatre repas. Jusqu'Ă
prĂŠsent, cette vie-lĂ me convient assez et je ne me suis pas trouvĂŠ
mal de ne rien faire qu'ouvrir la bouche et les yeux. Seulement, les
Allemandes sont devenues horriblement laides depuis ma dernière visite.
Voici le chapeau de la plus jolie que j'aie encore rencontrĂŠe;--ce
fut sur un bateau à vapeur entre Trèves et Coblence; la place me
manque pour l'illustration, que je mets au verso: c'est une capote
d'oÚ pend une pièce d'Êtoffe carrÊe, ouverte à l'extrÊmitÊ, dont un
angle est relevĂŠ Ă gauche au moyen d'une petite cocarde verte,
blanche et rouge; la capote est noire, l'Allemande fort blanche avec
des pieds comme il suit... _N. B._--Le dessin est exĂŠcutĂŠ Ă l'ĂŠchelle
de un centimètre pour mètre. Je voudrais que vous introduisissiez ces
capotes-lĂ . Vous leur feriez faire fortune.--En fait de monuments, je
n'ai guère ÊtÊ content de ce que j'ai vu: les architectes allemands
m'ont paru pires que les nĂ´tres. On a saccagĂŠ le Munster Ă Bonn et
peint l'abbaye de Laarh Ă faire grincer les dents. Les sites de la
Moselle sont beaucoup trop vantĂŠs. Au fond, cela est peu de chose.
Je ne trouve plus rien de beau depuis que j'ai passĂŠ le Tmolus. Mon
admiration demeure exclusive pour ses ombrages et surtout pour la façon
dont on y entend la cuisine; ici, la grande affaire est _zu speisen._
Tous les honnêtes gens, après avoir dÎnÊ à une heure, prennent le thÊ
et des gâteaux à quatre, vont manger à six un petit pain avec de la
langue fourrĂŠe dans un jardin; ce qui permet d'attendre jusqu'Ă huit
heures pour entrer dans un hĂ´tel et souper. Ce que deviennent les
femmes pendant ce temps-lĂ , je l'ignore; ce qu'il y a de certain, c'est
que, de huit Ă dix, il ne reste pas un homme dans les maisons: chacun
est dans son hĂ´tel favori Ă boire, manger et fumer; la raison est, je
crois, dans les pieds de ces dames et la bontĂŠ du vin du Rhin.
Je pense que vous allez ĂŞtre Ă Paris dans deux ou trois jours. En
voyant les bois du Rhin et de la Moselle si verts, je ne puis me
figurer que ceux de notre tempĂŠrature soient devenus des balais. Cela
n'est malheureusement que trop possible. Vous l'avez voulu. Adieu; je
suis fâchÊ de ne pas vous avoir dit de m'Êcrire à Cologne, mais il est
trop tard.
CXXIV
Soissons, 10 octobre 1846.
Il paraĂŽt que vous avez ĂŠtĂŠ de bien mauvaise humeur samedi dernier;
mais enfin vous avez repris votre sĂŠrĂŠnitĂŠ dimanche, sauf quelques
petits nuages qui flottent encore dans votre lettre. Pour suivre la
mĂŠtaphore, je voudrais bien un jour vous voir au beau fixe, sans qu'il
y eĂťt des tempĂŞtes auparavant. Malheureusement, c'est une habitude que
vous avez prise. Nous nous sĂŠparons presque toujours meilleurs amis
que nous ne nous sommes vus. Tâchons donc d'avoir, un de ces jours,
l'amabilitĂŠ continue que j'ai rĂŞvĂŠe quelquefois. Il me semble que nous
nous en trouverions bien l'un et l'autre. Vous me faites des menaces
pour le seul plaisir de m'Ă´ter les consolations de l'espĂŠrance. Vous
sentez si bien votre tort, que vous me dites que vous ĂŞtes dispensĂŠe
de loyautĂŠ Ă l'ĂŠgard d'une certaine promesse que vous m'avez faite
dĂŠjĂ une fois et que vous ne voulez pas tenir. N'est-ce pas un effet
du hasard seul qui vous a permis de dire que vous aviez accompli cette
promesse? Vous ne vouliez me voir que pendant un quart d'heure; ainsi,
il y avait de votre part trahison mĂŠditĂŠe. Je sais ce que vous pensez
vous-mĂŞme de ces subterfuges-lĂ , et je m'en rapporte Ă votre propre
jugement. Vous pouvez me faire beaucoup de plaisir ou beaucoup de
peine; c'est Ă vous de choisir.
Le temps affreux qui me m'a pas quittĂŠ depuis samedi est sans doute
celui que vous avez Ă Paris. Le seul chagrin qu'il me fasse, c'est que
je pense à mes bois, dont le vent enlève les feuilles, à mes gazons,
que la pluie inonde, et Ă l'ĂŠloignement de notre prochaine promenade.
Hier, au milieu des champs, par un vrai dĂŠluge, je ne pensais pas Ă
autre chose. Et vous, regrettez-vous la pluie Ă cause de moi, ou bien
parce qu'elle vous empĂŞche d'aller Ă _shopping_ Ă votre ordinaire?
Quel jour ĂŠtiez-vous Ă l'OpĂŠra italien?
Ătait-ce jeudi par hasard, et aurions-nous ĂŠtĂŠ tout près l'un de
l'autre sans nous en douter? J'aurais bien voulu vous voir un peu avec
votre cour, pour savoir si vous ĂŞtes pour le monde telle que je le
voudrais.
J'espère être à Paris jeudi soir ou vendredi au plus tard. S'il fait
beau samedi, voulez-vous faire une longue promenade? Dans le cas
contraire, nous en ferons une courte, ou nous irons au MusĂŠe. La
mĂŠmoire de ces promenades est Ă la fois un plaisir et une douleur.
C'est pour moi une sensation qu'il faut renouveler sans cesse pour
qu'elle ne devienne pas triste. Adieu, chère amie; je vous remercie
bien de tout ce qu'il y a de tendre dans votre lettre. Je tâche
d'oublier le peu qui reste de dur et de sec. Je pense que c'est Ă votre
usage une espèce de parure de fantaisie dont vous vous couvrez. J'aime
Ă deviner dessous que vous ĂŞtes tout cĹur et tout âme; croyez que cela
paraĂŽt, malgrĂŠ tous vos efforts pour le cacher.
CXXV
Paris, 22 septembre 1847.
. . . . . . . . . . . .
La _Revue_ me tourmente beaucoup pour _Don Pèdre._ Je voudrais savoir
votre opinion Ă ce sujet. Je suis partagĂŠ entre l'avarice et la
pudeur. J'aurais aussi Ă vous prier d'en lire quelque chose. Cela me
paraĂŽt avoir l'inconvĂŠnient de tout ce qui a ĂŠtĂŠ fait longuement et
pĂŠniblement. Je me suis donnĂŠ bien du mal pour une exactitude dont
personne ne me saura grĂŠ. Cela me chagrine quelquefois.
Vous comprendrez sans peine que, depuis votre dĂŠpart, j'ai eu
très-souvent les _blue devils._
. . . . . . . . . . . .
Ce que vous me dites de _Don Pèdre_ me plaÎt assez, parce que votre
opinion est d'accord avec mon dĂŠsir et ce que je crois mon intĂŠrĂŞt.
Pourtant, il y a une question de dignitĂŠ qui me tient encore au cĹur
et qui m'a empĂŞchĂŠ de tout terminer d'abord avant mon dĂŠpart. Je
serai bien aise d'avoir votre avis de vive voix, et je vous montrerai
quelques bribes d'après lesquelles vous jugerez mieux. Je n'ai
jamais ĂŠtĂŠ plus tristement choquĂŠ de la bĂŞtise des gens du Nord qu'Ă
ce voyage-ci, et aussi de leur infĂŠrioritĂŠ sur les MĂŠridionaux. La
moyenne du Picard me paraÎt au-dessous de la plus infÊrieure espèce du
Provençal. En outre, je mourais de froid dans toutes les auberges oÚ
mon triste sort me poussait.
. . . . . . . . . . . .
CXXVI
Saturday, 26 febr. 1848[1].
I believe you are now a little better. I don't know why you could be so
uneasy about your brother. No wonder you have no news. Bad ones corne
very soon. I begin to get accustomed to the strangeness of the thing
and to be reconciled with the strange figures of the conquerors, who
what's stranger still, behave themselves as gentlemen. There is now
a strong tendency to order. If it continues, I shall turn a staunch
republican. The only fault I find with the new order of things is that
I do not very clearly see how I shall be able to live and that I cannot
see you.
I hope though it will not be long before the coaches can go on.
[1] Samedi, 26 fĂŠvrier 1848.
Je crois que vous ĂŞtes maintenant un peu plus rassurĂŠe. Je ne vois pas
pourquoi vous ne seriez pas complètement tranquille à l'Êgard de votre
frère. Ne prenez point souci de l'absence de nouvelles. Les mauvaises
nouvelles arrivent promptement.
Je commence Ă m'accoutumer Ă la plus ĂŠtrange des choses, et Ă me
familiariser avec l'ĂŠtrange figure des vainqueurs qui, ce qui est
plus ĂŠtrange encore, se conduisent en gentlemen. Il y a maintenant
une violente tendance Ă l'ordre. Si cela continue, je deviendrai un
rĂŠpublicain dĂŠcidĂŠ. Le seul inconvĂŠnient que je trouve au nouvel ordre
de choses, c'est que je n'aperçois pas très-clairement comment je
pourrai gagner ma vie, et que je ne puis vous voir.
J'espère nÊanmoins qu'avant peu les voitures recommenceront à circuler.
CXXVII
Paris, mars 1848.
Je suis tourmentĂŠ par cette faillite de la maison ***, dans laquelle
je crains que vous n'ayez des intĂŠrĂŞts. Rassurez-moi, je vous prie,
là -dessus, ou, s'il y a quelque malheur, tâchons de nous consoler
ensemble. Chaque jour nous apportera d'ici Ă longtemps de nouvelles
peines. Il faut se soutenir et se faire part mutuellement du peu de
courage que l'on conserve. Voulez-vous nous voir demain ou après? Il
me semble qu'il y a un siècle que nous ne nous sommes vus. Adieu; vous
avez ĂŠtĂŠ l'autre jour bien aimable, et je regrette que vous ne l'ayez
pas ĂŠtĂŠ plus longtemps.
CXXVIII
Paris, mars 1848.
Je crois que vous vous effrayez un peu trop. Les choses ne sont pas
plus mal quelles n'ĂŠtaient hier; ce qui ne veut pas dire quelles soient
bien et qu'il n'y ait pas de danger. Quant Ă ce projet de voyage,
il est bien difficile de donner un conseil et de voir clair dans ce
grand brouillard ĂŠtendu sur notre avenir. Il y a des gens qui pensent
que Paris, Ă tout prendre, est un lieu plus sĂťr que la province. Je
suis assez de cet avis. Je ne crois pas Ă une bataille dans les rues:
d'abord, parce qu'il n'y a pas encore de motif; puis, parce que la
force et l'audace sont du mĂŞme cĂ´tĂŠ, et que, de l'autre, je ne vois
que platitude et poltronnerie. Si la guerre civile devait commencer,
c'est, je crois, en province quelle se dĂŠclarerait d'abord. Il y a
dĂŠjĂ une assez grande irritation contre la dictature de la capitale,
et peut-être des mesures que l'on ne peut prÊvoir amèneraient-elles ce
rĂŠsultat dans l'Ouest ou ailleurs. Quant aux consĂŠquences des ĂŠmeutes,
voyez ce qu'elles ont ÊtÊ à Paris dans la première rÊvolution, et ce
qu'elles ont ĂŠtĂŠ en province tout rĂŠcemment. Le dĂŠpartement de l'Indre,
oÚ vous voulez aller, en a vu une il y a deux ans, à Buzançais, plus
vilaine que toutes celles de 93. Il est bien entendu que je ne vous
conseille pas et que je raisonne seulement thĂŠoriquement. Je ne crois
pas Ă un danger immĂŠdiat. Je crois mĂŞme que, les circonstances devenant
plus graves, Paris serait encore le meilleur sĂŠjour. Enfin, entre
l'Indre et Boulogne, je prĂŠfĂŠrerais le dernier lieu, qui a l'avantage
d'être près de la mer. Mais je serais bien triste si vous partiez
sans me voir. Ne pourriez-vous pas retarder de quelques jours? Vous
voyez que tout s'est passĂŠ tranquillement hier. Nous aurons encore des
processions semblables et longtemps, avant qu'on en vienne aux coups de
feu, si l'on y vient jamais dans ce pays si timide. Adieu. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
CXXIX
Samedi, 11 mars 1848.
Le temps se met de la partie pour nous contrarier encore. J'espère
qu'il nous sera plus favorable lundi. Je suis inquiet de votre mal
de gorge par cette pluie ou ce froid. Soignez-vous bien et tâchez
d'oublier un peu tout ce qui se passe. Je suis moulu par une nuit
de corps de garde; mais, après tout, la fatigue a son bon côtÊ dans
ce temps-ci. Je voudrais bien avoir autre chose que votre ombre. Je
regrette que vous vous soyez retirĂŠe sitĂ´t. Le bonheur de vous voir est
aussi grand sous la rĂŠpublique que sous la monarchie, il ne faut pas en
ĂŞtre avare. Dans quel ĂŠtrange monde vivons-nous! Mais le plus important
Ă vous dire et le plus pressĂŠ, c'est que je vous aime tous les jours
davantage, je crois, et que je voudrais bien que vous prissiez assez de
courage pour m'en dire autant.
CXXX
Paris, 13 mai 1848.
J'espĂŠrais que vous ne partiriez pas si vite et sans me dire adieu.
Je vous avais mĂŞme ĂŠcrit hier, espĂŠrant vous voir aujourd'hui. Je ne
sais pourquoi je ne me rĂŠconcilie pas Ă ce voyage. Mais vous ne me
dites pas combien de temps vous prĂŠtendez demeurer Ă boire du lait, et
c'ĂŠtait pourtant le point capital. J'aimerais bien que vous fussiez Ă
Paris avec un chapeau neuf pour la rĂŠception de jeudi Ă l'AcadĂŠmie, oĂš
les chapeaux neufs seront rares, je le crains. C'est dans un intĂŠrĂŞt
purement acadĂŠmique que je vous fais cette demande. Dans le mien, je
compte sur vous samedi prochain pour une belle promenade. Si vous
voulez aller jeudi prochain Ă l'AcadĂŠmie, faites prendre des billets
chez moi jusqu'Ă midi.
CXXXI
Paris, mercredi 15 mai 1848.
Tout s'est passÊ très-bien, parce qu'ils sont si bêtes, que, malgrÊ
toutes les fautes de la Chambre, elle s'est trouvĂŠe plus forte qu'eux.
Il n'y a ni tuĂŠs ni blessĂŠs, on est fort tranquille. La garde nationale
et le peuple sont dans d'excellents sentiments. On a pris tous les
chefs des ĂŠmeutiers, et il y a tant de troupes sous les armes, que,
d'ici à quelque temps, il n'y a rien à craindre. J'espère que nous nous
verrons samedi. En somme, tout s'est passĂŠ pour le mieux. J'ai assistĂŠ
à des scènes très-dramatiques qui m'ont fort intÊressÊ et que je vous
raconterai.
CXXXII
27 juin 1848.
Je rentre chez moi ce matin, après une petite campagne de quatre jours
oĂš je n'ai couru aucun danger, mais oĂš j'ai pu voir toutes les horreurs
de ce temps et de ce pays-ci. Au milieu de la douleur que j'ĂŠprouve, je
sens par-dessus tout la bĂŞtise de cette nation. Elle est sans ĂŠgale.
Je ne sais s'il sera jamais possible de la dĂŠtourner de la barbarie
sauvage oÚ elle a tant de propension à se vautrer. J'espère que votre
frère va bien. Je ne pense pas que sa lÊgion ait ÊtÊ sÊrieusement
engagĂŠe. Mais nous sommes bien accablĂŠs de fatigue et nous n'avons pas
dormi depuis quatre jours. Croyez peu Ă tout ce que disent les journaux
sur les morts, les destructions, etc. J'ai parcouru avant-hier la rue
Saint-Antoine: les vitres ĂŠtaient brisĂŠes par le canon et beaucoup de
devantures de boutiques endommagĂŠes; d'ailleurs, le ravage n'ĂŠtait
pas si grand que je l'avais supposĂŠ et qu'on le disait. Voici ce que
j'ai vu de plus curieux. Je me hâte de vous le dire pour aller me
coucher: 1° La prison de la Force est demeurÊe plusieurs heures gardÊe
par la garde nationale et entourĂŠe d'insurgĂŠs. Ils ont dit Ă la garde
nationale: ÂŤNe tirez pas sur nous et nous ne tirerons pas. Gardez
les prisonniers. 2° Je suis entrÊ dans une maison qui fait le coin
de la place de la Bastille pour voir la bataille; elle venait d'ĂŞtre
enlevĂŠe sur les insurgĂŠs. J'ai demandĂŠ aux habitants: ÂŤVous a-t-on
pris beaucoup?--On n'a rien volĂŠ.Âť Ajoutez Ă cela que j'ai conduit Ă
l'Abbaye une femme qui coupait la tĂŞte aux mobiles avec son couteau de
cuisine, et un homme qui avait les deux bras rouges de sang pour avoir
fendu le ventre Ă un blessĂŠ et s'ĂŞtre lavĂŠ les mains dans la plaie.
Comprenez-vous quelque chose Ă cette grande nation? Ce qu'il y a de
sĂťr, c'est que nous nous en allons Ă tous les diables!
Quand revenez-vous? Nous ne nous battrons plus de six semaines, tout au
moins.
CXXXIII
Paris, 2 juillet 1848.
J'aurais bien besoin de vous voir pour me remettre un peu des tristes
scènes de la semaine dernière, et c'est avec le plus vif plaisir que
j'apprends vos projets de retour, plus prochains que je ne l'avais
espĂŠrĂŠ. Paris est et sera tranquille pour un temps assez long. Je ne
pense pas que la guerre civile, ou plutĂ´t la guerre sociale soit finie;
mais une nouvelle bataille aussi effroyable me semble impossible. Il
a fallu pour l'amener une infinitĂŠ de circonstances qui ne peuvent
plus se reproduire. Quand vous reviendrez, vous ne trouverez guère les
traces hideuses que votre imagination vous reprĂŠsente probablement.
Les vitriers et les badigeonneurs en ont dĂŠjĂ fait disparaĂŽtre la plus
grande partie. Mais j'ai peine Ă croire que vous ne nous trouviez
pas Ă tous la mine allongĂŠe, et encore plus triste que lorsque vous
ĂŞtes partie. Que voulez-vous! c'est le rĂŠgime actuel et il faut
s'y habituer. Petit Ă petit, nous en viendrons Ă ne plus penser au
lendemain et à nous trouver très-heureux quand nous nous Êveillerons
le matin ayant notre soirĂŠe assurĂŠe. Au fond, ce qui me manque le plus
Ă Paris, c'est vous, et je crois que, si vous y ĂŠtiez, je trouverais
le reste très-bien. Le temps s'est remis à la pluie depuis trois
jours. Maintenant, je la vois tomber avec la plus grande insouciance;
mais je ne voudrais pas cependant que cela durât trop. Vous me parlez
en termes si gĂŠnĂŠraux de votre retour, que je ne sais trop sur quoi
compter, et vous savez que j'aime assez Ă savoir combien de temps
durera le purgatoire. Vous parliez de six semaines en me disant adieu,
et maintenant vous dites que vous reviendrez plus tĂ´t? Que veut dire
plus tĂ´t? voilĂ ce que je voudrais bien savoir. Mandez-moi aussi ce que
deviennent les dĂŠsagrĂŠables affaires qui vous ont empĂŞchĂŠe d'assister
Ă ma fĂŞte, cĂŠlĂŠbrĂŠe par tant de coups de canon.--Adieu; pour prendre
patience, j'ai besoin d'avoir souvent de vos nouvelles. Donnez-m'en
vite et envoyez-moi quelque souvenir. Je pense Ă vous sans cesse. J'y
pensais mĂŞme en voyant ces maisons dĂŠsertes de la rue Saint-Antoine
pendant qu'on se battait Ă la Bastille.
CXXXIV
Paris, 9 juillet 1848.
Vous ĂŞtes comme AntĂŠe, qui reprenait des forces en touchant la terre.
Vous n'avez pas plus tĂ´t touchĂŠ votre pays natal, que vous retombez
dans tous vos vieux dĂŠfauts. Vous rĂŠpondez joliment Ă ma lettre. Je
vous priais de me dire combien de temps vous prĂŠtendiez demeurer encore
Ă manger des amiles; un chiffre de jour n'ĂŠtait pas bien difficile Ă
ĂŠcrire, mais vous avez prĂŠfĂŠrĂŠ trois pages de circonlocutions oĂš je ne
puis comprendre autre chose, sinon que vous seriez revenue, si vous
n'ĂŠtiez pas restĂŠe. Je vois aussi que vous passez votre temps assez
agrĂŠablement. Je pensais bien que l'ĂŠcharpe de madame *** n'avait pas
ĂŠtĂŠ achetĂŠe pour en faire des reliques. Vous auriez du me dire au moins
contre qui vous aviez jugĂŠ Ă propos de l'essayer. En somme, je suis
fort mĂŠcontent de votre lettre.--Nous passons ici des jours bien longs
et passablement chauds, mais aussi tranquilles qu'on peut le souhaiter
ou plutĂ´t l'espĂŠrer sous la RĂŠpublique. Tout annonce que nous aurons
une trêve assez longue. Le dÊsarmement s'opère avec assez de vigueur
et produit de bons rĂŠsultats. On remarque un curieux symptĂ´me: c'est
que, dans les faubourgs insurgĂŠs, on trouve quantitĂŠ de dĂŠnonciateurs
pour indiquer les cachettes, et mĂŞme les coryphĂŠes des barricades. Vous
savez que c'est bon signe quand les loups se battent entre eux. Je
suis allĂŠ hier Ă Saint-Germain pour commander le dĂŽner de la SociĂŠtĂŠ
des bibliophiles. J'ai trouvÊ un cuisinier très-capable et, de plus,
ĂŠloquent. Il m'a dit que c'ĂŠtait Ă tort que tant de gens se faisaient
un fantĂ´me des artichauts Ă la barigoule, et il a compris tout de suite
les plats les plus fantastiques que je lui ai proposĂŠs. C'est dans le
pavillon oĂš Henri IV est nĂŠ que demeure ce grand homme. On a, de lĂ ,
la plus belle vue du monde. En faisant deux pas, on se trouve dans un
bois avec de grands arbres et un magnifique _underwood_ au-dessous. Pas
une âme pour jouir de tout cela! Il est vrai qu'il faut cinquante-cinq
minutes pour parvenir dans ces beaux lieux. Mais serait-ce impossible
d'aller y dĂŽner ou dĂŠjeuner un jour avec madame...? Adieu. Ăcrivez-moi
bientĂ´t.
CXXXV
Paris, lundi 19 juillet 1848.
Vous devinez parfaitement les choses quand vous voulez bien vous en
donner la peine, et vous m'avez envoyĂŠ ce que je vous demandais;
qu'importe que ce fĂťt une rĂŠpĂŠtition! Ne suis-je pas comme le pauvre
ex-roi? Je reçois toujours avec un nouveau plaisir, etc. Ce que
je ne puis vous dire, c'est combien j'ai ĂŠtĂŠ charmĂŠ de retrouver ce
parfum connu et d'autant plus dĂŠlicieux qu'il est bien connu et qu'il
s'y rattache tant de souvenirs. Vous vous êtes enfin dÊcidÊe à lâcher
le grand mot. Il est vrai qu'il y a un mois que vous ĂŞtes partie et
qu'en partant vous aviez parlĂŠ de six semaines; d'oĂš il suivrait
que, dans quinze jours, je pourrais vous revoir; mais aussitĂ´t vous
vous mettez à compter les six semaines à votre manière, c'est-à -dire
du jour oÚ vous m'Êcrivez. Cela ressemble un peu à la manière de
compter du diable, qui, comme vous savez, groupe les chiffres tout
autrement que les bons chrĂŠtiens. Dites-moi donc un jour, prenons le
dĂŠlai le plus long que je puisse vous accorder, soit le 15 aoĂťt. Nous
avons passĂŠ fort paisiblement le 14 juillet, malgrĂŠ les prĂŠdictions
sinistres qu'on nous faisait. La vĂŠritĂŠ, si on peut la dĂŠcouvrir sous
le gouvernement oĂš nous avons le bonheur de vivre, la vĂŠritĂŠ, c'est
que nos chances de tranquillitÊ sont singulièrement augmentÊes. Il
avait fallu plusieurs annĂŠes d'organisation et quatre mois d'armements
pour prĂŠparer les affaires des 23-26 juin. Une seconde reprĂŠsentation
de cette sanglante tragĂŠdie me paraĂŽt impossible, du moins tant que
les conditions actuelles ne seront pas très-matÊriellement changÊes.
Pourtant, quelque petit complot, quelques assassinats, quelques ĂŠmeutes
même sont encore probables. Nous avons pour un demi-siècle peut-être
Ă nous perfectionner, les uns dans la confection des barricades, les
autres dans leur destruction. On emplit Paris en ce moment d'obusiers
et de mortiers à grenades, très-transportables et très-efficaces. C'est
un argument nouveau et qu'on dit excellent. Mais laissons la ĎοΝξΟΚĎá˝°.
Vous ne pouvez vous faire une idĂŠe du plaisir que vous me ferez en
acceptant mon invitation Ă dĂŠjeuner avec lady ***.
CXXXVI
Paris, samedi 5 aoĂťt 1848.
. . . . . . . . . . . .
On reparle de coups de fusil, mais je n'y crois nullement. Pourtant,
ce soir, mon ami M. Mignet se promenait avec mademoiselle Dosne dans
le petit jardin qui est devant la maison de M. Thiers. Une balle est
venue de haut en bas sans faire le moindre bruit, qui a frappĂŠ contre
la maison, près de la fenêtre de madame Thiers; et, comme toute balle
porte son billet, celle-lĂ en avait un pour une partie charnue sur
laquelle ĂŠtait assise une petite fille de douze ans en dehors de la
grille du jardin. On la lui a extirpÊe très-proprement et elle n'aura
aucun autre mal qu'une lĂŠgère cicatrice. Mais Ă qui en voulait-on? Ă
Mignet? cela est impossible; Ă mademoiselle Dosne? encore moins. Madame
Thiers n'ĂŠtait pas chez elle, ni Thiers non plus. Personne n'a entendu
d'explosion; pourtant, la balle ĂŠtait de calibre de guerre, et les
fusils Ă vent sont tous d'un calibre beaucoup plus faible. Pour moi, je
pense que c'est une tentative rĂŠpublicaine d'intimidation, bĂŞte comme
tout ce qui se fait aujourd'hui. VoilĂ les seules balles Ă craindre
à mon avis. Le gÊnÊral Cavaignac a dit: On me tuera, Lamoricière me
succĂŠdera, ensuite Bedeau; puis viendra le duc d'Isly, qui balayera
tout.Âť Ne trouvez-vous pas quelque chose de prophĂŠtique lĂ -dedans? On
ne croit guère à une intervention en Italie. La RÊpublique sera un peu
plus poltronne que la monarchie. Seulement, il se peut qu'on fasse
la frime de laisser soupçonner qu'on serait tentÊ d'intervenir,
dans l'espoir qu'on obtiendra des atermoiements, un congrès et des
protocoles. Un de mes amis qui revient d'Italie a ĂŠtĂŠ pillĂŠ par des
volontaires romains qui trouvent les voyageurs de meilleure composition
que les Croates. Il prĂŠtend qu'il est impossible de faire battre les
Italiens, exceptĂŠ les PiĂŠmontais, qui ne peuvent ĂŞtre partout.
Je vous envoie toute cette politique et j'espère qu'elle ne changera
rien Ă vos projets. On fait de grands prĂŠparatifs Ă la Marine pour
transporter six cents de ces messieurs pris en juin: ce sera le
premier convoi. Je ne serais pas ĂŠloignĂŠ de croire qu'il y eĂťt, le
jour du transport, quelques milliers de veuves ĂŠplorĂŠes Ă la porte de
l'AssemblĂŠe; mais de nouveaux insurgĂŠs, n'y croyez point.--Laissez
donc de cĂ´tĂŠ le romaĂŻque, oĂš vous avez tort de vous complaire, car il
vous jouera le mĂŞme tour qu'Ă moi, qui n'ai pu l'apprendre et qui ai
dĂŠsappris le grec. Je m'ĂŠtonne que vous compreniez quelque chose Ă ce
baragouin-lĂ . Il va, d'ailleurs, disparaĂŽtre en peu de temps. DĂŠjĂ on
parle grec à Athènes, et, si cela continue, le romaïque ne servira
plus qu'à la canaille. Dès 1841, on n'entendait plus prononcer, dans
la Grèce du roi Othon, un seul des mots turcs si frÊquents dans les
ĎĎιγ៥δΚον de M. Fauriel. Vous ai-je traduit une ballade très-jolie d'un
Grec qui revient chez lui après une longue absence et que sa femme ne
reconnaĂŽt pas? Elle lui demande, comme PĂŠnĂŠlope, des renseignements
sur sa maison; il y rĂŠpond fort bien, mais elle n'est pas convaincue;
elle en veut, d'autres qu'elle obtient et la reconnaissance se fait.
Tout cela est abandonnĂŠ Ă votre divination. Adieu; j'attends de vos
nouvelles.
CXXXVII
Paris, 12 aoĂťt 1848.
Le beau temps s'en va et nous allons entrer, d'ici Ă quelques jours,
dans la saison froide, qui m'est si antipathique. Je ne puis vous dire
combien je suis en colère contre vous. En outre, les abricots et les
prunes sont presque passĂŠs et je me faisais une fĂŞte d'en manger avec
vous. Je suis parfaitement sĂťr que, si vous aviez rĂŠellement voulu
revenir, vous seriez dĂŠjĂ Ă Paris. Je m'ennuie horriblement et j'ai
bien envie de m'en aller quelque part sans vous attendre. Tout ce que
je puis faire, c'est de vous donner jusqu'au 25 Ă trois heures, et pas
une heure de plus.--Nous sommes fort tranquilles. On parle toujours, il
est vrai, d'une Êmeute que M. Ledru ferait par manière de protestation
contre l'enquĂŞte; mais ce ne peut ĂŞtre quelque chose de sĂŠrieux. La
première condition pour qu'on se batte, c'est qu'il y ait de la poudre
et des fusils des deux cĂ´tĂŠs. Or, maintenant, tout est du mĂŞme cĂ´tĂŠ.
Avant-hier, au concours gĂŠnĂŠral, un gamin nommĂŠ Leroy a eu un prix.
Les autres gamins ont criĂŠ: ÂŤVive le roi!Âť Le gĂŠnĂŠral Cavaignac, qui
assistait, je ne sais pourquoi, Ă la cĂŠrĂŠmonie, a ri de fort bonne
grâce. Mais, le même gamin ayant eu un autre prix, les cris sont
devenus si forts, qu'il en a perdu toute contenance et tortillait
sa barbe comme s'il eĂťt voulu l'arracher. Adieu; je vous en veux
horriblement! ĂŠcrivez-moi bien vite.
CXXXVIII
Paris, 20 aoĂťt 1848.
. . . . . . . . . . . .
Je commence Ă croire que je ne vous verrai pas cette annĂŠe. VoilĂ
que l'on recommence Ă parler d'ĂŠmeutes, et puis le cholĂŠra va
venir compliquer les affaires. On dit qu'il est Ă Londres. IL est
certainement Ă Berlin. Depuis quelques jours, on s'attend Ă une
bagarre. On prĂŠdit des coups de fusil pour la discussion de l'enquĂŞte.
Je suis si entĂŞtĂŠ dans mes idĂŠes, que je n'y crois pas encore; mais
je suis à peu près seul de mon avis. La situation est au fond bien
embrouillĂŠe. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau Ă celle de Rome
pendant la conjuration de Catilina. Seulement, il n'y a pas de CicĂŠron.
Quant Ă l'issue d'une ĂŠmeute, je ne doute pas que la bonne cause ne
triomphe. Personne n'en doute, mais avec des fous il ne faut pas
compter sur des entreprises raisonnables; peut-ĂŞtre, en effet, ai-je
tort de croire que l'impossibilitĂŠ de rĂŠussir empĂŞche cette ĂŠmeute
susdite. Nous verrons, au reste, la semaine prochaine. Mercredi, la
discussion doit commencer; l'enquĂŞte me paraĂŽt surtout prouver une
chose, c'est la profonde division des rĂŠpublicains entre eux. Il est
ĂŠvident qu'il n'y en a pas deux de la mĂŞme opinion. Ce qu'il y a de
plus fâcheux, c'est que le citoyen Proudhon a un grand nombre d'adeptes
et que ses petites feuilles se vendent Ă milliers dans les faubourgs.
Tout cela est fort triste; mais, quoi qu'il arrive, nous vivrons
longtemps de cette vie-lĂ , et il faut nous y accoutumer. Le point qui
me paraĂŽt capital, c'est de savoir si vous viendrez le 25. S'il doit
y avoir bataille, elle sera perdue ou gagnĂŠe ce jour-lĂ . Ainsi, ne
faites pas encore de projets, ou plutĂ´t faites celui de venir assister
Ă notre victoire ou Ă notre enterrement pour le 25. Une autre chose
me chagrine: c'est que la chaleur s'en va, le beau temps se passĂŠ, et
il n'y aura plus de pĂŞches Ă votre retour. Les feuilles commencent Ă
jaunir et Ă tomber. Je prĂŠvois tous les ennuis du froid et de la pluie,
qui me semblent beaucoup plus graves et beaucoup plus certains que
l'ĂŠmeute. Je suis malade depuis quelques jours, c'est peut-ĂŞtre pour
cela que je suis triste. Je n'ai pas besoin de vous dire que je serais
très-contrariÊ de mourir avant notre dÊjeuner à Saint-Germain, qui, je
l'espère, tiendra toujours. Adieu; Êcrivez-moi vite. Vous ne devriez
pas taquiner les gens de si loin.
CXXXIX
Paris, 23 aoĂťt 1848.
Vous n'êtes guère aimable de ne pas me rÊpondre plus tôt. Je crois que
je vous ai Êcrit trop en noir la dernière fois. Je vois aujourd'hui les
choses, non en couleur de rose, mais gris de lin. C'est la couleur la
plus gaie que comporte la RĂŠpublique. On m'avait fait croire malgrĂŠ moi
Ă la bataille; maintenant, je n'y crois plus, ou, si j'y crois, c'est
pour plus tard. Aussi bien, je m'imagine que vous mourez de froid au
bord de votre mer. Je suis toujours malade, je ne mange ni ne dors;
mais le pire de mes maux, c'est que je m'ennuie ĂŠpouvantablement.
Cependant, j'ai Ă travailler, et ce n'est pas dans l'oisivetĂŠ que je
bâille; mais, dans quelque situation que le phÊnomène se manifeste,
il est toujours fort dĂŠsagrĂŠable. Pour vous, je ne comprends pas ce
que vous pouvez faire Ă D..., et je ne vois pas d'autre explication Ă
votre sĂŠjour parmi vos sauvages, que de penser que vous y avez fait
quelque conquête dont vous êtes toute fière. Je vous rÊserve une belle
querelle pour votre retour. Sera-ce vendredi ou bien lundi? Je ne crois
pas qu'il soit prudent Ă vous d'attendre plus longtemps. Adieu; je
vous quitte pour aller entendre votre favori, M. Mignet, qui fait un
discours Ă d'AcadĂŠmie morale. Croyez que l'enquĂŞte se passera sans
coups de fusil; quant au scandale, on ne sait plus ce que c'est par
le temps qui court.
CXL
Paris, samedi 5 novembre 1848.
J'ai ÊtÊ très-irritÊ contre vous, car j'avais le plus grand besoin
de vous voir; j'ai ÊtÊ et je suis encore très-souffrant et, qui pis
est, affreusement triste. Une heure passÊe auprès de vous m'aurait
fait grand bien. Vous n'avez mĂŞme pas pris la peine que vous preniez
autrefois de me dire quelque chose d'aimable lorsque vous aviez quelque
mĂŠchancetĂŠ en tĂŞte. Quelques justes reproches que j'aie Ă vous faire,
il faudra toujours finir par vous pardonner; mais je voudrais bien que
vous fissiez quelque chose pour cela. Me ferez-vous quelque finezay
pour me dĂŠdommager de tout l'ennui que j'ai eu pendant quinze jours? Je
vous laisse Ă trouver vous-mĂŞme ce dĂŠdommagement _adequate._
Avez-vous entendu le canon et avez-vous eu peur? J'ai cru qu'on
voulait dĂŠmolir la RĂŠpublique aux trois premiers coups. J'ai compris
au quatrième de quoi il s'agissait. Vous avez toujours à moi un livre
grec. J'ai peur que vous ne gâtiez votre hellÊnisme avec le baragouin
romaïque. Cependant, je crois qu'il y a de très-jolies choses dans ce
volume. Je travaille Ă un ouvrage nouveau ĂŠgalement historique.
CXLI
Londres, 1er juin 1850.
Si je ne vous ai pas ĂŠcrit plus tĂ´t, c'est que, ayant Ă faire dix
lieues par jour, je ne pouvais m'asseoir devant une table sans
m'endormir tout de suite. Je ne vous dirai pas grand'chose de mes
impressions de voyage, si ce n'est que dĂŠcidĂŠment les Anglais sont
individuellement bĂŞtes et en masse un peuple admirable. Tout ce qui
peut se faire avec de l'argent, du bon sens et de la patience, ils
le font; mais ils se doutent des arts comme mon chat. Il y a ici des
princes nÊpâlais dont vous deviendriez Êprise. Ils ont des turbans
plats tout bordĂŠs de grosses ĂŠmeraudes en pendeloques, et ne sont
que satin, cachemire, perles et or! Leur couleur est un cafĂŠ au lait
très-foncÊ. Ils ont bon air et on dirait qu'ils ont de l'esprit.
J'ai ĂŠtĂŠ interrompu en cet endroit de ma lettre par une visite et je
n'ai pu retrouver le fil de mes idĂŠes qu'aujourd'hui 2 juin, jour
de dimanche. Nous allons Ă Hampton-Court pour ĂŠviter les chances de
suicide que le Lord's day ne manquerait pas de nous offrir. J'ai dĂŽnĂŠ
hier avec un ĂŠvĂŞque et un _dean_ qui m'ont rendu de plus en plus
socialiste. L'ĂŠvĂŞque est de ce que les Allemands appellent l'ĂŠcole
rationaliste; il ne croit pas mĂŞme Ă ce qu'il enseigne, et, moyennant
son tablier de gros de Naples noir, il fricote ses cinq ou six mille
livres tous les ans et passe son temps Ă lire du grec. Outre cela, je
me suis enrhumĂŠ, en sorte que je suis on ne peut plus dĂŠmoralisĂŠ. Sous
le prĂŠtexte que nous sommes en juin, on me livre Ă des courants d'air
destructeurs. Toutes les femmes me paraissent faites en cire. Elles
mettent des _bustles_ (tournures) si considĂŠrables, qu'il ne tient
qu'une femme sur le trottoir de Regent's Street. J'ai passĂŠ ma matinĂŠe
hier dans la nouvelle chambre des Communes, qui est une affreuse
monstruositĂŠ. Nous n'avions pas encore d'idĂŠe de ce qu'on peut faire
avec un manque de goĂťt complet et deux millions de livres sterling.
Je crains de devenir tout Ă fait socialiste en mangeant de trop bons
dĂŽners dans de la vaisselle plate en vermeil, et en voyant des gens qui
gagnent quatorze mille livres sterling aux courses d'Epsom. Mais il n'y
a pas encore de probabilitĂŠ qu'une rĂŠvolution ĂŠclate ici. La servilitĂŠ
des pauvres gens est ĂŠtrange pour nos idĂŠes dĂŠmocratiques. Chaque jour,
nous en voyons quelque nouvel exemple. La grande question est de savoir
s'ils ne sont pas plus heureux. Ăcrivez-moi Ă Lincoln, poste restante.
Lincoln est dans le Lincolnshire, je crois, mais je n'en jurerais pas.
CXLII
Salisbury, samedi 15 juin 1850.
. . . . . . . . . . . .
Je commence Ă avoir assez de ce pays-ci. Je suis excĂŠdĂŠ de
l'architecture perpendiculaire et des manières Êgalement
perpendiculaires des natifs. J'ai passĂŠ deux jours Ă Cambridge et Ă
Oxford, chez des rÊvÊrends, et, tout bien considÊrÊ, je prÊfère les
capucins. Je suis particulièrement furieux contre Oxford. Un _fellow_
a eu l'insolence de m'inviter Ă dĂŽner. Il y avait un poisson de quatre
pouces dans un grand plat d'argent et une cĂ´telette d'agneau dans un
autre. Tout cela servi dans un style magnifique avec des pommes de
terre dans un plat de bois sculptĂŠ. Mais jamais je n'ai eu si faim.
C'est la suite de l'hypocrisie de ces gens-lĂ . Ils aiment Ă montrer aux
ĂŠtrangers qu'ils sont sobres, et, moyennant qu'ils font un _luncheon_,
ils ne dĂŽnent pas. Il fait un vent du diable et un froid de chien.
S'il ne faisait grand jour Ă huit heures du soir, on pourrait se
croire en dĂŠcembre. Cela n'empĂŞche pas toutes les femmes de sortir
avec un parasol ouvert. Je viens de faire une boulette. J'ai donnĂŠ une
demi-couronne Ă un monsieur en noir qui m'a montrĂŠ la cathĂŠdrale, et
puis je lui ai demandĂŠ l'adresse d'un gentleman pour qui j'avais une
lettre du _dean_. Il s'est trouvĂŠ que c'ĂŠtait Ă lui-mĂŞme que la lettre
ĂŠtait adressĂŠe. 11 a eu l'air fort sot, et moi aussi; mais il a gardĂŠ
l'argent. Je compte aller demain revoir Stone-Henge, et j'irai le soir
dĂŽner Ă Londres, s'il fait un peu moins de brouillard. Lundi ou mardi,
je partirai pour Canterbury, et je pense ĂŞtre Ă Paris vendredi. Je
voudrais bien que vous fussiez Ă Salisbury. Stone-Henge vous ĂŠtonnerait
fort. Adieu; je retourne Ă mon ĂŠglise. Ma lettre partira, Dieu sait
quand! On vient de me dire que, le jour du Seigneur, la poste se
reposait. J'ai un rhume abominable, je tousse et je n'ai que du vin
de Porto Ă boire.--Les femmes ont ici des cerceaux Ă leurs robes. Il
est impossible de voir quelque chose de plus ridicule qu'une Anglaise
en cerceau.--Qu'est-ce que c'est qu'une miss Jewsbury, un peu rousse,
qui fait des romans? Je l'ai rencontrĂŠe l'autre soir, et elle m'a dit
quelle avait rĂŞvĂŠ toute sa vie un plaisir quelle croyait impossible,
qui ĂŠtait de me voir (textuel). Elle a fait un roman sous le titre de
_ZoĂŠ._ Vous qui lisez tant, vous me direz quelle est cette personne,
pour qui je suis un livre. Il y a un petit hippopotame au Jardin
zoologique, qu'on nourrit de riz au lait. Le _Punch_ du 15, donne
son portrait qui est d'une ressemblance achevÊe. Adieu; tâchez de me
dĂŠdommager par une jolie promenade de mon voyage de trois semaines.
CXLIII
Bâle, 10 octobre 1850.
Il y a bien longtemps que je veux vous ĂŠcrire et je ne sais comment
il se fait que j'ai tant tardĂŠ. D'abord, j'ai vĂŠcu dans des lieux si
dĂŠserts et si sauvages, qu'il n'ĂŠtait pas vraisemblable que la poste y
pÊnÊtrât, et puis j'ai eu tant de gymnastique à faire pour visiter les
châteaux gothiques des Vosges, que, le soir, il ne me restait plus de
force pour prendre une plume. Le temps, qui avait ĂŠtĂŠ très-mauvais Ă
mon dĂŠpart, s'est mis au beau pour mon excursion d'Alsace, et j'ai joui
très-complètement des montagnes, des bois et d'un air que la fumÊe de
charbon de terre n'a jamais viciĂŠ, et qui n'a jamais vibrĂŠ aux accents
du chĹur des _Girondins._ J'ĂŠprouvais un vif plaisir au milieu de ces
lieux sauvages et je me demandais comment on pouvait vivre ailleurs.
Les bois sont encore tout verts et ont des odeurs dĂŠlicieuses qui me
rappellent nos promenades. Me voici enfin en pays rÊpublicain modèle,
oĂš il n'y a ni douaniers ni gendarmes, et oĂš il y a des lits de ma
taille, confort ignorĂŠ en Alsace, Je m'y repose un jour. Demain, je
verrai la cathĂŠdrale de Fribourg, et j'irai tout de suite vĂŠrifier
si les statues sont aussi belles que celles d'Erwin de Steinbach, Ă
Strasbourg.--De Strasbourg, je partirai le 12, et serai le lĂ Ă Paris.
J'espère vous y trouver. Je n'ai pas besoin de vous dire combien cela
me ferait plaisir. Mais cela ne vous empĂŞchera pas d'en faire Ă votre
tĂŞte. Adieu; vous devez, ĂŠtant paresseuse comme vous ĂŞtes, me savoir
grĂŠ de vous ĂŠcrire si tard, puisque cela vous dispense de me rĂŠpondre.
CXLIV
Paris, lundi 15 juin 1851.
Ma mère va mieux et je pense que sous peu elle sera tout à fait remise.
J'ai ĂŠtĂŠ bien inquiet; j'ai craint une fluxion de poitrine. Je vous
remercie de l'intĂŠrĂŞt que vous lui avez tĂŠmoignĂŠ.
Hier, je suis sorti pour la première fois depuis huit jours, pour aller
voir les danseuses espagnoles qui travaillaient chez la princesse
Mathilde. Elles m'ont paru mĂŠdiocres. La danse chez Mabille a tuĂŠ le
mĂŠrite du bolĂŠro. En outre, ces dames avaient une telle quantitĂŠ de
crinoline par derrière et tant de coton par devant, qu'on s'aperçoit
que la civilisation envahit tout. Ce qui m'a le plus amusĂŠ, c'est une
petite fille de douze ans et une vieille duègne, l'une et l'autre
encore toutes surprises de se voir hors de la _tierra_ de JĂŠsus et
aussi barbares qu'on puisse le dĂŠsirer.--Je viens de recevoir votre
coussin; vous êtes vraiment une très-habile ouvrière, ce dont je ne
vous aurais jamais soupçonnÊ. Le choix des couleurs et la broderie
sont Êgalement merveilleux. Ma mère a fort admirÊ le tout. Quant à la
symbolique, il m'a suffi du commencement d'explication que vous avez
bien voulu me donner pour comprendre tout le reste.--Je ne sais comment
vous remercier.
Je joins ici le Saint-Ăvremont. Je l'avais perdu, et il m'a fallu des
efforts de mĂŠmoire prodigieux pour le retrouver. Vous me direz ce que
vous pensez du père Ganaye. Je trouve qu'on ne peut plus lire après
cela rien du XIXe siècle.
Adieu.
CXLV
Londres, samedi 22 juillet 1851.
Je suis bien triste de ce que vous me dites de votre dĂŠpart; je
comptais vous retrouver Ă Paris et je ne puis m'accoutumer Ă l'idĂŠe de
votre ĂŠloignement. Je n'ai pas mĂŞme la consolation de vous gronder;
tâchez d'être de retour dans les premiers jours d'aoÝt. Je ne vous
ferai pas de reproches, parce que je suis sĂťr que vous ferez tous
vos efforts pour me dire adieu. Pensez qu'il est bien dur de passer
plusieurs mois sans vous voir. Enfin, vous savez tout le bonheur que
j'aurai, et, si la chose est possible, elle se fera.
Le Palais de Cristal est une grande arche de NoĂŠ, merveilleux pour la
singularitÊ des objets qui s'y trouvent, très-mÊdiocre d'ailleurs au
point de vue de l'art; en rÊsumÊ, on y passe une journÊe très-amusante.
Je suis si contrariĂŠ de votre lettre, que je n'ai pas le courage
d'ĂŠcrire. Adieu.
CXLVI
Paris, jeudi soir, 2 dĂŠcembre 1851.
Il me semble qu'on livre la dernière bataille, mais qui la gagnera?
Si le prĂŠsident la perd, il me semble que les hĂŠroĂŻques dĂŠputĂŠs
devront cĂŠder la place Ă Ledru-Rollin. Je rentre horriblement fatiguĂŠ
et n'ayant rencontrĂŠ que des fous, Ă ce qu'il m'a paru. La mine de
Paris me rappelle le 24 fĂŠvrier; seulement, les soldats font peur aux
bourgeois. Les militaires disent qu'ils sont sÝrs du succès; mais
vous savez ce que c'est que leurs almanachs. VoilĂ notre promenade
ajournĂŠe...
Adieu, ĂŠcrivez-moi et dites-moi si les vĂ´tres sont engagĂŠs dans la
bagarre.
CXLVII
Paris, 3 dĂŠcembre 1851.
Que vous dirai-je? Je n'en sais pas plus long que vous. Il est certain
que les soldats ont l'air farouche et font cette fois peur aux
bourgeois. Quoi qu'il en soit, nous venons de tourner un rĂŠcif et nous
voguons vers l'inconnu. Rassurez-vous et dites-moi quand je pourrai
vous voir.
CXLVIII
24 mars 1852.
. . . . . . . . . . . .
J'ai toutes les tracasseries du monde, outre beaucoup d'ouvrage sur les
bras; enfin, j'ai entrepris une Ĺuvre chevaleresque dans un premier
mouvement, et vous savez qu'il faut se garder de cela. Je m'en repens
parfois. Le fond de la question, c'est qu'à force de voir des pièces
justificatives sur l'affaire de Libri, j'ai eu la dĂŠmonstration la plus
complète de son innocence, et je suis à faire une grande tartine dans
la _Revue_, au sujet de son procès et de toutes les petites infamies
qui s'y rattachent. Plaignez-moi; il n'y a que des coups Ă gagner Ă
ce mĂŠtier-lĂ ; mais quelquefois on se sent si rĂŠvoltĂŠ par l'injustice,
qu'on devient bĂŞte.
Quand donc ferons-nous un tour au MusÊe? Je suis bien fâchÊ d'apprendre
cette triste mort d'une personne que vous aimez. Mais c'est une raison
de plus pour se voir et essayer si une intimitĂŠ comme la nĂ´tre est un
remède contre le chagrin. Vous avez bien raison de trouver la vie une
sotte chose, mais il ne faut pas la rendre pire qu'elle n'est. Après
tout, il y a de bons moments, et le souvenir de ces bons moments est
plus agrĂŠable que le souvenir des mauvais n'est triste. J'ai plus de
plaisir Ă me rappeler nos causeries que de chagrin Ă penser Ă nos
querelles. Il faut faire ample provision de ces bons souvenirs...
CXLIX
Paris, 22 avril au soir, 1852.
Votre lettre m'a fait grand bien. Je suis en ce moment nerveux comme
on l'est après avoir cÊdÊ à un premier mouvement; vous savez qu'ils
sont presque toujours honnĂŞtes. C'est le moment oĂš tous les sentiments
bas reviennent. On me menace d'un procès pour mÊpris de la justice
et attaque contre la chose jugĂŠe. Cela me paraĂŽt fort, mais tout est
possible, _y siempre lo peor es Cierto._ D'un autre cĂ´tĂŠ, l'Ăcole des
chartes aiguise ses griffes pour me dĂŠchirer. Il va falloir subir
peut-être des interrogatoires et faire une polÊmique enragÊe. J'espère
qu'au moment de la bataille je retrouverai mon ĂŠnergie. Ă prĂŠsent, je
suis tout dĂŠconfit et ennuyĂŠ. Je vous remercie de ce que vous me dites;
j'y suis très-sensible. Tâchez de vous porter de mieux en mieux pour
venir me voir en prison, le cas ĂŠchĂŠant.
CL
Vendredi soir, 1er mai 1852.
Ma bonne mère est morte; j'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Elle
avait les traits calmes et l'air doux qui lui ĂŠtait ordinaire. Je vous
remercie de tout l'intĂŠrĂŞt que vous lui avez tĂŠmoignĂŠ.
Adieu; pensez Ă moi et donnez-moi vite de vos nouvelles.
CLI
Paris, 19 mai 1852.
Ce beau temps ne vous dit-il rien? Il me renouvelle, Ă ce qu'il me
semble. Je vous attendais presque hier, je ne sais pourquoi; il me
semblait que vous auriez dĂť savoir que je vous attendais. Venez donc
au plus vite; j'ai quantitĂŠ de choses Ă vous dire. Je ne sais si l'on
veut me prendre ou non, et l'on me dit Ă ce sujet tantĂ´t blanc, tantĂ´t
noir. Ce qui me rend très _fidgetty_, c'est la pensÊe d'une cÊrÊmonie
publique[1] devant la fleur de la canaille et trois imbĂŠciles en robe
noire, roides comme des piquets et persuadĂŠs qu'ils sont quelque chose,
auxquels on ne peut songer Ă dire le profond mĂŠpris qu'on a pour leur
robe, leur personne et leur esprit.
Adieu; rĂŠpondez-moi un mot.
[1] L'audience pour l'article poursuivi concernant Libri.
CLII
Paris, 22 mai 1852.
Notre promenade vous a-t-elle fatiguĂŠe? Dites-moi vite que non.
J'attendais un mot de vous aujourd'hui. Je suis confisquĂŠ par mon
avocat, qui me plaĂŽt fort[1]. Il me semble homme d'esprit, point trop
ĂŠloquent et comprend l'affaire exactement comme moi. Cela me donne un
peu d'espĂŠrance. . . . .
. . . . . . . . . . . .
[1] M. Nogent Saint-Laurens.
CLIII
Mai 1852, mercredi Ă cinq heures.
Quinze jours de prison et mille francs d'amende! Mon avocat a très-bien
parlÊ; les juges ont ÊtÊ très-polis; je n'ai pas ÊtÊ nerveux du tout.
En somme, je ne suis pas aussi mĂŠcontent que j'aurais le droit de
l'ĂŞtre. Je n'en appelle pas.
CLIV
27 mai 1852, au soir.
Vous ĂŞtes, par ma foi, d'un bon sel! J'ĂŠtais allĂŠ l'autre jour chez
des magistrats et j'avais eu l'imprudence d'avoir un billet de mille
francs dans ma poche. Je ne l'ai plus retrouvĂŠ; mais il est impossible
que, chez des personnes d'un si haut mĂŠrite, il se glisse des coupeurs
de bourse; aussi le billet s'est ĂŠvaporĂŠ de lui-mĂŞme, n'y pensons
plus. En mĂŞme temps, j'ai eu le malheur de toucher un soi-disant
pestifĂŠrĂŠ et l'on a jugĂŠ prudent de me mettre en quarantaine pour
quinze jours; le grand malheur vraiment! Mon ami M. Bocher va en prison
Ă la fin de juin, nous nous y installerons ensemble. En attendant,
j'ai grand besoin de vous voir!--Mes vengeances ont dĂŠjĂ commencĂŠ. Mon
ami Saulcy se trouvait hier chez des gens oĂš l'on a parlĂŠ de l'arrĂŞt
qui me concerne; lĂ -dessus, sans consulter l'air du bureau, voilĂ
mon canonnier qui, avec la discrĂŠtion de son arme, se lance Ă tort
et Ă travers dans les grands mots de sottise, fatuitĂŠ, stupiditĂŠ,
amour-propre de faquins, etc., prenant Ă tĂŠmoin un monsieur en habit
noir qu'il connaissait de vue, mais dont il ignorait la profession.
Or, c'ĂŠtait M. ***, un de mes juges, qui aurait prĂŠfĂŠrĂŠ ĂŞtre ailleurs.
Figurez-vous l'ĂŠtat de la maĂŽtresse de la maison, des assistants, et
enfin Saulcy, averti trop tard, qui tombe sur un canapĂŠ en crevant de
rire, et disant; ÂŤMa foi, je ne me dĂŠdis de rien!Âť
CLV
Lundi soir, 1er juin 1852.
. . . . . . . . . . . .
Je passe tout mon temps Ă lire la correspondance de Beyle. Cela me
rajeunit de vingt ans au moins. C'est comme si je faisais l'autopsie
des pensĂŠes d'un homme que j'ai intimement connu et dont les idĂŠes des
choses et des hommes ont singulièrement dÊteint sur les miennes. Cela
me rend triste et gai vingt fois tour Ă tour dans une heure et me fait
bien regretter d'avoir brĂťlĂŠ les lettres que Beyle m'ĂŠcrivait. . . . . .
CLVI
Marseille, 12 septembre 1852.
. . . . . . . . . . . .
Je suis allĂŠ en Touraine, oĂš j'ai visitĂŠ Chambord par une pluie
battante et Saint-Aignan par une pluie intermittente. Je suis rentrĂŠ
Ă Paris le 7 par la pluie, reparti le mĂŞme jour au milieu d'un orage
et j'ai descendu le RhĂ´ne par un brouillard Ă couper au couteau. C'est
seulement dans la Canebière que j'ai retrouvÊ le soleil; depuis deux
jours, il brille dans toute sa gloire. J'y ai trouvĂŠ (Ă Marseille, et
non dans le soleil) mon cousin et sa femme, que j'ai embarquĂŠs hier
sur _le LĂŠonidas_ par une mer d'un bleu cĂŠleste, sans une vague, et un
temps ni froid ni chaud dont vous n'avez nulle idĂŠe en vos tristes pays
du Nord. Ce sont les seuls parents qui me restent, et les propriĂŠtaires
de ce salon que vous avez daignĂŠ honorer de votre approbation. Je
me suis senti pris d'un isolement bien triste lorsque j'ai vu le
panache de fumÊe du LÊonidas disparaÎtre derrière les Îles que vous
connaissez par la description de _Monte-Cristo._ Je me suis senti
vieux et ganache. J'aurais eu besoin de votre prĂŠsence et j'ai pensĂŠ
combien vous vous seriez amusĂŠe en ce pays qui me paraĂŽt si maussade.
Je vous y ferais manger des fruits de vingt espèces diffÊrentes qui
vous sont inconnues; par exemple, des pĂŞches jaunes et des melons
blancs et rouges, des azeroles et des pistaches fraĂŽches. Outre cela,
vous passeriez votre journĂŠe dans des boutiques de curiositĂŠs turques
et autres, oĂš il y a les inutilitĂŠs les plus agrĂŠables Ă voir et les
plus dĂŠsagrĂŠables Ă payer. Je me suis demandĂŠ souvent pourquoi vous
ne faites pas un voyage dans le Midi, et je ne trouve pas de bonnes
raisons contre. Je vais courir les montagnes pendant trois jours,
tout seul, sans pouvoir Êchanger une pensÊe avec un bipède parlant
français. Je ne sais, après tout, si cela ne vaut pas mieux que d'avoir
affaire aux provinciaux des villes; chaque annĂŠe, il me semble qu'ils
deviennent plus intolĂŠrables. Ici, maires et prĂŠfets ont la tĂŞte perdue
de l'arrivĂŠe du prĂŠsident; on blanchit toutes les prĂŠfectures, on met
des aigles partout oĂš il en peut tenir. Il n'y a pas de niaiseries
qu'on n'imagine; quel drĂ´le de peuple! Au milieu de tout cela, je
crains bien que les ĂŠpreuves de _DĂŠmĂŠtrius_ ne se perdent; car je dois
les corriger en route et elles ne m'arrivent pas.
. . . . . . . . . . . .
CLVII
Moulins, 27 septembre 1852.
. . . . . . . . . . . .
J'ai ĂŠtĂŠ fort malade et je suis encore assez faible, d'autant plus que
le remède qui m'a tirÊ d'affaire, c'est-à -dire le mistral ou le vent du
Nord, m'a donnĂŠ un rhume qui me fatigue fort et qui ne se guĂŠrit pas
par les nuits blanches et les courses continuelles. J'ai ĂŠtĂŠ, pendant
quarante-cinq heures, avec une disposition Ă la congestion cĂŠrĂŠbrale
telle, que je croyais que j'allais voir le royaume des ombres. J'ĂŠtais
absolument seul, et je me suis traitĂŠ moi-mĂŞme ou plutĂ´t je ne me suis
pas traitĂŠ du tout, car j'ĂŠtais dans un ĂŠtat de prostration physique
et moral qui me rendait la moindre excursion horriblement pĂŠnible. Je
sentais bien quelque ennui de passer dans un monde inconnu; mais ce qui
me semblait encore plus ennuyeux, c'ĂŠtait de faire, de la rĂŠsistance.
C'est par cette rĂŠsignation brute, je crois, qu'on quitte ce monde,
non pas parce que le mal vous accable, mais parce qu'on est devenu
indiffĂŠrent Ă tout, et qu'on ne se dĂŠfend plus. J'attends ici qu'un
monsignore à qui j'ai affaire sorte de _retraite._ Très-probablement
j'aurai pour deux ou trois jours à courir d'après ses indications, puis
je reviendrai Ă Paris. C'est demain mon jour de naissance, que j'aurais
voulu passer avec vous. Il se trouve que je suis toujours seul ce
jour-lĂ et d'une tristesse abominable.
. . . . . . . . . . . .
CLVIII
Carabanchel, 11 septembre 1853.
. . . . . . . . . . . .
En arrivant ici, j'ai trouvĂŠ que tout se prĂŠparait pour la fĂŞte de
la maĂŽtresse de la maison. On devait jouer une comĂŠdie et rĂŠciter et
chanter une _loa_[1] en son honneur et celui de sa fille. J'ai ĂŠtĂŠ
mis en rĂŠquisition pour fabriquer des ciels, rĂŠparer des dĂŠcorations,
dessiner des costumes, etc., sans parler des rĂŠpĂŠtitions que je
donnais Ă cinq dĂŠesses mythologiques dont une seule avait dĂŠjĂ montĂŠ
sur un thÊâtre de sociÊtÊ. Mes dÊesses se sont trouvÊes très-jolies
hier, jour fatal, mais mourantes de peur; cependant, tout a fort bien
ÊtÊ. On a fort applaudi, sans comprendre les vers très-amphigouriques
du poète auteur de la _Loa._ Sa comÊdie, qui Êtait une traduction
de _Bonsoir, monsieur Pantalon_, a encore mieux ĂŠtĂŠ, et j'admire la
facilitĂŠ avec laquelle les jeunes filles de la sociĂŠtĂŠ se transforment
en actrices passables. Après la comÊdie, bal et souper au milieu duquel
un jeune protĂŠgĂŠ de la comtesse a improvisĂŠ des vers assez jolis, qui
ont fait pleurer l'hĂŠroĂŻne de la fĂŞte et boire tout le monde un peu
vertement. Ce matin, j'ai un mal de tĂŞte de chien et je trouve le
soleil diablement chaud. Je vais aller Ă Madrid voir les taureaux, et
j'abandonne mes dĂŠesses pour deux ou trois jours afin de faire mes
visites et de travailler à la bibliothèque. Comme il y a neuf dames ici
sans un homme, on m'appelle Ă Madrid ÂŤApollonÂť. Des neuf muses, il y en
a malheureusement cinq qui sont mères ou tantes des quatre autres; mais
ces quatre-lĂ sont des Andalouses de race, avec des petits airs fĂŠroces
qui leur vont Ă ravir, surtout quand elles sont dans leur costume
olympien avec des pĂŠplum qu'elles s'obstinent par amour pour l'euphonie
Ă appeler _peplo._
Vous avez sans doute un moins beau temps que nous.
. . . . . . . . . . . .
[1] Loa, espèce de dithyrambe dialoguÊ en l'honneur de la personne que
l'on veut fĂŞter.
CLIX
L'Escurial, 5 octobre 1853.
Je vous envoie une petite fleur que j'ai trouvĂŠe dans la montagne,
derrière ce vilain couvent de l'Escurial. Je ne l'avais pas rencontrÊe
depuis la Corse; lĂ , cela s'appelle _mucchiallo_; ici, personne n'en
sait le nom. Le soir, lorsque le vent passe dessus, cela a une odeur
qui me semble dĂŠlicieuse. J'ai retrouvĂŠ l'Escurial aussi triste que
je l'avais laissĂŠ il y a quelque vingt ans, mais la civilisation y a
pĂŠnĂŠtrĂŠ: on y trouve des lits en fer et des cĂ´telettes, plus du tout de
punaises ni de moines. Le dernier article me manque beaucoup et rend
encore plus ridicule la lourde architecture d'Herrera. Je vais aller
dĂŽner Ă Madrid ce soir, car je ne supporterai pas un jour de plus de
ce sĂŠjour-ci. Selon toute apparence, je resterai Ă Madrid jusqu'au 15
de ce mois, et puis j'irai Ă Valladolid, Toro, Zamora et LĂŠon, si le
temps, qui jusqu'Ă prĂŠsent a ĂŠtĂŠ magnifique, ne se met pas tout d'un
coup au laid, chose improbable. Je suis allÊ à Tolède et ici. J'irai
Ă SĂŠgovie, par quoi j'ĂŠvite des bals qui m'ennuient fort. J'ai vu
l'autre soir l'ouverture du grand OpĂŠra. C'ĂŠtait pitoyable, sauf la
salle très-belle et très-commode et remplie de femmes très-jolies. Les
acteurs sont d'un mĂŠdiocre assommant. Si vous ĂŠtiez ici, vous verriez
la plus belle collection de fruits qu'on puisse rencontrer. Il y a une
foire Ă Madrid, et il vient des fruits de fort loin dont la plupart
vous sont inconnus. Il est fâcheux que cela ne puisse s'envoyer. S'il y
avait ici quelque chose qui vous fĂťt agrĂŠable, vous n'avez qu'Ă parler.
. . . . . . . . . . . .
CLX
Madrid, 25 octobre 1853.
. . . . . . . . . . . .
Notre colonie s'est dissoute, la duchesse ayant daignĂŠ accoucher d'une
fille. Sa mère s'est constituÊe garde-malade, et nous sommes revenus en
masse Ă la ville. J'y ai gagnĂŠ un rhume odieux, et, pour m'achever, il
fait un sirocco du diable. MalgrĂŠ ce vilain temps et mes ĂŠternuments,
je suis allÊ voir hier Cucharès, le meilleur matador depuis Montès. Les
taureaux ĂŠtaient si mauvais, qu'il a fallu en donner un aux chiens et
exciter la moitiĂŠ des autres avec des banderoles de feu. Deux hommes
ont ĂŠtĂŠ jetĂŠs en l'air et nous les avons cru morts un instant, ce qui a
jetĂŠ quelque intĂŠrĂŞt sur la course, autrement tout Ă fait dĂŠtestable.
Les taureaux n'ont plus de cĹur et les hommes ne valent guère mieux.
Je pense entreprendre mon voyage archÊologique dès que le temps se
sera fixĂŠ. On m'annonce un ĂŠtĂŠ de la Saint-Martin qui ne vient jamais.
Il est probable que, si vous me mandiez vos commissions, je recevrais
votre lettre Ă temps pour y faire honneur. Malheureusement, je ne sais
pas trop ce qu'il y a de bon dans ce pays-ci. Je vous ai pris Ă tout
hasard des mouchoirs d'un dessin fort laid; mais il m'a semblĂŠ que
vous vous Êtiez assez allègrement emparÊe d'un ces mouchoirs qui me
venait je ne sais d'oÚ. Ici, on ne voit plus guère que des costumes
français. Hier, aux taureaux, il y avait des chapeaux. Voulez-vous
des jarretières et des boutons? Si l'on en porte encore, dites-moi ce
qu'il vous en faut, mais ne perdez pas de temps pour me rĂŠpondre.--Je
lis _Wilhelm Meister_, ou je le relis. C'est un ĂŠtrange livre, oĂš les
plus belles choses du monde alternent avec les enfantillages les plus
ridicules. Dans tout ce qu'a fait Goethe, il y a un mĂŠlange de gĂŠnie et
de niaiserie allemande des plus singuliers: se moquait-il de lui-mĂŞme
ou des autres? Faites-moi penser Ă vous donner Ă lire Ă mon retour,
les _AffinitĂŠs ĂŠlectives._ C'est, je crois, ce qu'il a fait de plus
bizarre et de plus antifrançais. On m'Êcrit de Paris pour me vanter un
livre d'Alexandre Dumas fils, qui s'appelle _un Cas de rupture_, ou
quelque chose d'approchant. Ă Madrid, on ne lit pas. Je me suis demandĂŠ
Ă quoi les dames passent leur temps quand elles ne font pas l'amour,
et je ne trouve pas de rĂŠponse plausible. Elles pensent toutes Ă ĂŞtre
impĂŠratrices. Une demoiselle de Grenade ĂŠtait au spectacle quand on a
annoncĂŠ dans sa loge que la comtesse de TĂŠba ĂŠpousait l'empereur. Elle
s'est levĂŠe avec impĂŠtuositĂŠ en s'ĂŠcriant: _En ese pueblo y no hay
porvenir._[1]Âť
Au nombre de mes divertissements, j'ai oubliĂŠ de vous parler d'une
acadĂŠmie de l'histoire dont je suis membre. Elle est presque aussi
amusante que la nĂ´tre. Adieu.
[1] ÂŤDans ce pays-ci, il n'y a pas d'avenir.Âť
CLXI
Madrid, 22 novembre 1853.
. . . . . . . . . . . .
Quand je pense Ă la neige qu'il y a sur le Guadarrama, je perds tout
courage: pourtant, nous avons un soleil magnifique; mais il a beau
briller, il n'ĂŠchauffe pas. La nuit, il fait un froid abominable
et les factions des soldats au palais ne sont plus que d'un quart
d'heure. Avant mon dĂŠpart, je veux assister encore Ă quelques sĂŠances
des Cortès, qui se sont ouvertes avant-hier, très-modestement, sans
discours royal, Sa MajestÊ Êtant assez près de son terme pour qu'on
lui ĂŠpargne les ĂŠmotions. Je suis assez bien la politique locale et
je connais assez de gens dans tous les partis pour que le spectacle
m'amuse en ce moment oĂš nous sommes privĂŠs de taureaux. Je vous
apporterai des jarretières, puisque vous ne voulez pas de boutons. Ce
n'est pas sans peine que je les ai dĂŠcouvertes. La civilisation fait
de progrès si rapides, que l'Êlastique a remplacÊ à presque toutes
les jambes les _ligas_ classiques des temps passĂŠs. Lorsque j'ai
demandĂŠ aux femmes de chambre d'ici de m'indiquer une boutique, elles
se sont signĂŠes d'indignation, me disant qu'elles ne portaient pas de
ces vieilleries-là et que c'Êtait bon pour le peuple. Le progrès des
modes françaises est effrayant: les mantilles sont à prÊsent assez
rares. Les chapeaux, et quels chapeaux! les remplacent. Vous seriez
rĂŠjouie de voir les chefs-d'Ĺuvre des couturières de cette capitale. Je
suis allĂŠ il y a quelques jours passer cinq Ă six heures Ă Aranjuez,
chez un loup-cervier de mes amis, M. Salamanca. C'est le garçon le
plus spirituel et le meilleur diable que j'aie rencontrĂŠ. Il gagne
beaucoup d'argent, comme il semble, et le fait rouler noblement. Il
trouve le temps de faire des affaires et de la politique, car il a
ĂŠtĂŠ ministre et le sera encore, s'il veut. Tout dans cet homme sent
l'Andalousie, c'est la grâce même. Nous avons eu le 15, pour la fête
de Sainte-EugĂŠnie, un bal Ă l'ambassade de France oĂš a paru madame
***, femme du ministre des Ătats-Unis, avec un costume Ă faire crever
de rire. Velours noir bordÊ de galons, d'oripeaux, et diadème de
thÊâtre. Son fils, qui a l'air d'un maroufle, s'est fait renseigner
sur la soliditÊ des personnes prÊsentes, et, après avoir pris ses
informations, a envoyÊ un cartel à un duc très-noble, très-riche, fort
niais et dĂŠsireux de vivre longtemps. Les pourparlers durent encore,
mais il n'y aura pas mort d'homme.
Adieu.
CLXII
Madrid, 28 novembre 1853.
Votre lettre s'est croisĂŠe avec la mienne, que vous avez dĂť recevoir
au moment oĂš m'arrivait la vĂ´tre. Je vous y expliquais pourquoi je
resterais encore quelques jours ici. On me presse fort d'attendre
la _noche buena_, c'est-Ă -dire NoĂŤl; mais je serai en France et
probablement Ă Paris vers le 12 ou le 15, si le temps n'est pas trop
mauvais. Je vous ĂŠcrirai de Bayonne ou de Tours, oĂš je suis obligĂŠ de
m'arrĂŞter.
. . . . . . . . . . . .
On danse beaucoup ici, malgrĂŠ le deuil de cour. Seulement, on met
des gants noirs. On est très-agitÊ par les premières dÊlibÊrations
du SÊnat. Il s'agit de savoir si ce ministère durera ou s'il y aura
un coup d'Ătat. L'opposition est très-animĂŠe et se propose de donner
des coups de bâton par-dessus les Êpaules du comte de San-Luis. La
maison que j'habite est un terrain neutre oĂš se rencontrent les
ministres et les chefs de l'opposition; ce qui est assez agrĂŠable pour
les amateurs de nouvelles. Il est vrai que ce qui s'appelle ici la
sociĂŠtĂŠ se compose d'un si petit nombre de personnes, que, si elles
se fractionnaient, il n'y aurait plus moyen de vivre. Quelque chose
que l'on fasse Ă Madrid, pourvu qu'on aille dans un lieu public, on
est sĂťr de rencontrer les mĂŞmes trois cents personnes. Il en rĂŠsulte
une sociÊtÊ très-amusante et infiniment moins hypocrite qu'ailleurs.
Il faut que je vous conte une bonne bĂŞtise. L'usage ici est d'offrir
tout ce qu'on loue. La belle du premier ministre dĂŽnait l'autre jour Ă
cĂ´tĂŠ de moi; elle est bĂŞte comme un chou et fort grosse. Elle montrait
d'assez belles ĂŠpaules sur lesquelles tombait une guirlande avec des
glands en mĂŠtal ou en verre. Ne sachant que lui dire, je lui fis
l'ĂŠloge des unes et des autres, et elle me rĂŠpondit: _Todo eso a la
disposition de V._ Adieu; ĂŠcrivez-moi plus longuement. Je puis Ă la
rigueur recevoir de vos nouvelles ici, mais j'espère sÝrement trouver
une lettre de vous Ă Bayonne.--Pourquoi ai-je tant d'envie de vous
revoir? Il y a pourtant quelque chose de très-pĂŠnible Ă se conformer Ă
vos protocoles, dignes de M. de Nesselrode pour le mĂŠpris de la logique
et de la vraisemblance.
CLXIII
Paris, 29 juillet 1854.
Je suis arrivĂŠ ici avant-hier, et je ne vous ai pas ĂŠcrit plus tĂ´t
parce que j'ĂŠtais trop triste. J'ai trouvĂŠ ici un de mes amis d'enfance
entrepris par le cholÊra. Aujourd'hui, on le croit à peu près hors
de danger. En passant le dĂŠtroit, il faisait un vent glacĂŠ qui m'a
donnĂŠ un rhume ou rhumatisme ĂŠtrange. Je souffre comme si j'avais la
poitrine serrĂŠe dans un cercle de fer et tous les mouvements que je
fais sont douloureux. Pourtant, il faut que je parte ce soir pour la
Normandie, oĂš je vais faire un discours aux oisifs de Caen. La corvĂŠe
finie, je reviendrai au plus vite. Je pense ĂŞtre Ă Paris le 2 aoĂťt au
soir. Après cela, je n'ai plus de projet arrêtÊ. D'abord, j'avais eu
l'idĂŠe d'aller passer un mois Ă Venise; mais les quarantaines et les
autres ennuis suscitĂŠs par le cholĂŠra rendent un voyage de ce cĂ´tĂŠ Ă
peu près impossible. Mon ministre m'a offert de m'envoyer à Munich,
comme commissaire de je ne sais quoi, Ă propos d'une exposition
bavaroise. Je n'ai dit ni oui ni non et j'attendrai mon retour Ă
Paris pour me dĂŠcider. Probablement, vous irez passer quelques jours
Ă Londres, et le Palais de Cristal mĂŠrite ce voyage. Sous le rapport
d'art et de goĂťt, cela est parfaitement ridicule, mais il y a dans
l'invention et l'exĂŠcution quelque chose de si grand et de si simple
Ă la fois, qu'il faut aller en Angleterre pour s'en faire une idĂŠe.
C'est un joujou qui coĂťte vingt-cinq millions, et une cage oĂš plusieurs
grandes ĂŠglises pourraient valser. Les derniers jours que j'ai passĂŠs
Ă Londres m'ont amusĂŠ et intĂŠressĂŠ. J'ai vu et pratiquĂŠ tous les
hommes politiques, j'ai assistĂŠ au dĂŠbat des subsides Ă la Chambre des
lords et aux Communes, et tous les orateurs en renom ont parlĂŠ, mais
très-mÊchamment, à ce qu'il m'a semblÊ. Enfin, j'ai fait un très-bon
dĂŽner. On en fait d'excellents au Palais de Cristal, et je vous les
recommande, Ă vous qui ĂŞtes gourmande. J'ai rapportĂŠ de Londres une
paire de jarretières qui viennent, à ce qu'on m'assure, de chez Borrin.
Je ne sais ce que mettent les Anglaises Ă leurs bas, ni comment elles
se procurent cet article indispensable, mais je crois que ce doit ĂŞtre
une chose bien difficile et bien _trying_ pour leur vertu. Le commis
qui m'a donnÊ ces jarretières en a rougi jusqu'aux oreilles.--Vous me
dites des choses très-aimables, qui me feraient le plus grand plaisir,
si l'expĂŠrience ne m'avait rendu par trop dĂŠfiant. Je n'ose espĂŠrer ce
que je dĂŠsire le plus ardemment. Vous savez que vous n'avez qu'Ă remuer
un doigt pour que j'accoure.
Je voudrais que vous fissiez comme si nous ĂŠtions l'un et l'autre en
danger de ne plus nous revoir, en ce temps de si grande incertitude.
Adieu; je vous aime bien, quoi que vous fassiez. Ăcrivez-moi Ă Caen,
chez M. Marc, capitaine de vaisseau. Je serai bien heureux d'avoir de
vos nouvelles.
CLXIV
Paris, 2 aoĂťt au soir, 1854.
Je suis arrivÊ ici ce matin, très-courbaturÊ, très-ennuyÊ,
très-souffrant et très-triste. Je ne me guÊris pas de cette douleur
au cĂ´tĂŠ et Ă la poitrine qui m'empĂŞche de trouver une position
pour dormir. Avant-hier, je suis arrivĂŠ Ă Caen, le jour mĂŞme de la
cĂŠrĂŠmonie. J'ai vu le secrĂŠtaire et j'ai pris mes mesures pour ĂŠchapper
Ă toutes les visites officielles. Ă trois heures, je suis entrĂŠ dans
la salle de l'Ăcole de droit, oĂš j'ai trouvĂŠ dix-huit Ă vingt femmes
dans une tribune, et environ deux cents hommes avec des figures telles
que toute autre ville peut en offrir, selon toute apparence'; silence
merveilleux. J'ai dÊbitÊ ma tartine sans la plus lÊgère Êmotion, et on
a applaudi très-poliment. La sÊance a durÊ encore une heure et demie
et s'est terminĂŠe par la lecture de vers d'un bossu, haut de deux
pieds et demi, pas trop mauvais. ImmĂŠdiatement j'ai ĂŠtĂŠ emmenĂŠ entre
les autoritĂŠs Ă l'hĂ´tel de ville, oĂš l'on m'a donnĂŠ un banquet, qui
n'a durÊ que deux heures et oÚ il y avait de très-bons poissons et des
homards dĂŠlicieux. Je croyais en ĂŞtre quitte, lorsque le prĂŠsident des
antiquaires s'est levĂŠ et tout le monde avec lui. Il a pris la parole,
et a dit qu'il proposait de boire Ă ma santĂŠ, attendu que j'ĂŠtais
remarquable Ă trois points de vue, c'est Ă savoir: comme sĂŠnateur,
comme homme de lettres et comme savant. Il n'y avait que la table entre
nous et j'avais une grande envie de lui jeter Ă la tĂŞte un plat de
gelĂŠe au rhum. Pendant qu'il parlait, je mĂŠditais ma rĂŠponse sans qu'il
me fĂťt possible de trouver un mot. Lorsqu'il s'est tu, j'ai compris
qu'il fallait absolument parler et j'ai commencĂŠ une phrase sans savoir
comment je la continuerais. J'ai parlĂŠ de la sorte pendant cinq ou six
minutes avec beaucoup d'aplomb, sans trop me rendre compte de ce que je
disais. On m'a assurÊ que j'avais ÊtÊ très-Êloquent; mais je n'en Êtais
pas quitte. Le maire m'a empoignĂŠ et menĂŠ Ă un concert que les dames et
les messieurs de la SociĂŠtĂŠ philharmonique donnaient au bĂŠnĂŠfice des
pauvres. J'ai ÊtÊ exposÊ sur un fauteuil à un très-grand nombre de gens
bien vĂŞtus, les femmes très-jolies et très-blanches, habillĂŠes comme Ă
Paris, si ce n'est qu'elles exhibaient moins d'ĂŠpaules et qu'avec des
robes de bal elles avaient des brodequins marrons. On a chantĂŠ fort mal
et des airs d'opÊra-comique; puis une grande femme très-parÊe, de la
haute, a fait la quĂŞte dans une coupe de cristal. Je lui ai donnĂŠ vingt
francs, ce qui m'a valu une rĂŠvĂŠrence en fromage des plus gracieuses.
à minuit, on m'a ramenÊ chez moi, oÚ j'ai très-mal dormi et même pas
du tout. Ă huit heures, le lendemain, on est venu me chercher pour
prÊsider une sÊance non politique, et j'ai entendu le procès-verbal de
la veille, oÚ il Êtait dit que j'avais parlÊ très-Êloquemment. J'ai
fait un speech pour que le procès-verbal fÝt purgÊ de tout adverbe,
mais inutilement. Enfin, je suis remontĂŠ en malle-poste et me voilĂ :
tout serait au mieux si je pouvais passer une bonne journĂŠe avec vous
pour me remettre.--Je ne crois pas Ă vos impossibilitĂŠs. Je garde
mes doutes et mon chagrin. Mon ministre voudrait que j'allasse Ă
l'Exposition de Munich. Je n'en ai pas trop envie; mais oĂš aller cette
annĂŠe, si ce n'est en Allemagne? Adieu; je vous aime quoi que vous
fassiez et je crois que vous devriez ĂŞtre un peu plus touchĂŠe de cela.
Vous pouvez toujours m'ĂŠcrire ici.
CLXV
Innsbruck, 31 aoĂťt 1854.
Je suis bien las et pourtant j'ai envie de vous ĂŠcrire. J'ai la tĂŞte
lourde et je suis ivre de paysages et de panoramas magnifiques, depuis
quatre jours. Je suis parti de Bâle pour aller à Schaffouse, d'oÚ l'on
s'embarque sur le Rhin. Ă droite et Ă gauche, ce sont des montagnes
ravissantes, beaucoup plus belles que celles, ou les soi-disant
telles, qui bordent le Rhin infĂŠrieur, si admirĂŠ des Anglaises, entre
Mayence et Cologne. Du Rhin, nous entrâmes dans le lac de Constance
et dans la ville de ce nom, oÚ nous mangeâmes des truites fort bonnes
et entendĂŽmes des Tyroliens jouer du _zitther._ Traversant le lac,
nous allâmes à Lindau, oÚ nous attendait un chemin de fer qu'on a fait
passer devant les plus belles forĂŞts, les plus beaux lacs, les plus
belles montagnes que produit la contrĂŠe. Cela nous a menĂŠs Ă Kempten;
seulement, on est accablÊ de fatigue, comme après avoir longtemps
examinĂŠ une belle galerie de tableaux. Au lieu de nous reposer, nous
sommes repartis la nuit de Kempten, et nous sommes arrivĂŠs hier
quelques minutes avant minuit Ă Innsbruck, au travers d'un pays
encore plus beau, non, mais plus grand que celui que nous venions de
voir. Le dĂŠsagrĂŠment a ĂŠtĂŠ de changer, de calculer Ă toutes les postes.
Il y en a au moins une douzaine entre Kempten et Innsbruck.
Je mange des bĂŠcasses dĂŠlicieuses, pour me refaire, et des soupes
très-extraordinaires, mais qui ont leur mÊrite quand on a pris de
l'appÊtit à beaucoup de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le
drawback de ce voyage, c'est qu'on ne connaĂŽt pas les mĹurs et les
idĂŠes de ce peuple, et cela est plus intĂŠressant que tous les paysages.
Les femmes m'ont paru, dans le Tyrol, traitĂŠes selon leurs mĂŠrites. On
les attache Ă des chariots et elles traĂŽnent des fardeaux fort lourds
avec succès. Elles m'ont paru fort laides, avec des pieds Ênormes; les
belles dames que j'ai rencontrĂŠes en chemin de fer ou en bateau ne sont
pas beaucoup mieux. Elles ont des chapeaux indĂŠcents et des brodequins
bleu de ciel, avec des gants vert-pomme. C'est en grande partie ces
qualitĂŠs susdites qui composent ce que les naturels appellent _gemĂźth_
et dont ils sont très-vaniteux.
Ă voir les Ĺuvres d'art de ce pays, il me semble que ce dont il manque
le plus radicalement, c'est l'imagination. Il s'en pique pourtant et
tombe alors dans des extravagances prĂŠtentieuses. Je viens de voir la
ville: tout y est neuf, sauf le tombeau de Maximilien; mais un site
admirable. Plus de costumes: le monde qu'on rencontre est laid et a
l'air commun; mais on ne peut faire un pas sans voir une montagne,
et quelle montagne! Demain, nous montons au glacier. Le temps est
magnifique et promet de durer. En somme, je suis content d'ĂŞtre parti.
Je voudrais que vous fussiez avec moi; il me semble que vous trouveriez
de quoi vous amuser, plus qu'au milieu de vos loups marins. Quand
revenez-vous Ă Paris? Ăcrivez-moi Ă Vienne. Ne perdez pas de temps.
Ăcrivez-moi très-longuement et très-tendrement.
Tenez, voici une fleur du Brenner.
CLXVI
Prague, 11 septembre 1854.
Mes compagnons m'ont quittĂŠ ce matin pour s'en retourner en France.
Je suis souffrant et _out of spirits_, il me vient les idĂŠes les plus
noires. Si je suis mieux demain matin, je partirai pour Vienne, oĂš
je serai dans la soirĂŠe. Je commence Ă m'ennuyer horriblement. Cette
ville-ci est très-pittoresque et on y fait de très-bonne musique. Hier,
j'ai couru trois ou quatre jardins et concerts publics, oĂš j'ai vu
danser des danses nationales et des valses, le tout avec dĂŠcence et
sang-froid; pourtant, rien de plus entraĂŽnant qu'un orchestre bohĂŠmien.
Les figures ici sont très-diffÊrentes de celles que j'avais encore
vues en Allemagne: de très-grosses têtes, de larges Êpaules, très-peu
de hanches et pas du tout de jambes, voilĂ la description d'une beautĂŠ
bohĂŠmienne.
Hier, nous employions inutilement notre savoir en anatomie, pour
comprendre comment ces femmes-là marchent. à cela près, elles ont
de fort beaux yeux et quelquefois des cheveux noirs très-longs et
très-fins, mais des pieds et des mains d'une longueur, d'une grosseur
et d'une largeur qui surprennent les voyageurs les plus habituĂŠs aux
choses extraordinaires. La crinoline leur est inconnue. Le soir, elles
boivent, dans les jardins publics, une carafe de bière, et prennent
après une tasse de cafÊ au lait, ce qui les dispose à manger trois
cĂ´telettes de veau avec du jambon, et c'est Ă peine s'il leur reste de
la place pour quelques pâtisseries lÊgères, de la nature de nos babas.
Telles sont mes observations sur les mĹurs et les coutumes. Mon lit
se compose d'une couverture des couleurs les plus jolies, d'un mètre
de long, Ă laquelle est boutonnĂŠe une serviette qui me sert de drap.
Quand j'ai mis cela en ĂŠquilibre sur moi, mon domestique dĂŠpose sur le
tout un ĂŠdredon que je passe toutes les nuits Ă culbuter et Ă replacer;
mais, en revanche, je mange toute sorte de choses très-extraordinaires,
entre autres des champignons crus marinĂŠs qui sont excellents et des
oiseaux de montagne idem; tout cela ne m'empĂŞche pas de souhaiter
beaucoup votre prĂŠsence. Selon toute apparence, vous vous trouvez Ă
merveille Ă D..., sans songer aux gens malheureux qui errent en BohĂŞme.
Votre sublime indiffĂŠrence, vraie ou fausse (c'est ce que je n'ai pas
encore pu savoir), m'irrite beaucoup. Vous ne pensez aux gens que
lorsque vous les voyez. Je suis dans une grande incertitude quant Ă ce
que je ferai. Si j'avais l'assurance de vous faire enrager en restant
longtemps Ă Vienne, je m'y installerais pour Dieu sait combien de
mois; mais vous n'en perdriez pas une bouchĂŠe, et je crains fort de
m'ennuyer mortellement de leur _gemĂźth._ Il est donc probable que je ne
resterai Ă Vienne que juste assez longtemps pour voir les ĂŠtrangetĂŠs,
c'est-Ă -dire environ les derniers jours du mois. Vers le 1er octobre,
je pourrais ĂŞtre Ă Berlin, et, avant le 10 ou le 12, Ă Paris.--Je
suppose que vous m'avez ĂŠcrit Ă Vienne, pour me dire ce que vous faites
et ce que vous comptez faire; cela aura une grande influence sur mes
rĂŠsolutions. Je viens de voir des autographes de Ziska et de Jean
Huss. Ils avaient une très-belle Êcriture l'un et l'autre pour des
hĂŠrĂŠsiarques.
CLXVII
Vienne, 2 octobre 1854.
_Really truly_, cette bonne ville de Vienne est un sĂŠjour agrĂŠable, et
il me faut une certaine force d'âme pour la quitter, maintenant que
j'y ai des amis et que j'ai compris le plaisir d'y flâner. Ajoutez
Ă cela l'avantage d'avoir les nouvelles de CrimĂŠe quelques minutes
avant vous. Nous sommes depuis avant-hier dans toutes les ĂŠmotions.
SĂŠbastopol est-il pris? lorsque cette lettre vous arrivera, tout sera
fini sans doute. Ici, on le croit, mais un peu lÊgèrement, à mon avis.
Les Autrichiens, sauf quelques anciennes familles russes de cĹur, nous
font des compliments. Un cocher de fiacre m'a fĂŠlicitĂŠ avant-hier en
sortant de l'OpĂŠra. Plaise Ă Dieu que tout cela ne soit pas une de
ces nouvelles comme en fait le tĂŠlĂŠgraphe ĂŠlectrique quand il est de
loisir. Quoi qu'il en soit, je trouve très-beau que nos gens, six jours
après leur dÊbarquement, aient vigoureusement frottÊ les Russes. Nous
avons ici lady Westmoreland, qui est sĹur de lord Raglan et mère de
l'aide de camp du susdit, qui Êtait dans tous ses Êtats. Elle a reçu
hier au soir un mot de son fils, après la bataille. Nous jouissons
beaucoup de la figure des Russes de Vienne. Le prince Gortshakof a dit
que c'ĂŠtait un incident, mais que cela ne faisait rien aux principes.
Le ministre de Belgique, qui est ici le bel esprit, a dit qu'il avait
raison de se retrancher dans les principes, parce qu'on ne les prenait
pas Ă la baĂŻonnette. Ă propos de bel esprit, on m'a constituĂŠ ici
_lion_, bon grĂŠ, mal grĂŠ. Prononcez _laĂŻonne_ Ă l'anglaise, pour ne
pas avoir une idĂŠe fausse du rĂ´le qu'on m'a fait jouer. L'autre jour,
on m'amenĂŠ Ă Baden, qui est un endroit charmant, dans une vallĂŠe, aux
portes de Vienne, mais oĂš l'on se croirait Ă cent lieues d'une grande
ville. Mon cornac m'a conduit chez de très-belles dames. Le monde
Êtant ici _gemßthlich_, on prend tout ce que dit un Français pour de
l'esprit. On m'a trouvÊ très-aimable. J'ai Êcrit des pensÊes sublimes
sur des albums, j'ai fait des dessins; en un mot, j'ai ĂŠtĂŠ parfaitement
ridicule. C'est en partie la honte de ce mĂŠtier-lĂ qui me fait prendre
aujourd'hui le chemin de Dresde. Je ne m'y arrĂŞterai qu'un jour et
j'irai à Berlin; après avoir vu le musÊe, je partirai pour Cologne et
j'y trouverai une lettre de vous.
Vous ai-je dit que j'ĂŠtais allĂŠ en Hongrie? J'ai passĂŠ trois jours Ă
Pesth et me suis cru en Espagne ou plutĂ´t en Turquie. Ma pudeur y a
beaucoup souffert, car on m'a montrĂŠ un bain public Ă Bade, oĂš les
Hongrois et les Hongroises sont pĂŞle-mĂŞle dans un court-bouillon d'eau
minÊrale très-chaude. J'y ai vu une très-belle Hongroise, qui s'est
cachĂŠ la figure de ses mains, n'ayant pas comme les femmes turques
des chemises pour se voiler le visage. Ce spectacle m'a coĂťtĂŠ six
_kreutzer_, soit quatre sous. J'ai vu _la Dame de Saint-Tropez_ au
thÊâtre hongrois, n'ayant pas l'esprit de reconnaÎtre un mÊlodrame
français sous le titre _S.-Tropez à Unôz._ J'ai entendu des musiciens
bohÊmiens jouer des airs hongrois très-originaux, qui font perdre la
tête aux gens du pays. Cela commence par quelque chose de très-lugubre
et finit par une gaietĂŠ folle et qui gagne l'auditoire, lequel
trĂŠpigne, casse les verres et danse sur les tables. Mais les ĂŠtrangers
n'Êprouvent pas ces phÊnomènes. Enfin, et je garde le plus beau pour
la fin, j'ai vu une collection de vieux bijoux magyars, d'un travail
merveilleux. Si j'avais pu vous en apporter un, vous seriez venue
jusqu'Ă Cologne, pour l'avoir plus tĂ´t.
Parmi toutes ces courses, je me porte Ă merveille; le temps est
admirable, mais froid le soir. Je ne crains pas le froid pour ma route,
car j'ai achetĂŠ une pelisse ĂŠnorme pour soixante-quinze florins. Vous
trouveriez ici pour rien des fourrures magnifiques. C'est, je crois,
la seule chose Ă bon marchĂŠ en ce pays. Je m'y ruine en fiacres et en
dĂŽners en ville. L'usage est de payer son dĂŽner aux domestiques; on
paye le portier en sortant, enfin on paye partout, pas grand' chose
Ă la fois, il est vrai. Adieu; je ne suis pas trop content de votre
dernière lettre, sinon de ce que vous m'annoncez votre prochain retour
à Paris. Bien que je n'aie pas de chaÎnes magyares, j'espère que vous
me recevrez bien. Je commence Ă dĂŠsirer de revoir mon gĂŽte et les
soirĂŠes me semblent un peu bien longues.
Je pense ĂŞtre Ă Cologne avant huit jours, et Ă Paris du 10 au 15.
CLXVIII
Paris, dimanche, 27 novembre 1854.
Il est bien malheureux de perdre ses amis, mais c'est une calamitĂŠ
qu'on ne peut ĂŠviter que par une autre bien plus grande, qui est de
n'aimer rien. Surtout, il ne faut pas oublier les vivants pour les
morts. Vous auriez dĂť venir me voir au lieu de m'ĂŠcrire. Il faisait un
temps magnifique. Nous aurions causĂŠ philosophiquement sur les vanitĂŠs
de ce monde. Je suis restĂŠ toute la journĂŠe au coin de mon feu, en
disposition très-sombre et misanthropique, et de plus très-souffrant.
Ce soir, je vais un peu mieux, mais je serai plus mal si je ne vous
vois pas demain.
CLXIX
Londres, 20 juillet 1856.
J'ai reçu votre lettre hier soir, qui m'a fait un très-grand plaisir.
Si je ne craignais de rĂŞver, je vous dirais des tendresses Ă cette
occasion. Je partirai bientĂ´t pour Ădimbourg. Je consulterai un sorcier
ĂŠcossais. On veut me mener voir un vrai chieftain, qui n'a pas de
culottes et qui n'en a jamais portĂŠ, qui n'a pas d'escalier dans sa
maison, qui a son barde et son sorcier. Cela ne vaut-il pas la peine de
faire le voyage? J'ai trouvĂŠ ici des gens si accueillants, si aimables,
si accaparants, qu'il est ĂŠvident qu'ils s'ennuient beaucoup. J'ai
revu hier deux de mes anciennes beautĂŠs: l'une est devenue asthmatique
et l'autre mĂŠthodiste; puis j'ai fait la connaissance de huit Ă dix
poètes, qui m'ont paru quelque chose d'encore plus ridicule que les
nĂ´tres. J'ai revu le palais de Sydenham avec plaisir, quoiqu'on l'ait
entièrement gâtÊ par de grands monuments bâtis aux hÊros de CrimÊe.
Les hĂŠros en question sont ivres toute la journĂŠe par les rues. Il y a
encore beaucoup de monde Ă Londres, mais tous se prĂŠparent Ă s'envoler.
Pour moi, je vais lundi chez le duc de Hamilton. J'y resterai jusqu'Ă
mercredi, jour oĂš je ferai mon entrĂŠe Ă Ădimbourg. Probablement dans
quinze jours, je reviendrai ici vous retrouver. Tâchez d'être arrivÊe.
Vous ne pouvez me donner une plus grande preuve d'affection; vous savez
quel bonheur j'en ressentirais. Adieu; vous pouvez m'ĂŠcrire _Douglas
hotel, Edinburg._ J'y serai quelques jours avant de me lancer dans le
Nord.
CLXX
Ădimbourg, _Douglas hotel_, 26 juillet 1856.
J'espĂŠrais avoir une lettre de vous, ici ou Ă Ădimbourg. Point de
nouvelles. Le pire, c'est que je m'enfonce dans le Nord et je ne sais
oĂš vous dire d'adresser vos lettres. Je vais avec un Ăcossais voir
son château, bien loin au delà des lacs, mais je ne saurais vous dire
oĂš nous nous arrĂŞterons sur la route, ce qu'il me promet avec force
châteaux, ruines, paysages, etc. Dès que je serai apprêtÊ, je vous
ĂŠcrirai encore. J'ai passĂŠ trois jours chez le duc de Hamilton, dans un
château immense et dans un très-beau pays. Il y a tout près du château,
Ă moins d'une heure, un troupeau de bĹufs sauvages, les derniers qui
existent en Europe. Ils m'ont paru aussi civilisĂŠs que les daims de
Paris. Partout dans ce château, il y a des tableaux de grands maÎtres,
des vases grecs et chinois magnifiques et des livres aux reliures des
plus grands amateurs du siècle dernier. Tout cela est disposÊ sans
goÝt et l'on voit que le propriÊtaire en jouit très-mÊdiocrement.
Je comprends maintenant pourquoi on recherche les Français en pays
ĂŠtranger. Ils se donnent de la peine pour s'amuser, et, ce faisant,
amusent les autres. Je me suis senti la personne la plus amusante de
la très-nombreuse sociÊtÊ oÚ nous Êtions, et j'avais en même temps
la conscience de ne l'ĂŞtre guère. J'ai trouvĂŠ Ădimbourg tout Ă fait
Ă mon goĂťt, sauf l'architecture exĂŠcrable des monuments, qui ont
la prĂŠtention d'ĂŞtre grecs et qui la justifient comme une Anglaise
justifie celle de paraĂŽtre Parisienne, en se faisant habiller par
madame Vignon. L'accent de tous les natifs m'est odieux. J'ai ĂŠchappĂŠ
aux antiquaires après avoir vu leur exposition, qui est fort belle.
Les femmes sont ici en gÊnÊral très-laides. Le pays exige des robes
courtes, et elles se conforment Ă la mode et aux exigences du climat
en tenant leur robe Ă deux mains, Ă un pied de leurs jupons, laissant
voir des jambes nerveuses et des brodequins de cuir de rhinocĂŠros
avec des pieds idem. Je suis choquĂŠ de la proportion de rousses que
je rencontre. Le site est charmant, et, depuis deux jours, il fait
chaud et le temps est clair. En somme, je suis assez bien, sauf que je
voudrais vous avoir avec moi. Lorsque l'ennui et les _blue devils_ me
gagnent, je pense Ă nos jours de gaietĂŠ intime, auxquels je ne connais
rien d'ĂŠgal. Toute rĂŠflexion faite, ĂŠcrivez-moi Ă _Douglas hotel,
Edinburg_. Je ferai retirer mes lettres, si je ne reviens pas vite.
CLXXI
Dimanche, 3 aoĂťt 1856.
D'une maison de campagne,
près de Glasgow.
Je m'ennuie de vous, comme vous le disiez si ĂŠlĂŠgamment autrefois. Je
mène cependant une vie douce, allant de château en château, partout
hÊbergÊ avec une hospitalitÊ pour laquelle je dÊsespère de trouver un
adjectif et qui n'est praticable qu'en cet aristocratique pays. J'y
prends de mauvaises habitudes. Arrivant ici chez de pauvres gens qui
n'ont guère plus de trente mille livres de rente, je me suis trouvÊ
mĂŠconnu en voyant qu'on me donnait Ă dĂŽner sans instruments Ă vent et
sans un joueur de cornemuse en grand costume. J'ai passĂŠ trois jours
chez le marquis de Breadalbane, à me promener en calèche dans son
parc. Il y a environ deux mille daims, outre huit Ă dix mille autres
dans ses bois non adjacents au château de Faymouth. Il y a aussi comme
singularitĂŠ, chose Ă quoi chacun vise ici, un troupeau de bisons
amÊricains, très-fÊroces, qu'on enferme dans une pÊninsule et qu'on
va voir par les fentes de leurs palissades. Tout ce monde-lĂ , marquis
et bisons, a l'air de s'ennuyer. Je crois que leur plaisir consiste
Ă faire envie aux gens, et je doute que cela compense le tracas
qu'ils ont d'ĂŞtre les aubergistes du tiers et du quart. Parmi tout
ce luxe, j'observe de temps en temps de petites mesquineries qui me
divertissent. Au fond, je n'ai encore rencontrĂŠ que d'excellentes gens
qui me prennent avec mon caractère si opposÊ au leur, sans la moindre
difficultĂŠ.
On vient de me conter une histoire qui me rĂŠjouit et dont je veux
vous faire part. Un Anglais se promène le long d'un poulailler, dans
un château d'Ăcosse, un samedi soir. Grand bruit, cris de coqs et de
poules. Il croit que quelque renard est entrĂŠ et il avertit. On lui
rĂŠpond que ce n'est rien, et qu'on sĂŠpare seulement les coqs des poules
pour qu'ils ne polluent pas _the Lord's day._
Avant mon retour, vous voudrez bien m'ĂŠcrire: _18, Arlington Street,
care of the honble E. Ellne._ On m'enverra de lĂ vos lettres ou bien on
les gardera pour mon arrivĂŠe Ă Londres. Adieu. Je n'ai pas besoin de
vous dire de m'ĂŠcrire le plus souvent que vous pourrez.
CLXXII
Kinloch-Linchard, 16 aoĂťt 1856.
Je n'ai pas ÊtÊ trop content de votre lettre, que j'ai reçue au moment
de quitter Glenquoich Vous savez que vous avez toujours une première
façon prÊcipitÊe d'envisager les choses, qui vous fait regarder comme
impossibles les actions les plus simples. Repensez donc Ă ce que je
vous ai dit, et, après avoir rÊflÊchi mÝrement, rÊpondez oui ou non.
Adressez votre rĂŠponse Ă Londres, chez le _Right honble E. Ellne, 18,
Arlington Street._
. . . . . . . . . . . .
Je commence Ă avoir par-dessus la tĂŞte des grouses et de la venaison.
Les paysages, vraiment remarquables, que je vois tous les jours ont
encore du charme pour moi, mais j'ai satisfait ma curiositĂŠ, et je ne
trouverai plus rien d'extraordinaire. Ce que je ne puis assez me lasser
d'admirer, c'est la hĂŠrissonnerie de ces gens-lĂ . Ils seraient mis aux
galères ensemble, qu'ils n'en deviendraient pas plus sociables. Cela
tient Ă ce qu'ils craignent d'ĂŞtre pris sur le fait Ă ĂŞtre bĂŞtes, comme
disait Beyle, ou bien Ă une organisation qui leur fait prĂŠfĂŠrer les
jouissances ĂŠgoĂŻstes: le devine qui pourra. Nous sommes arrivĂŠs ici en
même temps que deux hommes et une femme entre deux âges, du grand monde
et ayant voyagÊ. Au dÎner, il a fallu casser la glace. Après le dÎner,
le mari a pris un journal, la femme un livre, l'autre homme s'est mis Ă
ĂŠcrire des lettres, tandis que, moi, je faisais la chouette au maĂŽtre
et Ă la maĂŽtresse de la maison. Notez bien que les gens qui s'isolaient
ainsi dans un salon avaient ĂŠtĂŠ aussi longtemps et plus que moi sans
voir notre hĂ´tesse, et qu'ils avaient nĂŠcessairement beaucoup plus de
choses que moi Ă lui conter. On me dit, et je suis disposĂŠ Ă le croire
par le peu que j'ai vu, que la race celtique (qui vit dans d'affreux
trous autour du palais que je frĂŠquente) sait causer. Le fait est qu'un
jour de marchÊ, on entend un bruit continuel de voix très-animÊes, des
rires et des cris. Le gaÊlique est très-doux. En Angleterre et dans
les Lowlands, silence complet. Ce n'est pas bien Ă vous de ne m'avoir
ĂŠcrit qu'une fois. Je vous ai ĂŠcrit au moins deux fois pour une. Mais
je n'ai pas envie de vous quereller de si loin. Voici mes projets. Je
partirai d'ici pour aller Ă Inverness, oĂš je resterai un jour; de lĂ Ă
Ădimbourg, puis Ă York, Durham et peut-ĂŞtre Derby. Je compte ĂŞtre le 23
Ă Paris.
CLXXIII
Carabanchel, jeudi, dĂŠcembre 1856.
(J'ai oubliÊ le quantième.)
Il fait une pluie effroyable. Hier, le plus beau temps du monde. On me
promet qu'il reviendra demain. J'ai profitĂŠ de ce beau temps pour me
fouler le poignet, et, si je vous ĂŠcris, c'est que j'ai ĂŠtĂŠ instruit
dans la mĂŠthode amĂŠricaine, oĂš l'on ne remue pas les doigts. Cela m'est
arrivĂŠ par la faute d'un cheval qui voulait absolument dire quelque
chose d'inconvenant Ă la jument de lord A..., et qui, irritĂŠ de ma
rĂŠsistance Ă sa passion coupable, m'a traĂŽtreusement jetĂŠ par-dessus
sa tĂŞte, d'une ruade, lorsque j'allumais mon cigare. Cela se passait
dans un sentier au bord de la mer, qui n'ĂŠtait qu'Ă cent pieds plus bas
et j'ai choisi heureusement le sentier pour tomber. Je ne me suis fait
aucun mal, sauf à la main, qui est aujourd'hui très-enflÊe. Je compte
aller la semaine prochaine Ă Cannes, oĂš vous serez aimable de m'ĂŠcrire,
poste restante. Pour en finir sur le chapitre de la santĂŠ, je crois que
je serai beaucoup mieux. Cependant, j'ai ressenti encore une fois un de
ces ĂŠtourdissements qui m'inquiĂŠtaient, mais moins fort qu'Ă Paris. Il
y a ici un mĂŠdecin qui me dit que ce sont des spasmes nerveux et qu'il
faut faire beaucoup d'exercice. Ainsi fais-je, mais je ne dors pas plus
qu'Ă Paris, bien que je me couche Ă onze heures. Il n'eĂťt tenu qu'Ă moi
de passer lion (dans le sens anglais); tout le monde s'ennuie ici. J'ai
ĂŠtĂŠ assiĂŠgĂŠ de cartes russes et anglaises, et on a voulu me prĂŠsenter Ă
la grande-duchesse HÊlène, honneur que j'ai dÊclinÊ avec empressement.
Nous avons pour fournir aux cancans une comtesse Apraxine, qui fume,
porte des chapeaux ronds et a une chèvre dans son salon, qu'elle a
fait couvrir d'herbes. Mais la personne la plus amusante est lady
Shelley, qui, tous les jours, fait quelque nouvelle drĂ´lerie. Hier,
elle ĂŠcrivait au consul de France: ÂŤLady S..., prĂŠvient M. P... qu'elle
a aujourd'hui un charmant dĂŽner d'Anglais et qu'elle sera charmĂŠe de
le voir après, à neuf heures cinq. Elle a Êcrit à madame Vigier,
ex-mademoiselle Cruvelli: ÂŤLady Shelley serait charmĂŠe de voir madame
Vigier, si elle voulait bien apporter sa musique avec elle.Âť Ă quoi
l'ex-Cruvelli a rĂŠpondu aussitĂ´t: ÂŤMadame Vigier serait charmĂŠe de voir
lady Shelley, si elle voulait bien venir chez elle et s'y conduire
comme une personne comme il faut.Âť--Et vous, Ă quoi passez-vous votre
temps? Je suis sÝr que vous ne pensez plus guère à Versailles, par
suite de cette absence de souvenirs qui vous caractÊrise. J'espère que
nous irons en mars voir pousser les premières primevères. Et cette
ĂŠtrange soirĂŠe et matinĂŠe de Versailles, tout cela ĂŠtait-il vrai?
Adieu; ĂŠcrivez-moi vite Ă Cannes.
CLXXIV
Lausanne, 24 aoĂťt 1857.
J'ai trouvĂŠ votre lettre Ă Berne, le 22 au soir, parce que mes
excursions dans l'Oberland se sont prolongĂŠes bien au delĂ du temps
que j'avais prĂŠvu. Je ne sais trop oĂš vous adresser celle-ci. Vous
ne devez plus être à Genève. Je l'adresse à Venise, oÚ, selon toute
apparence, vous ferez le plus long sĂŠjour. Je trouve que vous auriez pu
varier un peu vos tirades d'enthousiasme sur le plaisir de voyager, par
quelques compliments flatteurs en manière de consolation pour ceux qui
n'ont pas l'avantage de vous accompagner. Je vous pardonne cependant
en faveur de votre inexpĂŠrience des voyages. Vous comptez n'ĂŞtre que
trois semaines en route: cela me paraÎt à peu près impossible. Je
vous accorde un mois. Je vous prie seulement de considĂŠrer que le 28
septembre est un anniversaire malheureux pour moi, parce qu'il date
de très-longtemps. C'est le 28 septembre que je suis venu au monde.
Il me serait très-agrĂŠable de passer ce jour-lĂ en votre compagnie; Ă
bon entendeur salut. J'ai fait ma petite tournÊe très-agrÊablement.
Je n'ai eu qu'un jour de pluie; il est vrai que je n'en ai pas perdu
une goutte en descendant de la Wengernalp, pendant quatre heures,
sur une rosse qui glissait sur les roches et qui n'avançait pas. J'ai
bu du vin de Champagne que nous avions apportĂŠ sur la Mer de glace et
que j'ai frappĂŠ Ă mĂŞme le glacier. Le guide m'a dit que personne avant
moi n'avait eu cette idĂŠe sublime. Je suis en face de la Gemmi et de
la chaĂŽne du Valais, qui n'a pas les grands profils de la Jungfrau et
de ses acolytes. Je pense que nous aurions pu nous rencontrer à Genève
et faire ensemble quelque excursion; tout cela est triste Ă penser.
J'espère trouver une lettre de vous à Paris, oÚ je serai le 28.
Adieu; amusez-vous bien, ne vous fatiguez pas trop. Pensez quelquefois
Ă moi. Si vous me marquez votre itinĂŠraire avec quelque exactitude, je
vous donnerai des nouvelles de Paris. Ici, c'est le diable d'ĂŠcrire.
Les plumes du pays sont ce que vous voyez. Adieu encore.--Voici une
petite feuille qui a cru Ă six mille pieds au-dessus du niveau de la
mer.
FIN DU TOME PREMIER.
End of the Project Gutenberg EBook of Lettres ŕ une inconnue, Tome Premier, by
Prosper Mérimée
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LETTRES Ŕ UNE INCONNUE ***
***** This file should be named 56473-8.txt or 56473-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/6/4/7/56473/
Produced by Laura Natal Rodrigues and Marc D'Hooghe at
Free Literature (Images generously made available by the
Internet Archive.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
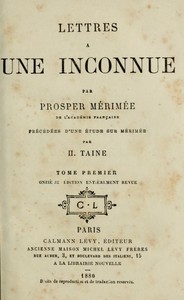
Lettres à une inconnue, Tome Premier - Précédée d'une étude sur P. Mérimée par H. Taine
Download Formats:
Excerpt
Project Gutenberg's Lettres ŕ une inconnue, Tome Premier, by Prosper Mérimée
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are...
Read the Full Text
— End of Lettres à une inconnue, Tome Premier - Précédée d'une étude sur P. Mérimée par H. Taine —
Book Information
- Title
- Lettres à une inconnue, Tome Premier - Précédée d'une étude sur P. Mérimée par H. Taine
- Author(s)
- Mérimée, Prosper
- Language
- French
- Type
- Text
- Release Date
- January 31, 2018
- Word Count
- 78,744 words
- Library of Congress Classification
- PQ
- Bookshelves
- FR Littérature, Browsing: Biographies, Browsing: Literature
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books
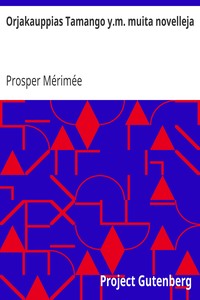
Orjakauppias Tamango y.m. muita novelleja
by Mérimée, Prosper
Finnish
436h 14m read
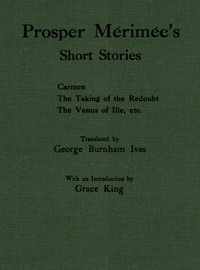
Prosper Mérimée's Short Stories
by Mérimée, Prosper
English
724h 19m read
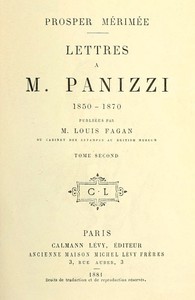
Lettres à M. Panizzi, tome II
by Mérimée, Prosper
French
1324h 59m read

Lettres à une inconnue, Tome Deuxième - Précédée d'une étude sur P. Mérimée par H. Taine
by Mérimée, Prosper
French
1194h 43m read

Mustalaistytön ennustus: Romaani Pärttylinyön ajoilta
by Mérimée, Prosper
Finnish
1116h 18m read
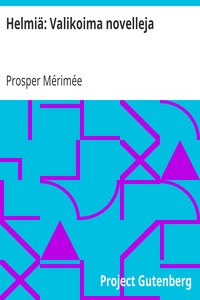
Helmiä: Valikoima novelleja
by Mérimée, Prosper
Finnish
742h 5m read