The Project Gutenberg EBook of Les mains pleines de rose, pleines d'or et pleines de sang
by Eugčne Houssaye
Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the
copyright laws for your country before downloading or redistributing
this or any other Project Gutenberg eBook.
This header should be the first thing seen when viewing this Project
Gutenberg file. Please do not remove it. Do not change or edit the
header without written permission.
Please read the "legal small print," and other information about the
eBook and Project Gutenberg at the bottom of this file. Included is
important information about your specific rights and restrictions in
how the file may be used. You can also find out about how to make a
donation to Project Gutenberg, and how to get involved.
**Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts**
**eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971**
*****These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!*****
Title: Les mains pleines de rose, pleines d'or et pleines de sang
Author: Eugčne Houssaye
Release Date: July, 2005 [EBook #8541]
[This file was first posted on July 21, 2003]
Edition: 10
Language: French
Character set encoding: ISO Latin-1
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK, LES MAINS PLEINES DE ROSE, PLEINES D'OR ET PLEINES DE SANG ***
Carlo Traverso, Anne Dreze, Marc D'Hooghe and the Online Distributed
Proofreading Team
LES MAINS PLEINES DE ROSES PLEINES D'OR ET PLEINES DE SANG
par ARSČNE HOUSSAYE
_A MADAME----
Le roman que voici n'est pas pour vous, madame,
Qui n'avez pas aimé,--pas męme votre amant!
Vous n'avez pas voulu des orages de l'âme,
Vous n'avez pas cueilli les fleurs du firmament;
Vous craignez de marcher dans la neige ou la flamme,
Vous fuyez le péché par épouvantement,
Et vous n'entendez pas, quand le vent, d'hiver brame,
Les fantômes d'amour vous pleurer leur tourment.
Non, ce roman n'est pas pour les fręles poupées
Que n'ont point fait pâlir les pâles passions,
Qui craignent les dangers des belles équipées,
Les larmes, les sanglots des désolations,
Et qui ne savent pas, trompeuses ou trompées,
Que l'amour, c'est Daniel dans la fosse aux lions.
AR--H--YE.
Juin 1874._
LES NOUVEAUX ROMANS D'ARSČNE HOUSSAYE.
[Note: Cette critique ou plutôt ce profil littéraire a paru le 1er
janvier dans _Paris-Journal_, avec cet avant-propos de Henri de Pčne:
«Un de nos amis, l'un des maîtres de tout journaliste qui tient une
plume française: Jules Janin, nous a donné, pour nos étrennes, un
article sur ce brillant et fécond esprit, qui est ŕ la fois de ses
amis et des nôtres: Arsčne Houssaye.
«Cet article de Jules Janin, nous n'avons pas besoin de le recommander
ŕ nos lecteurs. Le doyen du feuilleton parisien a fait ici oeuvre de
critique et d'ami en męme temps. A propos d'Arsčne Houssaye, Théophile
Gautier et Gérard de Nerval revivent aussi sous sa plume toujours
magique et toujours jeune.»]
La plus grande intimité s'est établie, il y a bien longtemps, entre
Jules Janin et Arsčne Houssaye. Quoi d'étonnant? Houssaye et Janin
sont partis du męme point pour arriver au męme but; ils ont parcouru
les męmes sentiers; ils ont porté tout le poids des męmes misčres. A
cette heure encore, ŕ l'heure du repos, l'un et l'autre ils sont ŕ
l'oeuvre, avec cette différence pourtant: que le premier n'a pas
quitté son humble emploi de critique hebdomadaire, et que le
second, beaucoup plus jeune, dans un mouvement plus vaste, embrasse
aujourd'hui, avec la plus grande ferveur, des drames et des passions
si compliqués et si terribles, que nous ne comprenons pas qu'il vienne
ŕ bout de tant et tant d'illustres entreprises.
Quand nous l'avons connu, Arsčne Houssaye était un jeune homme,
amoureux de la forme, enivré des espérances de l'artiste et du poëte.
Il vivait gaiement et facilement, en belle et bonne compagnie, avec
Gérard de Nerval, un talent de premier ordre, un bel esprit, qui-s'est
tué dans un désespoir muet: ne pas atteindre ŕ ces beaux ręves qu'il
portait, tout flamboyants, dans le coin de son cerveau!
Ils avaient tous deux, pour leur dévoué et fidčle compagnon, cet
esprit rare et charmant, voisin du génie, écrivant ses doux poëmes,
léger au pourchas et hardi _ŕ la rencontre_, Théophile Gautier, d'une
verve inépuisable, un peintre, un poëte, un narrateur, ŕ qui nous
devons la _Comédie de la mort_, le _Voyage ŕ Constantinople_, et tant
de pages heureuses qui lui servent d'oraison funčbre aujourd'hui.
L'amitié d'Arsčne Houssaye et de Théophile Gautier passera plus tard
ŕ l'état légendaire, et les lecteurs qui viendront ne sauraient les
séparer, dans leur estime et dans leur souvenir.
A ces trois-lŕ nous pourrions ajouter ce talent merveilleux, ce
faiseur de miracles, Eugčne Delacroix, enseveli dans son triomphe.
Il aimait ces jeunes gens pleins de vie et qui parlaient si bien des
choses qu'il aimait le mieux. Donc, vous voyez que commencer ainsi,
c'était bien commencer: une jeunesse enthousiaste, un esprit plein de
doute, un talent plein de croyance, et surtout cette aimable croyance
en soi-męme. On ne dépend de personne; on n'a rien ŕ demander ŕ
personne. On obéit ŕ l'inspiration, heureux de peu, content de
tout! C'était un grand plaisir de les voir si bien vivre et marcher
doucement dans les sentiers qu'ils avaient découverts. Cela dura dix
ans. Gérard de Nerval devint le voyageur favori de Charles Nodier, de
Mérimée, d'Armand Carrel et des voyageurs dans un fauteuil.
Théophile Gautier s'emparait victorieux de l'histoire et du jugement
des beaux-arts. Il régnait dans le feuilleton, par le talent, par la
volonté, et, qui le croirait? par la bienveillance. Il était l'ami de
Mme de Girardin, le prôneur de Victor Hugo; toujours ŕ son oeuvre,
et quand, parfois, il avait du temps ŕ perdre, il nous contait une
élégie, il nous racontait l'ardente histoire de Mlle de Maupin.
Cependant, le troisičme ami, le peintre, intrépide et ne doutant de
rien, se chargeait d'orner les plus beaux espaces, les places les plus
célčbres dans nos églises, au conseil d'État, au Panthéon, partout,
dans tous les lieux de pompe et de fęte oů il était désigné par son
génie.
Eh bien, le plus insouciant de cette association du bien faire et
du bien dire était justement ce jeune ręveur, ręvant toujours,
travaillant peu, Arsčne Houssaye! Son esprit, né pour la jeunesse,
n'était pas encore né pour le travail. Il semblait dire ŕ ses amis:
«Marchez devant, allez toujours, moi je fais l'école buissonničre, et
j'irai, s'il vous plaît, sans hâte et sans ambition, au rendez-vous de
la Fantaisie.»
Et pourtant ce fut alors qu'il écrivait _la Pécheresse_, un livre
charmant qui peint le duel du corps et de l'âme. Ce fut alors qu'il
commençait ses _Portraits du XVIIIe sičcle_, ce sičcle des magies de
Watteau, si dédaignées en notre jeunesse.
Il avait été pris dans son chemin par un travail inattendu, j'ai
presque dit inattendu. Il fut chargé de sauvegarder cette antique
institution du grand sičcle, appelée la Comédie-Française. En ce lieu
superbe, les plus grands esprits de la France avaient trouvé l'asile
et le respect pour lesquels ils étaient nés. Ici, Moličre, ami du
peuple, avait composé ses plus grands ouvrages: _le Misanthrope_ et
_Célimčne_, et _Tartufe_ et _les Femmes savantes_, enfants sérieux du
Théâtre-Français. Corneille avait apporté, du fond de la Normandie,
_Auguste, Cinna, Émilie_ et tant d'autres héros, la gloire et
l'orgueil du genre humain. Racine, en męme temps que Corneille, avait
glorifié le théâtre, et laissé--souvenirs de son glorieux passage
ici-bas--tant d'héroďnes charmantes et de héros glorieux: _Junie,
Agrippine_ et _Mithridate_; avec ses charmants railleurs qui
faisaient un pendant ŕ la comédie de Corneille: _les Plaideurs_;
puis _Iphigénie, Esther_ et tout le reste. Étaient venus, plus tard,
Voltaire et _Tancrčde_, la philosophie aprčs la croyance, et la
sagesse du poëte aprčs l'antique enthousiasme. Il n'y avait point de
position plus belle ŕ défendre, ŕ protéger, ŕ conserver, et les plus
habiles, quand ils virent ce jeune homme attaché ŕ ce pénible labeur,
furent en doute de savoir comment il va se tirer de peine et par quel
bonheur du temps présent il soutiendra les miracles du temps passé.
Lui, cependant, sans un moment de doute ou d'hésitation, il prit
en main la défense et la protection de ce théâtre incomparable; il
assistait, plein de respect, aux derniers moments de Mlle Mars. Il
encourageait la naissante ardeur de Mlle Rachel, et quand elle voulut
aller plus loin que _Camille_ et chanter _la Marseillaise_ [Note: Au
temps oů Mlle Rachel chantait _la Marseillaise_, M. Arsčne Houssaye
n'était pas encore directeur du Théâtre-Français.], il refusa de la
suivre en ces périls sans nom.
Ainsi lui fut compté, pour sa renommée, et disons le vrai mot, pour
sa gloire, ce passage heureux et rapide ŕ travers le Théâtre-Français
(1849-1856). Il le quitta comme il l'avait pris, sans trouble et sans
regret, laissant aprčs lui quelques oeuvres charmantes que lui seul il
avait protégées: _Mademoiselle de la Seigličre; Charlotte Corday, les
Contes de la reine de Navarre, Gabrielle_, et les chefs-d'oeuvre de
Victor Hugo, et les coups de théâtre d'Alexandre Dumas. J'allais
oublier l'inoubliable Alfred de Musset, avec son _Chandelier_. Et
Octave Feuillet, et Léon Gozlan, et Mme de Girardin!
Et désormais voilŕ Arsčne Houssaye rendu ŕ la vie littéraire, au culte
des belles-lettres, ses fidčles compagnes: un sourire dans le beau
temps, la consolation des heures mauvaises, fidčles compagnes qu'on ne
saurait trop servir et qu'on ne peut trop aimer.
Ce fut la premičre fois sans doute que l'on vit un directeur du
Théâtre-Français quitter la rčgle et le compas, pour reprendre avec
joie une plume fidčle et bien taillée.
Ainsi, il mit au jour ces livres charmants _le Roi Voltaire_ et
_le Quarante et uničme Fauteuil_, dont il écrivait l'histoire avec
quarante plumes différentes. On voyait qu'avant d'écrire ces beaux
livres, il avait traversé la grande poésie; il en avait gardé le
souffle et le parfum.
Heureux chez nous l'esprit libre et en gaieté de coeur, qui se
transforme, et glorifions, ô mes amis, l'imagination facile qui sait
prendre ŕ propos toutes les formes, toutes les grâces, j'ai presque
dit toutes les vertus. Qui veut écrire et durer longtemps dans
l'esprit et dans l'imagination du lecteur, aura grand soin de varier
la peine et le plaisir des gens restés fidčles ŕ cette intime lecture.
Il a sous les yeux de grands exemples, ŕ commencer par _le Roi
Voltaire_. Et quel homme, en ce bas monde, plus que Voltaire, fut
jamais plus changeant et plus divers? Il a tout tenté, et toujours il
a triomphé de l'obstacle. Et du théâtre ŕ la philosophie, et du conte
en vers au conte en prose, et męme, ô malheur de tant réussir! du
poëme épique aux légers poëmes, oů le sourire arrive avec toutes les
palpitations; et de l'histoire ŕ la critique, et męme du léger billet
avec lequel on finit par composer de trčs-gros tomes; et de la comédie
ŕ la tragédie, et de la pitié ŕ l'enchantement, ce roi Voltaire a
réussi en toutes choses. Il était la grâce et la censure, l'élégie
et la chanson, le charme enfin, le vrai charme, et le genre humain,
ébloui de toutes ces merveilles, se demandait s'il n'était pas le
jouet d'un ręve. Heureux changement! ces révolutions du bel esprit,
roulant ŕ l'infini dans un cercle qu'il s'est tracé ŕ lui-męme, et
dont il sait par coeur tous les détours.
L'auteur du _Quarante et uničme Fauteuil_ comprit bien celui-lŕ qui
eűt rempli, ŕ lui seul, tous les fauteuils; cet homme qui fut ŕ la
fois le juge et l'avocat de son sičcle.
Aussi quand il eut payé son tribut ŕ l'esprit vif et souriant qui
l'entourait, Arsčne Houssaye, un beau jour, se mit ŕ raconter, dans
un grand livre intitulé _la Comédie parisienne_, une suite infinie,
imprévue, énorme, des plus terribles accidents.
Il divisait ce livre en trois séries, ŕ savoir: _les Grandes
Dames,--les Parisiennes,--les Courtisanes du monde_, c'est-ŕ-dire
douze gros tomes in-octavo, que nous avons lus avec stupeur,
trčs-étonné que le męme écrivain qui tournait d'une façon si légčre
autour des plus graves questions, maintenant qu'il était délivré de
ces belles jeunes filles innocentes qui conservaient encore l'aspect
et le parfum de leur village, entreprît, dans une suite de drames
impitoyables, de dévoiler ces courtisanes cachées sous le manteau des
duchesses, et ces duchesses qui portaient insolemment le voile obscčne
des courtisanes: _Titulum mentitae Lysicae_, disait Juvénal; et
véritablement nous savons, grâce ŕ ces livres, les monstres hideux et
charmants qui se cachent sous ces noms-lŕ: Mme _Vénus_, Mme _Phryné_,
la _Messaline blonde_, la _Chanoinesse rousse_, la _Marquise Danaé_ et
l'adorable _Violette_, et cent et une autres. Il les connaît toutes,
il sait leur vrai nom, et comment elles sont tombées, et par quel
miracle la femme déchue est devenue une grande dame, et qu'il ne faut
pas prendre au sérieux les cheveux blonds de Messaline, pas plus que
les cheveux noirs de sa soeur.
Ah! mon Dieu, quelle suite incroyable de déguisements et d'aventures,
de mensonges et de perfidies, et comment toutes ces femmes adultčres
ne sont plus que des femmes tarées! C'est ainsi dans ce charmant livre
intitulé _la Bohčme_, écrit par un bohémien, nous avons vu la petite
Mimi: qui, parfois, ŕ la fin du trimestre, aux modes nouvelles, s'en
allait chercher les robes et les manteaux de ce matin. Elle partait
nue, ou peu s'en faut, et s'en revenait, huit jours aprčs, vętue de
soie et de velours, parée de chaînes et de dentelles, la soie
aux souliers, le diamant ŕ la jarretičre, et les bras chargés de
bracelets. C'est trčs-vrai, la petite Mimi était une marquise, et
ses grands dégingandés sentaient redoubler, aux fanfioles de ses
toilettes, leur admiration pour Mimi.
Dans ces livres si curieux d'Arsčne Houssaye, il y a de ce mélange
éhonté de la courtisane et discret de la duchesse. Le romancier en
connaît beaucoup des unes et des autres, et quand il les réunit dans
le męme salon, ŕ l'ombre ardente, un demi-jour mystérieux, favorable
aux vierges folles, le plus sage et le plus sceptique lecteur se
surprend ŕ ętre attentif, souvent charmé et toujours amoureux. Ces
ceintures, si facilement nouées et dénouées, ont un si grand attrait!
Ces beaux rires contagieux ont un si grand charme! Enfin, nous allons
si facilement ŕ ces doux visages, ŕ ces lčvres emperlées, au beau sein
de ces pécheresses! Voilŕ le charme et l'attrait de ces études: c'est
du pur Balzac, mais du Balzac sans voiles et sans embűches, disant
toutes choses hardiment, et jamais lassé dans ses révélations.
Cette fois, par quel travail, quel mystčre et quelle infatigable
interprétation des vices les plus cachés, le conteur infatigable est
parvenu ŕ composer ces douze volumes incomparables? Nous ne saurions
le dire. Il a fallu rompre absolument et le męme jour avec ses petits
livres accoutumés, les _Charmettes_, par exemple. Loin d'ici, mes
élégies! loin de moi mes fręles chansons! J'ai fermé pour jamais ce
petit monde oisif, galant et dameret qui m'a suffi vingt années. Il
me faut désormais de grandes héroďnes, des passions illustres, et
quelqu'une de ces nudités fameuses que le monde entoure ŕ plaisir de
ses haines et de ses adorations. Telle était l'oeuvre ardue, et
voilŕ par quel sacrifice il a forcé la porte obstinée et pourtant
hospitaličre de ces grands boudoirs et de _l'Hôtel du Plaisir,
mesdames._
Une fois dans ces fameux romans de sa deuxičme maničre, soyez en
repos, vous trouverez toutes les palpitations imaginables. L'homme est
savant dans toutes les intrigues du hasard et dans toutes les choses
de l'amour. Autant que les plus grands artistes il excelle ŕ parer et
ŕ scalper ces dames précieuses. Il sait qui donc les habille, et qui
donc dénoue ces beaux cheveux tordus sur ces nuques vaillantes. Il
vous dira le nom de tous les amants de ces magiciennes, pour qui
l'amour, la passion et la volupté n'ont plus de secrets. La femme
ainsi aimée et parfumée en vain ne veut pas qu'on la suive: on la
suit. Des mains invisibles vous poussent ŕ cet abîme. Il sait aussi
le nom de toutes les pierres précieuses, et celles qui conviennent le
mieux ŕ la beauté, parée ŕ son plaisir. Męme, aprčs avoir décrit le
carrosse oů la dame se promčne, il vous dira le nom de la dame. Il
sait oů la prendre et dans quel hôtel, entre cour et jardin, il
retrouvera cette pestiférée, et notez bien qu'il n'est point amoureux
de ces miracles de beauté et de ces beautés d'occasion. Au contraire,
on dirait qu'il les raille et qu'il les hait, tant il les a bien vues.
Harpies! la honte et le chagrin de tant d'honnętes gens. Ces douze
volumes sont remplis de leurs mensonges et de leurs trahisons vus par
un sceptique, mais un sceptique qui a ses quarts d'heure de pardon.
Pour comble d'ironie, il ne va pas enfermer dans un méchant tome, en
vil papier, ces trouvailles de son esprit et de sa souvenance; au
contraire, il veut les publier superbes, sur un papier fait pour les
grands poëtes, et que chaque dame, ici présente, apparaisse dans sa
grâce et dans sa beauté. Voyez plutôt, dans ces deux tomes de _la
Femme fusillée_, Blanche de Volnay et Mlle Angeline Duportail, l'une
armée d'un couteau ŕ la façon de Charlotte Corday, l'autre ŕ la
poitrine sans voile, aux bras nus, et d'une beauté irrésistible. Ce
sont lŕ ses armes de combat. Et maintenant que, par un si long détour,
j'arrive ŕ cette publication derničre, accordez-moi la permission d'en
parler tout ŕ mon aise et longuement.
Ce nouveau livre en deux volumes non moins splendides que les autres
études de moeurs parisiennes, est intitulé: _Le Chien perdu et la
Femme fusillée_, en souvenir d'un petit livre écrit deux ans avant la
révolution de Juillet: _L'Ane mort et la Femme guillotinée..._ On a
plus tard effacé le second titre, et ce n'est plus que _l'Ane mort..._
Je puis parler de ce livre, autrefois célčbre, oublié de nos jours
[Note: Oublié! _L'Ane mort et la Femme guillotinée_ est un des
chefs-d'oeuvre de l'école romantique. Tout en voulant railler la
littérature de sang, Jules Janin a créé des figures vivantes: la
nature a vaincu le critique.]. C'était l'oeuvre hésitante d'un nouveau
venu dans les lettres, qui ne se doutait pas que cette histoire le
jetterait, irrévocablement, dans la vie littéraire.
L'âne et la fillette, héros de ces pages timorées, sont nés dans le
męme village, et l'âne et la jeune fille accomplissent le męme voyage,
jusqu'au moment oů celui-ci est traîné ŕ la barričre du Combat, oů
celle-lŕ est menée ŕ l'échafaud. C'était un récit trčs-simple et
trčs-exact. On voyait que la fillette et la bęte avaient vécu, mais
nulle parure, et rien pour arręter le lecteur. Cela était presque naďf
et faisait si peu de bruit!
Seulement l'écrivain, trčs-jeune encore, avait tenté de montrer
comment, dans un style élégant et châtié, l'on pouvait décrire ŕ
l'usage des honnętes gens les lieux les plus corrompus de la grande
ville, ŕ savoir la Bourbe et la Morgue, et le lupanar abominable, et
le bourreau, qui n'était pas encore un personnage. Il y avait męme
un certain baiser ŕ la guillotine que nous trouvions charmant en ce
temps-lŕ. Le livre, ŕ peine publié, fut proclamé comme une chose bien
faite. Il trouva, pour ses premiers répondants, M. de Salvandy, jeune
homme, et M. Victor Hugo, dans toute la jeunesse et l'indulgence d'un
grand écrivain qui était la fęte et l'amour du public.
Je crois bien que M. Sainte-Beuve eut quelque souci du livre nouveau;
mais il s'en repentit, comme a fait plus tard George Sand, effaçant de
ses pages le titre du livre et le nom de l'auteur. Cependant _l'Ane
mort_ a fait son chemin; on l'a mis en tableau, en gravure, en mauvais
drame, et l'illustration de ce petit conte fut le dernier travail de
Tony Johannot. D'autres livres sont venus plus tard qui ne devaient
pas le laisser vivre. On ne va pas ŕ _l'Ane mort_ quand on peut
lire _Eugénie Grandet_ et _Notre-Dame de Paris_. Mais quoi! peu de
lecteurs suffisent ŕ l'homme sensé: _Contentus paucis lectoribus_,
disait Horace, et l'auteur de _l'Ane mort_, aprčs quelques tentatives
pour arriver ŕ son premier succčs, finit par traduire Horace et
ne trouva pas de concurrents. Il a fait plus tard un livre assez
considérable: _la Fin d'un Monde et du Neveu de Rameau_, dont la
premičre édition--ô surprise!--est épuisée au bout de cinq ans, sans
que l'auteur ait pu se plaindre de la critique ni de la curiosité de
ses contemporains.
C'est donc en souvenir de _l'Ane mort et la Femme guillotinée_ que M.
Arsčne Houssaye lui dédia: _Le Chien perdu et la Femme fusillée_. Or,
cette fois, vous pourrez juger ŕ quel point de réalisme, et, disons
mieux, de vérité, l'illustre écrivain a poussé les qualités par
lesquelles il est parvenu ŕ composer _les Grandes Dames, les
Parisiennes_ et _les Courtisanes du monde_. Il a choisi pour son
texte: les _Epouvantements_ et les _Abîmes_, c'est-ŕ-dire les derniers
jours de l'infâme Commune. Il la connaît par coeur, il la connaît
aussi bien qu'il connaît le grand monde et le demi-monde; et quand
vous aurez lu ces deux tomes des abîmes et des épouvantements, ne vous
étonnez pas que vous sachiez toute cette histoire. Ah! voilŕ bien
cette autre fin d'un monde au milieu des flammes et des égorgements!
Il y avait, en ce temps-lŕ, un franc-tireur qui sauvait un chien
d'une mort certaine; il s'appelait Ducharme; il était amoureux d'une
certaine Virginie Duportail, qui lui rendait amour pour amour, mais
aussi trahison pour trahison. Elle riait quand elle avait bien
trompé un amoureux de sa beauté; elle était męlée ŕ ces histoires de
Belleville et de l'Hôtel de ville. S'il y avait une barricade, elle
abordait la barricade avec du vin de Champagne. Enfin, s'il était
terrible, elle était violente. Elle vivait avec ce qu'il y avait de
pire ŕ Paris, et l'auteur ne se gęne pas pour les hommes, disant:
«Celui-ci est un Spartiate et celui-lŕ est un Athénien de barričre!»
Entre tous ces jeunes gens il y avait ce beau chien nommé Thermidor,
trčs-bien venu des bataillons de Montmartre, de Montrouge et de
Ménilmontant.
Thermidor est une bęte plus intéressante, et plus aimable que _l'Ane
mort_. Il gambade autour de ces terroristes, Raoul Rigault et Gustave
Flourens! Pauvre Flourens! je l'ai connu beaucoup, moi qui vous parle;
il était simple et bon. Il serait resté tout un jour assis dans le
męme fauteuil et ręvant, Dieu sait ŕ quoi! Nous avons aussi, ŕ coté du
chien Thermidor, le citoyen Carnaval, qui nous fait rire, et puis
Mlle de Volnay, qui se tue ŕ la grande façon romaine, ŕ la façon de
Lucrčce, et qui n'en meurt pas! Bref, dčs les premičres pages, tout
se męle et se confond dans ce récit, qui est déjŕ le récit d'un autre
monde.
Avant l'heure oů les soldats de Versailles s'emparent de Paris et
viennent ŕ bout de la Commune, le peintre excelle ŕ nous montrer les
communards dans leur désordre et dans leur désastre. Ici Jules Vallčs
apostrophant Courbet; plus loin Dacosta tendant son verre ŕ Théophile
Ferré. On ne boit plus dans tout Paris que du vin de Champagne, hormis
du vin bleu; on n'entend plus que les échos de _la Marseillaise_, et
nous avons vu le moment oů l'on allait représenter l'oeuvre nouvelle
de M. Pyat. Mais sa prudence a pressenti l'orage; il avait peur d'ętre
sifflé--et fusillé! Et tout ce monde en męme temps piaule et rugit, et
chante, et crie. Il y en a qui s'enivrent, d'autres qui se cachent,
plusieurs font l'amour, plusieurs s'en vont ŕ Versailles ŕ une partie
oů les comédiennes déclament des vers de Théophile Gautier. Les
demoiselles perdent des discrétions, les dames perdent leur mouchoir,
les vivandičres gagnent des fédérés, les honnętes femmes se cachent et
font de la charpie. Le colonel Rossel, le général Dombrowski, M. de
Rochefort, rčgnent et gouvernent. Le gamin de Paris s'en va de l'un
ŕ l'autre, et la belle Angeline Duportail fait la garde ŕ l'Hôtel de
ville.
Aventures monstrueuses! On s'empare ŕ la fin d'Angeline Duportail, et,
dans un hôtel du parc Monceaux, on la fusille; elle tombe ŕ la porte
de Violette, une héroďne des _Grandes Dames_.
Quand elle est frappée, elle ressuscite et s'en va, chancelante, ŕ la
recherche de son amant. Car ici nous appelons les choses par leur nom:
ma maîtresse, mon amant, gros comme le bras. Enfin la mal fusillée, ŕ
peine couverte des voiles d'une dame de la charité, est reconnue
par son chien et par un agent de police; alors commence une série
interminable d'épreuves et de malédictions. M. Arsčne Houssaye est
habile en toute sorte de péripéties. Angeline Duportail, sitôt qu'elle
est rendue ŕ la douce lumičre, pleure des larmes de repentir; mais
quand son amant est condamné ŕ la déportation, elle le suit avec
Thermidor jusqu'au port oů le colonel Ducharme est embarqué pour
Nouméa.
Alors Thermidor, voyant partir son maître, l'appelle en désespéré; il
finit par se jeter dans le flot retentissant. Il aboie sa douleur;
mais comment quitter celle-ci pour celui-lŕ? Il va, il revient. Il
finit par se noyer, et la belle Angeline, ŕ son tour, meurt d'amour et
de chagrin. Ah! que de peines avant d'arriver ŕ la tombe, et que la
jeune Henriette, de _l'Ane mort_, a plus tôt fait de courber sa belle
tęte sous la main du bourreau!
De tous les romans de M. Arsčne Houssaye, il semble que celui-lŕ
est le plus rempli d'épouvante et de terreur. J'ai presque dit de
sympathie et de pitié. Ainsi, ces créatures de l'autre monde auront
mérité l'honneur d'aller rejoindre, dans leurs châteaux, dans leurs
boudoirs, en leurs abîmes, en leurs cercueils, toutes les maîtresses
de M. Don Juan de Parisis.
Mais que M. Arsčne Houssaye, dans les entr'actes de ses livres plus
sévčres, retourne ŕ ses grandes dames, ŕ ses belles pécheresses, ŕ ses
passions de la vie parisienne. Pourquoi n'écrit-t-il pas ce livre,
depuis longtemps annoncé: _Les mains pleines de roses, pleines d'or
et pleines de sang_? Il m'a conté cette histoire. Il y a lŕ une idée
philosophique et un drame terrible.
JULES JANIN.
LIVRE PREMIER
LES MAINS PLEINES DE ROSES
Celui qui nie l'Inconnu nie les destinées de son âme.
GOETHE.
J'ai commencé par nier tout, j'ai fini par croire ŕ tout.
LA HARPE.
Cette femme qui sourit dans sa beauté te donnera l'amour
et la mort. Mais qu'est-ce que la vie sans l'amour!
OCTAVE DE PARISIS.
I
LA VISION DU CHATEAU DE MARGIVAL
Cette histoire va vous paraître étrange; c'est la Vérité elle-męme qui
parle.
Un jeune homme de vingt ans passait ŕ cheval dans une petite vallée du
Soissonnais, coupée de prairies, de bois et d'étangs, dominée par une
montagne oů s'agitaient et babillaient trois ou quatre moulins ŕ vent.
Le soleil disait adieu aux flčches aiguës de l'église; l'Angélus
ne sonnait pas comme dans les romans, parce que le maître d'école
arrosait son jardinet bordé de buis, oů fleurissait sur la męme ligne
la ciboule et le dahlia. On entendait le cri argentin du crapaud, ce
doux poëte des marais. Le coucou et le merle, qui avaient déjŕ
fait leur lit sur la ramure, ne se répondaient plus qu'ŕ de longs
intervalles.
Ce jeune homme allait je ne sais oů, ni lui non plus. Le cheval, tout
enivré par la verte et savoureuse odeur de la luzerne fauchée, était
léger comme la jeunesse; il effleurait l'herbe et dévorait l'espace.
Le cavalier allait plus vite encore; il voyageait ŕ bride abattue dans
le monde idéal qui vous ouvre ŕ vingt ans ses portes d'or et d'azur.
D'oů venait-il? du collčge. Il n'avait pas vécu de la vie jusque-lŕ.
Il n'avait connu que les Grecs et les Romains. L'étude avait
chastement veillé en sentinelle sur son coeur, comme la vestale
antique dans le temple de Junon.
Il allait vivre, enfin! La passion viendrait bientôt ŕ lui tout
échevelée avec ses fureurs divines, ses étreintes de flamme. Il avait
appris ŕ lire, mais il avait ŕ peine entr'ouvert ce livre sacré, ce
livre infernal oů Dieu et Satan ont écrit leurs poëmes. Comme il ne
croyait qu'ŕ Dieu, il entr'ouvrait le livre avec confiance. Il entrait
dans la vie avec la pieuse ferveur d'un chrétien qui franchit le seuil
d'une église en songeant que lŕ du moins, sous les regards des anges,
des vierges et des saints qui sourient dans les vitraux ou dans les
cadres, il est ŕ l'abri des méchants.
Georges du Quesnoy,--c'est son nom,--était fils d'un magistrat, frappé
dans sa carričre par 1848, un galant homme qui avait eu le tort de
mettre un peu de politique dans la balance de la justice. Il avait
trois enfants, deux fils et une fille. Sa fortune était des plus
médiocres. Il vivait dans le Soissonnais, trčs-retiré du monde, du
produit d'une ferme qui ne devait gučre donner que 100,000 francs ŕ
chacun de ses enfants. La fille était mariée ŕ un procureur impérial;
le fils aîné, depuis un an sorti du collčge, ne voulait rien faire,
sous prétexte qu'il faisait des vers; le plus jeune se disait bon ŕ
tout: au journalisme, ŕ la diplomatie, ŕ l'épée, ŕ la robe. Aussi il
y avait tout ŕ parier contre un que Georges du Quesnoy n'arriverait ŕ
rien.
Il devait, aprčs la saison, partir pour Paris, le grand dévoreur
d'hommes; Paris qui engloutit mille ambitieux pour faire un nain. En
attendant ce rude combat, il vivait d'insouciance, amoureux de l'aube
et du crépuscule, du rayon qui descend et du bruit qui s'élčve,
confiant ses ręves aux nuages, ŕ la foręt et aux fontaines.
Ce soir-lŕ on respirait l'amčre senteur des fčves qui enivre
quelques-uns jusqu'ŕ la folie. Le moissonneur s'attardait dans les
bois, au parfum des fraises déjŕ műres. L'écoličre s'amusait, au
retour de l'école, ŕ souffler, de ses lčvres virginales, le plantain
en fleur qui semblait chevelu et poudré comme un marquis. L'écolier
admirait la délicatesse architecturale des chardons; il cueillait le
pissenlit hérissé, il se hasardait ŕ sucer le suc de l'ortie, l'ortie
dont il comparait la gueule blanche au rabat du prętre. Tout était
joie et fęte en ce beau soir. La terre chantait son hymne ŕ Dieu par
la voix des hommes, des foręts, des moissons et des oiseaux. Il n'est
pas jusqu'au champ de pommes de terre qui ne livrât au vent l'odeur
plébéienne de ses vertes ramures, étoilées çŕ et lŕ de ces humbles
fleurs dédaignées que nulle main blanche n'a cueillies et que
nulle muse n'a chantées.--Je vous salue, ô pommes de terre, vertes
espérances des Spartiates futurs!
Georges, aprčs avoir côtoyé une haie de sureaux et d'aubépines oů
le liseron suspendait ses clochettes blanches et roses, s'arręta
soudainement ŕ la grille d'un parc touffu qui cachait ŕ demi la façade
Louis XVI du château de Margival, dont le parc était surnommé, on ne
sait pas bien pourquoi, le _Parc aux Grives_, peut-ętre parce que la
vigne grimpait sur tous les arbres et que les grives y venaient en
belles compagnies au temps de la vendange.
Le château de Margival est un des plus jolis du Soissonnais; un peu
moins, ce serait une simple villa, mais, un peu plus, ce serait un
château princier, tant l'architecte a bien marqué le style dans cette
oeuvre en pierre de la fin du XVIIIe sičcle.
Dans ce château souvent abandonné, M. de Margival amenait tous les
ans sa fille Valentine, qui était encore au Sacré-Coeur. Mais comme
c'était déjŕ une vraie demoiselle, on quittait Paris avant les
vacances, pour passer trois ŕ quatre mois dans cette belle solitude.
M. de Margival s'y trouvait bien, en souvenir de sa femme qu'il avait
adorée et qui était morte jeune.
Le pays oů on a été malheureux de son bonheur est toujours un pays
d'élection.
Mlle de Margival ne s'y trouvait pas mal, quoiqu'elle fűt peu éprise
de la solitude.
Ce n'était pas la premičre fois que Georges du Quesnoy venait se
promener aux alentours de Margival. Son pčre habitait ŕ trois quarts
de lieue; au petit village de Landouzy-les-Vignes, dans une simple
maison de campagne, appelée par la maison bourgeoise, petite cour avec
pavillons, un arpent de jardin par derričre, oů l'on veut jouer au
parc tout en ménageant un potager.
Il aimait le château de Margival. Quoiqu'il ne fűt pas poëte comme son
frčre, il avait déjŕ un vague sentiment de l'art: aussi était-il dans
l'enthousiasme devant cette façade.
«Ah! s'écria-t-il tristement, si mon pčre habitait un pareil château,
je voudrais y vivre et y mourir sans m'inquiéter des pommes d'or des
Hespérides! Ne peut-on trouver ici mieux qu'ŕ Paris les joies du
coeur, les fętes du ciel et de la nature?
Il avait mis pied ŕ terre pour appuyer son front brűlant sur la
grille. Il eűt donné quelques beaux jours de sa vie pour pouvoir
fouler en toute liberté l'herbe du parc. «Ainsi doit ętre la vie,
pensa le jeune philosophe: des tentations qui vous montrent leur sein
nu, mais qui vous défendent d'approcher.»
A cet instant il vit apparaître, comme dans un songe, une jeune fille
vętue d'une robe blanche, qui débusquait d'une avenue de tilleuls et
venait vers la grille d'un air recueilli. Elle avait vingt ans. Elle
était belle comme si elle fűt sortie des mains du Corrčge; elle était
pure comme si elle fűt sortie des mains de Dieu. Praxitčle, qui n'a
jamais trouvé son idéal, se fűt incliné devant elle.
Quoiqu'elle semblât méditer profondément, elle s'arręta tout ŕ coup
devant un papillon enjoué qui battait des ailes, comme pour applaudir
ŕ cette vision. Elle voulut saisir ces ailes toutes d'or et de
pourpre; elle se mit ŕ courir comme une écoličre ŕ travers les massifs
et les branches. Sa chevelure, ŕ peine nouée, s'envola sur ses épaulés
et lui voila les yeux. Sa robe, battue par le vent, s'accrochait
ŕ tous les rosiers. Vingt fois elle fut sur le point de saisir le
papillon, qui semblait comprendre le jeu et qui voulait secouer un peu
de la poussičre d'or de ses ailes sur cette main virginale.
Elle poussa un cri qui traversa comme une flčche le coeur de Georges;
elle avait déchiré sa main ŕ un rosier; le sang coulait comme des
perles de vin. Elle se mit ŕ rire pour oublier de pleurer; elle saisit
une rose blanche et la teignit de pourpre comme autrefois Vénus
chassant avec les Heures.
Elle avait oublié le papillon; elle cueillit des marguerites, elle les
éparpilla dans ses cheveux et regarda dans l'étang pour voir si elle
était plus belle avec des fleurs.
Je ne saurais raconter les mille et une folâtreries dont elle égaya sa
méditation. Georges du Quesnoy était toujours ŕ la grille. Il y serait
encore si un hennissement de son cheval n'eűt effrayé la jeune fille.
Dčs qu'elle se vit surprise en sa solitude, elle s'envola comme une
colombe ŕ travers les ramées. Georges du Quesnoy ne vit plus que les
branches émues qu'elle avait touchées au passage.
Il remonta ŕ cheval, bien décidé ŕ venir tous les soirs se promener
dans ce parc enchanté.
Comme il éperonnait son cheval pour arriver chez son pčre ŕ l'heure du
dîner:
«Prenez donc garde, lui dit une paysanne ensevelie sous une moisson
d'herbe fraîchement coupée, vous allez me jeter dans le ruisseau.
--Je ne vous avais pas vue.
--Oů avez-vous donc les yeux? Ne dirait-on pas que je suis une fourmi
portant un brin de paille ŕ sa fourmiličre!
--A qui appartient ce château?
--A la Belle au bois dormant.
--Est-ce cette jeune fille que je voyais tout ŕ l'heure vętue de blanc
comme une communiante?»
La paysanne regarda Georges du Quesnoy d'un air moqueur.
«Ętes-vous visionnaire?
--J'ai vu une jeune fille courant aprčs des roses et des papillons.
--C'est un conte. M. de Margival et sa fille sont en pčlerinage ŕ
Notre-Dame-de-Liesse. Il n'y a pas au château âme qui vive ŕ cette
heure.»
Georges du Quesnoy n'en voulait rien croire. Il partit au galop,
bien décidé ŕ revenir le lendemain pour revoir cette belle fille aux
cheveux flottants, Čve idéale de ce paradis terrestre.
II
TOUT ET RIEN
Quand Georges rentra ŕ Landouzy-les-Vignes, il rencontra son frčre qui
cueillait des rimes aux buissons.
«C'est moi, lui dit-il, qui ai eu une vision poétique.»
Et il conta ŕ Pierre comment une jeune fille, une ręverie idéale en
robe blanche lui était apparue dans le parc du château de Margival.
«C'est la préface de l'amour, lui dit Pierre. Mais moi qui suis poëte,
je vais t'expliquer en prose l'énigme de cette apparition. Mlle de
Margival est arrivée depuis quelques jours au château avec son pčre;
elle a dix-huit ans et elle a les dix-huit beautés voulues par le
peintre et le sculpteur...
--Allons, tu vas commencer par divaguer.
--C'est toi qui divagues; parce que tu vois une jeune fille en robe
blanche, te voilŕ ręvant ŕ une apparition magique.
--Tu as peut-ętre raison, je ne suis qu'un visionnaire.»
Et Georges du Quesnoy, qui n'y avait pas songé, chercha ŕ se prouver
que la jeune fille en blanc, c'était Mlle de Margival.
Mais voilŕ que tout ŕ coup, et comme pour jeter le trouble dans son
esprit, une calčche ŕ deux chevaux passa devant les deux frčres,
emportant vers le château M. de Margival et sa fille.
«Tu vois bien que ce n'était pas elle.»
Les paysans, qui s'étaient arrętés pour voir passer ce qu'ils
appelaient le carrosse, apprirent ŕ Georges que M. et Mlle de Margival
venaient du château de Marchais oů ils avaient déjeuné chez le prince
de Monaco, tout en faisant un pčlerinage ŕ Notre-Dame-de-Liesse.
«Cette fois, dit Pierre ŕ son frčre, je n'y suis plus du tout, ŕ moins
qu'il n'y ait au château quelque cousine inconnue, promenant sa robe
blanche.»
Mais les męmes paysans qui étaient les moissonneurs et les vendangeurs
de M. de Margival, affirmčrent que, hormis le pčre et la fille, il n'y
avait pas âme qui vive, sinon une cuisiničre grosse comme un tonneau
et une femme de chambre grande comme un moulin.
Les jeunes gens finirent par parler d'autre chose, ils allčrent
retrouver leur pčre, qui les attendait pour dîner. Au dessert, aprčs
avoir parlé de ceci et de cela, aprčs avoir mangé beaucoup de ces
belles cerises du pays qui valent bien mieux que les cerises de
Montmorency, M. du Quesnoy leur dit:
«Eh bien, messieurs mes fils, maintenant que vous voilŕ tous les deux
bacheliers čs lettres, il faut vous décider ŕ devenir des hommes; que
ferez-vous?
--Rien, dit Pierre.
--Tout, dit Georges.»
III
IL ÉTAIT UNE FOIS...
A quelque temps de lŕ, Georges du Quesnoy alla passer la soirée au
château de Sancy-Lépinay.
Ce n'était pas sans une certaine émotion qu'il se hasardait dans sa
vingtičme année vers un monde nouveau. Quoiqu'il ne fűt pas timide
jusqu'ŕ la bętise,--c'est souvent la timidité des gens les plus
spirituels--il avait peur de lui, il se demandait s'il trouverait
quatre mots ŕ dire dans ce beau monde, familiarisé avec toutes les
impertinences, car la comtesse de Sancy avait depuis huit jours, dans
son château, ces messieurs et ces dames, qui sont le tout Paris de
l'Opéra et des courses.
Georges du Quesnoy avait longtemps hésité ŕ affronter le feu. C'était
son premier duel avec la vie; il résolut d'ętre brave et de sourire au
premier sang, car il ne doutait pas qu'il ne fűt le point de mire de
beaucoup de railleries plus ou moins directes: les Parisiens sont des
francs-maçons qui font toujours subir une rude entrée aux provinciaux.
«Aprčs tout, disait Georges, ils ne me mangeront pas.»
Il savait bien, d'ailleurs, qu'il n'était pas plus bęte qu'un autre.
Il avait eu le prix d'excellence au collčge de Soissons,--ce qui
n'était pas une raison, puisque le génie n'a pas souvent de présence
d'esprit,--mais en outre ses camarades lui accordaient une certaine
éloquence humouristique. Ce n'était certes ni l'humour de Sterne, ni
de Hogarth, ni de Heine, ni de Stendhal. On ne revient pas si jeune de
Corinthe. Mais il y avait toujours du charme dans sa causerie, parce
que la gaieté y jaillissait des questions plus graves.
Il était moins content de son habillement que de son esprit, car aprčs
tout on peut apprendre ŕ lire Homčre et Platon ŕ Soissons comme ŕ
Paris, mais les tailleurs de Soissons n'ont pas encore le coup de
ciseau des tailleurs de Paris. Il avait eu beau s'étudier devant son
miroir, en se donnant des airs de désinvolture; il avait eu beau se
coiffer ŕ la derničre mode; il avait eu beau se relever la moustache:
il y avait encore en lui je ne sais quoi de soissonnais qui marquait
trop le terroir. Heureusement il ne se jugeait pas; il était trop
habitué ŕ lui-męme pour se critiquer ŕ propos; il trouvait męme que
son pčre et sa mčre n'avaient pas trop mal travaillé, car j'oubliais
de dire qu'il avait une belle tęte, peut-ętre un peu féminine, ŕ force
de jeunesse, mais qui promettait de prendre du caractčre. Le profil
était męme d'un dessin sévčre, mais l'oeil bleu de pervenche était
trop doux. On eűt dit des yeux d'hiver ou tout au plus de printemps,
car ils ne jetaient pas de flammes vives; peut-ętre le volcan
dormait-il sous la neige, peut-ętre la passion devait-elle allumer ces
yeux-lŕ.
Georges du Quesnoy n'était pas trop mal chaussé; aussi, dčs son entrée
dans le salon du château, la comtesse dit-elle ŕ une des ses amies:
«N'est-ce pas qu'il a de jolis pieds pour des pieds de province?»
Quand un domestique dit son nom ŕ la porte, il se sentit pâlir et
chanceler, il salua ŕ droite et ŕ gauche sans savoir son chemin. Il
alla trébucher contre un coussin et donna de la tęte sur l'éventail de
la jolie Mme de Fromentel, qui dit tout haut ŕ une de ses amies:
«Ce jeune homme est terrible, un peu plus il m'arrivait en pleine
poitrine.» Georges du Quesnoy était revenu ŕ lui ŕ ce point qu'il
hasarda ces paroles: «Je ne me serais pas cassé la tęte, madame.» Mme
de Fromentel ne savait si elle devait rougir ou se fâcher.
«Voyez-vous, monsieur, lui dit-elle avec une pointe d'impertinence,
c'est parce que vous n'y voyez pas avec votre lorgnon dans l'oeil.»
--C'est parce que j'avais peur d'ętre ébloui, madame.»
On disait la bonne aventure au voisinage, non pas avec les cartes ni
avec le marc de café, mais en lisant dans les mains:
«Vous n'y entendez rien, dit tout ŕ coup la maîtresse de la maison ŕ
la sibylle. Monsieur du Quesnoy, savez-vous prédire l'avenir en lisant
dans les mains?
--Puisque je sors du collčge, je sais tout, dit Georges, en
s'efforçant de sourire.
--Eh bien, vous allez commencer par moi.»
Georges du Quesnoy commença bien: la dame avait trente ans passés; or,
en lui prenant la main, voilŕ quelles furent ses premičres paroles:
«Madame la comtesse, quand vous aurez vingt-huit ans, vous traverserez
des périls sans nombre!» Jusque-lŕ tout le monde avait regardé le
nouveau venu avec le froid dédain des gens qui sont au spectacle de
la bętise humaine. On s'était quelque peu mis ŕ rire en le voyant se
jeter le lorgnon dans l'oeil sur l'éventail de Mme de Fromentel; on
l'avait comparé ŕ un écuyer du cirque qui va traverser un cerceau de
papier; mais quand on vit qu'il n'était pas trop dépaysé, on répéta de
bouche en bouche que le collégien n'était pas si bęte qu'il en avait
l'air.
Un rayon presque sympathique tomba sur lui, on se demanda qui il était
et d'oů il venait. On ne fut pas fâché d'apprendre que son pčre était
une des personnalités de la magistrature, demi-noblesse de robe qui
lui donnait ses petites entrées dans ce château héraldique s'il en
fut. Puisque ce n'était pas le dernier venu, on pouvait lui permettre
d'avoir de l'esprit, aussi toutes les femmes voulurent lui donner la
main.
Il s'était hasardé dans cette aventure sans savoir un mot de ce qu'il
allait dire. La fortune est aux audacieux; d'ailleurs il lui était
impossible de rebrousser chemin: coűte que coűte, il fallait parler.
Il parla. Il ressemblait fort ŕ ce bűcheron ivre qui fait des fagots
ŕ travers la foręt, donnant des coups de hache de çŕ de lŕ, abattant
comme un aveugle et se déchirant la main aux épines. Quoiqu'il fűt
toujours un peu troublé, il n'oubliait pas de regarder chaque patiente
face ŕ face, pour lire quelque peu dans sa physionomie. C'est encore
plus sűr que la main, surtout pour ceux qui n'ont pas appris ŕ lire
dans ces hiéroglyphes que déchiffrent si galamment les initiés, comme
si c'était vraiment une langue consacrée.
Déjŕ il avait contenté ou mécontenté deux curieuses plus ou moins
naďves, quand une troisičme, qui s'y entendait, lui prit sa main ŕ
lui-męme et lui débita quelques malices cousues de fil blanc.
Il se laissa faire d'autant mieux que la dame était jolie, étrange et
provocante.
«Monsieur, lui dit-elle, j'en sais plus que vous; tout ce que vous
avez dit lŕ, ce ne sont pas des paroles d'Évangile; vous avez sans
doute appris cela en faisant votre rhétorique ou votre philosophie. Je
vous ai ouď parler du démon de Socrate et des visions de Descartes....
--Des cartes! s'écria une femme, on va tirer les cartes. J'en suis.»
La dame qui tenait la main de Georges du Quesnoy se tourna vers
l'interruptrice:
«On voit bien, ma chčre, que si vous avez fait votre rhétorique, vous
n'avez pas fait votre philosophie: Descartes, c'est le philosophe.»
Cette chiromancienne, qui avait les secrets de Desbarolles, était une
demoiselle de Lamarre, cousine de la maîtresse de sa maison. Elle
n'avait pas voulu se marier, parce qu'elle avait lu dans sa main que
le mariage lui serait fatal. Elle avait d'ailleurs une figure ŕ rester
vieille fille, quoique avec de beaux yeux et de belles dents.
Cependant Mlle de Lamarre continuait ŕ étudier la main de Georges:
«Ah! mon Dieu!» dit-elle tout ŕ coup.
Elle prononça ces mots avec une pâleur soudaine et avec une voix émue
qui frappčrent tous ceux qui étaient lŕ en spectacle.
Georges du Quesnoy la regarda avec une curiosité inquičte, quoiqu'il
s'efforçât de prendre un masque moqueur.
Elle avait laissé retomber la main.
«C'est impossible, dit-elle en la reprenant.
--Mais qu'y a-t-il donc? lui demanda la comtesse de Sancy.
--Parlez! parlez! dit le jeune homme. Vous imaginez-vous que vous
allez me faire peur?
--C'est moi qui ai peur, murmura la devineresse.
--Vous avez donc vu le diable dans ma main?
--Si ce n'était que cela.
--Qu'avez-vous vu?
--Je ne le dirai pas.
--Permettez, dit un des assistants, c'est un peu le jeu des enfants
que vous jouez lŕ. Vous devez parler tout haut.»
Aprčs un silence de quelques secondes, la dame reprit gravement la
parole:
«Si je croyais beaucoup ŕ toutes ces sorcelleries, je ne dirais rien;
mais comme je n'y crois pas pour deux sous, je vais dire ce que j'ai
vu. La ligne de Saturne est brisée par un X fatal, c'est un signe de
mort violente.»
Un beau sourire s'épanouit sur la figure de Georges du Quesnoy.
«Madame, lui dit-il, vous ne pouviez pas m'annoncer une mort plus
agréable pour moi: mourir de mort violente, voilŕ qui n'est pas ŕ
la portée de tout le monde, c'est la mort des dieux et des rois. Si
j'étais un peu pédant, quelle belle occasion j'aurais lŕ de faire une
page d'histoire!
--Soyez un peu pédant, dit la maîtresse de la maison, je ne suis
heureuse que si on me raconte des morts tragiques.
--_Vae victis!_ Tant pis pour moi! Tous les grands noms sont morts de
mort violente, sans parler de Jésus-Christ. Homčre est mort de faim,
Socrate a bu la ciguë, César fut poignardé, Alcibiade fut percé de
flčches, toute l'antiquité est pleine de ces choses-lŕ. Sardanapale
se brűla vif, Anacharsis fut étouffé, Zénon mourut dans les tortures,
Polycrate fut crucifié, Ésope, comme Danaé, fut précipité du haut d'un
rocher, Sapho se précipita elle-męme; Philippe; roi de Macédoine,
tomba sous les coups de Pausanias, qui tomba sous les coups
d'Alexandre; Phocion but la ciguë, comme Socrate; Artaxercčs fut
dévoré par les bętes, Pyrrhus tomba sous le coup d'une pierre,
Antiochus et Bérénice furent empoisonnés, comme Annibal, comme
Aristippe; Archimčde fut tué au sičge de Syracuse; Mithridate a eu
beau s'habituer au poison, il n'en mourut pas moins de mort violente;
Cléopâtre mit un aspic ŕ son beau sein. Combien de morts terribles ŕ
Jérusalem! Plus de trois millions sous Vespasien et sous Titus. Et les
Romains, croyez-vous qu'ils soient morts de leur belle mort? Tibčre,
Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Domitien, Commode,
Caracalla. Agrippine, femme de Tibčre et fille d'Auguste, mourut de
faim; mais je passe par-dessus toutes les tragédies. Protée se brűla
lui-męme sur un rocher, Mančs fut écorché vif, Bhéram, roi des Perses,
fut tué d'une flčche; l'empereur Maxime eut la tęte tranchée, Attila,
qui avait ruiné cinq cents villes et tué un million d'hommes, mourut
de joie dans son lit: mort violente! L'empereur Xénon fut enterré
vivant par la belle Ariadne. Je passe sur tous les drames de la cour
de France avant Frédégonde, aprčs Brunehaut. Et le conseil des Dix! et
les Sforza! et les Borgia! Mais quel que soit le pays, qu'on s'appelle
Jean Huss ou Marie Stuart, qu'on soit Cinq-Mars ou le duc de
Montmorency, Barneweldt ou Buckingham. «Et la garde qui veille
aux barričres du Louvre n'en défend pas les rois:» Henri IV meurt
poignardé, Louis XVI guillotiné. 1793, c'est la grande époque; la
guillotine ne frappe pas assez vite quand les terroristes sont au
pouvoir. Et quand la guillotine se repose, tout est-il fini? Et Paul
Ier, assassiné; et Mohamed, poignardé; et le duc d'Enghien, et le
grand vizir Mustapha. Et le comte d'Entraygues et la Saint-Huberti
dans les bras l'un de l'autre; et Napoléon Ier cloué sur un rocher, et
Ney, qui inaugure la réaction blanche; et Kotzebue, et Karl Sand, et
le duc de Berry, et le pacha de Janina, dont la belle tęte, coupée,
fut envoyée au sérail; et les massacres de Chio, et l'empereur
Iturbide, et les janissaires massacrés ŕ Constantinople; et le dernier
des Condé, pendu ŕ l'espagnolette d'une croisée; et Napoléon II, et
Léopold Robert, et le baron Gros, et le maréchal Mortier, et Armand
Carrel, et le comte Rossi, et les archevęques de Paris, et Gérard
de Nerval, et Maximilien! Hécatombe, hécatombe, hécatombe de morts
violentes! Il n'y a que les paresseux qui meurent dans leurs lits.
J'accepte donc la mort violente; si je meurs ainsi, c'est que je
jouerai un grand rôle.»
Les auditeurs furent émerveillés de la mémoire du lycéen. Il avait
remué tous ces noms célčbres avec la rapidité d'un prestidigitateur.
Georges du Quesnoy paya encore d'audace.
«Et maintenant, madame, dit-il avec beaucoup de laisser-aller, je vais
vous raconter ma mort.»
Il se fit un grand silence; le jeune homme avait décidément conquis
tout le monde. On se groupa autour de lui, les femmes avec une
inquiétude romanesque, les hommes avec une curiosité railleuse, mais
pourtant attentive.
Georges du Quesnoy avait passé sa main sur son front comme pour faire
jaillir la lumičre dans sa pensée.
«Attendez donc, dit la maîtresse de la maison, on va servir le thé,
vous nous direz cette belle histoire tout ŕ l'heure, car je ne veux
pas que l'histoire soit coupée en deux.»
La comtesse sonna, on apporta le thé, elle le servit de sa blanche
main, mais en toute hâte, comme pour dire: «Dépęchez-vous, la tragédie
va commencer.»
Pendant qu'on prenait le thé bruyamment, Georges, replié sur lui-męme
dans l'attitude d'un chercheur, eut une vision étrange; soit que ce
mot: _mort violente_, lui eűt fait une profonde impression, soit que
la prescience lui montrât un des tableaux de l'avenir, il vit, sous le
rayon d'un soleil levant, cet abominable échafaud armé d'un couperet
qui s'intitule la guillotine.
«Eh bien, vous ne commencez pas?» lui dit Mme de Sancy.
Il leva la tęte et sembla ne plus savoir oů il était.
«Pardonnez-moi, madame, lui dit-il, mais j'étais déjŕ si loin dans mon
histoire, que j'oubliais de vous la raconter.»
Cinq minutes aprčs, tout le monde s'était remis en cercle autour du
conteur inédit.
Georges du Quesnoy n'était pas fâché d'avoir vu s'ouvrir cette
parenthčse entre le titre de son roman et son récit. Il avait pu,
tout en causant, ébaucher dans son esprit toute une histoire pour
la galerie, mais il avait peur de tomber dans quelques vulgarités
rebattues. Les beaux romans sont connus de tout le monde, on ne peut
pas les refaire; les mauvais sont toujours nouveaux, mais est-ce la
peine de les faire? Il craignait, d'ailleurs, que les choses ne se
passassent comme ŕ la lecture de _Paul et Virginie_: au beau milieu de
son conte tous les châtelains voisins demanderaient leur carrosse.
«Vaille que vaille, dit-il tout ŕ coup. Je commence.»
Il huma délicieusement sa seconde tasse de thé, du vrai thé chinois,
dans du vrai chine:
«Il était une fois....
--C'est un conte, dit une jeune fille; je n'y croirai pas.
--Chut! dit Mme de Sancy avec impatience, il n'y a rien de plus vrai
que la _Barbe-Bleue_. J'en connais plus d'un ici qui a eu sept femmes.
--A propos, dit Georges du Quesnoy en se tournant vers la devineresse,
vous m'avez dit que je mourrais de mort violente, mais de quelle mort
violente? Serai-je pendu? Serai-je fusillé? Boirai-je la ciguë? Me
précipiterai-je du rocher de Leucade? Serai-je assassiné? Serai-je
guillotiné?»
Aprčs chaque question, le jeune homme mettait un point d'interrogation
et un silence, la dame répondait: «Non» par un signe de tęte; mais ŕ
la derničre question: «Serai-je guillotiné?» elle se tut et porta la
main ŕ son coeur.
Et elle fit cela gravement, sans vouloir jouer la comédie, en femme
convaincue.
Tout ŕ l'heure elle ne croyait qu'ŕ moitié, maintenant elle ne doutait
plus. Elle murmura en se parlant ŕ elle-męme:
«Oui, guillotiné.»
Mme de Sancy fit remarquer alors que tout le monde écoutait, męme les
grillons du foyer.
IV
Mlle VALENTINE DE MARGIVAL
«Il était une fois, reprit Georges du Quesnoy, un bachelier čs lettres
qui ne savait rien de la vie, si ce n'est ce qu'on devine ou qu'on
apprend dans les livres. Il n'avait pas été plus mauvais écolier
qu'un autre, on avait męme dit de lui, comme de tous les enfants, que
c'était un prodige, parce qu'il avait fait en cinq jours une tragédie
en cinq actes sur _l'Enlčvement des Sabines_, laquelle tragédie fut
représentée, Romains et Sabines par tous les lycéens de Soissons aux
applaudissements de tous les Soissonnais. Ce jour-lŕ on se rappela que
Soissons avait eu une Académie.
«Or cet enfant prodige n'était pourtant devenu qu'avec peine un
bachelier čs lettres. Il était destiné ŕ la magistrature, il allait
bientôt partir pour Paris comme étudiant en droit, heureux d'entrer
dans cet enfer du pays Latin, comme d'autres seraient heureux d'entrer
dans le paradis de Mahomet, quand il alla passer la soirée dans un
château hospitalier qui, au moment des chasses, recevait le dessus du
panier des mondains et des mondaines.
«C'est ici que se dessina ŕ grands traits la destinée du lycéen de
Soissons, car il rencontra en ce château une sibylle qui en eűt
remontré ŕ la sibylle de Cumes. En effet, cette jolie sorcičre des
salons lui prédit ce soir-lŕ, en lisant dans sa main, qu'il serait
guil-lo-ti-né,--guillotiné,--guillotiné. Je dis trois fois la męme
chose, comme les Américains, parce que cela en vaut bien la peine.
«Le lycéen aurait bien pu répondre ŕ la sibylle que la guillotine
n'étant pas inventée quand on inventa la chiromancie, il était donc
impossible que la guillotine fűt marquée dans l'alphabet de la main.
Mais le lycéen n'était pas pédant, il passa condamnation sur sa
condamnation....»
Georges du Quesnoy en était lŕ de son récit, ou plutôt de sa préface,
quand on annonça M. de Margival et Mlle de Margival, le pčre et la
fille.
«Je ne les attendais pas si tôt! s'écria Mme de Sancy; décidément
c'est comme a Paris: quand on va en soirée on y va le lendemain,
c'est-ŕ-dire aprčs minuit.»
Mlle de Margival était une pensionnaire ŕ peu prčs comme Georges du
Quesnoy était un lycéen. On n'est plus naďf, on n'est plus ingénue: on
garde bien encore en sortant du collčge et du couvent une expression
de gaucherie et d'embarras qui révčle la candeur, mais cette
expression qui a bien son charme est trop tôt corrigée par la
désinvolture voulue, que dis-je! par la désinvolture apprise; car
aujourd'hui, c'est une des sciences de l'éducation.
Mlle de Margival fit une entrée radieuse; elle avait gardé sa pelisse,
mais arrivée au milieu du salon, elle la laissa tomber avec un abandon
charmant. Une pensionnaire se fut retournée pour la ramasser, mais
Mlle de Margival continua ŕ s'avancer vers la maîtresse de la maison,
sans s'inquiéter de sa sortie de bal. Elle savait bien, d'ailleurs,
que trois ou quatre beaux messieurs du Bois-Doré se précipiteraient
pour la recueillir.
«Ma belle enfant, dit Mme de Sancy, vous arrivez tout ŕ point, car M.
du Quesnoy nous conte un roman. Que dis-je, un roman! c'est son roman
ŕ lui, non pas le roman qu'il a vécu jusqu'ici, car il a encore sur
ses lčvres du lait de sa nourrice, mais le roman qu'il vivra dans sa
jeunesse.»
Mlle de Margival prit un air discret et pudique.
«Si c'est un roman, je n'écouterai pas, car les jeunes filles ne
lisent pas de romans.»
Elle regarda son pčre avec un adorable sentiment d'ingénuité.
Le pčre sourit comme s'il n'était pas bien convaincu que ce fűt
sérieux.
«Je crois, ma chčre Valentine, que tu peux te risquer, car ce doit
ętre ici un roman, pour les jeunes filles.»
Georges du Quesnoy n'avait jamais vu Mlle de Margival. Il s'était levé
ŕ son approche, il s'inclina devant elle en lui disant:
«Vous pouvez d'autant plus vous risquer, mademoiselle, que mon roman
est fini.
--Votre roman est fini? s'écria Mme de Sancy.
--Oui, madame, mon roman est fini parce qu'il n'est pas commencé.»
En disant ces mots, Georges du Quesnoy attachait ses deux yeux bleus
sur les yeux noirs de Mlle de Margival.
Ceux qui regardent de prčs le spectacle de la vie auraient pu voir ŕ
cet instant sur le jeune homme et sur la jeune fille ce choc imprévu
que les psychologistes appellent l'avant-coureur de l'orage, ou
l'entraînement du magnétisme. Pour moi qui ne suis qu'un historien
des choses du coeur, j'appellerai cela le premier avertissement de
l'amour.
On eut beau faire, Georges du Quesnoy ne voulut pas continuer.
Vainement Mlle de Margival, qui semblait fort attristée d'avoir
interrompu un roman ŕ son premier chapitre, pria le jeune homme de
poursuivre son récit, il s'y refusa avec quelque impatience.
«C'est ridicule, dit-il, de s'amuser aux jeux de l'imagination, quand
la vérité est bien plus romanesque. Tout ce que je puis faire, c'est
de vivre ŕ pleine coupe et ŕ quatre chevaux, si j'ai de quoi les
nourrir, pour avoir l'honneur, l'an prochain, de venir vous conter
cette année scolaire, puisque je suis étudiant en droit, ŕ moins que
d'ici l'an prochain je n'aie été guil-lo-ti-né.»
Et il apprit ŕ Mlle de Margival comment il avait été condamné ŕ mort
par la chiromancienne.
«Ce n'est pas un jugement sans appel? dit la jeune fille.
--Sans appel, mademoiselle.
--Vous aurez le recours en grâce.
--Je veux bien, si c'est vous qui devez me faire grâce.
--Je vous le promets, reprit Mlle de Margival, si je suis reine de
France.
--Oh! mon Dieu, mademoiselle, il ne faut pas toujours ętre la reine
pour avoir droit de grâce. Et puis pourquoi ne seriez-vous pas reine
de France?
--N'est-ce pas?»
Et la jeune châtelaine s'éloigna avec une attitude toute royale.
C'en était fait de la soirée, les voisins de campagne avaient demandé
leurs breacks ou leurs calčches; les invités de Paris aspiraient ŕ
leur chambre ŕ coucher. Plus d'un n'était pas fâché de n'avoir pas ŕ
subir le roman du lycéen. Mme de Sancy seule regrettait que la soirée
ne se continuât pas jusqu'ŕ l'aurore, tant elle avait peur de la nuit.
C'est que la nuit, de par un acte de l'état civil et par une cérémonie
religieuse, elle était bien et dűment la femme légitime du comte de
Sancy-Lépinay, un provincial s'il en fut,--un mari s'il en sera,--car
pour lui le mariage n'était pas une chambre ŕ deux lits. Il y a des
hommes qui se marient pour avoir une dot, le comte de Sancy-Lépinay
s'était marié pour avoir une femme.
Mais ce n'est pas lŕ notre histoire!
V
LE MONDE DES ESPRITS
A quelques jours de lŕ, il y avait encore une soirée chez la comtesse.
Mais cette fois le salon était presque désert, les Parisiens s'étaient
envolés, il n'y avait plus que les voisins de campagne et la jolie
sorcičre, qui passait l'automne au château. A cette autre soirée,
Georges du Quesnoy amena son frčre Pierre.
Pierre du Quesnoy était l'aîné. Sorti du collčge depuis Pâques, il
ne voulait rien faire, si ce n'est des vers; selon lui, vivre en
communion avec Dieu et la nature, c'était toute la vie.
Quoique son pčre lui eűt souvent représenté que le devoir de tout
homme digne de ce nom est de vivre avec les hommes; quoiqu'il lui eűt
répété sans cesse qu'il n'avait pas de fortune pour vivre les bras
croisés, le jeune homme n'en démordait pas, tant la poésie est aveugle
en sa passion.
Il vivait trčs-solitaire, tantôt chez son pčre, tantôt réfugié dans un
petit pavillon de chasse attenant ŕ une ferme de deux cents arpents,
qui était toute la fortune de la famille. Il vivait de rien, ręvant,
chassant, écrivant, tout aux livres et aux bois. Quand son pčre lui
reprochait son _far niente_, il lui répondait: «Faut-il donc tous les
biens du monde pour vivre?»
Beaucoup d'esprits sont ainsi pris par la ręverie en la premičre année
de la vraie jeunesse; les uns par paresse poétique, les autres dans
la peur de l'action. Il est si difficile de bien faire et il est si
facile de ne rien faire!
Georges du Quesnoy présenta son frčre ŕ la devineresse.
«Madame, je vous présente le plus beau paresseux des temps modernes.
Je serais bien curieux de savoir ce que celui-ci a dans la main. Je
crois qu'il n'a rien du tout. Et pourtant ce n'est pas faute de coeur
ni faute d'esprit.»
La jeune dame prit la main de Pierre.
«Voyons, dit-elle, j'aime les mains des jeunes, car je ne suis pas de
celles qui prédisent ce qui est déjŕ arrivé.»
Elle étudia silencieusement la main.
«C'est incroyable, dit-elle tout ŕ coup. L'alphabet n'est pas bien
formé, des lignes indécises comme dans la main d'un enfant, rien n'est
accentué, on voit bien que M. Pierre du Quesnoy n'a pas encore tenu
pendant toute une heure la main d'une amoureuse, car rien ne marque
les lignes comme cela.
--Enfin que voyez-vous? demanda Georges avec une vraie curiosité.
--Des prédictions vagues, comme pour le premier venu; ce n'est pas la
peine d'en parler. Attendons que la ligne de l'amour et de la fortune
ait mieux sillonné la main.
--Mais encore? dit ŕ son tour Pierre du Quesnoy.»
La jeune dame laissa retomber la main.
«Rien, vous dis-je.»
Mais en disant cela, une grande expression de tristesse s'empara de la
figure de la devineresse.
«C'est ma main qui vous a fait pâlir? lui dit Pierre du Quesnoy.
--Non, monsieur, répondit la dame en se levant, c'est un souvenir de
deuil qui a traversé mon esprit.»
La comtesse de Sancy alla vers son amie:
«Ma chčre belle, pourquoi ce visage, renversé?»
La devineresse se pencha ŕ l'oreille de Mme de Sancy.
«C'est étrange, dit-elle, cette famille est prédestinée, car celui-lŕ
périra de mort violente comme son frčre.
--Allons donc!
--Vous verrez cela.»
Georges du Quesnoy, qui écoutait aux portes, avait entendu. La
prédiction faite ŕ lui-męme ne l'avait pas ému beaucoup, mais cette
fois c'était plus que sérieux. Il devint pensif, tout en murmurant:
«Cette femme est une folle ou une voyante.»
La chiromancienne aussi avait entendu.
«Voyante, et pas folle, dit-elle tout haut. Puisque vous venez de
faire votre philosophie et que vous croyez encore ŕ la poésie,
n'oubliez pas que les philosophes et les poëtes, Socrate comme
Aristophane, Descartes comme Byron, ont tous été superstitieux, parce
que tous les grands esprits ont entrevu le monde surnaturel. Ce sont
les puissances occultes qui mčnent le monde. Les Orientaux nomment
Fagio les esprits qui donnent la mort aux hommes; car tous ne meurent
pas de maladie. Et encore, qui a donné la maladie?»
Georges du Quesnoy voulut railler.
«Ah! oui, la fičvre maligne, cela vient des esprits malins.
--Je ne ris pas. Il n'y a qu'une seule maladie: la décomposition du
sang. Or la décomposition du sang vient toujours d'une cause morale.
C'est l'âme qui tue le corps, par les passions ou par les chagrins.
Les Orientaux reconnaissent surtout l'esprit invisible--le Fagio--qui
frappe de mort soudaine. Voulez-vous un exemple? Le sultan
Moctadi-ben-Villa dit un jour ŕ une de ses femmes: «Pourquoi ces
gens sont-ils entrés ici?» La femme regarda et dit qu'il n'y avait
personne. Mais au męme instant elle s'aperçut que le sultan pâlissait.
«Chassez ces gens,» reprit-il. Disant ces mots, il expira.
--Tout cela, dit Georges du Quesnoy, ce sont des contes arabes des
_Mille et une Nuits_.
--Des histoires des _Mille et une Nuits_? Voulez-vous que j'ouvre
l'Évangile pour vous convaincre; monsieur l'esprit fort?
--Oui, ouvrez donc l'Évangile.»
Il y avait lŕ, sur la table, l'Évangile illustré par Moreau le Jeune.
La chiromancienne se leva pour le feuilleter.
«Tenez, dit-elle, voilŕ tout justement le cinquičme chapitre de
l'Évangile selon saint Marc. Lisez vous-męme.»
Georges lut qu'une légion d'esprits impurs, possédant un pécheur,
s'accrochaient ŕ sa vie _pour le fixer_ jour et nuit _dans les
sépulcres et sur les_ montagnes_, oů les légionnaires infernaux
imposaient tous les sépulcres ŕ ce pauvre homme. «Comment te
nommes-tu?» lui demanda Jésus. «Je me nomme légion, parce que nous
sommes innombrables.»
«Ah! reprit Mlle de Lamarre, vous ne croyez pas aux esprits, mais
l'Évangile, le livre des livres, les consacre ŕ chaque page. Saint
Luc ne vous dit-il pas que tout homme est une maison pour les esprits
flottants? «Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va
par des lieux arides cherchant la solitude, mais comme il ne trouve
pas le repos, il dit: «Je retournerai dans ma maison.» Y revenant, il
la voit belle et parée; alors il s'en va prendre sept esprits plus
méchants que lui et il leur dit: «Entrez dans ma maison, voilŕ votre
demeure.»
Georges relisait l'Évangile avec surprise.
«On sait tout, dit la chiromancienne, excepté l'Évangile.
--Oui, reprit Georges, l'Évangile ne parle que par parabole et par
symbole: les sept hommes plus méchants que le premier esprit, qui font
élection de domicile chez le pauvre pécheur, ce sont les sept péchés
capitaux!
--Qu'importe! qui vous dit que les sept péchés capitaux ne sont pas
des esprits? Saint Augustin, qui n'était pas un esprit faible, non
plus qu'un esprit fort, connaissait bien ces ambassadeurs de Satan.
Dans la _Cité de Dieu_ qui est son Évangile, ne vous dit-il pas:
«Veillez, veillez sur vous-męme, car ces natures perfides, subtiles
et familičres ŕ toutes les métamorphoses, se font tour ŕ tour Dieu,
démons ou âmes de trépassés: heureux qui leur échappe!» Avant saint
Augustin, saint Paul n'avait-il pas dit: «Satan lui-męme se déguise en
ange de lumičre pour nous mieux tromper»?
--Pour trouver le diable, dit gaiement Georges du Quesnoy, Mlle de
Lamarre va appeler ŕ son aide tous les saints du calendrier.
--Voulez-vous que je vous cite Socrate et Platon? Ceux-lŕ ne croyaient
ni ŕ l'Olympe ni au Paradis, mais ils ont reconnu l'existence des
anges. Qu'est-ce que la magie? Une fenętre ouverte sur le monde mixte
placé en dehors de nous, composé d'âmes en peine, celles-ci esclaves
du mal, celles-lŕ déjŕ libres, pour le bien.»
Mlle de Margival, qui venait d'arriver, s'était approchée de Mlle de
Lamarre, sous prétexte de feuilleter l'Évangile, mais au fond c'était
pour voir de plus prčs Georges du Quesnoy.
«Tout cela, dit-elle, ce ne sont que des paroles; puisque vous parlez
magie, faites-nous voir le diable.
--Le diable, dit Mlle de Lamarre, je ne crois pas que je le trouverai
chez moi. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se donner beaucoup de
peine pour le trouver un jour chez M. Georges du Quesnoy.
--Eh bien, mademoiselle, dit le jeune homme en s'inclinant vers la
jeune fille, ce jour-lŕ je vous ferai voir le diable.»
Ils causčrent tout un quart d'heure--ŕ l'américaine--dans la premičre
ivresse d'un amour imprévu.
VI
LES BUCOLIQUES
Le lendemain, Georges du Quesnoy alla encore se promener aux lisičres
du parc du château de Margival, s'imaginant voir réapparaître dans les
lointains cette adorable vision qui l'avait enchanté l'avant-veille.
Mlle de Margival la lui avait rappelée; mais, en la regardant bien, il
n'avait pas reconnu cette belle fille svelte, qui semblait s'envoler
en marchant, cette figure de séraphin, cette blancheur rosée, ces
attitudes idéales qui appartenaient tout ŕ la fois ŕ l'ange et ŕ la
femme.
Quoiqu'il fűt moins ręveur que son frčre le poëte, il aimait ŕ
s'isoler dans ses songes. La méditation n'était pas profonde, mais,
comme son âme était ardente, il s'abandonnait ŕ tous les méandres de
la pensée, sans souci des choses extérieures. Selon l'expression de
Swedenborg, «il ne lui fallait qu'un instant pour sortir de chez lui
et monter au septičme ciel».
Aussi, oubliant bien vite que le parc n'était pas une grande route,
il franchit le petit saut-de-loup comme s'il passait dans ses terres.
C'était le côté du parc le plus solitaire et le plus boisé. En le
voyant faire, le garde champętre ne l'eűt pas appréhendé au corps,
parce que M. de Margival permettait aux moissonneurs et aux vignerons
de venir puiser de l'eau ŕ une petite source minérale qui jaillissait
sous les grands arbres.
Georges s'arręta devant la source et but dans sa main.
Quand il releva la tęte, il murmura avec un sourire de joie: «Ah! la
voilŕ, la voilŕ encore.» Il venait de voir ŕ une portée de fusil, ŕ
travers les ramées, sa chčre vision, blanche, légčre, belle comme
l'avant-veille. Elle n'effeuillait plus de roses et elle semblait
pensive. Il vit bien que décidément ce n'était pas Mlle de Margival.
Il marcha rapidement, décidé ŕ aborder cette belle inconnue, mais ce
fut toujours le męme jeu: plus il s'avançait, plus elle s'éloignait.
Il ne désespérait pourtant pas de l'atteindre, quand tout ŕ coup
Mlle de Margival, débusquant d'un massif, lui apparut ŕ son tour,
effeuillant des marguerites.
«En vérité, dit Georges du Quesnoy, il y a de la féerie dans ce
château.»
Quoiqu'il n'eűt pas frappé ŕ la porte pour entrer, il jugea qu'il ne
pouvait moins faire que de saluer Mlle de Margival.
La jeune fille le salua ŕ son tour avec une grâce de pensionnaire
émancipée.
Elle voulut rebrousser chemin, comme si elle fűt fâchée d'ętre
surprise ainsi consultant l'oracle; mais comme, aprčs tout, elle
demandait ŕ la marguerite si M. Georges du Quesnoy l'aimerait un peu
ou beaucoup, passionnément ou point du tout, elle trouva bien naturel
de lui accorder une audience sous la voűte des cieux. Donc, aprčs
ce que nous appellerons une fausse sortie, elle vint bravement ŕ la
rencontre du jeune homme.
Ils s'abordčrent avec quelque embarras, tout en voulant cacher tous
deux leur timidité ou leur émotion:
«Mademoiselle....
--Monsieur....»
Et un silence glacial tomba devant eux.
«Mademoiselle, reprit Georges, vous habitez un château enchanté.
--Je ne trouve pas, monsieur. Oů voyez-vous qu'il soit enchanté?
--Primo, mademoiselle, vous l'habitez; secundo, il y a une autre jeune
fille qui m'est déjŕ apparue deux fois comme dans les contes de fées.
--Tertio, monsieur, vous ętes un visionnaire.»
Mlle de Margival, qui, au fond, n'était pas timide, qui promettait
męme d'ętre une femme sans peur, sinon sans reproche, avait repris
pied et maîtrisait son émotion.
«Je vous jure, mademoiselle, que tout ŕ l'heure j'ai vu lŕ-bas, plus
loin que les marronniers, une jeune fille passer en robe blanche,
légčre comme une ombre.
--Et d'abord, monsieur, vous conviendrez que la robe blanche n'est pas
de saison.
--Ma foi, mademoiselle, quand on est chez soi....
--Chez soi! dans un parc qui est ouvert ŕ tout le monde.
--Je ne puis le nier, puisque j'y suis moi-męme.
--Oh! vous, vous n'ętes pas tout le monde, vous ętes de nos amis
depuis hier.»
Georges s'inclina.
--«Mademoiselle, avez-vous une soeur? une cousine? une filleule?
--Ah! oui, vous revenez ŕ votre vision. Eh bien, la vérité, c'est
que je n'ai ni soeur, ni cousine, ni filleule; c'est qu'il n'y a au
château que mon pčre et moi, avec un jardinier, un valet de chambre,
une cuisiničre et une femme de chambre, qui ne sont pas du tout en
robes blanches.
--C'est que vous ne connaissez pas cette jeune fille, mademoiselle.
Puisqu’aprčs tout ce parc est ouvert ŕ tout venant, il n'est pas
impossible qu'une demoiselle du voisinage y soit venue cueillir des
fleurs.»
La jeune fille s'inclina ŕ son tour, comme si elle jugeait que
l'entrevue avait duré assez longtemps. Elle avait peur que son pčre ne
survînt.
«Adieu, mademoiselle, dit Georges du Quesnoy, qui s'était enhardi;
me permettez-vous de continuer ma promenade dans le parc et de
recueillir, une ŕ une, tous les pétales des marguerites que vous avez
effeuillées?
--Non, monsieur, dit Mlle de Margival en rougissant, je ne veux pas
que vous sachiez ce que m'a dit la marguerite.
--Mademoiselle, je le sais, la marguerite vous a dit: passionnément.»
Mlle de Margival s'était éloignée de quelques pas.
Georges venait de cueillir, lui aussi, une marguerite.
«Ce n'est pas la peine de la consulter, n'est-ce pas, mademoiselle,
car elle me répondra: Point du tout.»
Valentine se retourna. Jamais un pareil éclair ne jaillit des yeux
d'un jeune homme et d'une jeune fille.
VII
POINT DU TOUT.
Le dimanche, ŕ la messe, on se regarda encore; la messe parut trop
courte ŕ ces fervents catholiques. Au sortir de l'église, Georges du
Quesnoy salua M. de Margival, qui lui tendit cordialement la main;
mais Mlle de Margival semblait ne l'avoir jamais vu. La calčche du
château attendait sous les arbres, ŕ côté de l'église. Comme le comte
y conduisait sa fille, le suisse, encore armé de sa hallebarde, vint
lui dire qu'il y aurait le lendemain conseil de fabrique, et que M. le
curé, qui retirait son surplis, voudrait bien en causer avec lui. Il
était question d'une chaire ŕ pręcher. Le comte retourna ŕ l'église
pour causer avec le curé. Mlle de Margival se retrouva donc seule un
instant avec Georges. Pour cacher son émotion elle lui demanda, d'un
air un peu railleur, s'il était revenu de ses visions. Il lui répondit
qu'il était plus visionnaire que jamais; puisqu'elle-męme lui
apparaissait ŕ toute heure.
On se regarda encore comme ŕ la rencontre dans le parc.
«Est-ce que vous me permettrez, mademoiselle, de franchir demain le
saut-de-loup, rien que pour cueillir une marguerite?
--Non, monsieur, pas demain, parce que je n'y serais pas; mais
aujourd'hui si vous voulez.
--A quelle heure?»
Avant de répondre, Mlle de Margival réfléchit un peu.
Je ne sais pas si le diable qui perdit Marguerite ŕ la porte de
l'église vint troubler l'âme de la jeune fille, mais elle répondit: «A
six heures,» tout en se disant que son pčre ne serait pas au château ŕ
cette heure-lŕ.
M. de Margival devait dîner chez Mme de Sancy. Dîner de libres paroles
d'oů toutes les jeunes filles étaient exclues.
M. de Margival reparut presque aussitôt avec M. le curé.
Georges du Quesnoy le salua une seconde fois, tout en jetant ce mot ŕ
Mlle de Margival:
«Passionnément.»
A quoi elle riposta par:
«Point du tout.»
Comme Georges du Quesnoy avait déjŕ de la malice philosophique, il
jugea que ce _point du tout_ était un aveu. Si Mlle de Margival avait
voulu briser sur ce point délicat, elle se fűt contentée de ne pas
répondre.
Georges retourna chez lui l'âme pleine d'amour, l'esprit plein
d'espérance. Mlle de Margival, quel que fűt le point de vue, était une
bonne fortune: pour l'amoureux elle était belle, pour l'ambitieux elle
était riche, pour le glorieux elle était noble.
La question serait de décider le pčre, non pas ŕ dire _point du tout_,
mais ŕ dire oui. Georges pensa que ce ne serait point chose aisée, car
M. de Margival était une des personnalités du pays; il devait ręver
pour sa fille, ŕ qui il donnerait trois ou quatre cent mille francs de
dot, un mariage politique, nobiliaire, diplomatique. Georges aurait
beau se hausser sur la pointe de ses pieds, il ne pourrait faire
grande figure devant M. de Margival. Son pčre était fort honorable,
légčrement drapé dans sa noblesse de robe, mais il ne pouvait montrer
un blason sur fond d'or. A peine donnait-il ŕ ses trois enfants chacun
cinquante mille francs pour le jour de leur mariage. Mais il y avait
un autre abîme entre Georges et Valentine, c'est qu'ils étaient
presque du męme âge. L'échappé de collčge n'avait pas de temps devant
lui pour arriver ŕ quelque chose de sérieux qui pűt plaider en sa
faveur. Il ne serait pas encore avocat, sans doute, que déjŕ la jeune
fille aurait donné sa main.
Toutes ces réflexions n'empęchaient pas Georges d'ętre trčs-heureux
de son amour et de l'amour de Valentine, car décidément il prenait le
_point du tout_ pour l'argent comptant de l'amour.
Rentré ŕ la maison, il dit ŕ son frčre:
«Tu n'as jamais été amoureux, toi?
--Moi, je le suis tous les jours.
--De qui?
--De toutes les femmes, ici, lŕ, partout, plus loin.
--Je connais cela; c'est le contraire de l'amour. C'est égal, puisque
tu es poëte, fais-moi des vers ŕ ma beauté.
--Ta beauté! qu'est-ce que cela?
--Cela, c'est Mlle Valentine de Margival.
--Tu es fou, une orgueilleuse qui te mettra ŕ ses pieds.
--Eh bien, qu'elle me mette ŕ ses pieds; je me charge de la faire
tomber dans mes bras.
--Comme tu y vas.
--Oh! moi, je ne suis pas pour les ręveries platoniques.
--Tu es venu, tu as vu, tu as vaincu.
--Voyons, fais-moi des vers, je les enverrai demain matin dans un
bouquet.
--Et tu les signeras?
--Pas si bęte; mais elle saura bien qu'ils sont de moi.»
Pierre avait pris son crayon et ébauchait déjŕ des alexandrins.
«C'est si difficile d'écrire en prose! dit Georges.
--C'est si facile d'écrire en vers! dit Pierre. Vois si j'ai traduit
ton coeur.
--Déjŕ!»
Et il lut:
Vous ętes ŕ la fois la Grâce et la Beauté:
Votre sein chaste et fier dans la neige est sculpté,
Vous avez le pied fin, vous avez la main blanche;
Votre cou, c'est le lys que le vent d'avril penche;
Vos yeux ont dérobé les feux du firmament,
Et vos regards mouillés versent l'enchantement.
Valentine, croyez ma bouche oů le mensonge
Ne passera jamais: l'amour est un beau songe
Qui nous prend ŕ minuit et nous réveille au ciel,
Pour nous nourrir de lait, d'ambroisie et de miel.
C'est une chaîne d'or traînée avec délices,
Un doux parfum venu des plus chastes calices,
Une larme, une perle, un sourire, un rayon,
Une gazelle, un loup, une biche, un lion,
Une source oů jamais l'on ne se désaltčre...
Valentine, l'amour c'est le ciel et la terre!
«Mais c'est admirable, s'écria Georges, je n'aurais jamais trouvé
cela.
--C'est parce que tu n'es pas si bęte que moi, comme tu dis toujours.
--Vous autres poëtes, vous ętes comme des marchands de nouveautés.
Vous avez des rayons pour tous les sentiments: étoffes de printemps,
étoffes d'automne.
--Oh mon Dieu! oui, dit Pierre; quand tu voudras des imprécations
contre ta beauté, tu viendras encore frapper ŕ ma porte, je te
donnerai cela ŕ juste prix.»
Georges embrassa bien familialement Pierre.
Ces deux frčres étaient des frčres amis qui s'étaient toujours
beaucoup aimés. Ils étaient nés ŕ un an d'intervalle, si bien qu'ils
avaient traversé, les mains dans les mains, l'enfance et la premičre
jeunesse, ne se disputant jamais les jouets et se battant l'un pour
l'autre avec une bravoure touchante. Ils se rappelaient qu'au lit de
mort, leur mčre leur avait dit: «Embrassez-vous.»
Et chaque fois qu'ils s'embrassaient, ils sentaient que leur mčre
était encore avec eux.
Ce soir-lŕ, Georges eut des larmes dans les yeux en embrassant Pierre,
des larmes pour sa mčre et des larmes pour Mlle de Margival.
«Comme je voudrais que tu fusses heureux, dit Pierre en embrassant
Georges ŕ son tour.
--Et moi aussi, dit Georges en reprenant sa gaieté, car je n'ai pas de
temps ŕ perdre, puisque je dois mourir de mort violente.»
VIII
LES ÉTOILES
Le lendemain matin, Mlle de Margival, se promenant dans le parc, vit
venir ŕ elle une paysanne qui lui présenta un bouquet.
«Oh! les belles fleurs! d'oů cela vient-il?
--De partout, répondit la paysanne avec un sourire malin. Je les ai
cueillies par-ci par-lŕ pour vous les offrir.
--Oui, ce sont des fleurs des champs, n'est-ce pas? Elles sont si
jolies, si jolies, si jolies, qu'on dirait des fleurs artificielles.»
Vrai mot de paysanne. Celle qui était devant Mlle de Margival regarda
autour d'elle pour s'assurer de la solitude.
«Voyez-vous, mademoiselle, dans les fleurs des champs il y a le
langage des fleurs.
--On vous a appris cela au catéchisme?
--Non, ŕ la veillée. Quand vous serez dans votre chambre vous prendrez
chaque fleur, une ŕ une et elles vous diront ce que vous voulez
savoir.
--Je ne connais pas le langage des fleurs.
--Mademoiselle veut rire. Quand on sait lire comme mademoiselle, on
lit dans les fleurs et dans les étoiles.»
Mlle de Margival ne rentra pas dans sa chambre pour questionner le
bouquet. Elle s'enfonça dans une avenue ténébreuse de châtaigniers oů
elle était sűre de ne pas rencontrer son pčre. Elle ne doutait pas que
le bouquet ne vînt de Georges du Quesnoy. Elle avait trop l'esprit
féminin pour ne pas deviner que le langage des fleurs c'était une
lettre du jeune homme.
C'était mieux qu'une lettre, puisque c'étaient les vers de Pierre.
«Chut! ça brűle,» dit-elle en mettant les vers dans son sein.
Mais elle les reprit bientôt pour les relire encore.
«C'est amusant, les amoureux, murmura-t-elle.»
Elle ne disait pas encore: «C'est amusant, l'amour.»
A quelques jours de lŕ, Mme de Sancy donna un bal oů se retrouvčrent
Georges et Valentine. Ce soir-lŕ, Valentine eut tant de caprices et
de coquetteries que Georges souffrit mille morts. Il comprit qu'il ne
pourrait jamais retenir dans ses bras cette jeune fille, qui avait
soif de toutes les adorations. Mais comme elle le vit triste, elle
vint ŕ lui, elle l'emporta dans la valse, elle l'enivra de toutes les
ivresses virginales.
Ce qui les charmait et les détachait de la terre tous les deux,
c'était ce divin amour qui ne sait encore rien de la passion,
qui s'ignore lui-męme, tant il s'étonne de ses ravissements, qui
n'effleure męme pas la volupté, tant il brise les liens terrestres.
Amour tout esprit, tout âme, tout coeur. Mais pour ętre amoureux,
il faut ętre doué, car cela n'est pas ŕ la portée de tout le monde.
Combien qui passent ŕ côté et qui vont tout droit ŕ la passion sans
avoir entrevu cet adorable vision! Mais Georges et Valentine étaient
touchés du rayon divin. Ni l'un ni l'autre n'avait hâte de sortir du
paradis pour trouver le paradis perdu.
Un soir, en l'absence de M. de Margival, Georges du Quesnoy était
resté plus tard que de coutume; il avait dit ŕ Valentine qu'il ne
dînerait pas, espérant que Valentine reviendrait aprčs dîner.
Elle avait pour ainsi dire dîné par coeur, tant elle avait hâte de
renouer la causerie interrompue. Et de quoi causait-on? de rien; mais
c'était tout. Mlle de Margival était donc revenue bien vite. La nuit
tombait; les arbres de l'avenue du château masquaient les nuages
empourprés du couchant. Les oiseaux s'appelaient et se répondaient.
Déjŕ l'étoile du soir annonçait une belle nuit. Les deux amoureux ne
s'étaient pas encore vus dans le demi-jour. Ils se sentirent plus
émus que de coutume. Au plus léger bruit, Valentine se rapprochait de
Georges, qui n'osait se rapprocher d'elle. Ils allčrent s'asseoir
sur une petite meule de regain ramassé le jour męme. Les rainettes
criaient dans l'étang, les feuilles devisaient sur les arbres, une
chanson lointaine retentissait dans le bois.
Quoique Georges eűt horreur des banalités, il ne trouva rien ŕ dire,
sinon que c'était une fort belle soirée; ce ŕ quoi Valentine répondit
en soupirant, comme la premičre paysanne venue: «Ah! oui, on est
heureux d'ętre au monde.»
Il ne vint ni ŕ l'un ni ŕ l'autre la pensée d'ętre plus heureux que
cela.
Georges ne songea męme pas que dans cette solitude cachée par le
bois, presque voilée par la nuit, il lui serait bien doux d'étreindre
Valentine et de s'enivrer sur ses lčvres. Elle-męme, quoique plus
décidée par sa nature et son caractčre, n'eut pas un instant peur
que Georges ne tentât l'aventure. Elle se sentait si heureuse ainsi,
qu'elle ne doutait pas que le bonheur de Georges ne se contentât de ce
qui faisait son bonheur ŕ elle.
Peu ŕ peu les étoiles s'allumčrent au ciel. Ils firent par lŕ un
voyage au long cours abordant chez Saturne, débarquant chez Vénus,
s'attardant chez Jupiter, prenant pied dans la grande Ourse. Et
partout ils s'y créaient une existence enchantée, un amour étoilé,
s'il en fut. Deux belles heures se passčrent ainsi ŕ décrocher des
étoiles dans le bleu profond des nues.
«C'est un malheur, dit tout ŕ coup Valentine, j'ai trop étudié
l'astronomie, la science gâte l'imagination.
--Vous avez bien raison, dit Georges, mais ne croyez pas un mot de la
science. Le soleil n'a été créé que pour illuminer la terre, et les
étoiles pour illuminer la nuit. Ce ne sont pas des mondes, ce sont des
âmes égarées qui sont déjŕ venues sur la terre et qui y reviendront.»
La cloche du château sonna dix heures.
«Oh! mon Dieu, s'écria Valentine, dix heures ŕ la campagne, c'est
minuit ŕ Paris. On va me chercher avec des lanternes si je ne me sauve
tout de suite.»
Elle s'était levée. Elle tendit la main ŕ Georges, qui y appuya ses
lčvres. Elle trouva cela si naturel ce soir-lŕ, qu'elle pencha en
toute candeur deux fois son front vers les lčvres déjŕ apprivoisées.
Georges baisa et rebaisa les beaux cheveux avec délices. Mais, comme
il s'y attendait un peu, elle lui dit:
«Chut! les étoiles nous regardent.»
Leurs âmes s'étaient si bien fondues dans la męme idée et dans le
męme sentiment, que, tandis que Georges, s'en retournant ŕ
Landouzy-les-Vignes, s'imaginait que les étoiles lui faisaient une
auréole, Valentine, ŕ peine arrivée dans sa chambre, fit signe aux
męmes étoiles de venir jusque sur son oreiller.
IX
DAPHNIS ET CHLOÉ
Ces fraîches promenades dans le parc de Margival furent la vraie
jeunesse de coeur de Georges et de Valentine. Ils étaient nés ŕ
l'amour; ils n'étaient pas nés ŕ la passion. C'était l'aube vermeille
et rieuse, c'était le soleil ŕ ses premiers rayons, s'éblouissant
lui-męme ŕ tous les diamants et ŕ toutes les perles de la rosée. Plus
tard, ils dirent tous les deux: «O mes fraîches promenades dans le
parc de Margival, qui donc me les rendra!»
C'est que les arbres, les arbustes, les buissons, les herbes et
les fleurs, le ciel dans l'étang, le parfum des roses, la senteur
pénétrante des foins coupés, le bourdonnement des abeilles, les
molles secousses de la brise, le gai sifflement du merle, la chanson
interrompue du rossignol, les mille bruits, les mille couleurs, les
mille arômes, la nature, en un mot, était sympathique ŕ leur amour.
C'était le fond du tableau, c'était le cadre enchanteur.
Le soir, Valentine rentrait dans sa chambre, tout enivrée, mais prise
par les mélancolies, et elle se disait: «C'est donc triste d'aimer?»
C'est triste, mais c'est doux.
Qu'est-ce que la tristesse, d'ailleurs, sinon la porte ouverte sur
l'infini? Quand le peintre flamand Kalft met une rose toute fraîche
sur ses tętes de mort, il exprime une idée et un sentiment. L'amour
touche la mort, parce que, dans ses gourmandises de temps et d'espace,
il juge que la vie ne dure qu'un jour et qu'il ira plus loin que la
vie. La tristesse, c'est l'aspiration au lendemain.
C'était bien avec les męmes battements de coeur que Georges rentrait
dans sa chambre. Quand il avait vu Valentine, il ne voulait parler ŕ
personne, tant il avait peur de perdre les trésors de son coeur.
Il lui semblait qu'il emportait dans ses bras toute une gerbe de
souvenirs. Il les savourait un ŕ un avec une joie ineffable. Sa
fenętre donnait du côté de Margival. Quel que fűt le temps, il y
restait deux longues heures, l'oeil perdu dans les étoiles, comme s'il
dűt y rencontrer le regard de Valentine. Il se promettait déjŕ les
contentements, les troubles, les ivresses du lendemain. Or, le
lendemain, si Valentine lui avait donné rendez-vous pour deux heures,
il partait aprčs le déjeuner de midi, pour arriver une heure trop tôt,
tant il aimait le chemin. Il s'amusait ŕ battre les buissons, grand
écolier indiscipliné, qui fait déjŕ l'école buissonničre dans la vie.
On sait déjŕ que de Landouzy-les-Vignes ŕ Margival il n'y a pas une
heure ŕ pied. Le chemin tout sinueux est lui-męme indiscipliné; c'est
le vieux chemin primitif qui va, qui vient, serpentant ici, de lŕ,
se perdant sous les touffes ombreuses, se retrouvant dans la vigne,
sautant les ruisseaux et s'attardant ŕ la montagne. Rien n'est plus
pittoresque: tantôt ŕ fleur de terre, tantôt caché par les talus tout
égayés, d'épines et de sureaux. Aussi ce chemin était aimé de Pierre
comme de Georges.
«Tu ne t'imagines pas comme je cueille des rimes de ce côté-lŕ!»
disait Pierre.
Il accompagnait souvent son frčre au départ, mais ils se quittaient
en route, le poëte entraîné par la solitude, comme l'amoureux par
l'amour.
Quoiqu'il ne voulűt pas ętre indiscret et qu'il craignît de rencontrer
M. de Margival, Georges du Quesnoy arrivait toujours dans le parc
avant l'heure. Valentine elle-męme devançait l'aiguille, elle venait
chaque jour, avec une émotion grandissante. Quand elle s'approchait du
saut-de-loup du côté des bois, c'était avec de violents battements
de coeur. Elle pâlissait et n'osait regarder, peut-ętre d'ailleurs
aimait-elle mieux ętre surprise, quoiqu'elle eűt des yeux de lynx.
C'est ce qui arrivait souvent. Georges l'attendait sous une touffe
de châtaignier et débusquait ŕ son passage, elle tressaillait
et s'arrętait court. «C'est vous!--Déjŕ!--Si tard!--Il y a un
sičcle!--Quelle joie!» Les premičres fois on se donnait la main, on en
était arrivé ŕ s'embrasser, je me trompe, Valentine inclinait le front
et Georges lui baisait les cheveux.
C'était tout. Que faut-il de plus aux vrais amoureux qui ne veulent
pas égorger l'oiseau qui chante, ŕ ceux qui craignent de sauter des
pages dans le roman de l'amour, ŕ ceux qui veulent ouďr toute la gamme
qui résonne dans le coeur?
Bienheureux les amoureux qui commencent leurs ręves dans les _Idylles_
de Théocrite, dans les _Bucoliques_ de Virgile, dans les _Églogues_ de
Longus. Les merveilleux bouquets que les Parisiens payent cinq louis
pour envoyer le matin ŕ leurs maîtresses n'auront jamais le parfum
de la violette et de la primevčre que les amants rustiques cueillent
ensemble sur la lisičre du bois ou dans la prairie. Il y a aussi loin
d'un bonheur ŕ l'autre que de la foręt de l'Opéra ŕ la foręt du bon
Dieu.
Cette aventure romanesque promettait des chapitres charmants; par
malheur elle n'alla pas plus loin, car, le lendemain, M. de Margival
dit ŕ sa fille:
«Que dirais-tu s'il te fallait habiter Vienne, Rome ou
Saint-Pétersbourg?»
Valentine demeura d'abord silencieuse.
«Par exemple, voilŕ une étrange question. Je dirais que j'aime mieux
habiter Paris.
--Tu fais semblant de ne pas me comprendre, mais tu sais bien ce que
je veux dire.
--Oui, mon pčre, je sais bien ce que tu veux dire. Je sais que tu en
tiens pour la diplomatie. Je sais qu'il me serait fort désagréable
d'avoir trop chaud ŕ Rome, et trop froid ŕ Saint-Pétersbourg. Ce n'est
pas une vie, celle-lŕ. Tu veux donc m'exiler?
--Non, j'irai partout oů tu iras.»
Mlle de Margival était devenue pensive.
«Tu disposes de ma vie, mais si j'avais disposé de mon coeur?
--Ton coeur, tu ne connais pas cela. Le coeur, vois-tu, ma fille,
c'est la raison, c'est le devoir, c'est la vertu.
--Je crois que je le sais mieux que toi: le coeur, c'est le droit
d'aimer qui on veut.
--Tu dis des folies.»
Et M. de Margival, qui permettait bien ŕ sa fille d'ętre, çŕ et lŕ,
fantasque et volontaire, reprit despotiquement son autorité par la
force du raisonnement.
M. de Xaintrailles, déjŕ allié ŕ sa famille, était second secrétaire
d'ambassade ŕ Saint-Pétersbourg. Il était question de le nommer
premier secrétaire ŕ Rome ou ŕ Vienne.
Il n'était pas jeune, mais il possédait un demi-million; il avait de
la figure et de l'esprit; on ne pouvait donc pas trouver un mari plus
ŕ point pour une héritičre qui n'avait qu'une demi-fortune.
Mlle de Margival évoqua l'image de Georges du Quesnoy. Elle le
trouvait charmant, mais il était si jeune qu'elle ne pouvait songer ŕ
devenir sa femme avant quelques années. Et puis il n'avait ni fortune
ni position. Or elle voulait faire bonne figure dans le monde. «Et
pourtant je crois que je l'aime,» murmura-t-elle.
Valentine n'était pas précisément de la nature des anges. Née pour la
terre, elle avait un peu trop le souci des choses de la terre. Toute
jeune, elle avait vu son pčre pris aux difficultés de toutes sortes
parce qu'il se défendait contre les batailles du luxe avec une
trčs-médiocre fortune. Quoiqu'il adorât sa fille, il discutait
beaucoup avant de lui donner une robe nouvelle. Valentine aimait le
superflu, mais c'était un amour des plus platoniques. Chaque jour elle
s'indignait contre l'argent. Mignon cherchait son pays; le pays de
Valentine, c'était le luxe.
Et voici comment ces jolies bucoliques furent frappées d'un coup de
vent ŕ leur premičre aurore, sans quoi nous aurions peut-ętre retrouvé
dans le monde moderne les amours pastorales de Daphnis et Chloé.
X
L'AMOUR QUI RAISONNE
Valentine était romanesque. Tout en pleurant elle-męme son ręve
évanoui, elle songea avec une douce volupté ŕ toutes les larmes que
répandrait Georges du Quesnoy. Ne pas aimer dans le mariage, mais
savourer les larmes de l'amour, n'est-ce pas déjŕ une consolation! Il
était doux ŕ Mlle de Margival de penser que l'adoration de Georges du
Quesnoy la suivrait partout; il lui était męme doux de penser qu'il ne
pourrait ętre heureux sans elle. «Qui sait, dit-elle avec un sourire
amer, si l'amour n'est pas l'impossible? qui sait si l'amour n'est pas
un regret?»
Depuis qu'elle lisait des romans, Valentine voyait que tout finissait
mal; depuis qu'elle allait dans le monde, elle s'apercevait que les
gens mariés n'étaient pas amoureux. Les romanciers lui avaient appris
que le roman de l'amour n'a qu'un beau commencement. N'avait-elle pas
eu ce beau commencement?
«Non, dit-elle, ce n'était que le commencement du commencement.»
Un soir, en attendant M. de Xaintrailles, elle repassa les avenues du
parc oů Georges du Quesnoy avait semé tant de souvenirs. Pourquoi ne
vint-il pas ce soir-lŕ?
Elle se rappela le jour oů, lui disant adieu, elle avait penché
ingénument son front, toute perdue dans ses ręves.
Il l'avait prise dans ses bras avec un sentiment d'adoration sans
songer non plus qu'elle ŕ mal faire. Elle s'était envolée comme un
oiseau qui a peur d'ętre attrapé. Mais elle ne s'était pas envolée
bien loin et il ne l'avait pas poursuivie. C'était les amours de l'âge
d'or.
A ce charmant souvenir elle ne put s'empęcher de lui en vouloir.
«Pourquoi, dit-elle, ne m'a-t-il pas gardée sur son coeur?»
Elle avait peut-ętre raison: ce sont les hommes qui font la
destinée des femmes. Puisque Georges du Quesnoy l'aimait ardemment,
profondément, violemment, n'avait-il pas le droit, en vertu des lois
de la nature qui sont quelquefois les lois de Dieu de prendre son bien
oů il le trouvait, car, puisque Valentine l'aimait, c'était son bien.
Si le coeur de Valentine avait battu une minute de plus sur le coeur
de Georges, elle n'eűt pas si légčrement sacrifié son premier amour
qui fut son unique amour.
Certes, je ne veux pas faire le moraliste ŕ rebours; nul plus que moi
n'a le souci des grands devoirs de la vie, mais nul plus que moi ne
hait les préjugés. Il est des jours oů le grand chemin de la vie c'est
le chemin de traverse.
Le lendemain Mlle de Margival résista encore ŕ son pčre avec toutes
les mutineries d'un enfant gâté. «Que veux-tu que j'aille faire avec
ce M. de Xaintrailles?
--Ma chčre Valentine, quand on porte le nom de Margival, on ne peut
pas se mésallier. Aimerais-tu mieux épouser un homme qui n'eűt ni
titre ni nom?
--Peut-ętre, s'il était jeune comme moi.
--Tu ne dis pas ce que tu penses. Tu es fičre comme la princesse
Artaban. Si j'avais une dot sérieuse ŕ te donner, je pourrais bien te
marier ŕ un comte ou ŕ un baron sans le sou, mais tu sais que ta dot
est bien modeste, 200,000 francs ŕ peine; que veux-tu faire avec cela
par le temps qui court?
--Eh bien, deux cent mille francs, il y a de quoi vivre deux ans.
--Comme tu y vas! Et au bout de deux ans?
--Qu'importe si ta fille est bien heureuse pendant deux ans?
--Tu es folle, je veux que tu sois heureuse toujours.»
Valentine avait bien envie de dire ŕ son pčre qu'il lui serait
impossible d'ętre heureuse sans Georges du Quesnoy. Elle n'osa
pourtant point, tant elle comprit la distance qui la séparait de ce
jeune homme--sans nom, sans titre et sans fortune.--M. de. Margival
eűt l'éloquence des chiffres. Il démontra ŕ sa fille qu'il avait
toutes les peines du monde ŕ vivre sans faire de dettes au château de
Margival, oů certes on ne jetait pas l'argent par les fenętres. Celles
qui ont été élevées dans un château ne veulent pas tomber de leur
piédestal de châtelaine. Or M. de Margival prouva ŕ sa fille que, si
elle ne voulait pas épouser le comte de Xaintrailles, il serait forcé
de vendre son château et d'aller vivre avec elle ŕ Soissons de la
vie médiocre des fermiers et des commerçants qui ont fait une petite
fortune.
Valentine aimait Georges, mais son orgueil dominait son coeur. Elle
frémit ŕ l'idée de ne plus ętre châtelaine de Margival, de ne plus
monter ŕ cheval, de ne plus trôner dans le grand salon, de ne plus
poser ŕ la grille du parc pour les paysans émerveillés. Son pčre lui
fit d'ailleurs un tableau attrayant de sa vie future d'ambassadrice,
car, selon lui, M. de Xaintrailles serait nommé ministre de France
avant cinq ans. Quelle splendeur alors pour elle d'avoir le pas dans
toutes les cours étrangčres, męme ŕ la cour de France dans les jours
de congé! Elle avait déjŕ lu des romans, elle avait jugé que celles
qui sacrifient ŕ leur coeur, font le plus souvent des sacrifices en
pure perte. Voilŕ pourquoi elle se décida ŕ donner sa main, les yeux
fermés, ŕ M. de Xaintrailles.
Ce fut un coup terrible pour Georges du Quesnoy. Jusque-lŕ son amour
pour Valentine était riant et lumineux comme un rayon dans la rosée.
Il avait entr'ouvert la porte d'or des songes. Il avait retrouvé les
clefs du Paradis perdu. Ętre aimé de Valentine, tout était lŕ! Le
réveil fut le désespoir. Il alla se jeter dans les bras de son frčre
en lui disant qu'il voulait mourir.
«Mourir, lui dit Pierre, tu souffriras, mille morts et tu ne mourras
pas. Tu l'aimes donc bien?
--Si je l'aime!»
Georges ŕ moitié fou se frappait le coeur avec désespoir comme s'il
sentait lŕ tous les déchirements d'une bęte féroce. L'amour a des
dents aiguës et cruelles; s'il ne se nourrit pas de joie, il se
nourrit de douleur. La flčche des anciens était un symbole profond
comme tous les symboles de l'antiquité. On a eu beau en faire une
plaisanterie rococo de plus en plus démodée, la flčche frappe
toujours, et il n'est pas un amoureux jaloux ou désespéré qui ne la
sente ŕ tout instant. On a remplacé l'image par un coeur brisé, ce qui
n'est pas une image vraie, puisque le coeur n'est pas un vase de Chine
ni une coupe de Sčvres. Mais, par malheur, tout est de convention dans
l'art de parler et d'écrire, męme dans les expressions de la passion,
de la douleur et du désespoir.
XI
DESESPERANZA
Et comment Georges apprit-il son malheur? Pendant quelques jours il
chercha Mlle de Margival dans le Parc aux Grives sans la rencontrer.
Puisqu'elle était au château, pourquoi ne se promenait-elle plus dans
le parc? Il envoya encore un bouquet, mais, cette fois, la paysanne
qui le portait, toute rusée qu'elle fűt, ne put parvenir jusqu'ŕ
Valentine. Une grande tristesse s'empara du coeur de Georges. Avec la
jeune châtelaine il se sentait le courage d'arriver ŕ tout, mais sans
elle toutes ses aspirations tombaient ŕ ses pieds. D'oů venait qu'elle
se cachait pour ne plus lui parler? Il n'avait pas perdu toute
espérance, parce qu'il s'imaginait entrevoir Mlle de Margival ŕ
travers les rideaux des fenętres; mais un jour, il comprit que tout
était fini, parce qu'une femme de chambre du château, répondant ŕ une
de ses questions, lui dit ŕ brűle-pourpoint: «Vous ne savez donc pas
que nous nous marions dans trois semaines?»
Ce fut un coup de foudre. Mlle de Margival ne lui avait pas donné le
droit de lui demander des explications. Il s'éloigna en toute hâte et
il éclata en fureur contre sa destinée. Il interpella le ciel et la
terre, le soleil et les arbres, les nuages et les fleurs, nagučre
témoins de ses joies amoureuses. Il voulut mourir aux pieds de
Valentine; il voulut tuer son rival. Vous voyez d'ici toutes les
charmantes extravagances d'un amoureux de vingt ans.
«Oui, disait-il, je tuerai cet homme qui me vole mon bonheur.»
Mais tout ŕ coup il vit se dresser devant lui la guillotine. Il se
demanda si déjŕ la prédiction allait s'accomplir.
«Eh bien, dit-il, qu'elle se marie! cela ne m'empęchera pas de devenir
son amant.»
Le soir męme il apprit que Valentine venait de partir pour Paris; on
devait se marier au château, mais il fallait bien aller commander la
robe d'épousée et la couronne de fleurs d'oranger.
Le mariage fit grand bruit dans tout le pays, parce que la mariée
était belle et qu'elle épousait un quasi-ambassadeur. Tout le monde
la trouvait bien heureuse, mais elle-męme, quoiqu'elle fît du péché
Orgueil une de ses vertus, était-elle bien heureuse?
Georges du Quesnoy ne le croyait pas.
Il ne voulut pas ętre témoin de la cérémonie. Trois jours avant les
noces il partit pour Paris, saris en demander la permission ŕ son
pčre, mais non sans avoir dit adieu ŕ Valentine dans un sonnet, cette
fois rimé par lui, oů il annonçait ŕ la jeune fille que le mariage
n'était que la préface de l'amour et que le mari n'était que le
précurseur de l'amant. Ce fut le trait du Parthe. Je regrette bien que
ce chef-d'oeuvre ne soit pas venu jusqu'ŕ moi pour vous l'offrir ici,
mais il paraît que Valentine, qui avait déjŕ vu la lune rousse avant
le mariage, le noya de ses larmes et le jeta au feu,--aprčs l'avoir
lu,--pour voir une derničre fois briller la flamme de son premier
amour, car sans le savoir elle avait aimé Georges du Quesnoy.
Avant d'écrire ce sonnet, Georges avait vingt fois commencé et
recommencé une lettre tour ŕ tour terrible et suppliante, oů son amour
et son coeur éclatait en sanglots, pendant que son esprit éclatait en
sarcasmes. Mais, tout bien considéré, quoique cette lettre eűt des
accents d'éloquence, comme il avait l'esprit critique, il la trouva
ridicule.
«Non, s'écria-t-il, il ne faut pas que Valentine garde de moi un
mauvais souvenir.»
Voilŕ pourquoi il avait rimé un sonnet moqueur.
Dčs que Georges fut ŕ Paris, l'amour et la jalousie lui furent plus
terribles. La grande ville indifférente ne pouvait apaiser ni son
coeur ni son esprit. Paris n'a de distractions que pour les initiés.
Les arrivants n'y sont pas chez eux, ŕ moins qu'ils ne soient de la
franc-maçonnerie, de ceux qui s'amusent partout.
Georges eut hâte de retourner ŕ Landouzy-les-Vignes, oů du moins son
frčre était sympathique ŕ ses angoisses.
Et, d'ailleurs, il voulait ętre spectateur ŕ son propre drame.
Pourquoi n'irait-il pas ŕ la messe de mariage, pour voir la figure que
ferait devant l'autel cette belle Valentine qui lui avait promis le
bonheur?
Et quelle figure ferait-elle en passant, devant lui? car, sans męme le
regarder, elle le verrait.
Et puis il irait dans la sacristie pour la féliciter,--comme tout le
monde. Peut-ętre oserait-elle le présenter ŕ son mari?
«Ah! mon cher Pierre, dit-il en embrassant son frčre, figure-toi que
plus je m'éloignais, et plus mon chagrin était violent. Mon coeur
m'abandonnait en route; j'étais comme une âme en peine. Je suis
revenu, tu me consoleras,--si je puis ętre consolé.
--C'est la douleur qui tue la douleur. A force de pleurer, on épuise
la source des larmes. Aussi ce n'est pas moi qui te conseillerai «de
jeter un voile lŕ-dessus.» Il faut oser aborder son malheur de front;
il faut s'y heurter comme dans une attaque ŕ fond de train. Tiens,
pour commencer, je vais te jeter en pleine poitrine, comme une arme de
combat, la lettre de mariage.»
Pierre passa ŕ Georges une lettre imprimée dans la plus belle anglaise
des temps modernes:
_«M. le comte de Margival a l'honneur de vous faire part du mariage de
Mlle Madeleine-Valentine de Margival avec M. le comte François-Xavier
de Xaintrailles, secrétaire d'ambassade;_
_«Et vous prie d'assister ŕ la bénédiction nuptiale, qui sera donnée en
l'église de Margival le 27 septembre 186..»_
Dans le męme pli, naturellement, se trouvait la lettre de faire-part
du comte de Xaintrailles. Georges prit cette seconde lettre, la
déchira et la piétina.
«Voilŕ ce que je ferai de lui un jour, dit-il dans sa colčre.
--Tu ferais peut-ętre mieux de commencer par lŕ, dit froidement
Pierre; c'est lui qui vient te voler ton bonheur, va lui en demander
raison. Si tu le tues, elle ne l'épousera pas.»
Et comme Georges saisissait cette idée avec passion, Pierre jeta tout
de suite de l'eau sur le feu.
«Non, ne fais pas cela, parce qu'on dirait que tu es fou, parce que tu
ne trouverais pas de témoins dans ce pays-ci. Et puis, aprčs tout, le
vrai coupable, c'est Valentine. Le comte de Xaintrailles ne te doit
rien, tandis qu'elle te doit tout, puisque tu l'aimes.»
XII
QU'IL NE FAUT PAS TOUJOURS ALLER A LA MESSE
Georges entraîna Pierre ŕ la messe de mariage.
Ils arrivčrent de bonne heure pour ne pas manquer le passage de la
mariée.
Mais la mariée, toute ŕ sa beauté, ne voyait qu'elle-męme. Elle était
rayonnante. C'étaient les vingt ans couronnés de fleurs d'oranger.
Rien dans ses yeux ni sur ses lčvres ne révélait que son coeur eűt des
remords; elle semblait obéir ŕ ce dicton: «Que le mariage est le plus
beau jour de la vie.»
«La cruelle!» dit Georges en la voyant passer.
Il était si agité qu'il sortit de l'église. Que fit-il? Il fuma une
cigarette. Aujourd'hui, dans tous les moments tragiques, on commence
par fumer une cigarette.
«Que m'importe, reprit-il, qu'elle dise devant Dieu oui ou non ŕ cet
homme, puisqu'elle ne m'aime pas? Et, d'ailleurs, puisqu'elle a passé
par la mairie, elle est ŕ tout jamais Mme de Xaintrailles. C'est égal,
elle ne portera pas ce soir son sourire au lit nuptial, car elle ne
l'aime pas et elle ne l'aimera jamais.»
Quoique Georges fűt ŕ moitié fou de douleur et de désespoir, il
n'avait pourtant pas le dessein de poignarder l'épousée. Mais il
voulait, avant la fin de la journée, aller jusqu'ŕ elle, non pour
l'injurier, mais pour lui montrer sa pâleur. Il lui dirait: «Vous
m'avez tué, et vous riez!»
Mais comment arriver jusqu'ŕ elle? Il ne voulait pas faire un
scandale; il avait le respect de son pčre, comme il avait la peur du
ridicule.
Aprčs la messe, quand la mariée monta dans le coupé du marié, avec la
mčre de M. de Xaintrailles, il s'approcha d'abord; mais la haie des
curieux le tint ŕ distance. Il s'en retourna désespéré avec son frčre,
ruminant toujours son dessein de voir face ŕ face Valentine.
Il ne fut pas plutôt de retour ŕ Landouzy-les-Vignes, qu'il revint
sur ses pas, décidé, coűte que coűte, ŕ s'aventurer dans le
Parc-aux-Grives.
Aussi, ŕ son retour ŕ Margival, il franchit le saut-de-loup du parc,
comme si Valentine l'attendait.
Mais Valentine ne vint pas.
Il vit passer dans les avenues les rares invités parisiens en
promenade plus ou moins sentimentale.
Comme la mariée n'était pas avec eux, il se flatta de cette idée
qu'elle n'avait pas voulu profaner le souvenir de leur amour en
amenant le mari lŕ oů l'amoureux avait passé.
Valentine n'était pas si poétique, quoiqu'elle fűt romanesque. Une
jeune mariée a toujours un peu la fičvre; Valentine avait passé par
tant d'émotions de vanité, de coquetterie, d'amour perdu et retrouvé,
qu'elle resta toute l'aprčs-midi au salon, ŕ faire la causerie avec
les provinciales émerveillées et les Parisiennes revenues de tout.
Le dîner dura trois heures comme un vrai dîner de province, quoique la
marquise eűt donné des ordres pour que ce fűt un dîner napoléonien.
Aprčs le dîner, un orchestre ŕ peu prčs improvisé appela les danseuses
sous les armes.
M. de Xaintrailles, qui n'avait pu s'arracher ŕ cette fęte, quoiqu'il
eűt bien voulu emmener sa femme aprčs la messe, ouvrit le bal avec la
mariée. Mme de Sancy, qui faisait vis-ŕ-vis avec un des témoins, le
vicomte Arthur de la--, dit étourdiment:
«Vous ętes témoin du marié; eh bien, vous serez témoin qu'il sera
marri.
--Je n'en doute pas, dit l'ambassadeur ŕ Constantinople, puisque vous
lui avez donné la plus belle fille du monde.
--Elle est arričre-petite-cousine de Mme de Montespan. Je crois
qu'elle est bien de la męme famille.
--Prenez-y garde. Lauzun disait de Mme de Montespan: «Elle est de
celles-lŕ ŕ qui il faut deux hommes pour avoir raison d'elles, un le
matin et un le soir.
--Ah! si Valentine avait épousé Georges du Quesnoy!»
Et, tout en dansant, la comtesse de Sancy raconta l'histoire, qu'elle
savait fort mal, des bucoliques de Georges et de Valentine.
M. le vicomte de la--, un Lamartine en prose, reconduisit sa danseuse
en lui disant: «Ne craignez rien, je mettrai les deux mondes entre
la mariée et son amoureux. Je vais prier le ministre d'envoyer M. de
Xaintrailles ŕ Rio ou ŕ Téhéran, car je ne veux pas ętre témoin....»
Le témoin du comte s'arręta sur ce mot.
XIII
LE DERNIER COUP DE MINUIT
A minuit, M. de Xaintrailles trouva qu'il avait bien assez dansé. Je
me trompe: que Valentine avait déjŕ trop valsé. Il tenta de lui faire
comprendre que l'heure était venue.
«L'heure de quoi? dit Valentine en se rembrunissant; allez-vous déjŕ
faire le mari?
--Et vous, n'allez-vous pas faire l'enfant?»
Valentine s'indigna, pleura, et ... continua ŕ valser.
A une heure, nouvelle pričre,--nouvelle rébellion.
A deux heures, le combat finissant faute de combattants, il fallut
enfin s'expatrier du salon pour monter ŕ la chambre nuptiale.
Valentine pleurait de vraies larmes. Qu'est-ce que le lit nuptial,
sinon le tombeau de la jeune fille?
Comme Valentine n'avait plus sa mčre, elle était accompagnée de Mme de
Sancy.
Vainement le marié avait dit ŕ la comtesse: «Ne vous inquiétez pas, je
connais les femmes.»
La comtesse avait répliqué: «Vous connaissez les femmes et les filles,
mais vous ne connaissez pas les jeunes filles.»
Il s'était résigné ŕ subir cette suivante improvisée, qui menaçait de
mettre deux points sur les i.
«Eh bien, Dieu merci! dit-elle quand elle fut seule avec Valentine;
vous n'avez pas perdu votre temps, ce soir: tudieu! vous valsiez comme
une comčte.
--Oui, et vous vous figurez, peut-ętre que je me suis beaucoup amusée.
Point du tout.
--Pourquoi?
--Parce que j'ai mes idées sur le mariage. Voyez-vous, le mariage est
une fęte comme toutes les fętes, mais une fęte sans lendemain.
--Vous ętes une hérésiarque! je vous ferai brűler en effigie.
--Je voudrais bien vous y voir.
--Mais, ma chčre enfant, je m'y suis vue.
--Vous allez me raconter vos impressions de voyage dans ce pays que je
ne connais pas?
--Nous n'avons pas le temps.
--Comment! nous n'avons pas le temps! Nous avons jusqu'ŕ demain matin.
Vous allez vous coucher avec moi.»
Mme de Sancy leva les bras au ciel.
«Si je faisais cela, le comte me jetterait par la fenętre. Vous me
faites poser, d'ailleurs; vous savez bien que vous ętes mariée le jour
et la nuit.
--La nuit? jamais!
--Taisez-vous, belle sournoise, on n'est pas revenue du Sacré-Coeur
sans savoir que le lit nuptial est le lit nuptial.»
Et, pour tempérer cette parole, Mme de Sancy ajouta bien vite: «Tout
ce que l'Église ordonne est sacré.»
Tout en parlant, la comtesse avait commencé ŕ déshabiller Valentine;
les cheveux étaient dénoués, la robe jetée sur un fauteuil, le corset
de satin ne tenait plus que par une agrafe.
«N'est-ce pas que j'étais mal habillée? dit Valentine en retenant
l'autre agrafe. Ce Worth n'a pas le sens commun; il dit que le jour
de ses noces une femme est encore une jeune fille; il m'a surchargée!
C'est ridicule, je lui avais demandé deux doigts de satin sur les
épaules, il m'en a mis trois doigts: pourquoi pas une robe montante?»
Mme de Sancy se mit ŕ rire.
«Voyons, ma chčre, il fallait bien laisser quelque chose pour votre
mari.»
Valentine se laissa tomber de son haut sur un fauteuil.
«Ah çŕ, décidément le mari a donc des droits superbes, dit-elle avec
un effroi non joué.
--Oui, écoutez plutôt.»
En ce moment on entendit frapper trois coups.
Valentine voulut cacher son émotion ŕ Mme de Sancy, qui lui avait
appris ŕ rire de tout.
«Frappez, on ne vous ouvrira pas, dit-elle, sans pouvoir toutefois
lever la voix.
--Tout ŕ l'heure, ajouta Mme de Sancy.
--Jamais, reprit Valentine.»
Mais le corset était dégrafé; Mme de Sancy avait dénoué le dernier
jupon: elle entraîna Valentine vers le lit.
Cette fois, la jeune mariée prit son rôle au tragique et se remit ŕ
pleurer.
«Ce n'est pas ma mčre qui me trahirait ainsi,» dit-elle.
Valentine était plus belle encore dans les larmes, sous sa chemise
transparente, ŕ demi voilée par ses cheveux.
«Ma foi, sauve qui peut,» s'écria Mme de Sancy.»
Et la comtesse s'envola par une porte dérobée.
Elle reparut presque aussitôt. «Je suis bonne,» reprit-elle. Et
elle tira le verrou, pour que le comte pűt entrer, jugeant bien
que Valentine n'oserait pas lui ouvrir la porte. Aprčs quoi, elle
redisparut comme une ombre.
Valentine n'eut pas le temps de faire un monologue. Le comte était
entré. Il s'avança doucement, vers elle, mais elle se jeta sous le
rideau.
Il se passa une scčne qui décida de la destinée de ce mariage. Si le
comte avait été décidément un homme d'esprit, il n'eűt pas joué ŕ
l'esprit cette nuit-lŕ; il se fűt montré amoureux de Valentine,
elle se fűt brűlée au feu; mais quand il la vit en rébellion, se
barricadant dans sa vertu et dans sa pudeur, au lieu de la battre par
les vraies armes, par la passion et par la force, il escarmoucha ŕ
traits d'esprit. Si bien que Valentine fut de plus en plus indignée.
A un moment de paroxysme, elle se précipita du lit ŕ la fenętre, le
menaçant de se jeter du haut de son balcon, s'il ne se hâtait pas de
rentrer dans sa chambre.
M. de Xaintrailles continua ŕ rire.
«On a joué cela au Gymnase, dit-il, la comédie s'appelle: _Une femme
qui se jette par la fenętre._»
Quoique Valentine n'eűt pas sérieusement le dessein de se jeter par la
fenętre, elle ouvrit la croisée.
«Georges! Il est lŕ! s'écria-t-elle en se penchant sur le balcon.»
Oui, Georges. Il était lŕ. Il avait toute la nuit erré dans le parc,
un revolver ŕ la main, de plus en plus jaloux, de plus en plus
furieux, en écoutant les violons et la joie des convives. Il avait
assisté, en spectateur invisible, au commencement et ŕ la fin de la
fęte. Tous les convives étaient partis, mais il était demeuré, comme
s'il dűt ętre encore le spectateur de la derničre scčne.
Il ne lui avait pas été trčs-facile de s'approcher du château,
quelques convives étant sortis çŕ et lŕ pour fumer; sans parler des
domestiques qui allaient se conter sous les grands arbres les mystčres
de la journée. Mais il connaissait bien le parc et il avait l'art de
s'y cacher, dčs qu'il craignait d'ętre surpris.
Cette fois il était bien seul. Il avait suivi, ŕ travers les rideaux
de mousseline brodée, toutes les marches et contre-marches de la
chambre nuptiale; vraies ombres chinoises qui ne l'amusaient pas du
tout.
Au moment oů Valentine ouvrit la fenętre, il se demandait s'il
n'allait pas, pour que sa folie fűt plus accentuée et marquât mieux
dans les reportages des journaux, escalader le balcon de la chambre
nuptiale, pour se tirer un coup de revolver sous les yeux męmes de Mme
Valentine de Xaintrailles.
Il lui semblait déjŕ entendre par delŕ le tombeau le bruit
quasi-scandaleux de sa mort. Je dis le bruit quasi-scandaleux; car on
ne manquerait pas de dire que s'il s'était tué pour Valentine, c'est
qu'elle lui avait donné le droit de se tuer. Il y avait donc un peu de
fatuité et un peu de mensonge dans cet acte de désespoir. Il n'était
pas fâché qu'on soupçonnât, non pas la femme de César, mais la femme
du secrétaire d'ambassade. Disons-le pourtant ŕ la gloire de sa
passion: c'était l'amour lui-męme qui le poussait ŕ cette folie.
Ne plus pouvoir aimer, c'est la mort: il voulait mourir.
Tout ŕ coup Valentine poussa un cri, et se rejeta sur M. de
Xaintrailles, qui était venu ŕ elle.
«Qu'y a-t-il? s'écria le secrétaire d'ambassade.
--Ce qu'il y a!» dit-elle en le repoussant
En cet instant un coup de revolver retentit.
Georges du Quesnoy ne se tua pas du coup. Le cri d'effroi que jeta
Valentine le troubla profondément, sa main vacilla, le coup partit,
mais la balle qui devait frapper au coeur ne brisa qu'une côte.
Georges chancela, et tomba, ne sachant pas encore s'il était tué.
Le sang jaillit abondamment; il se releva et chercha son revolver pour
s'achever; mais il avait fait quelques pas avant de tomber; il ne le
trouva pas. «Enfin, dit-il, en voyant son sang, c'est peut-ętre assez
pour mourir.»
Il retomba sur l'herbe, tout en regardant la fenętre de Valentine.
Il espérait qu'elle viendrait sur le balcon, par curiosité sinon par
amour.
Ce fut bien mieux. Cette mariée toute déshabillée, qui n'était plus
qu'ŕ un pas du lit nuptial, passa en toute hâte une robe ouverte, jeta
sur elle un manteau, et, quoi que fît son mari pour l'arręter, elle
courut au jardin, n'écoutant que son coeur, se croyant une héroďne
de roman, bravant tout, les devoirs de la jeune fille et de la jeune
femme.
M. de Xaintrailles avait couru aprčs elle, tout affolé de ce coup de
théâtre imprévu; mais elle allait plus vite que lui, connaissant mieux
le chemin dans la nuit.
Quand elle fut devant Georges du Quesnoy, elle se pencha sur lui,
comme pour le secourir, ne trouvant que ce seul mot:
«Georges! Georges!
--Ah! que je suis heureux de vous revoir avant de mourir! dit Georges;
je voulais frapper au coeur, votre voix a détourné le revolver, mais
la blessure est mortelle.
--Non, Georges, vous ne mourrez pas.
--Je veux mourir! si je me suis manqué, je m'achčverai, je retrouverai
mon revolver.»
Et sa main cherchait toujours dans l'herbe.
«Dieu soit loué! s'écria Valentine, je l'ai trouvé votre revolver.»
Le comte, qui poursuivait sa femme, la surprit un revolver ŕ la main.
«Valentine!» cria-t-il avec effroi.
XIV
LA LUNE DE MIEL
Voici quelle fut la fin du premier acte de ce drame en trois actes,
qui avait commencé si gaiement, malgré les prédictions de Mme de
Lamarre.
Le médecin de Margival fut appelé. Il jugea que Georges ne pouvait
retourner chez son pčre; il lui donna l'hospitalité.
M. de Xaintrailles avait arraché le revolver des mains de sa femme. La
femme du monde avait reparu dans la jeune fille romanesque. Sur les
pričres de son pčre, elle s'était résignée ŕ ses devoirs de fille,
sinon d'épouse.
Mais ce fut en vain qu'on lui représenta que «l'escapade» de Georges
était une action démodée, męme sur les théâtres de mélodrame: elle
persista dans son for intérieur ŕ trouver que c'était l'héroďsme de
l'amour.
Je ne dirai rien de la nuit nuptiale, qui ne commença pas męme au
chant du coq. Aussi Mme de Sancy disait-elle le soir que le coq
n'avait pas chanté trois fois ŕ cause de la catastrophe.
Le lendemain, M. de Xaintrailles brusqua le départ ŕ la fin du
déjeuner. Il avait été nommé la veille premier secrétaire ŕ Rome. Il
emmena Valentine ŕ Paris, disant qu'il partirait pour Rome ŕ quelques
jours de lŕ.
A l'heure męme du départ, la jardiničre du château portait un
admirable bouquet ŕ Georges du Quesnoy.
«D'oů viennent ces fleurs? demanda-t-il en cachant deux larmes.
--Vous le savez bien,» répondit la jardiničre en s'esquivant.
Georges baisa le bouquet, en s'imaginant qu'il avait été cueilli par
Valentine elle-męme, dans les sentiers oů ils s'étaient tant de fois
promenés ensemble.
«Ainsi va le monde, dit le médecin, qui savait un peu cette histoire;
c'est peut-ętre vous qu'elle aime, et c'est un autre qui l'emporte.»
Quand Georges apprit que les mariés avaient quitté le château de
Margival, il voulut retourner chez son pčre; mais le médecin le garda
pendant les quelques jours de fičvre. Son frčre, venu le premier jour,
ne le quittait pas et lui parlait de Valentine.
«Ne te désole pas, le comte a beau l'emmener ŕ Rome, elle te
reviendra, par un chemin ou par un autre.»
Un mois aprčs, Georges était sur pied, se trouvant tout ŕ la fois
héroďque et ridicule.
C'était au temps oů l'École de droit rouvre ses portes. M. du Quesnoy
n'avait pas eu le courage de brusquer son fils aprčs le coup de
revolver, mais il lui fit comprendre que l'heure de la sagesse était
venue.
«Tu n'étais qu'un enfant, tu vas devenir un homme. Quand tu seras
avocat, la Cour d'assises te montrera tous les jours oů vont ceux que
ne contient pas le devoir.»
Georges ne voulut pas repartir pour Paris sans aller ręver une
derničre fois dans le Parc-aux-Grives. Il ne voulut pas s'y hasarder
en plein jour. On savait dans tout le pays l'histoire du coup de
revolver, il craignait d'ętre surpris en flagrant délit de souvenirs
et regrets.
Il y passa une heure au clair de la lune, en se demandant si c'était
la lune de miel pour Valentine.
Comme il cherchait les roses des mains plutôt que des yeux, car la
nuit était profonde, il vit passer, sous les arbres noirs, cette
adorable vision blanche qui avait enchanté son coeur.
Il s'élança pour la saisir, mais elle disparut comme le fantôme d'un
ręve. «Et pourtant, se disait-il, je ne suis pas un visionnaire.»
Sans doute, dans son voyage ŕ Rome, Valentine regretta plus d'une fois
d'avoir écouté son orgueil plutôt que son coeur. Ce fut en vain que le
secrétaire d'ambassade la berça dans toutes les vanités du titre et de
la fortune. Elle ne vit pas se lever la lune de miel. «Ah! dit-elle un
jour, si Georges était second secrétaire d'ambassade!»
C'était aprčs le premier quartier de lune rousse.
Que devint Valentine ŕ Rome? quelles furent les joies et les peines de
ce mariage sans amour? Valentine n'aimait que le titre de son mari, le
comte n'aimait que la beauté de sa femme: deux vanités. On ne bâtit
pas le bonheur avec ce point d'appui.
Ils commencčrent par éblouir les curieux du Corso par le faste de
leur équipage et les modes de Paris. Mais au bout de huit jours ils
s'ennuyčrent de poser.
Valentine s'amusa huit jours encore des hommages des princes romains,
des marquis désoeuvrés et des monsignors curieux, aprčs quoi elle se
mit ŕ lire des romans.
Un soir, en fermant un volume de George Sand, elle murmura: «Le vrai
roman je l'ai commencé dans le Parc-aux-Grives.»
LIVRE II
LES MAINS PLEINES D'OR
Si tu ne tues pas ton amour, ton amour te tuera.
GÉRARD DE NERVAL.
Regarde ton âme pour voir ta conscience.
SAADI.
I
LE PORTRAIT FATAL
Six semaines aprčs le mariage du comte de Xaintrailles, Georges reçut,
non sans quelque surprise, une photographie représentant Valentine en
pied avec ces deux signatures: Carolus Duran et Bertall.
C'était donc une photographie d'aprčs un portrait.
Qui lui avait envoyé cette figure? Il étudia l'écriture de
l'enveloppe; c'était une écriture libre et emportée. Valentine ne lui
avait jamais écrit; mais, plus d'une fois dans leurs promenades,
elle avait ébauché des phrases sur le sable; il ne douta pas que le
portrait ne lui fűt envoyé par la jeune femme.
Pourquoi? se demanda-t-il.
Un peu plus, il partait pour Rome.
Quelques initiés ont vu ce portrait ŕ l'emporte-pičce, de Valentine de
Margival par Carolus Duran. C'était quelques jours aprčs son mariage.
Le comte de Xaintrailles avait voulu que M. de Margival ne perdît pas
tout ŕ fait sa fille; Carolus Duran, qui est un Espagnol des Flandres
françaises, réussit comme par merveille ŕ représenter la femme
extérieure et la femme intérieure, la sculpturale beauté, l'ardente
curiosité, la despotique coquetterie. Il peignit la future comtesse de
Xaintrailles en pied sur un fond rouge, comme il a peint depuis une
princesse Bonaparte. S'il n'a pas exprimé toutes les nuances de ce
caractčre mobile, il a imprimé sur la toile tout l'éclat de la beauté,
tout le charme du sourire, toute la fierté du regard, tempérée par les
grands cils voluptueusement retroussés. On n'a jamais vu de si beaux
yeux nageant dans le bleu.
Comme toutes les beautés, celle de la comtesse de Xaintrailles
était discutable, selon qu'elle fűt dans le repos ou dans l'action.
Quoiqu'elle fűt souverainement intelligente, on peut dire qu'elle
sommeillait souvent les yeux ouverts. La réflexion éteignait ses yeux
et masquait le charme de sa bouche. Pour qu'elle fűt belle, il fallait
donc que sa figure fűt éclairée par le rayonnement. Alors, il
n'y avait qu'ŕ mettre un point d'admiration. Mais si la figure
s'endormait, les yeux voilés, la bouche close, on avait le temps de
remarquer que sa peau n'avait ni le duvet de la pęche ni l'éclat «des
roses et des lys». La chair était trop brune. On pouvait remarquer
aussi que la figure était un peu courte quand le sourire n'entrouvrait
pas la bouche.
Valentine savait bien cela, aussi avait-elle l'habitude, quand elle
était seule, de lire, de dessiner, de faire de la tapisserie, devant
sa psyché ou devant un miroir, car dčs qu'elle s'apercevait que sa
figure «tombait», elle la relevait soudainement. C'était le coup
d'éperon donné ŕ son cheval attardé.
Ce portrait fut fatal ŕ Georges. Il le regardait matin et soir avec
adoration et avec colčre. C'était l'éternelle tentation qui devait le
décourager ŕ jamais. C'était le souvenir sans l'espérance, c'était
l'amour sans la volupté, c'était le battement de coeur sans
l'étreinte.
II
COMMENT GEORGES DU QUESNOY ÉTUDIA LE DROIT
Quand Georges du Quesnoy fît son entrée dans le pays latin, c'était en
l'une des années les plus prospčres du second Empire. Tout le monde
avait cent mille livres de rente. Il était impossible d'aller aux
Champs-Élysées oů au Bois de Boulogne sans ętre mordu au coeur du
péché d'envie, en voyant s'épanouir aussi follement la haute vie
parisienne. Naturellement Georges se dit: «Pourquoi n'aurais-je pas ma
part du festin?»
Il excusa presque Valentine d'avoir donné sa main au comte de
Xaintrailles. Il comprit que la société dans ses exigences condamne
les belles femmes ŕ aller oů est la fortune. On n'enchâsse pas les
diamants dans du cuivre.
Chaque fois que Georges était venu au spectacle du Paris mondain, il
rentrait chez lui avec la rage dans l'âme. Il habitait une petite
chambre de vingt francs par mois, qui pouvait faire aimer le travail,
mais qui ne pouvait faire aimer la vie. C'était ŕ l'hôtel du Périgord,
rue des Mathurins; mais on n'y mangeait jamais de truffes. Quoique
Georges ne fűt pas habitué aux lits capitonnés, il n'était pas content
du tout dans ce lit de noyer traditionnel oů cinq cents étudiants
s'étaient endormis avant lui, sans autre ambition que de passer
leurs examens. Aussi, Georges ne fit pas un long séjour ŕ l'hôtel du
Périgord, se risquant déjŕ ŕ sauter par-dessus les limites de son
budget. Son pčre, en ne lui donnant que deux mille francs par an,
lui réservait pour des temps meilleurs le revenu de sa part dans la
fortune de sa mčre: environ cinquante mille francs. Donc, s'il avait
beaucoup de jeunesse ŕ dépenser, il n'avait pas beaucoup d'argent.
Avec deux mille francs on peut encore vivre studieusement dans le pays
latin, mais ŕ la condition de ne pas passer l'eau, tandis qu'avec deux
mille francs sur les boulevards on ne fait que deux bouchées.
Par malheur Georges du Quesnoy passait l'eau; il était de ceux qui
s'échappent du devoir comme les enfants qui s'échappent de leur
lisičre, sauf ŕ faire la culbute. Il ne se croyait pas né pour vivre
dans les infiniment petits. Il avait horreur de l'horizon bourgeois,
disant qu'il y mourrait d'ennui.
Dčs son arrivée ŕ Paris, il s'était résigné ŕ vivre mal six jours
de la semaine, sauf ŕ vivre bien le dimanche. Peu ŕ peu, comme les
ivrognes, il avait fait le lundi, puis le mardi, puis le mercredi,
puis le jeudi, puis le vendredi, puis le samedi. Non pas qu'il se fűt
mis ŕ boire au cabaret du coin, mais au fond c'était la męme chose:
le jeu de dominos au café, la Closerie des lilas, Mabille, l'Élysée,
Valentino, enfin les coulisses des petits théâtres oů il avait
pénétré grâce ŕ sa bonne mine et ŕ son esprit. En un mot, la vie des
désoeuvrés. Il fut bientôt ŕ bout de ressources, mais il connaissait
déjŕ l'art de faire des dettes: la dette ouverte et la dette
insidieuse.
Georges commença par se dire qu'il pouvait bien s'emprunter ŕ lui-męme
un billet de mille francs par an. Une fois sur cette pente, il marcha
vite; il prit une chambre de soixante-quinze francs par mois ŕ l'hôtel
Voltaire, et commença ŕ passer l'eau pour aller dîner avec quelques
amis de collčge qui vivaient de l'autre côté.
L'étudiant qui ne reste pas fidčle au pays latin est un étudiant
perdu. Si le Paris du plaisir entraîne le Paris de l'étude, les
meilleures résolutions s'évanouissent; le désoeuvrement frappe
l'esprit; les droits de la vie s'imposent avant les droits du travail.
Georges continua ŕ étudier une heure par jour, mais le reste du temps,
il s'amusa.
«Ah! si j'avais connu Paris! disait-il souvent, Valentine ne m'eűt
pas échappé. Au lieu de lui faire des phrases sentimentales dans le
Parc-aux-Grives, je lui eusse peint le tableau d'une vie ŕ quatre
chevaux ŕ travers les folies parisiennes. Elle n'eűt pas résisté.
Mais, comme un imbécile, je lui faisais pressentir que, si elle
m'épousait, nous repasserions par les moeurs de l'âge d'or. C'était
enfantin!»
Déjŕ Georges ne songeait plus qu'aux chemins de traverse; il prenait
en pitié ses camarades d'école, qui se promettaient ŕ leur tour de
devenir avocats de province et d'épouser quelque fille de notaire de
campagne, pour mener une existence ŕ six, huit ou dix mille francs par
an.
«J'aimerais mieux me faire enterrer tout de suite!» disait Georges
d'un air hautain.
Mais comment faire pour avoir les cent mille livres de rente d'un
Parisien ŕ la mode? Georges n'avait pourtant pas de goűt pour la
banque.
«Qui sait? disait-il, ne voulant pas désespérer; il y a des hasards
heureux. Je suis beau, ne puis-je pas faire un beau mariage?»
Mais il aimait toujours trop Valentine pour penser sérieusement ŕ une
autre femme. Il se consolait bien çŕ et lŕ avec quelque consolatrice
du pays latin; mais ce n'était que des quarts d'heure d'amour.
Il se levait ŕ midi sous prétexte qu'il se couchait aprčs minuit. Il
allait étudier au café en compagnie de sa voisine, qui lui répondait
politique quand il lui parlait amour. Il admirait beaucoup Lycurgue
en fumant ŕ la Closerie des lilas. Il vantait, aprčs dîner, le brouet
lacédémonien et déclamait contre l'argent en pensant qu'il avait des
dettes.
Çŕ et lŕ il était allé ŕ l'École de droit; une fois on lui avait parlé
_mur mitoyen_: il était rentré en toute hâte pour redire sa leçon ŕ sa
voisine.
Une autre fois il avait rencontré sur le seuil de l'École de droit une
fille d'Čve qui cherchait son chemin.
«Oů allez-vous?
--Je ne sais pas.
--C'est mon chemin, nous ferons route ensemble.»
Et ils étaient allés.
Aussi Georges du Quesnoy passa son premier examen comme Louis XIV
passa le Rhin. Ses ennemis, les professeurs de droit, ne réussirent
pas ŕ le battre avec leur grosse artillerie. Il leur fit un discours
sur la peine de mort en matičre politique, en homme qui avait
profondément étudié la question. Un des trois oracles s'endormit,
le second éclata de rire, le dernier essuya une larme: total, trois
boules rouges.
Dans le tohu-bohu amoureux du quartier latin, Georges du Quesnoy avait
oublié son pays--le pays de sa mčre.--Les roses qu'il avait cueillies
sur la tombe trop tôt ouverte, les baisait-il encore d'une lčvre
respectueuse? La vie était devenue pour lui un bal masqué, un carnaval
sans fin, presque une descente de Courtille; il allait sans détourner
la tęte, enivré par toutes les ardentes folies de la premičre
jeunesse, jetant son coeur comme son argent--par la fenętre—-ŕ tous
les hasards de l'amour.
On se demanda bientôt comment ses maîtresses avaient de si belles
robes; on finit par se demander pourquoi il était si bien chaussé et
pourquoi il n'allait jamais ŕ pied. O scandale inouď, une coquine ŕ
la mode l'amena un jour ŕ l'École de droit dans une Victoria ŕ deux
chevaux! Qui payait la coquine? ce n'était pas lui; qui payait les
chevaux? ce n'était pas la coquine. Donc Georges du Quesnoy promenait
sans vergogne, ŕ deux chevaux, son déshonneur. Le matin, entre onze
heures et midi, on reconnaissait encore l'étudiant au café Voltaire,
ou au café de Cluny; déjeunant d'une simple tasse de chocolat, mais le
soir entre onze heures et minuit, il changeait ses batteries: on
le rencontrait sur le boulevard au sortir des théâtres méditant un
souper, ŕ la _Maison d'or_ ou au _Café du Helder_.
Vous me saurez gré de ne pas vous conter, le mot ŕ mot de cette
existence ŕ la dérive qui est aujourd'hui fort commune ŕ Paris pour
les étudiants qui ont de l'argent, qui passent leurs examens chez
quelque _demoiselle trente-six vertus_ et qui font leur stage dans
toutes les folies parisiennes. Beaucoup finissent par rentrer dans le
giron de la sagesse, mais plus d'un finit mal pour avoir mal commencé.
Sera-ce l'histoire de Georges du Quesnoy? Ce fut en vain que son pčre
vint ŕ diverses reprises pour le ramener ŕ la raison.
Comme ce n'était pas un mauvais coeur, il jurait de bonne foi qu'il
briserait avec ses fatales habitudes. Il embrassait son pčre avec
l'effusion la plus filiale; mais dčs que M. du Quesnoy était parti, il
retombait sous le charme des magiciennes. Et quelles magiciennes! Des
femmes qui n'ont de prix que parce qu'on les paie. «On n'en voudrait
pas pour rien,» disait Georges d'un air dégagé. Mais il en voulut
encore quand il ne les paya plus.
Son frčre vint lui-męme. Mais que vouliez-vous que conseillât un
ręveur ŕ un désoeuvré? Ils furent heureux de causer ensemble: ce fut
tout.
«Et toi, demanda Georges ŕ Pierre, que fais tu?
--Je suis amoureux.
--De qui? de quoi?
--Un amour désespéré.
--Parle.
--J'aime Mme de Fromentel.
--Ah! mon pauvre Pierre, je te plains, car on m'a dit qu'elle aimait
son mari et son amant!
--Je tuerai l'amant.
--Et le mari?»
Pierre ne répondit pas.
«Te voilŕ plus fou que moi-męme, reprit Georges. Crois-moi, viens
habiter Paris. La Seine c'est le Léthé. Il n'est que Paris pour
oublier.
--Allons, donc! Tu n'as pas oublié Valentine.
--C'est vrai. Mais Valentine, c'est Valentine. C'est la jeunesse,
c'est la beauté, c'est la poésie. Et encore je finirai par l'oublier.»
Le lendemain Pierre partit.
«Pourquoi si vite?
--J'ai promis d'aller ce soir jouer aux échecs avec M. de Fromentel.»
III
LE COEUR MAITRE DE L'ESPRIT
Georges croyait que l'esprit gouverne le coeur comme un navire qui
fuit le rivage. Il avait compté sans la tempęte. Maintenant qu'il
avait déjŕ la prescience du naufrage, il s'avouait qu'il subissait la
domination de son coeur. Il ne pouvait dominer son amour.
Et comme beaucoup de jeunes gens qui portent un coeur blessé, il
cachait la blessure par un sourire railleur.
Mais il ne trompait pas ceux qui ont aimé et qui ont souffert.
Ce fut cette passion trahie qui le jeta ŕ la recherche de l'Inconnu,
plutôt encore que les prédictions de Mme de Lamarre. Son coeur
entraîna son esprit.
Il tenta tout, décidé ŕ rire de Dieu et du diable.
Je me trompe, il ne croyait ni ŕ Dieu ni au diable.
O logique de la raison! Tout sceptique qu'il était il se mit ŕ croire
aux esprits, cet esprit fort!
Un philosophe a dit que chaque heure du jour et de la nuit impose son
despotisme ou tout au moins son influence. Les anciens, nos maîtres
éternels, n'avaient pas pour rien créé des théories pour symboliser la
force occulte des actions de la nature sur l'homme. On a beau jouer au
scepticisme, l'esprit fort le plus résolu n'est le plus souvent qu'un
esprit faible, quand sonnent, dans la solitude et le silence, les
heures nocturnes. Socrate et Platon, dans l'antiquité, Descartes et
Byron dans le monde moderne, pour ne citer que les plus sages et les
plus rebelles aux menées invisibles des puissances supérieures, ont
reconnu que minuit est une heure fatale oů l'esprit humain n'a pas ses
coudées franches. Certes, quand on est en belle et bonne compagnie,
quand on soupe gaiement ou amoureusement, l'heure passe sans vous
donner le frémissement de ses ailes, mais si la douzičme heure vous
surprend dans la ręverie ou la méditation, quand vous ętes seul avec
vous-męme dans le cortčge des souvenirs, vous subissez le contre-coup
de cette heure du sabbat qui répand autour de vous, comme une pluie de
fleurs mortes, les âmes en peine qui ont été les âmes de votre vie et
qui viennent tenter leur résurrection dans votre coeur.
Ce n'est pas seulement le moyen âge qui a imprimé un caractčre
mystérieux ŕ la douzičme heure; dans l'antiquité, quelles que soient
les religions, on retrouve partout ce sentiment de terreur religieuse
qui s'empare des hommes, qui fait crier les bętes. C'est la nature
elle-męme qui a commencé le sabbat; l'homme n'a rien inventé; il a
déchiffré peu ŕ peu les vérités éternelles dans le livre grandiose que
Dieu tenait ouvert sous ses yeux.
Les esprits forts disent que la nature n'a pas de mystčres. Ils ne
croient ŕ rien et ils parlent de tout avec la désinvolture des gens
qui ne savent rien. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y
ramčne. On peut appliquer ceci aux âmes en peine, aux esprits errants,
au monde invisible, qui nous obsčdent. Il faudrait ętre un docteur de
l'omniscience pour résoudre si lestement le premier de ces terribles
problčmes. Mais l'esprit humain est comme la mer qui perd d'un côté
ce qu'elle gagne de l'autre. Nous ne pouvons aborder qu'un coin de la
vérité. Et encore, parmi les plus hardis navigateurs, combien qui vont
se briser dans les récifs aprčs avoir entrevu le rivage! Celui qui
dit: «Je sais que je ne sais rien,» est déjŕ un sage. Le Régent
Philippe d'Orléans, qui fut un homme de beaucoup d'esprit et
d'impiété, disait gaiement: «Je ne crois pas ŕ Dieu, mais je crois
au diable.» C'est l'histoire de tous les athées, c'est l'histoire de
beaucoup de chrétiens qui ne croient ŕ Dieu que parce qu'ils ont peur
du diable.
Eh bien, le Régent avait la bonne foi d'avouer qu'il avait peur des
ombres, voilŕ pourquoi il soupait bruyamment pour lutter contre la
nuit. Il avait abordé le grand oeuvre; avant d'inventer Law, il avait
voulu faire de l'or par la vertu de l'alchimie. Il riait tout haut en
plein midi des apparitions nocturnes, mais il ne les niait pas: il
reconnaissait qu'il ne faut pas «trop s'approcher de l'inconnu».
Certes il ne tombait pas dans le pičge grossier des magiciens et il
se moquait des commérages de la sorcellerie. Ce n'était pas lŕ qu'il
avait étudié les sciences occultes, il était parti de plus haut et de
plus loin.
Je parle ici du Régent, parce que c'était un sceptique, il me serait
trop facile de mettre en scčne les esprits enthousiastes pour prouver
l'existence de «l'invisible». Bon gré mal gré, il faut reconnaître sa
force sans vouloir s'y heurter. Les sciences humaines sont toutes des
abîmes: si on s'y penche trop on s'y précipite. Rien n'est plus prčs
de l'extręme sagesse que l'extręme folie.
Georges du Quesnoy s'était aventuré dans ce pays de l'inconnu; son
imagination ardente voulait dépasser tous les horizons visibles.
Il doutait de tout, mais il se laissait pourtant envahir par l'âme
mystérieuse des choses. Comme il se croyait appelé ŕ de hautes
destinées, il posait ŕ toute heure son point d'interrogation devant
l'avenir, sans jamais oublier, d'ailleurs, les prédictions de la
chiromancienne.
L'idée fixe est la premičre station de la folie. Les amis de Georges
du Quesnoy commençaient ŕ chuchoter autour de lui. Nagučre il éclatait
en saillies, il était l'homme de toutes les discussions et de tous
les plaisirs; mais peu ŕ peu ce ne fut plus la gaieté que par
intermittence; on le surprenait méditatif, inquiet, assombri. Il eut
toutes les peines du monde ŕ passer son dernier examen, quoiqu'il fűt
certes un des plus subtils esprits parmi ses camarades.
Il s'aperçut lui-męme de ses chimériques préoccupations. Il voulut
s'arracher ŕ cette fascination de l'abîme. Il reconnut qu'il marchait
dans le vide, la raison fuyait sous ses pieds, il résolut de ne plus
hanter «l'Inconnu».
Mais quand l'esprit a pris des habitudes, il ne peut pas «découcher»,
comme dit Montaigne. Georges du Quesnoy s'était tourné vers la folie;
aprčs avoir divorcé avec la raison, il ne pouvait rebrousser chemin.
Tout le rejetait dans sa voie nouvelle, soit qu'il fűt chez lui, soit
qu'il fűt dans le monde. Chez lui il n'aimait que les livres
des visionnaires, dans le monde il n'aimait que la causerie des
spiritistes ou des femmes qui croient aux évocations ou aux revenants.
Partout oů il allait, on faisait cercle autour de lui, comme on eűt
fait cercle autour d'un sphinx. On le questionnait comme un voyageur
qui revient d'un pays inconnu. Tout le monde espérait qu'il ferait un
peu de lumičre dans les ténčbres, mais il jetait un peu plus de
nuées sur les nuées, tout en imprimant autour de lui un sentiment
de terreur. Il avait d'ailleurs tout ce qu'il faut pour inspirer
confiance. Il parlait fort bien; il était physionomiste jusqu'ŕ
pénétrer les âmes; il lisait dans les mains comme Desbarolles; il
tirait mieux les cartes que tous les charlatans ŕ la mode. «Mais,
disait-il ŕ ses amis, ce ne sont lŕ que des jeux d'enfant; je voudrais
bien n'avoir pas été plus loin que ces amusements de salon; par
malheur, moi aussi, j'ai franchi le Rubicon, et j'ai vu de trop prčs
l'autre monde pour vivre en paix dans celui-ci.» Et quand on voulait
rire, il mettait au défi le premier venu de braver la solitude
nocturne en bravant le sommeil, parce que le sommeil endort plus
encore l'esprit que la bęte, parce que le sommeil nous fait retourner
sur nos pas toutes les nuits, parce que le sommeil baisse la toile
devant notre imagination ŕ l'heure męme oů elle s'envolerait avec ses
coudées franches loin de toutes préoccupations humaines.
IV
VISION A LA CLOSERIE DES LILAS
Un soir Georges du Quesnoy errait ŕ la Closerie des lilas attendant
l'heure de l'arrivée de quelques grandes cocottes qui l'avaient averti
d'une entrée triomphale.
Il fut attiré sur le champ de bataille de la danse par les dehors
engageants de Mlle Pochardinette,--une Taglioni bien connue ŕ l'Opéra
en plein vent.
Plus que jamais, Georges était un ręveur qui brouillait le monde réel
et le monde idéal. Telle femme qui passait lui rappelait telle femme
oubliée, qui réapparaissait comme par évocation. Ce va-et-vient de la
vie égare toutes les imaginations ardentes. Goethe et Byron disaient
qu'ils ne distinguaient plus bien les figures vivantes des figures
ręvées, créations de la nature ou créations de la poésie.
Or, tout ŕ coup, tandis que cent yeux suivaient gaiement les
gargouillades spirituelles de cette danseuse illustre, Georges pâlit
et chancela.
Il venait de voir passer dans un tourbillon de nouveaux venus une
figure qui lui était bien connue.
C'était une jeune fille d'une beauté insolente, en plein
épanouissement. Elle se jeta follement au milieu du quadrille et
dansa avec passion. Jamais Fanny Elsler n'avait montré avec plus de
coquetterie impertinente sa jambe ŕ la Diane chasseresse; jamais gorge
plus franche n'avait fatigué corsage plus orgueilleux. Elle était
belle par la vie, par la jeunesse, par la volupté. Sa chevelure
légčrement dorée et ses yeux qui avaient dérobé un rayon au soleil,
rappelaient Flora, la belle Violante, cette immortelle maîtresse du
Titien. C'était la męme _floraison_, la męme _violence_, la męme
luxuriance de beauté humaine. Mais de beauté divine point. Elle avait
oublié le ciel pour la terre. Cependant quand elle fut au bout de sa
cachucha enragée, elle pencha sa tęte avec un nuage de mélancolie
comme si un souvenir eűt touché son coeur.
Mais au męme instant, un sourire désordonné passa sur sa bouche; elle
jeta ses mains jointes sur l'épaule de son danseur et lui ordonna de
l'emporter dans toutes les joies furieuses de la valse.
Georges du Quesnoy avait reconnu la jeune fille du Parc-aux-Grives.
C'était la męme figure chargée de trois printemps de plus; trois
printemps savoureux, couronnés de bleuets, d'épis et de cerises. Elle
était fraîche encore; mais déjŕ atteinte par les premiers ravages des
passions. Sa bouche, autrefois pure comme un sourire de pęche, n'avait
plus cette adorable naďveté d'une bouche ignorante qui n'a encore ri
qu'ŕ elle-męme: la science d'aimer avait trop passé par lŕ.
«C'est elle pourtant, dit Georges en s'avançant du côté de la
danseuse. J'ai reconnu ce beau cou nonchalant que je n'ai retrouvé que
dans la _Psyché_ de Praxitčle. Et ces yeux si fiers et si doux! Et ce
profil taillé en plein marbre! A n'en pas douter, c'est elle. Enfin!
elle va m'expliquer ce mystčre étrange.
--A qui en as-tu dans ton monologue?»
Georges fut ainsi interrompu par un ami intime qu'il connaissait
depuis la veille.
«Écoute: il y a trois ans, dans un parc de mon pays, j'ai vu
passer--comme une vision--une belle fille dont je suis encore amoureux
et que je n'ai jamais pu approcher.
--Ce n'était qu'une vision.
--Peut-ętre. Mais aujourd'hui, cette vision détachée du bleu des nues,
voilŕ que je la retrouve dansant ici. Vois plutôt cette robe bariolée,
ce chapeau insolent, cette écharpe dont elle fait un serpent, cette
ceinture de pourpre qui vaut une bonne renommée.
--Tu te moques de moi! je ne vois ni la robe, ni le chapeau, ni
l'écharpe, ni la ceinture. Est-ce que tu es visionnaire?
--Comment! s'écria Georges avec impatience, tu ne vois pas cette
danseuse éperdue, qui jette des roses par poignées et qui répand
autour d'elle une odeur savoureuse de jeunesse. Regarde-moi bien, je
cours ŕ elle et je l'enlčve avec toute la force de ma passion.»
Georges s'élança pour saisir la danseuse; mais comme il croyait la
toucher déjŕ, elle disparut dans un flot envahissant de beautés
surannées que M. Brididi amenait sur ses pas.
Durant plus d'une heure, Georges du Quesnoy courut tout le jardin pour
la retrouver. Il tomba épuisé dans les bras de son ami, qui lui offrit
une glace et lui jeta au-dessus la tęte un verre d'eau frappée, tout
en lui promettant de le recommander au docteur Blanche.
«Je ne suis pas fou,» dit Georges avec fureur.
Survinrent les cocottes en rupture de ban. Il essaya de rire et de
«blaguer» avec elles, mais il était trop ému encore par cette vision
qui agitait son coeur. Il riait des lčvres, mais il répondait de
travers.
«Voyons, dit une comédienne sans emploi, qui croyait faire des mots,
tu n'es ni ŕ la Closerie ni ŕ la causerie. Est-ce que tu es sorti
comme ton argent?
--Ni argent ni esprit comptant, dit une autre demoiselle de la męme
paroisse.
--Vous m'avez tout emprunté!
--On n'emprunte qu'aux riches, mon cher!
--Eh bien, prętez-moi cent sous pour vous offrir des cigares.»
Ce jour-lŕ, Georges du Quesnoy avait ŕ peine les cinq sous du Juif
errant pour fumer le cigare de minuit.
«Oui, je veux bien te pręter cent sous, dit la grande cocotte en
prenant pour rire un air de protection, mais c'est ŕ la condition que
tu vas me dicter une lettre d'injures ŕ mon amant.»
Georges se récria.
«Écrivain public! ŕ cent sous la séance! Pour qui me prends-tu?
--Ah! voilŕ que tu fais ta tęte, mais, mon cher, tu ne vaux pas
mieux que nous autres. Si tu ne te donnais pas pour cent sous, tu te
donnerais pour cent francs.
--Peut-ętre! Tu as raison. Donne-moi cinq louis et je te dicte une
lettre qui sera un chef-d'oeuvre.»
On s'était assis ŕ une petite table; la demoiselle demanda des bocks
et des glaces, une plume et de l'encre--ce qui ne s'était jamais vu
lŕ.
Et quand elle eut la plume en main:
«Eh bien, j'y suis, dit-elle.
--Et les cinq louis?
--C'est comme au théâtre, on paye en entrant?
--Eh bien, tu paieras aprčs la lettre. Mais pourquoi cette lettre?
--C'est bien simple, mon amant ne revient ŕ moi que quand je lui dis
des injures.
--Écris. Cela se trouve bien, car je voudrais ce soir injurier le
ciel, la terre, la lune et les étoiles.»
Georges du Quesnoy dicta ŕ cette fille un vrai chef-d'oeuvre
d'impertinences passionnées. On sentait que c'était l'indignation de
l'amour. Chaque mot frappait juste. Jamais femme jalouse n'avait si
bien marqué les battements de son coeur par des mouvements de colčre.
Aussi, ŕ la derničre phrase, la demoiselle se jeta au cou de Georges
du Quesnoy.
«Un chef-d'oeuvre! s'écria-t-elle, Léon est capable de me répondre par
un billet de mille francs.»
Georges ne rougissait pas de son rôle, tant il avait déjŕ perdu
ce sixičme sens qui s'appelle le sens moral. Il croyait faire une
«blague» ŕ la don Juan.
«Eh bien, dit-il, pręte-moi cinq louis sur les mille francs.
--C'est sérieux?
--Trčs sérieux. Je te dirai pourquoi.»
La demoiselle prit gravement son porte-monnaie et le passa ŕ Georges,
qui ne fit aucune façon pour y prendre un billet de cent francs.
«Demain j'irai te voir pour te demander des nouvelles de la lettre.
--Écoute, s'il m'envoie mille francs, je te donnerai encore cent
francs.
--Tu me pręteras encore cent francs.»
Georges du Quesnoy rectifiait le mot de la demoiselle, mais ce n'était
pas la peine, car déjŕ ŕ cette époque de sa vie, quiconque lui prętait
risquait de lui donner.
Une des amies de la comédienne vint s'asseoir ŕ leur table.
«Tu sais que ton amant me plaît, dit-elle ŕ cette demoiselle, en
prenant la cigarette allumée de Georges du Quesnoy. S'il veut, je lui
ferai bien le sacrifice de toute une soirée.
--Eh bien, dit l'autre en raillant, tu auras de la chance si tu ne
fais que de te donner, car avec lui, ça coűte plus cher que ça.»
Georges du Quesnoy s'indigna d'abord et voulut déchignonner un peu
l'impertinente par une chiquenaude sur ses faux cheveux; mais il était
devenu si philosophe qu'il se croyait au-dessus ou au-dessous de tout
ce qu'on pouvait dire.
On se leva de table et on alla voir valser Mlle Pochardinette.
«J'en ferais bien autant,» dit la comédienne. Et elle entraîna Georges
du Quesnoy.
Il commença ŕ valser avec elle. Mais tout d'un coup il l'abandonna
pour se jeter ŕ la rencontre de la vision qui l'avait frappé une heure
auparavant.
«Tu es donc fou?» lui dit la comédienne en le ressaisissant.
Il était pâle comme la mort.
«Figure-toi, lui dit-il, que je viens de voir passer une jeune fille
de mon pays, que j'ai aimée, ŕ qui je n'ai jamais parlé, que je
n'espérais pas revoir... Elle m'a jeté une poignée d'or et une poignée
de roses ŕ la figure....»
Georges se baissa et ramassa des roses.
«Tiens, vois plutôt.
--Des roses fanées, souillées, piétinées!»
Georges du Quesnoy promenait partout son regard anxieux.
«Voilŕ que je l'ai reperdue, tout en la retrouvant.»
Quoi que fît la comédienne, Georges du Quesnoy ne voulut pas aller
souper avec elle. Il rentra chez lui, voulant s'isoler pour vivre une
heure dans son souvenir. La vision l'avait arraché ŕ la vie parisienne
pour le rejeter en cette adorable saison oů il croyait ŕ tout: au
travail, au devoir, ŕ l'amour. Il lui sembla qu'il prenait un bain de
jeunesse et qu'il revoyait flotter sur son front ces beaux fils de la
Vierge qui portent bonheur aux voyageurs. Il pensa ŕ son pčre, qu'il
n'avait pas vu depuis trois mois; ŕ son frčre, qui n'était pas revenu
ŕ Paris pour le rappeler une fois de plus ŕ la vie de famille.
«Mon frčre a raison, dit-il tristement. Je le prenais pour un fou, ŕ
cause de ses rimes; mais lui aussi est un voyant et j'ai peur de ses
prédictions.»
Il résolut d'aller le lendemain chez son pčre et de se retremper aux
sources vives.
Il se coucha et dormit mal. Toute la nuit la vision passa au-dessus de
son lit. Ce fut une obsession.
Le matin on lui apporta une dépęche de son pčre qui ne contenait que
ces mots:
«_Ton frčre est mort. Je t'attends_.»
V
COMMENT PIERRE DU QUESNOY MOURUT DE MORT VIOLENTE
La mort de Pierre Du Quesnoy fut une aventure tragique, qui a éclaté
dans les journaux aux quatre coins de la France.
Il était devenu l'amant platonique d'une Mme de Fromentel, qui avait,
ŕ ce qu'il paraît, un amant plus réel, nommé M. de Vermand. Je ne fais
que copier la _Gazette des Tribunaux_. Le mari, un vrai mari de la
vieille comédie, ne voulant pas se donner les émotions d'un duel avec
M. de Vermand, trouva fort malicieux de préparer un duel entre l'amant
et l'amoureux, se disant que c'était le moyen le plus pratique de se
débarrasser de l'un et de l'autre. Il joua si bien son jeu qu'il mit
bientôt en effet les armes ŕ la main ŕ M. de Vermand et ŕ Pierre du
Quesnoy. Seulement, ce fut un duel entre un homme qui savait se battre
et un enfant qui ne savait pas se défendre. Circonstances aggravantes,
le duel eut lieu le soir, dans un bois, aux derniers feux du jour, aux
premičres clartés de la nuit. Pierre du Quesnoy ne se défendit pas
longtemps. Quoique M. de Vermand ne voulűt que lui donner une leçon,
il le frappa d'un coup au coeur, parce que Pierre se précipita
au-devant de son épée. Ce fut une désolation dans tout le pays. M. de
Vermand était parti la nuit męme pour l'Angleterre, disant que c'était
pour éviter la prison préventive, mais il ne se présenta pas devant le
jury quand il fut appelé. On le condamna, par défaut, ŕ cinq ans de
prison. Les jurés furent trčs-sévčres, parce qu'ils connaissaient
tous Pierre du Quesnoy. M. de Fromentel en fit une maladie. Mme de
Fromentel ne se consolera jamais.
Georges du Quesnoy arriva ŕ temps pour voir son frčre. Ce fut une
scčne déchirante, car on sait combien ils s'aimaient tous les deux.
«J'ai tout perdu, disait Georges, pensant ŕ Valentine comme ŕ Pierre.
C'était la vie de mon coeur et de mon esprit; il ne me reste plus qu'ŕ
mourir.» Il fallut que son pčre, non moins désespéré, lui redonnât du
courage. Il fallut que sa soeur, qui était arrivée par l'express du
matin, l'arrachât dix fois dans la journée du lit funéraire.
Le lendemain, pendant la messe mortuaire, Georges du Quesnoy aperçut
Mlle de Lamarre, qui était venue prier avec Mme de Sancy.
«Elle l'avait dit, murmura Georges, _lui aussi mourra de mort
violente_. Décidément, il me faudra donc monter sur la guillotine,
puisque les prédictions de cette voyante se réalisent!»
Georges ne manqua pas de faire encore un pčlerinage au château de
Margival. Mais ce n'était plus qu'une solitude abandonnée.
Le comte, qui aimait les voyages, était parti quelques jours aprčs le
mariage de sa fille pour Rome, Naples, Athčnes, Constantinople. Il
n'était pas encore revenu.
Georges lut sur une pancarte attachée ŕ la grille:
CHATEAU A VENDRE.
«Ce château est comme moi, pensa-t-il. Ce château n'a plus de maître
et il est ŕ vendre.»
Il pensait en philosophe. Tout homme qui ne se possčde plus est ŕ
vendre.
«La mort partout,» dit tristement Georges.
Et il s'éloigna du château comme du cimetičre de sa jeunesse.
VI
LA VOYANTE
M. du Quesnoy ne voulut pas rester ŕ Landouzy-les-Vignes aprčs la mort
de son premier fils. Il alla vivre ŕ Rouen avec sa fille.
Georges ne le consola pas, car il mit bientôt la main sur sa part dans
la petite fortune que Pierre avait recueillie de sa mčre. Georges
faisait déjŕ argent de tout.
Cet argent, venu de son frčre bien-aimé, ne lui porta pas bonheur.
Il le joua et le perdit. Il n'en fut que plus avancé vers toutes les
tristesses et tous les découragements.
Son pčre, indigné de cette conduite, ne répondit plus ŕ ses lettres.
Sa soeur elle-męme lui ferma son coeur, parce qu'elle ne lui
pardonnait pas, elle qui avait des enfants, d'avoir dissipé si vite de
quoi nourrir une famille.
L'homme qui n'est plus sous la main ou sous les yeux de sa famille a
déjŕ perdu son meilleur point d'appui sur la terre. Georges ne savait
plus oů se tourner. S'il devenait avocat sans le sou, resterait-il
avocat sans causes? Il continua pourtant son droit; mais dans son
amour de l'Inconnu, il étudia la chimie; bientôt il passa dans
l'alchimie, voulant ŕ son tour tenter l'Impossible, jouant le superbe
devant Dieu et devant le diable.
Quand on pénčtre dans le monde des Esprits, on se demande tout d'abord
si on a franchi le seuil de Charenton. Comme Pascal on voit l'abîme
sous ses pieds, et comme Newton on est pris de vertige. C'est que Dieu
n'a pas permis ŕ l'homme de franchir le monde visible, il lui a dit
comme ŕ la mer: «Tu n'iras pas plus loin.»
Ce qui est d'autant plus inquiétant pour cette parcelle de sagesse
humaine que nous appelons orgueilleusement la raison, c'est que les
plus grands philosophes sont des visionnaires. Descartes n'a-t-il pas
vu apparaître la vierge Marie; Voltaire ne se sentait-il pas possédé
d'un esprit surhumain, dont il disait: «Je ne suis pas le maître;»
Kant, qui certes n'était pas le Jupiter assemble-nuages de la
philosophie, ne disait-il pas: «On en viendra un jour ŕ démontrer
que l'âme humaine vit dans une communauté étroite avec les natures
immatérielles du monde des Esprits; _que ce monde agit sur le nôtre_
et lui communique des impressions profondes, dont l'homme n'a pas
conscience aussi longtemps que tout va bien chez lui?»
Georges du Quesnoy finit par s'apercevoir que plus il interrogeait
tous les docteurs de la science occulte, plus la nuit se faisait dans
son âme. Que lui importait d'ailleurs qu'il y eűt des démons s'il ne
pouvait s'en servir?
Un jour il jeta tous ses livres au feu et se tourna vers le soleil en
lui disant: «Je te salue, lumičre du monde, les meilleurs esprits ne
feraient pas le plus mince de tes rayons.»
Il rouvrit Lucrčce, Newton et Voltaire, ces fils du soleil; mais il
eut beau se baigner dans les vives clartés de l'esprit humain, il
sentit que ce n'était pas tout. Il ne put effacer de son âme l'image
de Dieu, il ne put rayer de son souvenir cette prédiction de Mlle de
Lamarre qui avait vu la guillotine se dresser pour lui.
Vainement il jouait ŕ l'esprit fort: il sentait une âme dans le monde
invisible.
Il avait dit souvent que pour les imbéciles la terre tournait dans le
vide, tandis que pour les hommes d'esprit elle tournait dans le ciel.
Il ne pouvait s'habituer ŕ l'idée du néant, le néant avant lui, le
néant aprčs lui. Comment nier le pressentiment quand il y a quelque
chose lŕ, sous le front, et quelque chose lŕ, dans le coeur? Du
pressentiment ŕ la divination, il n'y a pas loin. Si Dieu n'existait
pas, on n'aurait pas l'idée de Dieu; si les devins n'avaient pas lu
dans les astres, dans les physionomies, jusque dans les mains, le jeu
des destinées humaines, qui donc aurait cru ŕ tous les oracles de
l'antiquité, ŕ toutes les sorcelleries du moyen âge, aux esprits
frappeurs d'aujourd'hui? pourquoi les âmes du purgatoire
n'auraient-elles pas la mission de nous conduire par la vie ŕ travers
le bien et le mal? Et alors qui les empęcherait de se manifester
par des signes visibles pour les voyants, car il y a des voyants?
Swedenborg n'était ni dupe pour lui-męme ni charlatan pour les autres.
A force d'ouvrir les yeux de son âme, il avait vu. Quand Dieu a dit:
Malheur ŕ l'homme seul, c'est que Dieu n'a pas voulu que l'homme se
tournât avant l'heure vers l'infini. Dans le tourbillon du monde,
l'homme ne voit passer que les figures du monde, tandis que dans les
studieuses méditations de la solitude, il ose franchir les abîmes qui
séparent la vie de la mort. Les grands solitaires ont tous été des
voyants.
Voilŕ ce que disait Georges du Quesnoy, non pas qu'il tombât dans les
illusions des spiritistes qui voient partout graviter des âmes. Il
n'avait, jamais voulu faire tourner les tables possédées; il se
moquait de quelques-uns de ses amis qui parlaient des esprits
frappeurs, mais il ne pouvait aller jusqu'au scepticisme absolu.
«C'est pourtant trop bęte, disait-il quelquefois en se rappelant les
prédictions du château de Sancy; parce qu'une femme distraite aura
dit, pour étonner son monde, que je serai guillotiné, il faudra que je
sois toute ma vie préoccupé de la guillotine. C'est lŕ une mauvaise
plaisanterie dont je veux faire justice.»
Mais plus il voulait n'y plus penser, et plus il y pensait.
Un jour qu'il se retournait vers le passé, appuyé ŕ sa fenętre, il vit
un étudiant et une étudiante qui revenaient de Vanves, bras dessus
bras dessous, avec des branches de lilas dans la main, s'éventant l'un
l'autre, avec la grâce du Misanthrope, s'il se fűt armé de l'éventail
de Célimčne.
«Ah! s'écrie-t-il, que les lilas doivent sentir bon dans le
Parc-aux-Grives!»
Une heure aprčs, il était au chemin de fer du Nord, ligne des
Ardennes. Le soir il dînait ŕ Soissons et s'en allait ŕ pied jusqu'ŕ
Landouzy-les-Vignes.
La maison natale abandonnée lui sembla un cimetičre, que dis-je! un
tombeau, car le lendemain matin quand il alla saluer la tombe de sa
mčre et celle de son frčre, le cimetičre lui parut un pays souriant
par ses arbres, ses fleurs et ses gazons.
Ce lui fut aussi un pays souriant que le Parc-aux-Grives, tout épanoui
sous les pousses printaničres. Il y passa des heures regardant
ŕ chaque minute les fenętres de Valentine--un cadre sans
portrait.--«Hélas! murmura-t-il, la fenętre ne s'ouvrira pas!»
Il eut l'idée d'aller faire une visite au château de Sancy; il ne
s'avouait pas que c'était pour revoir la chiromancienne, mais au fond
il n'y allait que pour cela.
Il retrouva au château la męme société provinciale; Paris se
métamorphose sans cesse, mais la province est sempiternelle dans ses
évolutions. Non-seulement c'était la męme société, mais c'étaient les
męmes causeries. Georges du Quesnoy se crut un instant rajeuni de
trois ans.
Mais il pensa ŕ son frčre et cacha une larme; on n'avait jamais pleuré
une plus belle âme.
«A propos, dit Mme de Sancy, plus étourdie chaque année, vous n'ętes
pas encore guillotiné?»
Georges du Quesnoy s'inclina en essayant un sourire.
«Je vous remercie de votre impatience, madame; que voulez-vous, j'ai
manqué l'occasion.»
Disant ces mots, il regardait ŕ la dérobée la sibylle en cheveux
blonds qui, tout en piquant sa tapisserie, murmura d'un air convaincu:
«Oh! oh! nous n'y sommes pas, M. Georges du Quesnoy a encore bien du
temps devant lui.»
Le jeune homme se leva et traîna son fauteuil devant la dame.
«Puisque aussi bien, lui dit-il, me voilŕ avec vous face ŕ face,
je vous demande sérieusement de me dire pourquoi vous avez mis une
guillotine sur mon chemin?
--Avez-vous lu Cazotte? lui demanda Mlle de Lamarre.
--Oui, j'ai lu ses prédictions dans La Harpe.
--Eh bien, c'était un voyant, comme je suis une voyante. Aprčs l'avoir
écouté, puisque c'était un homme de bonne foi, il fallait se mettre en
garde contre les malheurs qu'il voyait de si loin et de si prčs. Louis
XVI, tout le premier, a ri de ses prédictions, comme les enfants qui
jouent au bord l'abîme. S'il y eűt ajouté foi, il pouvait prévenir la
Révolution en se mettant en travers. On peut rire des voyants, mais il
faut tenir compte de ce qu'ils ont vu.
--Alors, madame, vous ętes une spectatrice qui voyez déjŕ le drame ŕ
travers le rideau quand les acteurs sont encore dans la coulisse.
--Oui, le rideau se fait diaphane pour moi et j'entrevois les acteurs
qui répčtent leurs rôles.
--Et vous m'avez vu dans la coulisse, au dénoűment de ma vie, répétant
mon rôle avec le prętre et avec le bourreau?
--Je vous en ai trop dit, vous ętes un noble coeur, car je vous ai vu
pleurer sur la tombe de votre frčre; vous ętes un esprit hors ligne,
car je vous ai entendu discuter sur les destinées de l'âme avec le
curé de Sancy. Vous n'ętes pas né pour une existence vulgaire. Si vous
escaladez les cimes, prenez garde au vertige; si votre esprit hante
les nues, prenez garde au tourbillon.»
Et, parlant plus bas, la chiromancienne dit ŕ Georges:
«Il n'est pas douteux pour moi que vous aimez toujours Valentine.
Voilŕ un tourbillon dont il faut vous défier. Prenez garde! si vous la
rencontrez, ce sera votre malheur ŕ tous les deux.
--Vous ne savez donc pas, madame, qu'il y a des heures de malheur
qu'on voudrait acheter par des éternités de joie!»
Georges du Quesnoy rentra ŕ Paris un peu plus troublé qu'ŕ son départ.
Je défie l'homme le plus sceptique de se moquer du lendemain.
VII
LES DÉCHÉANCES
Georges du Quesnoy passa son dernier examen, mais plus préoccupé de
poser des points d'interrogation devant toutes les philosophies, plus
préoccupé surtout de vivre ŕ plein coeur et ŕ pleine coupe que de
prendre la robe sévčre de l'avocat.
Vivre ŕ plein coeur! Mais depuis qu'il avait ébauché la plus adorable
des passions avec Valentine de Margival, il ne croyait pas qu'il lui
fűt possible d'aimer une autre femme.
Qui donc aurait pour lui ce charme pénétrant? qui donc le ravirait par
cette beauté opulente, beauté divine et beauté du diable? yeux qui
rappelaient le ciel, mais qui promettaient toutes les voluptés?
Georges se contentait de distraire son coeur par des aventures d'un
jour.
On sait déjŕ que, dčs son arrivée dans le pays latin, il avait été
ŕ la mode parmi les étudiantes, ces demoiselles étant encore assez
primitives pour tenir plus compte de la beauté et de l'esprit que de
la fortune. Ceci peut paraître une illusion, c'est pourtant la vérité.
On sait aussi que Georges avait étendu ses conquętes de l'autre côté
de l'eau, si bien qu'il ne fut jamais en peine de femmes, quand il
voulait perdre une heure ou męme un jour.
Il avait trop pris au pied de la lettre la pensée du philosophe qui
dit: «L'homme sans passions est un vaisseau qui attend le vent, voiles
tendues, sans faire un pas.» Il avait appelé ŕ lui tous les vents:
ceux qui viennent par la tempęte comme ceux qui viennent par la fleur
des blés. Il s'était brisé aux écueils, il avait fait eau de toutes
parts; encore quelques ouragans, il échouait sans une planche de
salut.
L'orgie--l'orgie de l'esprit--l'avait envahi de la tęte au coeur. Il
était entré dans le labyrinthe de la passion--la passion sans âme.
Il vécut plus que jamais des hasards du jeu et de l'amour.
Un soir qu'il désespérait de tout, il reçut ce mot mystérieux,
griffonné par une main qui voulait masquer son écriture:
_Souvenez-vous de l'oubliée_.
Il ne douta pas que ce mot ne lui vînt de Valentine.
«Ah Valentine! s'écria-t-il tristement, c'était l'âme et la force de
ma vie!»
Or cette femme, qui eűt été l'âme et la force de sa vie, qu'était-elle
devenue? Sa chute avait été non moins rapide.
La jeune châtelaine de Margival avait jeté son bonnet par-dessus le
Capitole et il était tombé sur la roche Tarpéienne. C'était au temps
oů quelques grandes dames émerveillaient Paris de leurs aventures.
La comtesse de Xaintrailles avait voulu que la France fűt bien
représentée ŕ Rome. Pendant que son mari allait ŕ confesse pour la
convaincre que Dieu seul vaut la peine d'ętre aimé, elle courait
gaiement les villas voisines avec de nobles étrangčres qui n'étaient
pas venues ŕ Rome seulement pour voir le pape. Parmi les princesses du
nord et les duchesses du midi qui voyagent par curiosité, il en est
plus d'une qui ne rentrent pas le front haut dans leurs maisons.
Un soir, la comtesse de Xaintrailles ne rentra pas du tout.
Grand scandale ŕ Rome jusque chez le pape qui lui avait donné sa
bénédiction. Il est vrai que, ce jour-lŕ, un jeune monsignor lui
avait offert ŕ Saint-Pierre la clef du paradis de Mahomet. Elle avait
refusé, mais l'impiété avait fleuri dans son coeur. Rome est le pays
des grands repentirs; mais aussi des grandes perversités.
Il ne fallait pas ętre d'ailleurs un profond physionomiste,
physiologiste et psychologiste, pour prédire au comte de Xaintrailles
qu'il ne serait bientôt qu'un mari de Moličre, en voyant l'impétueuse
nature de sa jeune femme. On ne marie pas impunément le couchant ŕ
l'aurore, le couchant est rejeté dans la nuit, quand l'aurore s'allume
dans le soleil. C'est la loi des forces et des défaillances. Toute
femme qui ne se jette pas dans les bras de Dieu se jettera dans les
bras de son prochain.
Valentine était adorée de son pčre, elle savait que, quoi qu'elle fît,
elle aurait son pardon. L'opinion publique c'était sa conscience, sa
conscience c'était son coeur, son coeur c'était sa passion. L'exemple
en a perdu plus d'une. Valentine voyait tous les jours ŕ Nice et ŕ
Bade, ŕ Rome et ŕ Tivoli, ŕ Paris oů elle venait souvent en congé
avec ou sans son mari, de trčs-nobles dames qui se pavanaient dans
l'adultčre avec une gaieté impertinente. Elle trouvait cela de bon
air. Il fut un temps oů c'était presque ŕ la mode. Valentine voulut
ętre une femme ŕ la mode.
Ce jour-lŕ, le mari put s'écrier: «Tu l'as voulu, Georges Dandin.»
Il songea ŕ se venger. Il parla de faire enfermer sa femme. Il jura
qu'il tuerait son rival.
Mais il en avait deux.
Il voulut ętre le troisičme larron: il se jeta aux pieds de sa femme.
Il la conjura de lui pardonner ses crimes ŕ elle--combien de maris
tombent dans cette lâcheté?--Mais M. de Xaintrailles avait bien
quelques péchés sur la conscience. Il continuait de vagues relations
avec une ci-devant danseuse qui avait été sa maîtresse pendant dix
ans. Valentine renvoya son mari ŕ sa maîtresse en lui disant:
«Si vous voulez que je vous aime, faites-vous une autre tęte. Je vous
ai sacrifié quatre années de ma jeunesse, de ma fortune, de ma beauté,
si vous n'ętes pas content vous ętes difficile ŕ vivre.»
Et elle s'enfuit ŕ Bade avec le marquis Panino, son second amant.
VIII
LE MISERERE DU PIANO
C'était au temps des prodiges de M. Home. Il était bien naturel que
Georges du Quesnoy, déjŕ visionnaire, voulűt voir de prčs le célčbre
médium, espérant avoir le premier et le dernier mot de toutes ces
aventures occultes.
Il voulait aller tout exprčs ŕ Bade pour le rencontrer, lorsqu'il
lut un matin dans un journal la liste des étrangers en villégiature
lŕ-bas. Le nom de:
_Madame la comtesse de Xaintrailles_
le frappa comme un coup de soleil.
«Décidément, dit-il, ma destinée m'appelle ŕ Bade.»
Mais, arrivé ŕ Bade, il lui fut impossible de découvrir Valentine. Il
alla chez M. Home. On sait que M. Home ne se laissait pas aborder par
le premier venu; mais Georges du Quesnoy, arričre-petit-cousin de M.
de Ravignan, arriva jusqu'ŕ lui, grâce ŕ ce nom trčs-révéré par cet
esprit troublé. Georges du Quesnoy, quoiqu'un peu hautain, était,
quand il le voulait, l'homme du monde le plus sympathique. M. Home se
laissa conquérir ŕ moitié, quoiqu'il fűt toujours sur la réserve. Cet
homme, qui avait commencé par les malices des dessous de cartes, avait
fini par se prendre au jeu. Il avait vu devant lui l'abîme de Pascal,
et pour les autres il était devenu un abîme. Georges eut peur d'y
tomber; mais au delŕ de cet abîme on voyait la lumičre comme on voit
la vie future au delŕ du tombeau. Le médium avoua qu'il n'était pas
maître de lui depuis qu'il était obsédé par un esprit dominateur qui
le rappelait toujours ŕ l'ordre quand il voulait se révolter. C'est
ainsi qu'il expliquait ce mouvement des choses matérielles, tables,
fauteuils, pianos, quand il voulait nier les esprits.
«Car je ne les appelle jamais, disait-il, surtout depuis ma confession
ŕ l'abbé de Ravignan. Ils me font peur, et je passe ma vie ŕ les
exorciser moi-męme. C'est dans la lutte qu'ils reviennent ainsi faire
le sabbat.
--Eh bien, faites-moi voir ce sabbat, je vous en supplie,» dit
Georges.
Il avait déjŕ raconté au médium ses visions du parc de Margival et
de la Closerie des lilas; mais il ne voulait pas croire aux tables
tournantes non plus qu'ŕ la sarabande des fauteuils.
Depuis quelques jours, M. Home refusait aux plus belles étrangčres en
villégiature ŕ Bade, de se remettre en communication avec les esprits
frappeurs ou tourbillonnants. On parlait beaucoup alors de sa célčbre
séance chez l'impératrice des Français, oů il avait convaincu les plus
incrédules de ses obsessions démoniaques. C'en était assez pour sa
gloire éphémčre. Pour lui, les grands de la terre étaient ceux qui,
comme le pčre Ravignan, travaillaient ŕ la rédemption des âmes. Il
jouait le dédain du monde périssable.
Georges du Quesnoy fut donc bien mal venu ŕ demander des miracles.
Mais un soir qu'ils se promenaient tous les deux dans l'avenue de
Lichenthal, M. Home lui dit:
«Voyez comme je suis malheureux! ce que j'aimerais c'est la solitude,
pour ręver ŕ toutes les merveilles du monde, mais je ne connais pas
la solitude; dčs que je suis seul, les esprits reviennent ŕ moi plus
furieux que jamais.»
Quoique ce fűt avant le coucher du soleil, Georges regarda de
trčs-prčs M. Home. Il était pâle et effaré.
«Ne me quittez pas ce soir, ne me quittez pas ce soir,» disait-il avec
une inquiétude, qui ne semblait pas jouée.
Georges jugea que c'était une bonne fortune pour lui que cette
soudaine reprise des esprits. Il allait enfin savoir! M. Home lui dit
qu'il ne voulait pas rentrer ŕ l'hôtel de Russie, oů il avait pris
pied depuis quelques jours. Il décida qu'il irait ŕ l'hôtel Victoria,
oů était descendu Georges.
«C'est un hôtel plus vivant et plus gai; les esprits ne franchiront
peut-ętre pas le seuil, surtout si vous leur tenez tęte.»
Ce n'était pas l'affaire de Georges. Aussi il n'eut garde de faire le
sceptique. Bien au contraire, il appela lui-męme les esprits avec la
douceur des oiseleurs qui appellent les oiseaux.
Les voilŕ entrés. M. Home demanda une simple chambre; il n'y en avait
pas une seule qui fűt libre. On lui proposa l'appartement d'une des
grandes-duchesses de Russie, qu'on attendait toujours et qui ne venait
jamais.
«Il faut bien l'accepter,» dit Home, qui ne regardait pas ŕ l'argent.
En passant dans le salon, il fut fâché de voir un piano.
«Pourvu qu'ils ne me fassent pas de musique,» dit-il avec
tressaillement.
Georges se disait: «Il y a lŕ un charlatan, un fou ou un voyant;
peut-ętre y a-t-il de tout cela.»
Ils allčrent jusqu'ŕ la chambre ŕ coucher.
«Je suis brisé,» dit M. Home.
Il se jeta sur son lit et fit signe ŕ Georges de s'asseoir en face de
lui sur le canapé.
«Ne vous en allez qu'aprčs minuit, c'est une grâce que je vous
demande, lui dit le médium. Attendez que je sois endormi, car, si vous
n'étiez lŕ, je n'aurais pas de toute cette nuit une heure de sommeil.»
Georges voulut parler des esprits, mais M. Home le supplia de changer
de causerie.
Et il parla ŕ voix haute de toutes les belles dames qu'ils avaient
rencontrées dans leur promenade, femmes sérieuses et femmes légčres,
princesses étrangčres et princesses de la rampe. M. Home ne parlait
si haut et n'évoquait de si belles figures que pour faire peur aux
esprits.
A un certain moment, il se jeta hors du lit pour arręter la pendule.
«Pourquoi faites-vous cela?
--Pourquoi? C'est que cette pendule pourrait sonner les douze coups de
minuit, et me frapper douze fois le coeur presque mortellement.»
Cinq minutes aprčs:
«Voyez, reprit-il, la pendule marche malgré moi; je l'ai pourtant
bien arrętée. Parlez-moi bien vite de la princesse *** et de Mme Anna
Delion. Voilŕ deux beautés, souveraines, une pour Dieu, l'autre pour
le diable.»
Une seconde fois il alla arręter la pendule.
«Pourquoi avez-vous allumé cette troisičme bougie? dit-il ŕ son
compagnon.
--C'est singulier, dit le jeune homme, car, en effet, il n'y avait
tout ŕ l'heure que deux bougies d'allumées.»
M. Home en éteignit une; mais ŕ peine fut-il couché que Georges vit
encore trois bougies allumées.
Il commença ŕ croire aux esprits.
Il éteignit lui-męme la troisičme bougie.
Pendant toute une heure, ils causčrent de la vie parisienne ŕ Bade, de
toutes les aventures amoureuses, de la folie des joueurs.
«Vous savez, dit Georges; que ce grand Italien, qui avait l'air d'un
Meyerbeer brun, s'est pendu au vieux château?
--Chut! dit M. Home, ne me parlez pas du vieux château; c'est lŕ que
je n'irais pas ŕ minuit.»
Un silence.
«Voyez, reprit le médium en montrant la pendule, cette fois elle
est bien arrętée, mais les aiguilles vont toujours, il est minuit;
accourez vite, je vais mourir.»
Georges se jeta vers M. Home. La pendule sonna minuit. M. Home prit la
main de Georges et la porta ŕ son coeur.
«N'est-ce pas que c'est épouvantable?» lui dit-il.
Chaque tintement de la pendule se répétait dans le coeur de M. Home
par un battement de toute violence; c'était ŕ le briser.
«Voyez comme elle tinte lentement; c'est pour prolonger mon agonie.»
Georges courut ŕ la pendule et la secoua pour arręter la sonnerie,
mais elle persista ŕ sonner. Cette fois, sa raison l'avait abandonné,
mille nuages passaient sur son front. Sans bien savoir pourquoi, il
agita le cordon de la sonnette.
«C'est inutile, lui dit M. Home, la sonnette ne sonnera pas, les
esprits sont les maîtres ici; il faut nous en aller.»
Mais il se passa plus d'une heure sans que M. Home reprît la force de
se tenir debout. Georges avait voulu appeler.
«Non, lui dit le médium, je ne veux pas donner ce spectacle.»
Enfin M. Home, tout défaillant, se mit debout, prit son chapeau et
marcha vers la porte du salon. Georges allait le suivre, quand il
s'arręta court.
«N'entendez-vous pas?» lui dit M. Home en tombant sur un fauteuil.
Georges écoutait.
Il entendit résonner le piano comme une harpe éolienne; c'était une
vague musique d'église écoutée dans le lointain. Le _De profundis_ et
le _Miserere_ n'ont pas de clameurs plus doucement funčbres.
«Qui touche du piano? demanda Georges, plus ému encore.
--Pouvez-vous le demander? ce sont mes ennemis. Ne les entendez-vous
pas qui chantent la mort de mon âme? c'est horrible.»
M. Home avait des larmes dans les yeux. Il se traîna ŕ la fenętre et
l'ouvrit; mais déjŕ Bade dormait.
«On n'entend plus, dit le médium, que le sabbat qu'ils font lŕ-haut au
vieux château.
--Voilŕ ce que vous entendez, dit Georges, mais moi, j'entends un
autre sabbat; on danse lŕ tout ŕ côté, chez Mlle Soubise. J'y suis
invité et je vous y emmčne. Vous serez sauvé, car vous ne serez plus
dans le monde des Esprits. Méry est lŕ avec Scholl et quelques autres
esprits bien pensants.
--Jamais, dit M. Home, jamais je n'irai dans ce monde-lŕ.
--Ce n'est pas la peine de quitter l'esprit des ténčbres pour
retrouver l'esprit de l'enfer.
--Ne rions pas, dit M. Home avec un accent sévčre. Vous ne sentez donc
pas que vous ętes au milieu du sabbat? Tout est sens dessus dessous
ici. Regardez plutôt dans la glace, vous ne vous verrez pas.»
Comme M. Home disait ces mots, les bougies s'éteignirent.
«Permettez, ce n'est pas de jeu,» dit Georges en voulant rire encore.
M. Home frappa du pied.
«Croyez-vous donc que je suis maître de faire le jour et la nuit?»
Et aprčs un silence:
«Avez-vous aimé?
--Si j'ai aimé! j'ai aimé ŕ en mourir. Ç'a été le malheur de ma vie.
--Et quelle était la femme?
--Une adorable créature. Je ne suis venu ici que pour la voir.
--Et vous l'avez vue?
--Non. Elle n'a fait que passer, je crois qu'elle est allée ŕ Ems, oů
j'irai demain.
--Contez-moi cette histoire. J'aime beaucoup les contes amoureux.»
Georges ne se fit pas prier. Il conta en quelques mots rapides, avec
tout l'accent de la passion, les premiers chapitres de son roman. Il
peignit, en s'y attardant un peu, cette belle figure de Valentine dont
le seul souvenir lui masquait toutes les femmes.
«Et vous ne l'avez pas revue une seule fois? lui demanda M. Home.
--Non, pas une seule fois; je voulais aller jusqu'ŕ Rome, mais j'avais
peur de la trouver heureuse lŕ-bas. Si je suis venu ŕ Bade, si je me
décide ŕ aller ŕ Ems pour la poursuivre, c'est que j'ai appris qu'elle
avait planté lŕ le comte de Xaintrailles....
--Attendez donc, je la connais. C'est un miracle de beauté, surtout
quand elle rit. Je l'ai beaucoup vue ŕ Rome. Je sais mieux son
histoire que vous ne la savez vous-męme. Elle a enlevé le marquis
Panino qui n'osait pas tenter l'aventure. Ç'a été le bruit de la Ville
éternelle au dernier carnaval. Comment a-t-elle passé ici sans venir
me voir? J'ai causé vingt fois avec elle ŕ Rome: et causeries les plus
intimes. Elle m'a souvent donné sa main, en me priant de lui dire
sa destinée. Eh bien, mon cher ami, vous voyez qu'il ne faut jamais
désespérer; maintenant qu'elle est en rupture de mariage, vous aurez
votre tour.
--Mon tour! s'écria Georges blessé au coeur. Je la veux toute pour
l'emporter ŕ tout jamais dans ma passion. Ce n'est pas une bonne
fortune que je cherche. Dieu merci, j'ai usé ma curiosité ŕ ces
folies-lŕ. Ce que je veux retrouver en elle, c'est ma jeunesse.
Mais retrouverai-je son amour? Voyez-vous, si elle voulait m'aimer,
j'oublierais les mauvaises années de ma vie. Je renouerais la chaîne
d'or et je redeviendrais un homme.
--Tout beau! vous voilŕ déjŕ un enfant. Enfin je vois que vous
l'aimiez bien.
--Oh! oui, je l'aimais bien! je l'aimais ŕ ce point, que, depuis que
je l'ai perdue, je n'ai aimé les autres femmes que par contre-coup,
que parce qu'elles me la rappelaient. Celle-ci avait sa voix, celle-lŕ
la couleur de ses yeux; mais aucune n'avait ce charme terrible qui me
poursuit encore, qui me poursuivra jusque dans la mort. Je suis
devenu le plus grand sceptique de l'amour. Eh bien, si je retrouvais
Valentine, je tomberais ŕ ses pieds aussi ému et aussi croyant
qu'autrefois.
--Voulez-vous la voir?
--Puisque je vous ai déjŕ dit que je voulais partir demain pour Ems oů
elle doit ętre.
--Je vous demande si vous voulez la voir tout de suite.
--Vous le savez bien. Mais elle n'est pas ici.»
M. Home se leva et s'approcha de la glace en saisissant avec force la
main de Georges.
«Regardez dans cette glace.
--Mais il faudrait au moins rallumer les bougies.
--Regardez dans cette glace.»
Georges voulut regarder, mais ŕ cet instant M. Home lui passa la main
sur les yeux.
«Regardez bien.»
Georges croyait qu'il allait se voir lui-męme, mais il vit la comtesse
de Xaintrailles. Ce ne fut qu'une vision, car elle disparut au męme
instant.
«J'ai vu, dit-il, mais je ne crois pas.
--Eh bien moi, dit M. Home, je n'ai pas vu, mais je crois.»
Les bougies venaient de se rallumer. Georges, déjŕ fort ému, fűt
frappé de la pâleur de M. Home.
«Puisque vous croyez; expliquez-moi ce miracle.
--C'est bien simple; ne savez-vous pas que les âmes ont l'image plus
ou moins invisible des corps? Quoi de plus naturel que l'âme de Mme de
Xaintrailles, si elle vous aime, ne soit venue ŕ vous sur ma pričre,
quand vous l'attendez?
--Ce que vous me dites n'est pas si simple que cela. Et d'abord
comment voulez-vous que l'âme de Mme de Xaintrailles se soit si
galamment détachée de son corps?
--C'est élémentaire: l'âme, qu'est-ce autre chose que la pensée? Mille
fois par jour, votre âme quitte son corps pour faire le tour de
tous les mondes connus, męme des mondes qu'elle ne connaît que par
ouď-dire. Ne voyage-t-elle pas dans le passé qu'elle n'a jamais vu?
dans l'avenir qui n'a jamais existé?
--Je veux bien, mais pourquoi voulez-vous que l'âme de Valentine?--si
j'admets l'image de l'âme--vienne s'égarer ici ŕ l'hôtel Victoria, oů
elle ne sait pas que je suis?
--Par les attractions de l'amour, par la volonté de mon âme, car j'ai
voulu qu'elle vînt. Ne vous est-il pas arrivé souvent, quand vous
étiez au théâtre ou ŕ votre fenętre, de forcer une femme ŕ vous
regarder par le magnétisme de votre regard? Si l'homme corporel a une
telle force, pouvez-vous douter de la force cent mille fois plus forte
de l'homme incorporel? Puisque l'âme est une parcelle de la Divinité,
elle peut soulever un monde.»
Georges du Quesnoy ne fut pas convaincu, et pourtant la vision le
frappait encore.
M. Home s'étant approché de la fenętre:
«Mon cher ami, dit-il ŕ Georges, je dédaigne de vous mettre les points
sur les i. Rappelez-vous cette lettre de Marie-Antoinette oů elle
raconte que Cagliostro lui a fait voir la guillotine dans une carafe.
--La guillotine! s'écria Georges avec un sentiment de terreur.
--Eh bien, oui, la guillotine. Quand la malheureuse reine fut au
Temple, elle se rappela la carafe de Cagliostro; aussi elle demanda
toujours qu'on lui servît de l'eau dans une cruche.
--La guillotine! dit encore Georges.
--C'est un mot qui vous épouvante?
--Non, je n'ai peur de rien, mais je dois vous dire qu'une
chiromancienne m'a prédit que je mourrais guillotiné.
--Si je n'avais pas ouvert la fenętre, dit M. Home, j'interrogerais
votre destinée. Peut-ętre la glace nous dirait-elle s'il y aura ou
s'il n'y aura pas de guillotine. Mais c'est fini, je suis délivré des
esprits. Si vous voulez ŕ toute force savoir comment vous mourrez,
interrogez un miroir quand vous serez seul la nuit avec la foi au
monde invisible. Mais il ne faut pas un seul ętre vivant autour de
vous.»
M. Home respirait avec bonheur l'air vif de la nuit.
«Je suis sauvé encore une fois,» reprit-il en s'animant.
Un silence.
«Les esprits ont livré bataille, mais les voilŕ vaincus, grâce ŕ votre
présence. Adieu. Je vais me coucher; je n'ai plus peur.»
Ils sortirent tous les deux.
Georges serra la main de M. Home. C'était une main de marbre. Comme il
avait oublié sa canne, il retourna dans la chambre ŕ coucher.
Quand il passa devant le piano, ce ne fut pas sans frissonner un peu.
A peine fut-il ŕ la porte, que le piano eut encore quelques notes de
son chant lugubre.
La porte se ferma violemment derričre lui; aussi il eut beau vouloir
reprendre son air de scepticisme pour entrer chez Mlle Soubise, Mlle
Anna Delion lui dit:
«Vous avez l'air d'un mort qui a la permission de minuit.
--Ma foi, dit Georges, je suis plus mort que vif. J'ai passé la soirée
avec M. Home, qui m'a livré aux esprits.
--Eh bien, dit Aurélien Scholl avec son sourire diabolique, ici vous
serez livré aux bętes.»
IX
VOYAGE SENTIMENTAL
Le lendemain Georges du Quesnoy partit pour Ems. A peine était-il dans
le wagon qu'il vit passer la comtesse de Xaintrailles, au bras du
marquis Panino. Ils étaient en retard et ils semblaient s'entraîner
l'un l'autre. En reconnaissant la comtesse, en la voyant si belle et
si gaie, Georges ressentit un coup au coeur, un vrai coup de poignard;
car s'il avait pu admettre jusqu'ŕ un certain point que Valentine le
quittât pour se marier, comment pouvait-elle, trahissant tout ŕ la
fois le mariage et l'amour, s'abandonner avec la joie dans l'âme ŕ
ce Napolitain, qui d'ailleurs n'était ni jeune ni beau? C'est lŕ
le mystčre des passions. Si elles marchaient ŕ pas comptés avec la
logique, elles ne seraient plus des passions. C'est peut-ętre la
volonté occulte de la nature, qui veut toujours marier le beau et le
laid, le chaud et le froid, le bien et le mal, l'esprit et la bętise
pour les lois de l'harmonie universelle.
Georges pensa ŕ se jeter hors du wagon pour courir ŕ la comtesse et
lui reprocher sa double félonie. Mais ce fut le premier mouvement. Il
avait trop vécu déjŕ pour ne pas comprendre le ridicule d'une telle
action. Sa seconde pensée fut de rentrer tout simplement ŕ Bade et d'y
risquer ses derniers louis, au lieu de les dépenser dans ce voyage
inutile.
Mais il était trop tard, le coup de sifflet retentit: il fallait
partir! Il se promit de descendre ŕ la prochaine station et de monter
vaillamment dans le compartiment du marquis et de la comtesse. Ainsi
il savourerait douloureusement ce spectacle de la trahison. Comme il
n'avait peur de rien, il parlerait haut et ferme, il braverait l'amant
et tenterait de reconquérir la maîtresse.
Et en effet, dčs que le train s'arręta, il sauta ŕ terre et il alla
droit au wagon des amoureux.
Il lut sur la portičre: _compartiment réservé_. Mais il n'était
pas homme ŕ s'arręter pour si peu. Il tourna la poignée et monta
lestement.
«Chut! lui dit le marquis, en se précipitant vers lui, nous sommes
chez nous.
--Chut! riposta Georges du Quesnoy en mettant un pied sur le tapis, je
suis ici chez moi et je prends mon bien oů je le trouve.
--Qu'est-ce que c'est que cela?» dit le marquis en lui fermant le
passage.
Georges eűt certes passé outre si un des hommes du train ne l'eűt
saisi par le pan de sa redingote, en lui disant qu'il se trompait de
compartiment. Georges était vaincu. Vainement il persista ŕ vouloir
entrer, l'homme du train le fit tomber du marchepied au moment męme
oů le train repartait. Il envoya cet homme d'un coup de pied rouler
jusqu'ŕ la porte de la gare, mais il n'en était pas plus avancé.
Pourtant il se rejeta tout éperdu sur le compartiment, qui ne courait
pas encore ŕ grande vitesse. Cette fois il y pénétra comme le
tonnerre; il saisit le marquis Panino et le voulut précipiter sur la
voie. Par malheur le marquis tenait bon et il l'entraîna lui-męme dans
sa chute.
Si bien que la comtesse de Xaintrailles fit le voyage toute seule
jusqu'ŕ la prochaine station.
«Enfin monsieur! que me voulez-vous? dit le marquis ŕ Georges.
--Rien. Je veux seulement vous empęcher de voyager avec la comtesse de
Xaintrailles.
--De quel droit, monsieur?
--La force prime le droit. D'ailleurs vous n'ętes pas son mari.
--Ni vous non plus, monsieur.
--La question n'est pas lŕ. Si vous n'ętes pas content....
--Non, certes, monsieur, je ne suis pas content.
--Eh bien, voici ma carte. Vous me trouverez partout: ŕ Bade, ŕ
Paris ou ŕ Rome, si vous vous permettez de retourner par lŕ avec la
comtesse.»
Le marquis Panino donna lui-męme sa carte; aprčs quoi il alla
questionner le chef de gare sur le moyen le plus rapide de rejoindre
le train qui partait pour Ems.
Georges du Quesnoy se promettait d'empęcher son rival d'aller plus
loin, voulant lui-męme rejoindre Valentine sur la route d'Ems, quand
un de ses amis du boulevard des Italiens, qui attendait ŕ la gare le
train retournant sur Bade, frappa sur les vitres de la salle d'attente
et l'appela non-seulement par sa voix, mais par la voix de deux
demoiselles ŕ la mode dans les coulisses des Bouffes-Parisiens: Mlles
Rose Blanche et Adčle Cherche-Aprčs, la Gaieté et l'Insouciance en
voyage.
«Je suis furieux! dit Georges ŕ son ami; si tu veux partir pour Ems
avec moi, tu seras mon témoin dans un duel ŕ mort, avec ce marquis
napolitain qui vient de m'enlever la plus adorable des femmes.
--Allons donc! dit Mlle Cherche-Aprčs, une de perdue, deux de
retrouvées!
--D'autant plus, ajouta Mlle Rose Blanche, que nous avons peur de
ne pas trouver d'appartement ŕ Bade et que nous avons compté sur ta
chambre ŕ coucher.
--Ma chambre ŕ coucher! dit Georges qui se rappela alors le sabbat de
la veille, il y revient des esprits.
--Des esprits! Ils ne reviendront pas si nous sommes lŕ. Conte-nous
donc cette bętise?»
Georges leur dit mot ŕ mot ce qui s'était passé ŕ la gare et ŕ l'hôtel
Victoria.
«Et tu es assez candide pour t'imaginer que tu as vu ta bien-aimée
dans le miroir, par la volonté de M. Home?
--Oui, je suis assez candide pour cela.
--Qui te dit qu'elle n'était pas lŕ avec M. Home?
--Aprčs tout, murmura Georges, ceci n'est pas impossible, d'autant
plus qu'elle habitait l'hôtel Victoria.»
Il se décida ŕ ne pas poursuivre plus longtemps la comtesse de
Xaintrailles, jugeant que c'était maintenant ŕ elle ŕ lui donner de
ses nouvelles. Il retourna donc ŕ Bade, en compagnie de son amie et
des comédiennes.
Quand il revit M. Home, il l'interrogea sur la vision dans la glace.
Mais le médium lui prouva sans beaucoup de peine qu'il lui eűt été
bien plus difficile de préparer cette comédie impossible que d'appeler
l'âme de Valentine. Il lui jura que d'ailleurs il la croyait partie
pour Ems.
«Croyez-vous, lui dit-il, que je me suis confessé ŕ l'abbé de Ravignan
pour trahir la religion? Ç'a été pour moi une bénédiction. L'abbé de
Ravignan m'a exorcisé, mais, par malheur, les esprits reprennent peu ŕ
peu leur empire.»
Georges avait conté ŕ M. Home sa mésaventure sur le marchepied du
wagon.
«Quand vous verrez la comtesse, lui dit le médium, vous l'interrogerez
ŕ son tour.
--Mais la reverrai-je?
--N'en doutez pas. Vous vous ętes trop aimés pour ne pas vous revoir.
Dieu et la nature le veulent.
--Comment a-t-elle pu m'oublier jusqu'ŕ prendre un amant?
--Qui vous dit que ce n'est pas le chemin fatal pour revenir ŕ vous?
Du reste, elle doit repasser par Bade. Cette fois, ne manquez pas
l'occasion.»
Georges attendit la comtesse de Xaintrailles sans trop d'impatience,
parce qu'il oubliait son coeur et son esprit dans les folies du jeu
et des filles galantes. Comme il passait pour avoir de la veine, sans
doute parce qu'il était ruiné, ces demoiselles lui faisaient tous
les matins une bourse de jeu. Il était toujours sur le point de se
révolter contre lui-męme, mais comment se relever de ses déchéances
sans avoir de l'argent pour point d'appui?
Il espérait toujours faire sauter la banque. Cette bonne fortune lui
arriva un jour; mais comme il était en spectacle et comme il jouait
l'argent des autres, il ne voulut pas s'arręter en si beau chemin.
Il joua encore, il joua toujours, jusqu'au moment oů ce fut lui qui
sauta. Désespoirs et récriminations de ces demoiselles; un instant il
avait eu toutes les caresses, il en fut bientôt aux égratignures. On
l'accusa d'avoir mis de l'argent de côté.
La vérité, c'est qu'il revint ŕ Paris sans un sou, n'osant pas
attendre ŕ Bade la comtesse de Xaintrailles au retour d'Ems, parce
qu'il ne voulait reparaître devant elle qu'en vainqueur et non en
vaincu.
«Soyez mon ambassadeur, dit-il ŕ M. Home. Si vous revoyez Mme de
Xaintrailles, dites-lui que jamais héroďne de roman ne fut aimée comme
elle.»
X
LA CHIMIE ET L'ALCHIMIE
La fortune est aux audacieux: ne doutant pas de son audace, Georges ne
douta pas de sa fortune.
Ce fut alors qu'il se męla ŕ la tourbe des coquins en gants de Sučde
qui s'abattent sur Paris comme sur un grand chemin, sans souci de
l'honneur non plus que du devoir, jetant leur conscience par-dessus
le dernier moulin de Montmartre, décidés ŕ tout pour arriver ŕ tout,
brassant des affaires qui n'ont que des commencements, sautant tous
les jours ŕ pieds joints par-dessus la police correctionnelle, vrais
saute-ruisseaux des hauts financiers, tentant les hasards de la
Bourse, jetés par la fenętre du parquet, tombés dans la coulisse,
aujourd'hui courtiers, demain remisiers, aprčs-demain directeurs de
la Banque des Familles avec des succursales sans nombre. Vous les
connaissez tous: celui-lŕ crée un journal qui n'aura qu'un numéro,
celui-ci ouvre un dépôt de _pręts sur titres_, l'un vous vendra ŕ
juste prix la honte de votre ennemi, l'autre vous vendra ŕ plus juste
prix les bonnes grâces d'une femme en renom.
Je dirai pourtant que Georges du Quesnoy fut longtemps dans ce monde
perdu, homme de pensée, mais point homme d'action. Il partait de ce
beau principe: l'homme est né voleur, depuis le berceau jusqu'ŕ la
tombe, avec le souci de prendre ici, lŕ, plus loin, toujours. Le grand
art, c'est de voler avec la protection du gouvernement. Par exemple,
le marchand de vin et le marchand d'eau ne volent-ils pas sur la
qualité et la quantité avec une patente du gouvernement? Le banquier
qui fait un emprunt d'État vole d'abord le roi qui emprunte et ensuite
les peuples qui prętent. Il est volé ŕ son tour par la fille d'Opéra,
qui vole tout aussi bien, puisqu'elle se vend sans se donner.
Georges, comme s'il riait de tout, débitait ainsi mille paradoxes
subversifs, armé de Baboeuf et de Proudhon, mais ne croyant pas un mot
de ce qu'il disait.
Ses vrais amis lui conseillaient de se hasarder au Palais, puisqu'il
avait l'éloquence naturelle et l'éloquence étudiée; mais comme c'était
un chercheur et un inquiet, comme il appartenait ŕ la secte de ces
esprits turbulents et désordonnés qui n'aiment pas les chemins
officiels de la vie, il se jeta décidément dans les hasards de la
chimie.
La curiosité le dominait toujours. Tout en reconnaissant que la
science n'aimait pas les mystčres, lŕ encore il voulait trouver des
mystčres. Mais ce qu'il voulait trouver surtout, c'était le miracle
d'une fortune rapide.
Il avait d'ailleurs vu quelques-uns de ses amis de rencontre et
d'occasion, faire leur fortune dans des découvertes imprévues. La
chimie est une loterie. Il en est qui ne tirent jamais le bon numéro,
mais il en est qui gagnent du premier coup.
Il ne tenta pas de faire de l'or, comme les alchimistes du sabbat,
mais il tenta d'orifier le cuivre. Ce fut le sabbat des métaux.
Le cuivre fut rebelle ŕ toute métamorphose. On ne refait pas une
virginité ŕ la fille perdue.
Aprčs cette tentative il s'aventura dans les eaux des fées voulant
retrouver les teintures vénitiennes. C'était encore chercher l'or.
Il retrouva le blond de Diane de Poitiers, le blond du Nord; mais il
comprit que le soleil seul donnait aux filles de Venise le chaud rayon
qui les auréole.
De lŕ il passa dans les poisons. C'est lui qui inventa ou réinventa
le poison des Médicis, ou le poison des bagues et des perles. On se
souvient que, vers les derničres années de Napoléon III, beaucoup de
crevés, de journalistes, de chercheurs, de femmes déchues, de hautes
courtisanes, ne voulaient mourir que par ce poison doux et violent.
J'ai rencontré hier ŕ la table d'une comédienne un prince et un homme
politique qui portent encore le poison de Georges du Quesnoy «pour
ętre maîtres de leur mort ŕ travers les révolutions». Ils oublient
trop que le poison se dissout et perd sa vertu par la chaleur.
Par malheur pour Georges du Quesnoy, ce poison ne fit pas sa fortune,
n'étant pas ŕ la portée de ceux et de celles qui n'ont ni bagues ni
perles. Il chercha d'autres inventions, mais il n'eut pas la main
heureuse, quoiqu'il eűt le coup d'oeil subtil.
Il commençait pourtant ŕ se faire un nom dans la science. Il faut lui
rendre cette justice qu'il aimait la science pour la science.
Jusqu'ŕ Lavoisier, la chimie avait encore des airs de famille avec
l'alchimie; mais Lavoisier prit des balances pour peser l'or vrai et
l'or faux. Il marqua d'une vive lumičre les agents invisibles, comme
les oxydes; il prouva les corps simples et ruina la théorie des
transmutations: c'était ruiner la pierre philosophale. Il décomposa
tout, pour tout recomposer. Il fonda la théorie atomique, prouvant que
la combinaison des différents corps provient de la juxtaposition des
atomes. Autour de la théorie atomique se groupčrent la théorie des
radicaux et celle des substitutions. On comprit enfin que les composés
chimiques étaient les pierres d'un monument, qu'on pouvait substituer
les unes aux autres sans changer la forme ni l'équilibre. Il y
eut encore la théorie des types, qui donne la clef de la méthode
universelle. Georges du Quesnoy admirait beaucoup les Dumas et les
Wurtz; il poursuivit la science moderne jusqu'ŕ ses confins; mais il
était trop épris du merveilleux pour ne pas s'obstiner ŕ voir autre
chose que la vérité. Il rencontra Claude Bernard et le contredit par
les paradoxes les plus inattendus. Il voulut lui prouver que toutes
les théories modernes étaient déjŕ dans La Bruyčre, dans Fontenelle et
dans tous les malins du XVIIIe sičcle. Il lui développa sa théorie ŕ
lui, la théorie des affinités, qui ne voulait pas sacrifier l'alchimie
ŕ la chimie, parce que tout est dans tout, et que c'est l'inconnu,
bien plus que le connu, qui fait marcher le monde.
Que Georges fűt dans le vrai ou dans le faux, il n'en devint pas moins
un des sous-oracles de la science moderne; on citait son nom dans les
journaux scientifiques; on lut un mémoire de lui sur l'électricité
ŕ l'Académie des sciences: c'était écrit ŕ l'emporte-pičce, dans un
style imagé, qui égarait l'esprit bien plus qu'il ne l'éclairait. «Et
la conclusion?» demanda un membre de l'Académie aprčs la lecture.
Georges était peut-ętre trop raisonnable pour conclure. Qui donc a dit
le dernier mot sur toutes choses, hormis le philosophe qui a écrit:
«Je sais que je ne sais rien?»
Je ne raconterai pas toutes les chutes de Georges du Quesnoy. Un seul
sentiment le relevait au-dessus de lui-męme: c'était l'amour de la
patrie. L'orgie n'avait pu l'entamer par ce côté-lŕ. La patrie a cela
de bon--comme la mčre--qu'elle peut préserver un homme des derničres
chutes et le relever męme sur les hauteurs d'oů il était tombé.
Georges ne fut pourtant pas préservé, il tomba jusqu'au fond de
l'abîme--l'abîme sans fond. Comme Figaro, ne sachant plus que faire,
il avait pris une plume--entre deux femmes--pour fustiger cette
société bâtie sur l'argent, vivant pour l'argent, adorant l'argent.
On avait du premier coup d'oeil reconnu en lui un véhément satirique,
poétiquement inspiré dans ses patriotiques et sauvages colčres.
Quelques journaux lui donnčrent de quoi fumer.
Un de ses amis était devenu secrétaire du ministre de l'intérieur. Ils
se rencontrčrent, ils se comprirent; Georges fut inscrit parmi les
honnętes gens qui sont marqués au coeur de ces deux mots odieux:
_fonds secrets_. La veille il avait bafoué la royauté, le lendemain il
souffleta la France.
Ce ne fut pas son premier crime, ce crime de lčse-nation.
Quelles que fussent les déchéances de cet esprit malade, il gardait
avec religion le souvenir radieux de Valentine de Margival. C'était
une source pure oů il retrempait son âme; c'était le rivage aprčs
toutes les tempętes; c'était le coin du ciel ŕ travers les nuées les
plus sombres. Saint Augustin a dit: «Il n'est pas de pécheur si égaré
qui ne voie encore Dieu sur son chemin.» Georges ne voyait pas Dieu,
mais il voyait Valentine. Il se rappelait avec délices ces beaux jours
perdus oů il vivait des joies les plus pures et les plus idéales de
l'amour. Il ouvrait encore les lčvres comme pour boire les fraîches
senteurs du Parc-aux-grives.
«Ah! Valentine! s'écria-t-il avec désespoir, vous avez tué en moi ce
qu'il y avait de beau et de bon. Vous avez tué ma force ŕ ce point que
je n'ai męme pas le courage de vous haďr.»
Il ne pouvait pas la haďr, parce qu'il l'aimait toujours.
«Et pourquoi? se demandait-il. C'est qu'aucune femme n'aura eu pour
moi, męme celles qui m'ont aimé, la saveur de cette Valentine, que je
n'ai appuyée qu'une seule fois sur mon coeur.»
Un soir qu'il lisait la vie de Marie-Magdeleine, il fit cette
réflexion qu'aux femmes seules il est beaucoup pardonné si elles ont
beaucoup aimé; ce qui est une vertu chez la femme est considéré comme
une faiblesse chez l'homme. «Et pourtant, disait-il, combien qui ne
sont plus des hommes, parce qu'ils ont rencontré une femme sur leur
chemin!»
XI
LE MIRACLE DU JEU
Tout le monde a connu ŕ Paris la misčre ŕ la mode: une femme du monde
déchue, toute ravagée, toute flétrie, toute dépenaillée, qu'on trouve
le soir et le matin accroupie ŕ la porte, les mains dans les cheveux,
les yeux fixes, les joues pâles. Elle ne prie pas, elle ne pleure
pas. La fortune l'a trahie, mais n'a pas vaincu sa fierté. Si elle se
confesse ce n'est pas pour mendier, c'est parce qu'elle a trouvé une
âme sympathique. Çŕ et lŕ elle se hasarde pourtant ŕ tendre la main
discrčtement, mais, presque toujours, elle aime mieux mourir de faim,
s'enveloppant dans le linceul de sa dignité.
Georges du Quesnoy connut bien cette misčre-lŕ. Vainement il la
chassait de son seuil par toutes les roueries d'un viveur qui trouve
de l'argent dans sa famille et chez ses amis, voire męme chez ses
maîtresses. Mais ce jeu-lŕ n'a qu'un temps. Comme a dit un vieux
jurisconsulte, l'argent mal recueilli ne germe point. Aussi Georges
du Quesnoy, aprčs toutes ses escapades, se retrouvait-il plus pauvre
qu'auparavant. Trois fois déjŕ il avait changé de quartier pour
dépister ses créanciers, mais il avait beau se rouvrir de nouveaux
crédits sur la naďveté publique, il pressentait que Paris tout
grand qu'il soit lui serait bientôt impossible ŕ habiter: on le
reconnaissait ŕ sa tęte hautaine et railleuse, partout oů on lui avait
fait crédit.
En quelques années, il était parvenu ŕ dévorer cent quatre-vingt mille
francs, dont moitié pris ŕ son pčre. Il avait cent créanciers pour
l'autre moitié. Comment avait-il mangé tant d'argent? On pourrait se
demander pourquoi il n'en avait pas dépensé le triple, car il avait
joué, il avait soupé, il avait loué des avant-scčne et des carrosses;
en un mot, sans mener ŕ front découvert la grande vie des fils de
famille, il avait vécu ŕ peu prčs comme eux.
Georges du Quesnoy avait des amitiés demi-célčbres; car il y a la
demi-célébrité comme le demi-monde, ou plutôt il y a la petite
célébrité et la grande célébrité, comme il y a la petite académie et
la grande académie. Dans la confusion des personnalités la plupart des
gens ne font pas de distinction entre les unes et les autres, mais il
y a toujours une élite qui met tout le monde ŕ sa place.
Cette élite, Georges du Quesnoy en était par l'intelligence, mais sa
vie désordonnée, sans fortune et sans talent, ne lui avait pas permis
d'ętre du vrai monde de toutes les aristocraties: aristocratie de la
naissance, des lettres et des arts. Il y touchait, mais c'était tout.
Il fallait qu'il se contentât d'ętre en camaraderie avec une foule de
gens d'esprit qui sont toujours un peu sur le pavé, parce qu'il leur
manque deux choses: la dignité et le génie; fils de famille tombés,
gens de lettres et artistes qui n'ont pas signé une oeuvre pour
demain, journalistes, faméliques, admirant ou critiquant selon le
journal, s'imaginant qu'ils font l'opinion publique, parce qu'ils la
font fille publique. Comme Georges parlait haut et parlait bien dans
les brasseries politiques, littéraires, artistiques, qui sont des
académies comme les clubs sont des tribunes, on lui disait souvent de
se faire journaliste. Mais il était né pour parler et non pour écrire.
Toutefois il prit la plume et fit quelque bruit dans un journal
bruyant. Naturellement, il n'exprima pas une seule de ses opinions.
Il lui fallut prendre l'air connu de la maison. On lui donna, en
politique et en littérature, le nom des hommes ŕ exalter et le nom
des hommes ŕ fusiller ŕ traits d'esprit. Il fit cela haut la main.
Quelques niais du journalisme s'imaginent volontiers que ce qu'ils
disent est toujours parole d'Évangile. Ils s'embusquent derričre un
pseudonyme et débitent leurs injures avec la conviction que les hommes
qu'ils attaquent ne s'en relčveront pas. C'est de la poudre aux
moineaux: la fumée retombe sur eux. Ce sont eux qui ne s'en relčvent
pas. Georges n'était pas si bęte: il savait trčs-bien que, dans la
bataille de la vie, les blessures qui ne tuent pas sont des titres
de plus. Il avait trop le véritable orgueil pour tomber dans cette
puérile vanité du critique qui raisonne comme sa pantoufle: «Tout le
monde admire celui que j'attaque, je prouve que j'ai plus d'esprit que
lui, donc c'est moi qu'il faut admirer.» Georges n'avait pas l'esprit
si dépravé. Il admirait dans le journalisme cinq ou six hommes hors
ligne qui parlent haut parce qu'ils parlent bien; il aurait voulu
marcher ŕ leur suite, mais ii s'était embourbé dans le mauvais chemin.
Aussi s'arręta-t-il bientôt en route, disant que le véritable esprit
vit de considération, comme l'estomac vit de pain.
De lŕ il tomba dans la passion du jeu. Il joua partout: au café, au
tripot, au cercle, jouant ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas.
Au cercle, son compte ne fut pas long ŕ régler, car, au cercle, on ne
joue pas longtemps sur parole.
Mais il tomba du cercle dans le tripot. Lŕ on trouve toujours de quoi
jouer. Lŕ tout n'est jamais perdu, hormis l'honneur.
La fortune avait trahi Georges du Quesnoy au cercle, elle lui fut
bonne fille au tripot.
--C'est étonnant, se disait-il ŕ lui-męme, il y a lŕ un voleur sur
deux joueurs; il me faut une fičre veine pour avoir raison de tout le
monde.»
Non-seulement il avait de la veine, mais il avait des yeux. Il
empęchait les méridionaux en rupture de soleil de forcer la carte. Les
plus beaux escamoteurs le savaient décidé ŕ tout, ils n'osaient trop
le braver.
Aprčs avoir perdu vingt-cinq mille francs au cercle, les derničres
épaves de sa fortune patrimoniale, il gagna prčs de cinquante mille
francs dans les tripots, ŕ petites journées. Il retourna au cercle,
armé de toutes pičces, voulant se venger.
A sa premičre rentrée de jeu, il gagna un peu plus de cinquante mille
francs. Il est vrai que cette nuit-lŕ, celui qui perdait le plus lui
jeta les cartes ŕ la figure en l'accusant d'avoir apporté des cartes.
Qu'y avait-il de vrai? Je ne veux pas me faire l'avocat d'office de
Georges du Quesnoy, je me contente de dire qu'il sauta ŕ la figure de
celui qui l'outrageait en lui jetant ces mots qui ne prouvent rien:
--Et toi, quand tu m'as gagné il y a trois mois, avec quelles cartes
jouais-tu?
Les deux adversaires se battaient le lendemain au bois de Vincennes,
mais ils ne parurent plus au cercle ni l'un ni l'autre.
Or la moralité de ceci, c'est que Georges du Quesnoy soupa le soir
avec une comédienne ŕ la mode qu'il afficha le lendemain pour
s'afficher avec elle.
Depuis le commencement de l'hiver, il était courbé sur les tables
vertes, il n'avait jamais pris une heure pour relever la tęte et
respirer la vie. Maintenant qu'il avait cent mille francs, il se
sentait le coeur léger. Une porte d'or s'ouvrait pour lui sur le
monde. Il allait dépouiller la misčre et vivre de loisirs, en
attendant qu'il trouvât sa voie, car il se croyait toujours appelé ŕ
de hautes destinées.
En plein mois de janvier, il retrouvait un printemps en lui. La neige
qui tombait sur le boulevard lui semblait douce, comme autrefois la
neige des pommiers du Soissonnais.
«O Valentine! s'écriait-il avec un renouveau d'enthousiasme; ô
Valentine! quel printemps virginal je retrouverais cette année si tu
venais me dire: «Me voilŕ!»
XII
LA BACCHANTE
Ce coup de dés fut le commencement d'une vraie veine. Georges joua
partout: dans le cercle, dans les tripots, ŕ la Bourse, le tripot des
tripots. Il gagna partout; mais partout il fut quelque peu accusé de
faire sauter la carte, car ŕ la Bourse il avait un partner qui jouait
le contre-coup et qui ne payait pas.
Il vivait ŕ fond de train de l'argent du jeu, le prodiguant ŕ toute
occasion, achetant des tableaux peints et des tableaux vivants, des
objets d'art et des vertus.
Un soir, vers minuit et demi, il rencontra un de ses amis qui
descendait en habit de bal d'une voiture de maître.
«D'oů viens-tu?
--D'un bal de banquiers. Mais décidément l'or est trop triste, je vais
m'égayer un peu au bal de l'Opéra.»
Georges prit le bras ŕ son ami.
«L'or n'est pas si triste que cela. Moi aussi; je vais au bal de
l'Opéra. Et si tu me promets d'ętre gai, je te payerai ŕ souper avec
des drôlesses.
--Si tu me promets qu'elles seront drôles, je veux bien.»
On entra au bal. On fureta toutes les loges pour y trouver des amis,
on finit par s'établir dans une avant-scčne louée par un prince
moldave que Georges avait rencontré chez ces demoiselles. Il y en
avait quelques-unes qui venaient faire galerie dans la loge.
Le prince trépignait de joie en voyant bondir les almées parisiennes.
«Quel peuple! disait-il, comme il a de l'esprit, quoi qu'il fasse!
Il n'y a que les femmes de Paris pour avoir de l'esprit au bout des
pieds.»
Sans doute il osait hasarder cette opinion parce qu'une chicarde de la
danse levait, ŕ chaque mesure, le pied vers l'avant-scčne, en criant
au prince qu'elle lui faisait des pieds de nez. En effet, plus d'une
fois elle avait failli le toucher au nez.
Georges du Quesnoy étonna d'abord toute l'avant-scčne par ses menus
propos éblouissants. Mais ce ne fut qu'une fusée. Malgré les agaceries
des femmes, il se tourna vers le spectacle de la danse avec toute la
curiosité d'un habitué des premičres représentations. Il était de ceux
qui s'écoutent parler, mais qui n'écoutent jamais les autres, si bien
que, presque toujours aprčs avoir jeté son feu, il se recueillait dans
la ręverie ou la méditation, ne voulant causer qu'avec lui-męme, tant
il était personnel.
Que méditait-il, ou ŕ quoi ręvait-il? Il pensait toujours ŕ ses
cent mille francs. C'était le point d'appui d'Archimčde. Rien
ne l'arręterait plus dans son ambition. Cent mille francs! du
savoir-vivre et du savoir-faire, de l'esprit, de la figure et «de la
blague», il faudrait ne pas vouloir faire un pas en avant pour ne pas
arriver ŕ tout.
Mais Georges du Quesnoy n'avait pas seulement l'ambition de marcher
vers les grandeurs de ce monde. Il avait l'ambition d'arriver ŕ
Valentine, aux joies inespérées de son amour, ŕ cet idéal du coeur,
plus rayonnant que tous les mirages de l'esprit.
Le roman de sa premičre jeunesse se rouvrait ŕ toute heure dans son
souvenir et répandait dans son âme toute la fraîcheur de l'aube et de
la rosée. Quels que fussent les orages de sa vie, il n'oubliait jamais
ce point de départ rayonnant, ce ręve irréalisé, cette promesse
miragée du bonheur.
Pendant que le prince voyait par les yeux du corps toutes les comiques
péripéties du champ de bataille de la danse, Georges se créait un
autre théâtre et voyait passer sur la scčne de l'Opéra les bucoliques
de ses vingt ans. Il n'y a pas d'âme parmi les plus troublées qui ne
retourne aux sources vives.
Toutefois la réalité s'accusait trop bruyamment pour que Georges
effaçât le spectacle des danses emportées qui tourbillonnaient sous
ses yeux. Si bien qu'il męlait le présent au passé, la vérité ŕ
l'imagination, comme lorsqu'un ręve nous prend dans le demi-sommeil.
«Voyez-vous? dit-il tout ŕ coup au prince.
--Je vois tout et je ne vois rien.
--Comment, vous ne voyez pas, dominant toutes les danseuses, cette
bacchante toute couronnée de pampres qui jette des louis ŕ pleines
mains?
--Je crois que vous devenez fou.
--Regardez bien! c'est une pluie d'or.
--Si c'est une pluie d'or, je n'en suis pas ébloui du tout. Vous savez
bien, d'ailleurs, que toutes ces filles qui sont lŕ ne trouveraient
pas dans leur porte-monnaie de quoi faire une poignée d'or. Il n'y a
que Jupiter qui fasse ces miraclespour Danaé....»
Mais le prince parlait seul; Georges du Quesnoy s'était élancé hors de
la loge pour se précipiter vers la bacchante.
Comme ŕ la Closerie des lilas, il avait reconnu la jeune fille qui lui
était apparue toute blanche dans le Parc-aux-Grives.
Mais quelle métamorphose! La virginale figure, couronnée de
marguerites, était ce soir-lŕ tout allumée et toute couperosée par les
orgies nocturnes. Au lieu de ce regard timide qui se dérobait, c'était
un coup d'oeil insolent qui jetait l'ivresse et la luxure. Au lieu
de cette bouche candide, qui souriait sous la ręverie et qui n'avait
baisé que des roses, c'était une bouche gourmande et inassouvie qui
avait dévoré les sept péchés capitaux, lčvres ŕ jamais flétries et
toutes barbouillées de rouge.
«Pourquoi cette fille jette-t-elle de l'or ŕ pleines mains?» demanda
Georges en s'approchant d'elle.
Celui ŕ qui il s'adressait était un pierrot, qui se contenta de
l'appeler polichinelle en habit noir.
Georges fit un pas de plus, mais on avait commencé la quatričme figure
du quadrille _d'Orphée aux Enfers_. Ce fut une vraie bourrasque. Il
fut jeté de côté et ne retrouva pas la bacchante.
XIII
LA DESTINÉE
Cependant le jeu le trahit. Il reperdit en quelques nuits de baccarat
et en une seule liquidation de Bourse ce qui lui restait de son gain
et bien au delŕ. Il se retrouva donc plus pauvre que jamais.
Il avait tenté plus d'une fois de s'arracher au désoeuvrement qui
rongeait son âme comme la rouille ronge le fer. Tout en se prenant aux
voluptés énervantes des débauches parisiennes, il aspirait ŕ l'air vif
des sommets. Il se disait sans cesse qu'il n'était pas né pour vivre
sous cette atmosphčre. Un jour il eut le courage--il croyait qu'il
fallait du courage pour cela--de s'arracher aux mille toiles
d'araignée qui l'emprisonnaient. Il courut chez sa soeur, ŕ Rouen; il
se jeta dans ses bras, il la pria de le sauver de lui-męme.
«Quoi! lui dit-elle, tu es un homme, et c'est ŕ une femme que tu
demandes de te sauver?»
Il resta quelques jours avec sa soeur. Il s'attendrit au tableau de
famille, tout épanoui d'enfants.
«Hors de lŕ, dit-il, point de salut.
--Eh bien, mon cher Georges, lui dit sa soeur, qui t'empęche de
prendre une femme et d'avoir des enfants?
--Une femme! murmura-t-il amčrement, je n'en connais qu'une au monde.
Dieu me l'a montrée comme une raillerie: c'est Valentine de Margival.
--Pourquoi s'obstiner ŕ celle-lŕ, puisqu'elle est mariée?
--Elle est mariée, mais elle a pris mon coeur, elle a pris mon âme. Je
la sens toujours qui tue ma vie. Vous me condamnez tous, mais vous ne
savez pas comme je suis esclave de cette femme, męme loin d'elle.
Elle m'a rendu tout impossible. Je ne me sauverai d'elle que si j'en
triomphe un jour. Jusque-lŕ je l'aimerai, je la haďrai, je ne serai
bon ŕ rien.»
Il en était arrivé ŕ désespérer de tout, sinon de lui-męme.
Il songeait ŕ se retremper dans une vie nouvelle en partant pour
l'Amérique, la patrie hospitaličre des esprits aventureux, quand il
reçut un petit billet tout parfumé, écrit sur papier whatman par une
main qui n'était pas anglaise du tout:
«_Vous avez peut-ętre oublié Valentine de Marginal; si oui,
_requiescat in pace; _si non, venez continuer une conversation
interrompue dans le Parc-aux-Grives_.»
«VALENTINE.»
On ne saurait dire avec quelle joie Georges lut ces quelques lignes!
Sa jeunesse déjŕ mourante se releva, en lui avec toute sa force et
toute sa sčve. Ce fut une renaissance soudaine.
«Valentine, murmura-t-il, mon ręve, ma vie, mon âme!»
Était-ce l'amour ou la destinée qui avait dicté cette lettre? lŕ est
le mystčre de i'inconnu.
Georges du Quesnoy ne se fit pas attendre longtemps ŕ l'hôtel du
Louvre. Il lut la lettre deux fois, il baisa la signature, il prit un
coupé et se présenta un quart d'heure aprčs au numéro 17.
Une femme de chambre vint ouvrir qui lui dit que Mme la comtesse
prenait un bain, dans sa chambre ŕ coucher.
Georges ne doutait pas que Valentine elle-męme n'eűt grande hâte de le
revoir.
«Donnez-lui ma carte et dites-lui que je n'ai que cinq minutes.»
Il voulait brusquer les choses, il espérait que la comtesse le
recevrait devant la baignoire.
En effet, elle fit d'abord quelques façons, mais elle finit par lui
faire dire d'entrer dans sa chambre ŕ coucher, quoique tout y fűt sens
dessus dessous.
Il se précipita.
Elle lui tendit sa main toute mouillée, en lui disant de l'air du
monde le plus simple:
«Vous voyez que je vous reçois toute nue.
--Pas si nue que ça, dit Georges qui voulait cacher sa surprise d'un
tel accueil: vous me recevez comme Vénus avant de sortir des ondes.
--Quel langage! vous ętes démodé, mon cher. Vénus s'habille chez
Worth.
--Je le sais trop, hélas!
--Est-ce que vous payez beaucoup de factures par lŕ?
--Pas précisément: je n'ai payé chez Worth qu'une robe d'indienne
qui m'a coűté dix-huit cents francs. Les femmes que j'ai l'honneur
d'habiller ne vont pas encore lŕ.
--Et les femmes que vous n'habillez pas?
--Ah! c'est autre chose, celles-lŕ vont toutes chez Worth.
--Eh bien, dit la comtesse en se soulevant un peu, nous avons lŕ une
jolie conversation pour commencer. Mais aujourd'hui il n'y a plus que
les femmes honnętes qui parlent mal et qui ne soient pas des grues.
Georges avait admiré les épaules de Valentine. Il l'avait aimée jeune
fille svelte et légčre comme un cygne; il la retrouvait dans toute la
luxuriance de la femme, nourrie de chair, comme on disait des figures
de Rubens.
XIV
LA BAIGNEUSE
Georges du Quesnoy, qui s'était assis ŕ une distance respectueuse
de la baignoire, s'approcha tout contre, en disant avec passion, au
risque d'ętre entendu de la femme de chambre qui venait de passer dans
le cabinet de toilette:
«O Valentine, comme je vous aime!»
Ils étaient loin tous les deux de ces fraîches promenades dans le parc
de Margival oů ils ne s'aimaient que par le coeur et par l'âme; oů
l'amour ne songeait pas encore ŕ la passion; oů ils jetaient sur leurs
ręveries les chastes écharpes de la candeur.
Quel chemin ils avaient fait tous les deux en descendant!
Georges dévorait des yeux Valentine:
«En vérité, vous ętes plus belle que jamais.
--Si je n'étais pas plus belle que jamais, je ne vous eusse pas dit de
venir me voir.
--Vous ętes donc bien heureuse, comtesse, pour vous porter si bien?
--Ah! oui, parlons-en: je suis si heureuse, si heureuse, si heureuse
que je voudrais mourir.
--Vous ętes encore en pleine lune de miel.»
La comtesse prit une expression de sauvage tristesse.
C'était une question insidieuse. Georges ne voulait pas accuser
Valentine, mais il ne pouvait vaincre sa jalousie, non pas sa jalousie
contre le mari, mais contre les amants. Il faillit męme éclater en
reproches, mais il se contint.
«Voyez-vous, Georges, je suis la femme la plus malheureuse du monde.
--Pourquoi?
--Vous ne le devinez pas?» dit Valentine en veloutant ses yeux.
Les femmes veulent toujours qu'on leur parle d'elles, ŕ moins qu'elles
n'en parlent elles-męmes. La comtesse de Xaintrailles ne se fit pas
prier pour conter ses aventures ŕ Georges, tout en ne disant que
ce qu'elle voulait dire, jouant ŕ l'héroďne de roman, et voulant
convaincre son amoureux que toutes ces folies, elle ne les avait
faites que dans l'enivrement de sa passion pour lui. Ce qui était bien
un peu vrai.
«Je n'en crois pas un mot, dit Georges.
--C'est toute la vérité. Pourquoi n'ętes-vous pas venu ŕ Rome?
--Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé?
--Je vous ai envoyé mon portrait et je vous ai écrit: _Souvenez-vous
de l'oubliée_.
--Comment ne m'avez-vous pas fait signe ŕ Bade?
--Vous étiez en trop mauvaise compagnie; mais d'ailleurs je ne vous ai
pas vu, sinon sur la route d'Ems.»
Valentine dit ŕ Georges que, le voyant ŕ Bade, elle s'était cachée.
«Voilŕ pourquoi j'ai voulu aller ŕ Ems. Vous m'avez entrevue et vous
m'avez violemment séparée du marquis Panino. J'étais ravie de votre
belle action, mais je suis devenue furieuse en voyant que vous ne me
poursuiviez pas ŕ Calsruhe. Le marquis m'a retrouvée plus folle que
jamais, mais je ne l'aimais plus du tout.
--Vous l'avez donc aimé?
--J'aimais l'amour, toujours ŕ cause de vous.»
Georges expliqua ŕ la comtesse qu'il n'avait pas poursuivi l'aventure
dans la peur du ridicule.
«C'est que vous ne m'aimiez plus.
--Peut-ętre. Et qu'avez-vous fait de votre marquis?
--J'ai failli le précipiter dans le Vésuve.
--Pour un autre?
--Non. Je revins ŕ mon mari un jour de repentir en lisant une lettre
de mon pčre. Mais c'en était fait des joies conjugales. Un matin,
aprčs une nuit orageuse, je courus ŕ Civita-Vecchia, et je me jetai
dans le premier navire en partance pour Marseille, décidée ŕ revoir
Paris,--je veux dire ŕ vous revoir;--je suis arrivée
aujourd'hui męme, et mon premier travail a été de vous écrire.»
Georges baisa la main droite de Valentine.
«Mais savez-vous mon malheur? C'est que monsieur mon mari est arrivé ŕ
Paris avant moi. Voilŕ ce que vient de m'apprendre ma femme de chambre
en allant ŕ son petit pied-ŕ-terre, rue de Penthičvre. Le chemin de
fer va plus vite que le navire. Heureusement que je suis descendue
sous un nom de guerre: _Mme Duflot, rentičre ŕ Dijon_. Et puis je suis
ŕ peine connue ŕ Paris et je ne veux sortir que sous un triple voile.»
Toute cette histoire, Valentine la conta ŕ Georges du Quesnoy avec une
désinvolture charmante, comme si elle eűt parlé d'une autre.
«Oui, ŕ travers toutes ces folies, je n'ai aimé que vous, dit-elle en
penchant son front vers Georges. Mais vous n'étiez pas lŕ.
--J'y serai toujours maintenant.»
On voit que la comtesse de Xaintrailles en était arrivée ŕ ne plus
vouloir que du masque de la vertu. Elle avait une fureur de gaieté,
de passion, de curiosité qui la jetait toute en dehors. Elle avait
endormi, sinon étouffé les plus adorables vertus de la femme. En six
mois de folies, elle s'était métamorphosée en demi-mondaine. «C'est la
faute de son sang, disait Cabarrus, son médecin, il ne faut pas lui en
vouloir.»
Et pendant que la comtesse Valentine de Xaintrailles dévoilait ainsi
les années de sa vie ŕ son premier amoureux, Georges, penché au-dessus
d'elle, baisait avec passion ses cheveux rebelles et parfumés épars
au dehors de la baignoire. Il baisait aussi le cou, il baisait aussi
l'épaule. Mais Valentine, toute rieuse, lui jetait des poignées d'eau
ŕ la figure. Il ne se tenait pas pour battu, il ripostait par des
baisers. C'était un jeu charmant.
«Maintenant, dit-elle tout ŕ coup, vous allez me faire le plaisir de
passer dans le salon, parce que je vais sortir du bain.
--Puisque je suis un mythologue, lui dit-il, figurez-vous que vous
ętes une Diane ou une Vénus qui sort de la fontaine ou de la mer, sans
s'inquiéter des simples mortels.
--Je vous comprends, mais je ne suis pas de marbre.
--Je vous jure que je vous regarderai comme une statue, avec le
sentiment de l'art.
--C'est égal, allez vous-en par lŕ.
--Eh bien, savez-vous le fond de ma pensée? c'est que si vous étiez
belle comme une déesse, vous ne vous cacheriez pas.
--J'y ai pensé, dit-elle, mais, tout bien considéré, j'ai encore de la
pudeur, męme pour ceux que j'aime.
--La pudeur! simple question d'atmosphčre.»
XV
PROMENADE AU BOIS
Je ne sais pas bien ce qui se passa ce jour-lŕ entre l'amoureux et
l'amoureuse. Ce que je sais bien c'est que le lendemain, dans leur
joie d'ętre ensemble, ils étaient allés déjeuner ŕ Versailles.
En débarquant ŕ l'hôtel des Réservoirs, Georges avait signé au livre
des voyageurs: _Baron de Villafranca_. C'était son nom quand il
voyageait. Il avait encore un autre pseudonyme pour se cacher dans les
petites occasions: _Edmond Duclos_.
C'était au temps oů Versailles n'avait pas encore reconquis la
dictature. On n'allait lŕ que pour voir l'olympe de Louis XIV. Les
amoureux trouvaient leur compte dans cette solitude des solitudes,
hantée autrefois par toutes les passions et toutes les voluptés. Il
en reste bien encore quelque chose. Les Lavalličre, les Fontange, les
Montespan répandent toujours dans les bosquets les douces senteurs de
leurs chevelures dénouées. Qui n'est pas amoureux ŕ Versailles n'a
jamais été pris par les magies de l'amour.
Georges et Valentine amoureux ŕ Paris furent amoureux ŕ Versailles.
Avant le déjeuner, pour aiguiser la faim, ils s'égarčrent dans le
parc, elle, suspendue ŕ son bras, lui, toujours penché pour lui baiser
le front. C'était un gracieux spectacle de les voir tous les deux,
ivres de jeunesse, sans souci du monde, oublieux du temps et cueillant
l'heure. Georges publiait męme qu'il avait ŕ peine de quoi payer
l'addition ŕ l'hôtel des Réservoirs.
Il paraît que ce ne fut pas un gracieux spectacle pour tout le monde,
car un autre promeneur plus matinal encore faillit les heurter dans
l'Ile d'amour.
C'était le comte de Xaintrailles.
Comment était-il lŕ? C'était bien simple: Mlle Émilie, la femme de
chambre de la comtesse, le trahissait et la trahissait pour se venger
de tous les deux.
Mlle Émilie était une de ces créatures qui fleurissent dans la fange
parisienne. Fille de couturičre, elle avait eu des aspirations; mais
elle avait manqué de figure et de tenue pour prendre les premiers
rôles. Elle compta sur l'amour, mais elle eut d'abord ŕ faire ŕ un
drôle qui la roua de coups et la dépouilla, quoiqu'elle n'eűt encore
rien. Elle se résigna ŕ se faire femme de chambre, mais femme de
chambre de grande maison, en attendant qu'elle pűt se faire servir
elle-męme. C'était un caractčre par la volonté; elle n'aimait rien que
l'argent. Elle était fort caressante avec Mme de Xaintrailles; mais
c'était les caresses du chat qui cache ses griffes. A l'époque oů la
comtesse commençait ŕ tourbillonner dans les galanteries romaines, le
comte, qui aimait les femmes pourvu que ce fussent des femmes, avait
fait deux doigts de cour ŕ Mlle Émilie, en lui disant que c'était
en faveur des parisiennes. La femme de chambre fűt charmée d'ętre
désagréable ŕ sa maîtresse. Si bien qu'un jour Valentine trouva cette
fille en tęte-ŕ-tęte avec le comte, qui voulut se sauver de lŕ en
disant que c'était un quiproquo.
La comtesse, qui n'était pas sérieusement jalouse, avait pardonné ŕ
Emilie, croyant se faire une créature. Mais la femme de chambre aimait
trop les trahisons et les catastrophes pour ne pas garder son libre
arbitre et pour ne pas tromper le mari et la femme. Elle y trouvait
d'ailleurs son compte et elle aimait beaucoup l'argent.
Voilŕ pourquoi M. de Xaintrailles avait été renseigné sur le voyage ŕ
Versailles.
Que fit-il en les voyant dans l'Ile d'amour? Un contre deux: on
pouvait le jeter ŕ l'eau. Il se détourna pour mieux jouir du tableau
de son malheur.
Jusque-lŕ, quoique séparé de sa femme, non pas officiellement, mais
par les fugues perpétuelles de Valentine, il croyait encore ŕ la vertu
de cette belle aventureuse. Il n'y avait plus ŕ douter.
«C'est bien, dit-il, je me vengerai.»
Les jeunes gens étaient si éperdus dans leur bonheur, si aveuglés par
ce nuage de volupté dont Homčre a couvert Mars et Vénus, qu'ils ne
virent pas le mari. Une heure aprčs ils déjeunaient gaiement ŕ l'hôtel
des Réservoirs, pendant que le mari déjeunait tristement ŕ l'hôtel de
la Chasse. Pauvre mari! pourquoi ne pas dire: pauvres amants!
Le soir męme, au café Anglais, Georges vit venir ŕ lui deux hommes
qu'il ne connaissait pas. Le plus grave prit la parole:
«Vous ętes bien M. le baron de Villafranca?
--Oui, dit Georges, qui se rappelait avoir pris ce nom-lŕ le matin ŕ
l'hôtel des Réservoirs.
--Monsieur, le comte de Xaintrailles se trouve offensé par vous, il
veut avoir demain matin raison de cette offense, voulez-vous nous dire
les noms de vos témoins?»
Georges dînait avec trois amis; il les regarda tous les trois:
«Messieurs, leur dit-il, répondez.»
Deux des amis se levčrent et accompagnčrent tout de suite les
ambassadeurs de M. de Xaintrailles jusque sur le boulevard. Ils
revinrent bientôt et demandčrent ŕ Georges s'il reconnaissait avoir
offensé le comte de Xaintrailles.
«Non-seulement je l'ai offensé, mais je veux l'offenser encore.
Puisque ce n'est plus un secret, je vous dirai que j'adore sa femme,
que ni lui ni ses témoins ne m'empęcheront de l'adorer aujourd'hui,
demain, toujours.»
On décida que le duel aurait lieu le lendemain ŕ huit heures dans
les bois de Meudon. On se battrait au pistolet parce que M. de
Xaintrailles avait perdu l'habitude de faire des armes.
On dîna rapidement, aprčs quoi Georges courut ŕ l'hôtel du Louvre, oů
Valentine l'attendait en lisant un journal du soir.
«Demain, lui dit-il, vous apprendrez quelque chose en lisant le
journal.»
Elle eut beau le questionner, il ne voulut pas dire un mot de plus.
Mais il avait beau vouloir refouler son inquiétude, une légčre
expression de mélancolie passait sur sa figure. Il était brave, mais
il ne pouvait s'empęcher de penser ŕ tout le bonheur qu'il perdrait
s'il était tué le lendemain.
Dans la soirée, Valentine parla de son mari; elle raconta ŕ Georges
comment il la laissait sans le sou, sous prétexte de sauvegarder sa
dot, dont il ne voulait pas se désemparer. Par malheur, M. de Margival
avait généreusement donné ŕ sa fille plus qu'il ne devait lui donner.
Elle ne pouvait donc plus compter sur lui.
«Comment faire, dit-elle, pour ressaisir ma dot dans les mains
crochues de cet avare?
--Ah! pardieu! s'écria Georges, qu'il ne se trouve jamais sur mon
chemin, car je le provoque et je le tue en duel.
--Je ne lui veux pas de mal, dit Valentine, mais vous me feriez lŕ une
belle grâce.»
Il y eut un silence expressif. Elle continua:
«Mais c'est surtout ŕ lui que vous feriez une belle grâce. Il a la
goutte, il a la pierre, il a déjŕ la mort dans le coeur. Quand je
pense que je suis allée m'enchaîner ŕ ce tombeau, quand je pouvais me
jeter dans vos bras et faire un mariage d'amour.»
Valentine se jeta dans les bras de Georges toute éplorée et toute
éperdue.
«Ah! Georges, je vous aimais et je vous aime, tandis que cet homme je
ne l'aimais pas et je le hais. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce mariage
sacrilčge, quand il m'avait promise ŕ vous?»
Valentine eut tout un quart d'heure d'éloquence. Georges eut tout un
quart d'heure de passion.
«Ah! si je pouvais tuer demain M. de Xaintrailles!» se disait-il ŕ
lui-męme.
Ils ne se tučrent ni l'un ni l'autre.
M. de Xaintrailles tira le premier ŕ vingt pas. Georges du Quesnoy se
croyait sűr de son coup, mais il ne fit que défriser son adversaire.
M. de Xaintrailles voulut recommencer. Les témoins de Georges
obtinrent que les deux adversaires partiraient de vingt-cinq pas et
tireraient quand ils voudraient.
Georges impatient tira le premier, toujours sűr de lui. Quand M. de
Xaintrailles fut ŕ dix pas, les témoins de Georges lui cričrent:
«Tirez donc!»
Il tirai mais n'atteignit pas non plus son rival. Tous les deux
demandčrent ŕ recommencer, mais les témoins se récusčrent, en disant
que c'était déjŕ trop.
Georges n'en revenait pas d'avoir cassé tant de poupées et de n'avoir
pu toucher un homme, car c'était la premičre fois qu'il se battait au
pistolet.
Quand il raconta son duel ŕ Valentine, il lui dit:
«J'espérais vous apporter un extrait mortuaire, mais c'est ŕ peine si
j'ai coupé une mčche de cheveux ŕ votre mari.»
XVI
QUE LE BONHEUR EST UN RĘVE QUAND ON N'A PAS D'ARGENT
«Enfin, se disait Georges du Quesnoy, je tiens donc le bonheur sous la
main. Mon idéal c'était Valentine: j'ai fini par atteindre mon idéal.»
Ce n'était pas encore le bonheur, Valentine n'aimait pas comme lui.
C'était la curieuse et l'affamée. Elle se jetait ŕ travers la vie
pour toucher ŕ tout et pour mordre ŕ tout. Mais elle avait trop
d'aspirations pour se contenter des joies de l'amour caché.
«Tu es trop belle pour m'aimer bien, disait Georges. Il faut que tu
montres ta beauté ŕ tout le monde. Tu aimes encore mieux l'admiration
que l'amour.
--Peut-ętre, disait-elle. Je suis comme la vigne: j'éclate dans ma
sčve, je brise mon corset. Mon coeur m'emporte au triple galop ŕ
toutes les sensations. J'aime tout ce qui est beau: les robes et
les chevaux, la fleur dans l'hiver, la neige dans l'été, le soleil
partout. Mon esprit a toujours soif et toujours faim.»
Georges lui disait souvent:
«Vois-tu, ton amour est charmant, mais il a des entr'actes. Tu
m'embrasses bien, mais tes lčvres sont distraites. Quand tu me
regardes, c'est divin, mais tu vois plus loin que moi. Ah! Valentine,
ce n'est pas lŕ le véritable amour. Si tu m'aimais comme je t'aime, tu
viendrais vers moi sans détourner la tęte et sans regarder au-delŕ.
--O mon Dieu, oui! répondait gaiement Valentine. Tu voudrais me
comparer ŕ la louve affamée, qui court chercher la pâture de ses
louveteaux, sans rien voir sur son chemin. Tu veux que je te serve mon
coeur sans qu’une seule pensée étrangčre l'agite et le fasse battre.
Tu veux l'amour dans toute sa fureur et dans tout son aveuglement. Il
y a peut-ętre des femmes qui donnent cet amour-lŕ; va les chercher.»
Et, se reprenant:
«Non, prends-moi comme je suis. Vois-tu, mon cher Georges, tu ne seras
jamais heureux, parce que tu cherches l'absolu.
--Ah! tu sais bien qu'il n'y a point d'absolu.»
Si Georges n'était pas heureux, męme dans son bonheur, c'est qu'il
pressentait déjŕ que Valentine lui échapperait comme un beau ręve.
Ce qui l'empęchait aussi d'ętre heureux, c'est qu'il n'avait pas
d'argent et qu'il n'y a point d'amour sans argent--dans le beau monde.
C'était aussi le malheur de Valentine dans son bonheur. Quand le
marquis Panino l'avait enlevée, il ne lui avait pas donné d'argent,
mais il lui avait donné une vie fastueuse, ŕ Bade, ŕ Ems et ailleurs.
Elle n'avait eu qu'ŕ parler pour ętre obéie dans tous ses caprices de
grande dame et de grande prodigue. Le marquis Panino n'avait, pas jeté
moins de cent mille francs dans ce voyage d'agrément s'il en fut.
C'était męme pour cela qu'il l'avait «plantée lŕ», comme on dit clans
le beau monde. Il avait sans doute compris qu'avec de si belles dents
elle lui croquerait sa fortune en quelques saisons. Rien n'est plus
difficile, en amour, que de compter avec les femmes, ou plutôt de leur
apprendre ŕ compter, surtout quand on a commencé par prendre des airs
de prince. Elles ne s'inquičtent pas de la question d'argent, ou
plutôt elles ne veulent pas s'en inquiéter. Est-ce qu'on marchande
l'eau aux fleurs et le millet aux oiseaux? Une femme est une fleur et
un oiseau.
La comtesse de Xaintrailles était venue échouer sans un sou ŕ l'hôtel
du Louvre, poursuivie par son mari qui l'adorait, mais se cachant
de lui. Si elle avait choisi cet hôtel de provinciaux de
l'arričre-province, c'est qu'elle savait bien que le comte n'irait pas
la chercher lŕ.
Mais cela ne lui donnait pas d'argent. Une femme ne se fait jamais
enlever sans ses diamants; mais la comtesse n'avait pas emporté sa
parure des grands jours. A son arrivée ŕ Paris, elle ne put mettre en
gage qu'une broche et deux bagues. Les pendants d'oreilles étaient
pour elle deux lumičres pour sa beauté: elle ne voulait pas les
éteindre. Aussi ne fut-elle pas longtemps sans crier misčre ŕ sa femme
de chambre.
On sait que Mlle Émilie n'était pas la premičre venue. Ancienne femme
de chambre d'une actrice, c'était une fille de ressources, pareille
ŕ ces anciens valets de comédie qui se mettaient en campagne pour
trouver de l'argent ŕ leur maître.
La comtesse s'était attachée ŕ sa femme de chambre, et n'avait pu s'en
séparer depuis son mariage, quoiqu'elle la trouvât trop familičre avec
le comte. Mais, dans sa fierté, Valentine avait dit devant les plus
belles Romaines qu'elle mettrait sur son blason: «Jalouse ne daigne.»
Ce n'était pas pour s'inquiéter des yeux noirs de sa femme de chambre,
d'autant plus qu'elle se gardait bien de mettre le comte sous clef.
Moins il était avec elle, plus il s'en trouvait bien.
Les femmes ne sont pas prévoyantes quand elles ont une fortune sous
la main. Mais quand elles sont sans argent, elles se tournent vers le
lendemain avec inquiétude.
Valentine se disait vaguement qu'elle avait encore sa dot, s'imaginant
que deux cent mille francs sont un capital aujourd'hui. Mais comment
reprendre sa dot? La femme de chambre lui amena un matin une marchande
ŕ la toilette de ses connaissances, qui lui pręta sur cette dot cinq
mille francs, comme si c'était par amitié; d'autant plus que, ce
jour-lŕ, elle ne lui offrit rien de sa boutique.
XVII
LE MARI ET L'AMANT
Georges du Quesnoy s'imaginait qu'il était débarrassé du mari, mais
il comptait sans le mari. M. de Xaintrailles avait commencé par le
commencement, c'est-ŕ-dire par le duel, voulant se donner les airs
d'un galant homme, mais il voulait finir par les tribunaux.
Voilŕ pourquoi un beau matin, le commissaire de police vint sonner ŕ
la porte de la comtesse, au n° 17 de l'hôtel du Louvre.
La femme de chambre, qui trahissait toujours le mari et la femme,
poussa un cri et tomba en syncope; comme si elle n'eűt pas été
prévenue de cette visite inopportune.
Mme de Xaintrailles, qui entendit ce cri, pressentit un malheur: elle
se jeta hors du lit pour aller fermer le verrou de sa chambre; mais il
était déjŕ trop tard.
Le commissaire de police parut sur le seuil. Il n'était pas seul: M.
de Xaintrailles se montra presque aussitôt. Le flagrant délit fut
constaté, car la comtesse non plus n'était pas seule. La comtesse se
jeta au-devant de son mari:
«Quoi! lui dit-elle, furieuse, échevelée, menaçante, vous n'avez pas
honte de venir ainsi chez moi!
--Chez vous! madame, dit M. de Xaintrailles, je suis chez moi.
--Vous ętes chez moi!» lui cria Georges du Quesnoy, qui venait
d'arracher le rideau du lit pour se draper dedans.
Ce fut une vraie tragi-comédie.
Georges du Quesnoy voulut avoir raison du commissaire et du mari, mais
il n'était pas assez habillé pour cela. Pourtant il les secoua si
rudement tous les deux que le commissaire de police appela deux agents
qui attendaient dans le salon. La force représentait la loi, la loi
représentait la force.
Valentine finit par demander grâce ŕ son mari.
«Monsieur, je vous abandonne ma dot, mais laissez-moi libre.»
Le mari n'avait plus d'oreilles pour sa femme.
Le soir, elle couchait au couvent des Dames-Sainte-Marie. Georges du
Quesnoy couchait ŕ la Conciergerie, non pour le flagrant délit, mais
pour coups et blessures.
Il avait pu parler un instant ŕ la femme de chambre en quittant le
Grand-Hôtel.
«Je ferai votre fortune, lui dit-il, mais répondez toujours que vous
ne savez pas qui je suis.»
En arrivant au greffe de la Conciergerie, il avait pu s'entendre avec
Mme de Xaintrailles.
Comme quelques aventureux qui sont un peu aventuriers, Georges avait
dans sa poche des cartes toutes faites pour les deux pseudonymes qui
lui servaient souvent:
EDMOND LEBRUN
CHIMISTE.
Regent street, 93.
Et celle-lŕ:
BARON DE VILLAFRANCA
Hôtel du Louvre.
Lorsque le commissaire de police l'interrogea, il s'empressa de
répondre qu'il se nommait Edmond Lebrun, chimiste, né ŕ Turin,
domicilié ŕ Londres, habitant l'hôtel du Louvre pendant son passage ŕ
Paris.
Quand le juge d'instruction l'interrogea le lendemain, il le serra de
prčs par ses questions. Mais il était homme ŕ tenir tęte ŕ tous les
juges d'instruction. Il lui fagota une histoire si vraisemblable, que
celui-ci n'y vit que la vérité.
«Mais pourtant, monsieur, on ne vous connaît pas au Grand-Hôtel
d'autre appartement que celui de Mme de Xaintrailles.
--Je suis venu de Londres tout exprčs pour la voir.
--Vous la connaissiez donc?
--Je l'ai connue ŕ Rome, ŕ Nice, ŕ Bade.
--Pourquoi ce nom de Villafranca quand vous vous ętes battu avec le
comte?
--Quand je voyage, je prends un titré qui appartient ŕ ma famille, je
suis baron de Villafranca, mais le nom de mon pčre comme le mien est
tout simplement Lebrun. Je me nomme Edmond Lebrun.»
Malgré les coups et blessures, Georges, grâce ŕ son pčre, finit par
obtenir sa liberté jusqu'au jour oů il devrait répondre ŕ l'accusation
d'adultčre.
La prévention fut longue, comme toujours; mais le matin męme oů lé
procčs fut appelé, aucun accusé ne répondit ŕ l'appel.
Les curieux en furent pour leur curiosité, car l'affaire ne vint pas.
M. de Xaintrailles, pour l'honneur de son nom, avait enfin compris
qu'il était indigne de lui de faire ce procčs. On rendit une
ordonnance de non-lieu.
Il espérait que Georges du Quesnoy, ŕ cause des coups et blessures, ne
reparaîtrait pas de sitôt. Aussi chercha-t-il ŕ se rapprocher de sa
femme par toute une comédie sentimentale. Mais Valentine avait mis sur
son blason: JE N'OUBLIE PAS. Non-seulement elle n'oubliait pas, mais
elle voulait se venger.
Elle refusa de recevoir M. de Xaintrailles, quelles que fussent les
pričres de ses billets doux. Elle demanda une séparation de corps,
voulant enfin disposer de sa fortune. Mais M. de Xaintrailles lui fit
croire que la justice n'avait que suspendu son action; si Valentine
refusait de se remettre avec lui, il finirait par la faire condamner
comme adultčre. Il la menaça d'ailleurs de lui envoyer les gendarmes
pour la réintégrer au domicile conjugal.
La comtesse était désespérée; elle se penchait ŕ toute heure ŕ sa
fenętre de l'hôtel du Louvre, oů elle était retournée, comme si elle
dűt voir revenir Georges du Quesnoy.
Elle avait repris sa femme de chambre, qui s'était juré ŕ elle-męme
de ne plus trahir sa maîtresse, parce que le comte ne l'avait pas
récompensée.
Huit jours se passčrent sans que la comtesse vît venir son amant.
Enfin, un soir, vers minuit, on sonna ŕ sa porte. Elle savait bien que
ce n'était pas son mari. Elle ouvrit elle-męme, la femme de chambre
étant déjŕ endormie.
«C'est toi!
--Enfin!».
Et des étreintes ŕ perdre l'âme.
«J'ai deviné que tu reviendrais ici, voilŕ pourquoi j'y suis revenue.
Que m'importe l'opinion des gens de cet hôtel! L'opinion, c'est toi:
si tu es content, je suis contente.»
On se conta les ennuis et les anxiétés de la prison et du couvent; on
avait pu s'écrire, mais on n'avait pas tout dit; la haine contre M. de
Xaintrailles s'était accrue de toutes les douleurs subies depuis trois
mois.
«Je me vengerai, dit Valentine.
--Je te vengerai, dit Georges.
--Songe qu'il tient ma fortune et qu'il me laisse sans argent.
Georges était désespéré de ne pouvoir mettre une fortune aux pieds de
Valentine.
«Combien a-t-il ŕ toi?.
--200,000 francs! toute ma dot. Il n'a pas pu la manger, puisque je
suis mariée sous le régime dotal.
--Que dit ton pčre?
--Mon pčre lui donne tort, mais il me donne tort aussi. Il est
d'ailleurs malade ŕ Margival. Il ne veut pas encore revenir ŕ Paris.
Mes deux avocats, Me Allou et Me Carraby, me disent que je ne puis
demander la séparation de corps si je ne suis d'accord avec mon mari.
Et, d'ailleurs, męme si on me donne raison contre lui, ce sera bien
long. Le comte veut que je revienne chez lui. Que vais-je faire? que
vais-je devenir?
--Comptez sur moi, dit Georges.»
Mais il ne pouvait pas męme compter sur lui.
Vers une heure du matin, comme Georges allait sortir de l'hôtel du
Louvre, il fut rappelé par une voix de femme. C'était la femme de
chambre de la comtesse.
«Monsieur, lui dit-elle, il ne faut pas que madame sache que je vous
parle, mais je vous avertis que nous sommes tout ŕ fait sans argent.
On fait crédit ŕ madame sur sa bonne mine et sur son titre de
comtesse, mais les créanciers se fâcheront bientôt. Par exemple,
avant-hier, nous avons acheté des dentelles aux magasins du Louvre, je
les ai portées au Mont-de-Piété et je n'ai eu que 1,000 francs qui on
été éparpillés dans la journée, car madame devait ici avant d'aller au
couvent. Ce qui ne l'a pas empęchée de donner cinq louis ŕ une pauvre
femme qui portait deux enfants dans ses bras. Or, aujourd'hui, on est
déjŕ venu deux fois des magasins du Louvre. Jugez donc si on savait
que nous avons mis les dentelles au Mont-de-Piété!
--Que vous ont-elles coűté?
--Je crois bien que c'est 2,400 francs.»
Georges du Quesnoy fouillait dans sa poche.
«Tenez, ma chčre, voilŕ cinq louis, ne dites pas ŕ la comtesse que
je vous les ai donnés; si on revient des magasins du Louvre, vous
enverrez chez moi; mais ne prenez pas la fičvre, ni vous ni votre
maîtresse: je veille sur vous.
--Voyez-vous, monsieur, il n'y a qu'une chose ŕ faire, c'est de se
débarrasser du mari.
--Vous en parlez bien ŕ votre aise.
--Ayez encore un duel avec lui, cette fois vous ne le manquerez pas.»
Georges alluma un cigare sous les arcades de la rue de Rivoli.
«Cette fille a raison, dit-il, il faut se débarrasser du mari.»
Comme il disait ces mots, l'heure tintait ŕ Saint-Germain-l'Auxerrois,
ce qui le ramena ŕ ses impressions du monde invisible.
XVII
LA PRÉFACE DU CRIME
C'était un vendredi; M. de Nieuwerkerke recevait. La plupart des
invités étaient déjŕ partis, il ne restait plus chez lui que les
intimes, qui assistaient, tout en fumant, aux spirituelles caricatures
d'Eugčne Giraud. Un peintre sortit, un ami de Georges du Quesnoy. Il
le reconnut dans la nuit.
«Bonsoir, Georges, que diable fais-tu lŕ ŕ cette heure occulte? Est-ce
que tu songes ŕ aller coucher avec la Vénus de Milo?
--Non, je n'aime pas les femmes de marbre.
--Ni les antiques!
--Ah! que vous ętes heureux, vous autres artistes, vous vivez de rien
quand vous n'avez rien; vous ne vous éparpillez pas aux quatre coins
du monde. Vous ętes consolés de tout par la passion de l'art.
--Je te croyais l'homme du monde le plus heureux. Je t'ai rencontré
avec la plus belle femme que j'aie vue, et on m'a dit que tu faisais
de l'or.
--Allons donc! je fais de la chimie et point de l'alchimie. Cela
coűterait d'ailleurs plus cher ŕ faire de l'or qu'ŕ en acheter.
--Je ne suis pas en peine, tu es de ceux qui ne restent pas en chemin.
Quand on te voit, on juge que tu monteras haut. Adieu, je vais me
coucher.»
Resté seul, Georges murmura:
«Je monterai haut. Si j'étais superstitieux, je dirais que tout me
conduit ŕ la guillotine.»
Il vit alors dans les parterres du Louvre une guillotine avec le
bourreau, le prętre et le condamné.
Dans l'aprčs-midi du lendemain, Émilie lui apporta cette lettre de sa
maîtresse:
_Mon ami,
Je suis désespérée; M. Dufaure, avocat de mon mari, est venu me voir
tout ŕ l'heure. Il m'a dit les choses les plus éloquentes en me
parlant du devoir. Si tu ne viens pas tout de suite me voir, je
serai peut-ętre assez bęte pour retourner avec le comte. Tu sais,
d'ailleurs, que je n'ai pas d'argent et que je ne veux pas que tu m'en
donnes.
Je t'attends.
VALENTINE._
«Oh monsieur! dit la femme de chambre, c'est moi qui suis au
désespoir. Nous voyez-vous rentrer avec monsieur? Il paraît qu'il nous
emmčnera ŕ Rio de Janeiro. C'est ŕ se jeter ŕ l'eau. Vous n'ętes pas
un homme a ne pas trouver un truc pour nous tirer de lŕ. Du reste, moi
je m'en moque, parce que moi je ne partirai pas. Chacun a ses affaires
ŕ Paris.
--Je comprends, vous ne voulez pas emmener votre amant au delŕ des
mers? Vous figurez-vous que je vais laisser partir Valentine? Jamais!
--Comment ferez-vous?
--Ah! si vous vouliez ętre de moitié dans l'aventure, ce serait
bientôt fait.
--Voyons, parlez.»
Georges ne parla pas si vite.
«Non, dit-il. C'est tenter le diable:
Souvent femme varie,
Bien fol qui s'y fie.
--Vous ne me connaissez pas! je ne suis pas une grue, ni une éventée.
--Qu'est-ce que votre amant?
--Mon amant? J'en avais deux, un surnuméraire ŕ la Banque et....
--Et?....
--Le comte de Xaintrailles!
--Quoi! vous trahissiez la comtesse?
--Non, je trahissais le comte: il n'avait pas de secret pour moi et je
n'avais pas de secret pour madame.
--O temps! ô moeurs! s'écria Georges, qui ne pouvait s'empęcher de
«blaguer», męme dans les moments les plus critiques.
--Oui, mais maintenant, n-i ni, c'est fini.
--Vous ne pourriez pas le réacpincer, cet Othello?
--Oh! il ne faudrait pas me mettre en quatre pour cela.
--Eh bien, allez-y gaiement, je vous dirai pourquoi.
--Non, dites-le-moi d'abord.
--C'est que quand vous serez redevenue sa maîtresse, nous serons
maîtres de lui.
--J'y vais de ce pas.
--Allons donc!
--Comme je vous le dis! Voici une lettre que madame vient de me donner
pour le comte; au lieu de la mettre ŕ la poste, je cours la lui
porter.»
Et Émilie partit du pied gauche pour aller trouver le comte qu'elle
ne voyait plus, tandis que Georges du Quesnoy partait pour l'hôtel du
Louvre.
Il la rappela dans l'escalier:
«Pas un mot au surnuméraire.
--Ętes-vous bęte!
--Je connais du monde ŕ la Banque, je vous réponds qu'il fera son
chemin.
--J'en accepte l'augure.»
Quand Georges du Quesnoy fut avec Mme de Xaintrailles, il s'aperçut
que l'avocat du comte avait bouleversé ce jeune esprit ardent ŕ tout,
męme au bien. Elle avait déjŕ tempéré sa passion. Elle comprenait
qu'une femme bien née doit ętre pręte ŕ tous les sacrifices. On lui
pardonnerait ses folies, qui n'étaient que des folies d'une heure, si
elle redevenait loyalement la comtesse de Xaintrailles. Au contraire,
que ferait-elle en se maintenant dans sa révolte? Le comte, justement
blessé, la punirait en s'opposant ŕ une séparation de corps. Il
continuerait ŕ retenir ses biens. Son pčre menaçait de ne plus la
recevoir. Elle n'avait pas ŕ Paris une seule amie qui lui tendît la
main.
«Tant pis, mon cher, dit-elle ŕ Georges. C'est l'heure de la
résignation.
--Ah! si j'avais tué votre mari en duel!
--Oui, vous avez manqué l'occasion ce jour-lŕ de faire notre bonheur ŕ
tous les trois.»
Et quoiqu'elle eűt bien envie de pleurer, Valentine se mit ŕ rire.
Georges du Quesnoy était au paroxysme de la passion. En la voyant si
belle, en la voyant si prčs de lui échapper, il jura qu'elle ne serait
plus au comte.
Le soir, il eut une seconde conférence avec la femme de chambre.
Émilie lui conta qu'elle avait été fort mal reçue par M. de
Xaintrailles. Il était malade. Elle avait pénétré jusqu'ŕ son lit,
mais il s'était écrié qu'il ne la voulait plus voir tout en lui
montrant la porte.
«Alors, vous ne le verrez plus?
--Je ne suis pas fille ŕ obéir quand on me dit de m'en aller. J'ai si
bien fait mon compte, qu'une demi-heure aprčs j'étais encore au chevet
de M. Xaintrailles, lui rappelant les beaux jours de Rome et de
Tivoli, quand il me disait que plus je l'aimais, plus il aimait
sa femme. En un mot, j'ai triomphé ŕ ce point qu'il m'a priée de
retourner demain. Il a fini par me dire: «Tu as bien fait de venir
me demander ton pardon, sans quoi je ne t'aurais pas gardée quand la
comtesse va revenir chez moi.»
--Quoi! s'écria Georges, il en est si sűr que cela?
--Oui, son avocat n'en doute pas.
--Eh bien, il était temps de se mettre en travers.
Georges du Quesnoy demanda ŕ Emilie quelle était la maladie du comte.
Elle lui répondit que c'était une névralgie qui lui faisait souffrir
mille morts. Il souffrait en outre de la goutte et de la pierre, mais
son médecin, qui était venu ce jour-lŕ, lui promettait que dans huit
jours il serait debout.
--Eh bien, je vous réponds que dans huit jours il ne sera pas debout,
dit Georges en se mordant les lčvres.
Vers minuit il alla se jeter encore aux pieds de la comtesse de
Xaintrailles, pour lui dire tout son désespoir, ŕ la seule idée de la
voir retourner avec son mari.
Elle parut bien peu touchée; elle semblait n'écouter que son devoir,
ou plutôt elle était toute soumise encore aux conseils de M. Dufaure.
Le célčbre jurisconsulte lui avait montré le néant de toutes ces
passions bâties, sur un volcan, qui n'enfantent que la douleur et le
remords.
«Non, se disait-elle, quand on porte mon nom, on n'a pas le droit de
trahir la société. Je veux reconquérir la considération; le bonheur
que vous me donnez m'épouvante. Je vous aime encore, mais je sens que
je vous haďrais bientôt. Je vais quitter cet hôtel de malheur....
--Pouvez-vous dire cela? Valentine.
--Cet hôtel de bonheur, si vous voulez. J'ai déjŕ envoyé ma femme de
chambre au comte pour le soigner. Moi, je vais retourner au couvent
pour faire quarantaine.»
Georges eut toutes les éloquences, toutes les caresses, toutes les
colčres.
«Quoi! lui dit-il, je vous avais presque oubliée; c'est vous qui
m'avez appelé, et c'est vous qui me rejetez. Que voulez-vous que je
fasse dans ce désespoir? Ce sera le coup mortel.
--Vous vivrez de souvenirs, comme moi. Ou plutôt, comme vous ętes un
homme, vous oublierez et vous aimerez une autre femme. Pour moi, je
vous jure que je n'aurai aimé que vous. Votre souvenir sera ma seule
joie.
--J'étais déjŕ perdu ŕ moitié, reprit Georges en marchant ŕ grands
pas, vous me précipitez au fond de l'abîme, au lieu de me sauver.
--Mon ami, ne dites pas cela. Vous savez que si je le puis, je vous
tendrai les bras. Jusqu'ici vous avez perdu votre temps, mais vous
ętes si jeune que vous vous relčverez de toutes vos folies. Je connais
trois ministres, voulez-vous que j'aille les trouver pour vous? Je
n'ai pas encore perdu mon crédit, voulez-vous ętre magistrat, consul,
sous-préfet?
--C'est cela; vous voulez m'exiler.
--Vous ętes fou! je veux vous emprisonner dans un devoir rigoureux,
comme je veux m'emprisonner moi-męme dans la maison de mon mari.»
Georges prit la main de Valentine. «Eh bien, non, c'est au delŕ de mes
forces. J'aime mieux mourir que de vous perdre.»
Et, se penchant pour l'embrasser: «Tu ne sais donc pas comme je
t'aime?»
La comtesse leva ses beaux yeux sur son amant. «Tu ne sais donc pas
comme je t'aime aussi?» dit-elle.
Il retomba ŕ ses pieds et il pleura.
Elle pleura aussi.
Il croyait l'avoir reconquise, mais elle se releva de cette rechute.
«Non, mon ami, lui dit-elle, je ne serai plus votre maîtresse. Vous
ętes cruel de me décourager. Redevenez un homme et non un enfant.
--Si je vous décourage, c'est parce que je sais bien que vous voulez
jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Les femmes ne se repentent
jamais si jeunes.
--Je m'appelle Valentine, mais je m'appelle aussi Madeleine.
--Madeleine ne s'est repentie que parce qu'elle a aimé Dieu lui-męme.
Mais ce n'est jamais avec M. de Xaintrailles que vous vous repentirez.
Vous aller tenter l'impossible; aussi, dans six mois, vous aurez
planté lŕ votre mari pour la troisičme fois; car ne m'avez-vous
pas dit vous-męme que vous aviez voulu vous repentir avec M. de
Xaintrailles de votre aventure avec le marquis Panino?
--Eh bien, si je n'ai pas la force du devoir, j'aurai la force de
l'amour: je viendrai me jeter encore dans vos bras. Mais, pour
aujourd'hui, ne perdez pas votre temps; je vous jure que vous ne
gagnerez rien.
--Vous me donnerez un quart d'heure de grâce?
--Je vous offrirai ŕ dîner, si vous voulez, ŕ la condition que vous me
donnerez de l'appétit.»
Ils dînčrent ensemble dans le petit salon, comme ils avaient souvent
dîné aux meilleurs jours de leur passion. Georges voulait encore se
faire illusion, tout en s'avouant que c'était lui qui avait toujours
été dominé. Elle avait eu beau s'abandonner avec les voluptueuses
lâchetés de l'esclave, il n'était jamais parvenu ŕ se rendre maître
de cet esprit rebelle. La raison, ce n'est pas seulement sa timidité
presque enfantine dans le Parc-aux-Grives; c'était qu'il l'aimait
trop. Pour Valentine, quand elle était devant lui, il y avait toujours
une société, une famille, un Dieu. Pour lui, il n'y avait plus rien
que Valentine.
Aprčs le dîner, il aurait bien voulu rester encore--rester
toujours,--mais Valentine lui dit qu'elle avait promis ŕ M. de
Xaintrailles d'aller passer une heure avec lui, et que, pour rien
au monde, elle ne manquerait ŕ cette promesse. «Songez donc, lui
dit-elle, il est si malade que ce serait un homicide.»
Il fallut bien que Georges se résignât. «A demain, dit-il ŕ Valentine.
--Qui sait!» répondit-elle.
Mais elle le vit si triste, qu'elle se hâta d'ajouter un de ces _oui_
charmants que les femmes savent si bien dire.
Georges eűt peut-ętre, d'ailleurs, insisté davantage, s'il n'eűt été
attendu ŕ une table de jeu, car le bonheur ne lui avait pas fait
perdre ses bonnes habitudes des jours malheureux.
Le lendemain, quand il vint pour voir la comtesse, elle n'y était pas.
Il vint jusqu'ŕ trois fois sans la trouver. Il revint le surlendemain.
Cette fois, on lui donna ce mot:
«Adieu! nous ne nous verrons plus. Si vous m'aimez encore, ne cherchez
pas ŕ me rencontrer.»
Georges devint pâle. Il eut froid au coeur; il lui sembla qu'il allait
mourir.
Il questionna, et on lui apprit que la comtesse avait quitté l'hôtel
pour n'y pas revenir. Elle était retournée au couvent de Sainte-Marie.
Il courut au couvent, mais ne fut pas reçu. On lui apprit que la
comtesse était toute seule, męme sans sa femme de chambre. Il écrivit,
mais on ne lui répondit pas.
Il était si désespéré qu'il en devint presque fou. Cette fois c'en
était fait. Valentine mariée n'était pas si loin que ne le devenait
Valentine repentie. Il ne la verrait donc plus! Il ne rallumerait pas
cette belle passion qui le tuait dans les délires et les délices! Il
fallait donc tenter l'impossible pour arracher cette pécheresse ŕ son
repentir! Pour la ramener dans ses bras, plus égarée que jamais, pour
lui prouver que la vie c'était l'amour!
Mais il aurait beau faire, c'était tenter l'impossible, ŕ moins que le
comte ne mourűt.
«C'est moi qui suis mort!» s'écriait Georges.
Il s'était si bien habitué au savoureux parfum de Valentine, qu'il
voulut habiter la chambre męme quelle occupait ŕ l'hôtel du Louvre.
Aucun voyageur n'y était encore entré; il s'y précipita et s'y enferma
avec une sombre volupté. Il se jeta sur le lit, il baisa l'oreiller,
il s'enroula dans les couvertures. Il aurait voulu rattraper de chez
la blanchisseuse les draps de la comtesse.
«Ici, se disait-il, au moins je ne suis pas aussi loin d'elle! je la
sens partout! Cette pendule-lŕ parlait de moi.»
Et il portait ses lčvres partout et sur toutes choses, ne comprenant
pas lui-męme que la folie humaine puisse égarer ainsi un homme.
«Oh! Valentine, Valentine! comme je vous aime!» dit-il en tombant
agenouillé devant le lit.
Quoiqu'il n'eűt pas beaucoup d'argent, il paya huit jours d'avance
pour ętre bien sűr qu'on ne lui enlčverait pas la chambre de
Valentine.
Dans l'aveuglement de sa passion, il se hasarda rue de Penthičvre,
jusqu'ŕ l'appartement du comte. Ce fut Émilie qui vint lui ouvrir.
«Pourquoi avez-vous quitté la comtesse?
--Je ne l'ai pas quittée pour longtemps, puisqu'elle doit venir ici la
semaine prochaine. D'ailleurs, vous savez bien que je suis devenue la
garde malade du comte.
--Comment va-t-il?
--Vous ętes bien bon! ni bien ni mal. Mais il a trop de maladies ŕ la
fois pour en avoir une bonne.
--Il faut que je voie la comtesse.
--Ah! si madame a dit non, c'est non! Je la connais encore mieux que
vous; quand vous verrez madame, c'est que madame voudra vous voir.
--Elle vient ici?
--Oui! elle est venue hier, elle reviendra demain. Mais je suppose que
vous ne songez pas ŕ lui donner ici un rendez-vous. D'ailleurs, elle
ne vient pas seule; elle est accompagnée de Mme de Fromentel, une
autre femme romanesque, qui, depuis la mort tragique de votre frčre,
passe la moitié de sa vie ŕ pleurer au couvent de Sainte-Marie.
--Il faut pourtant que je voie Valentine. Je lui ai écrit, elle ne
me répond pas. Si vous la voyez demain, dites-lui bien que tout ceci
finira mal.»
Cette petite conversation se passait, moitié dans l'antichambre,
moitié sur le palier; car ni Georges ni Emilie n'avaient franchi le
seuil.
La femme de chambre baissa la voix pour murmurer: «Tout ça finirait
bien, si le comte aimait assez sa femme pour en mourir.»
XIX
LE CRIME
Cependant Georges n'était plus maître de sa passion ni de son
désespoir. Il souffrait les mille morts de l'amour. Il ne dormait pas,
il ne mangeait pas, il ne vivait pas. Il subissait tous les tourments
et toutes les angoisses. Cette femme attendue si longtemps! Cette
femme retrouvée et reperdue, Dieu la lui rendrait-il?
«Mais il n'y a pas de Dieu, dit-il avec colčre. Il n'y a pas de Dieu,
puisque le bonheur est impossible, puisque la vie est trahie ŕ chaque
pas, puisque les ręves ne sont pas des ręves, puisque notre pain
quotidien est la douleur, puisqu'une heure de joie se paye par une
éternité de larmes!»
Et quand Georges eut bien déclamé ces imprécations, il s'écria: «Si
Dieu n'existe pas, c'est aux hommes forts ŕ faire la justice. Pourquoi
ne tuerais-je pas le comte de Xaintrailles, puisque c'est lui qui m'a
volé mon bonheur?»
Il s'enhardit dans cette belle idée, en appelant ŕ lui tous les
docteurs de l'athéisme. Qu'est-ce qu'un homme inutile de plus ou de
moins? César, Napoléon, ne passent pas pour des homicides, quoiqu'ils
aient tué des millions d'hommes.
Ce fut en vain que son imagination--ou sa conscience--lui montrait ŕ
l'horizon la guillotine, que la chiromancienne lui avait prédite; il
était décidé ŕ tout braver, étouffant en lui toute prescience et
toute divination; niant les mystčres de l'inconnu, aprčs les avoir
expliqués.
«Mais comment me débarrasser de cet homme?» se demandait Georges.
On s'habitue au crime comme au poison.
A la premičre idée, on se révolte; la conscience ferme la porte, c'est
ŕ peine si on ose regarder le crime par la fenętre.
C'est aussi l'histoire de la femme qui s'effraye d'abord de prendre un
amant. Quand elle s'abandonne ŕ cette pensée, elle croit encore que
c'est un ręve irréalisable. Quand elle savoure par avance les voluptés
de l'amour, elle ne peut pas s'imaginer qu'elle franchira jamais le
Rubicon.
La minute qui précčde le crime ou la chute semble l'éternité: on n'y
arrivera jamais.
Georges était bien né; il appartenait ŕ ce monde chrétien qui se
résigne et qui ne se révolte pas. Il avait vécu sa premičre jeunesse
dans toutes les soumissions aux lois de l'Évangile, ce code des codes.
Le paradoxe avait hanté ses lčvres sans descendre dans son coeur; il
sentait Dieu en lui. L'amour de la famille le sauvegardait, comme
l'amour des lettres, car il avait trouvé dans l'histoire une seconde
famille. Tous ceux que le génie a doués étaient des siens, depuis
Hésiode jusqu'ŕ Lamartine, depuis Achille jusqu'ŕ Napoléon, depuis
Apelle jusqu'ŕ Delacroix.
Si, au temps de ses études; quand il prenait la plume pour expliquer
les maîtres de toutes les langues, on lui eűt dit: «Cette main-lŕ
frappera du poignard, ou versera le poison,» il se fűt noblement
indigné, en s'écriant: «Je me nomme Georges du Quesnoy, du nom de mon
pčre.» Et il eűt pris ŕ témoin toutes les figures qui lui étaient
sympathiques, tous ses amis d'élection dans le monde ancien et dans le
monde moderne.
Ce qui l'eűt indigné alors l'indigna encore, męme aprčs ses déchéances
morales, quand le désoeuvrement eut couvert cette intelligence d'élite
dont on pouvait tout espérer; mais l'homme avait trop abdiqué pour
que la passion ne fűt pas plus forte que son coeur. Il n'était plus
capable que de faire un sacrifice ŕ lui-męme, l'homme périssable, au
lieu de le faire ŕ sa conscience, l'âme immortelle.
En quelques jours, Georges s'habitua donc au crime. Mais comment
pratiquer le crime? S'il eűt obéi ŕ son tempérament, il eűt pris le
poignard, car il gardait une haine violente ŕ cet homme qui l'avait
jeté en prison, pour ce qu'il appelait un délit de droit commun; mais
il choisit le poison, pour pouvoir cacher son crime ŕ tout le monde,
surtout ŕ Valentine.
Il pensa d'abord au poison des Indiens. Il irait trouver le comte de
Xaintrailles; il lui demanderait raison de ses nuits blanches ŕ la
Conciergerie, de sa fičvre de prisonnier; dans sa colčre, il lui
saisirait le bras et ferait pénétrer le poison dans la chair, par les
angles d'une bague imbibée. Tout le monde sait que ce poison est le
plus violent et le plus rapide.
Ou bien encore, il verserait dans un des breuvages du malade son
fameux poison des Médicis, soit celui qui tue ŕ l'instant męme, soit
celui qui tue lentement. Grâce ŕ la femme de chambre, consciente ou
inconsciente, cela n'était pas bien difficile.
Ou bien encore, il porterait ŕ Émilie, pour tenir compagnie au comte,
le cerf-volant du charnier qui donne le charbon.
Et l'aconit, ce capuchon de Vénus, avec ses jolies fleurs blanches et
violettes qui vous endorment dans l'éternité!
Mais, comme depuis quelque temps il avait étudié les effets inouis
de l'eau de laurier-cerise, il se décida ŕ se servir de ce poison,
peut-ętre parce que c'était le plus nouveau.
Il était, d'ailleurs, armé de toutes pičces. A partir du jour oů il
conçut le crime, quoiqu'il ne fűt pas bien décidé ŕ le commettre, il
portait toujours sur lui trois ou quatre poisons, sans parler d'un
revolver américain, un bijou s'il en fut.
Georges avait traversé plus d'une aventure périlleuse. Il disait que
rien ne préserve de la mort comme la mort elle-męme. Il ne sortait
donc jamais sans elle.
Il ne hâta pas les choses, espérant encore que M. de Xaintrailles
mourrait de sa belle mort. Le lendemain, il retourna rue de
Penthičvre, espérant toujours voir Mme de Xaintrailles; mais ce
jour-lŕ elle ne vint pas. Il retourna le surlendemain. A le voir errer
par la rue, avec l'inquiétude peinte sur sa figure de plus en plus
pâlissante, les sergents de ville commençaient ŕ se confier qu'il
méditait sans doute un mauvais coup, ŕ moins qu'il ne méditât tout
simplement d'enlever une des dames du quartier.
A force d'aller et de venir ce jour-lŕ sans voir arriver Valentine,
Georges se décida pour la seconde fois ŕ monter chez M. de
Xaintrailles. Ce fut la cuisiničre qui lui ouvrit. Il ne voulut pas
entrer, disant qu'il ne voulait parler qu'ŕ la femme de chambre. La
cuisiničre alla avertir Émilie, qui vint sur le palier, ŕ moitié
endormie, parce qu'elle ne s'était pas couchée la derničre nuit.
«Ce n'est pas moi que vous voulez voir, dit la femme de chambre ŕ
Georges, mais je vous avertis que vous ne verrez plus madame; elle
est venue ce matin avec son pčre; la réconciliation a été des plus
touchantes. Je ne dis pas que cela amuse beaucoup madame, mais elle
s'y résigne. Dans quelques jours, elle partira pour le Brésil ou pour
la Perse, car on ne sait pas encore oů monsieur sera nommé ministre.
--Le comte va donc mieux?
--Hélas! oui. Pourtant, selon moi, il a encore une patte dans la
tombe; les nuits sont trčs-mauvaises; la fičvre le fait divaguer comme
un fou; pour moi, je suis au bout de mes forces.
--Jetez-lui donc sur le nez un mouchoir imbibé de chloroforme, pour le
calmer un peu.
--Oui, mais je n'ai pas de chloroforme. Justement je voulais en
demander au médecin parce que j'ai mal aux dents.»
Georges donna ŕ Émilie une petite fiole, fermée ŕ l'émeri, pleine
d'extrait de laurier-cerise.
«Qu'ŕ cela ne tienne, dit-il, voilŕ qui vaut mieux que du chloroforme.
Si vous buviez tout cela, vous n'auriez plus jamais mal aux dents.
Mais vous avez trop d'esprit pour faire une bętise, surtout quand je
pense ŕ votre fortune. Bonsoir.»
Georges n'ajouta pas un mot. Dčs qu'il fut sorti, il alla droit au
café de la Paix pour écrire ŕ Mme de Xaintrailles; mais il eut beau
donner cent sous ŕ l'Auvergnat qui porta la lettre, cet homme ne
rapporta pas de réponse.
«Oui, dit-il, c'est bien fini, ŕ moins que le comte ne s'en relčve
pas.»
Et aprčs avoir pensé ŕ sa fiole d'extrait de laurier-cerise:
--Si Émilie me comprenait! murmura-t-il. Mais je ne me suis pas assez
bien expliqué pour me faire comprendre.
Le soir, quoiqu'il n'eűt pas trop l'espérance de rencontrer Valentine
rue de Penthičvre, il y retourna aussitôt son dîner; un dîner sommaire
s'il en fut, car depuis quelques jours il n'avait pas faim.
Aprčs avoir dépęché une fruitičre ŕ la femme de chambre, comme cette
fille refusait de descendre, il monta pour lui parler.
Cette fois ce fut le valet de chambre, qui lui ouvrit. La femme de
chambre vint bientôt et lui dit qu'il était fou de se montrer dans la
maison.
«Heureusement, ajouta-t-elle, que j'ai dit que vous étiez médecin;
mais, je vous en prie, ne venez plus, si vous voulez que tout aille
bien.
--L'eau de laurier-cerise a-t-elle calmé votre mal de dents?
--Je crois bien! ŕ la premičre goutte, je dormais debout.
--C'est souverain! Vous pouvez en donner au comte, avec l'approbation
de son médecin. Il vous signera une ordonnance. Il le faut, car s'il
arrivait un malheur, on ne manquerait pas de dire que vous avez voulu
empoisonner ce moribond.
--Est-ce que c'est du poison?
--Oui, si on prenait toute la fiole dans une tisane.
--A bon entendeur, salut! Mais allez-vous-en bien vite.»
On montait dans l'escalier. C'était une femme. Georges ne fut pas
peu surpris de reconnaître Valentine. Elle était préoccupée et ne
regardait pas; si bien qu'elle ne vit pas que c'était lui quand il lui
saisit la main.
«Vous!» s'écria-t-elle.
Elle faillit se trouver mal.
«Oui, je vous poursuivrai jusque chez votre mari. Je veux vous voir et
vous parler, ne fűt-ce que pour la derničre fois.
--Georges! vous allez me perdre. Que dirait-on si on vous voyait ici?
--On dira ce qu'on voudra. J'ai le coeur brisé; j'ai la tęte perdue.
--De grâce! laissez-moi, dit la comtesse en dégageant sa main. Vous
savez bien que tout est fini.
--Je sais que je veux vous voir encore, ne fűt-ce qu'une heure, ne
fűt-ce qu'un instant.
Georges avait ressaisi la main de Mme de Xaintrailles.
--Eh bien, dit-elle, subissant cette volonté plus forte que la sienne,
demain matin, ŕ dix heures, j'irai vous voir ŕ l'Hôtel du Louvre.
--Vous me le jurez?
--Je vous le jure!»
On se sépara. Je ne sais si le comte remarqua que sa femme était
trčs-émue en venant lui dire bonsoir. Il se plaignit d'ętre plus
malade que le matin. Son médecin avait eu peur d'un érysipčle; sa
névralgie était plus insupportable que jamais: «Quelle nuit je vais
passer!» dit-il.
La comtesse lui promit de venir le veiller le lendemain. Elle lui
proposa męme de rester ce jour-lŕ; mais M. de Xaintrailles lui dit
qu'elle était trop bien habillée pour cela. Le bruit de sa robe de
soie l'agaçait, tant il était énervé. Ils se dirent adieu, sans se
douter que ce fűt le dernier adieu.
Le médecin revint vers onze heures; le comte dormait. La femme de
chambre dit qu'il fallait une potion pour que la nuit fűt bonne, car
elle ne doutait pas que le comte ne se réveillât bientôt. Elle parla
d'eau de laurier-cerises, disant qu'un ami de M. de Xaintrailles lui
avait conseillé d'en prendre quelques gouttes dans du lait.
Le médecin ne fit aucune difficulté de signer une ordonnance d'eau de
laurier-cerise. Il était venu entre deux entr'actes des Italiens, en
se disant sans doute que cette visite payerait sa stalle. Il raffolait
de la Patti, qui chantait pour la derničre fois.
LIVRE III
LES MAINS PLEINES DE SANG
La mort n'est pas une porte qui se ferme, c'est une porte
qui s'ouvre. Mais la porte de l'Enfer s'ouvre sur le Paradis.
OCTAVE DE PARISIS.
Dieu a créé une peine pour chaque joie. La porte
du Paradis s'ouvre sur l'Enfer. Mais la porte de
l'Enfer s'ouvre sur le Paradis.
Mlle CLÉOPATRE.
L'amour qui perd son bien est comme Prométhée
sur son rocher. Il ne voit rien autour de lui, rien
que la mer, qui vient pleurer ses larmes trois fois
amčres jusqu'ŕ ses pieds meurtris. Il attend, mais
le vautour vient seul, qui, sous son bec affamé, lui
boit le coeur jusqu'ŕ la derničre goutte de sang.
GEORGES DU QUESNOY.
Pleure pour te consoler. Meurs pour revivre.
MAHOMET.
I
LA TROISIČME VISION
Georges du Quesnoy savait-il déjŕ la destinée de M. de Xaintrailles,
vers onze heures du soir, quand il se promenait sur le boulevard des
Italiens?
Sans doute sa conscience était inquičte, car il murmurait entre ses
dents:
«Je ne veux pas vivre sans cette femme. Ceinture dorée vaut mieux que
bonne renommée. Il y a des crimes qui sont de belles actions. Si cet
homme meurt; il délivre sa femme. C'est le bonheur de sa femme, par
contre-coup c'est mon bonheur. Et puis, qu'est-ce que tuer un homme
déjŕ penché sur le tombeau? C'est lui donner une chiquenaude. M. de
Xaintrailles est déjŕ mort ŕ toutes les joies de la terre. Si je brise
ses chaînes corporelles, si je renverse les murs de sa prison, je lui
ouvre le ciel ŕ deux battants, car un homme assassiné meurt en état de
grâce. Que ferait sur la terre cet homme qui n'a plus la force d'avoir
des passions? C'est le fourreau sans la lame, c'est la tige sans les
fleurs, c'est l'autel sans le dieu. M. de Xaintrailles, lŕ-haut, aux
voűtes éthérées, me bénira des deux mains pour l'avoir frappé. Dans
onze mois, quand j'épouserai sa femme, il nous bénira tous les deux.
Onze mois! c'est la loi qui a marqué ce chiffre. Onze mois, quelle
ironie! puisqu'il y a onze mois que j'ai épousé Mme de Xaintrailles.»
Georges cherchait dans les fumées du vin de Champagne ŕ jouer au grand
criminel et ŕ tuer sa conscience, mais sa conscience était encore
debout.
Au moment oů il se disait toutes ces belles choses, il coudoya sur le
boulevard une fille de joie qui lui jeta au nez un rire insolent. Il
faillit tomber ŕ la renverse.
Il venait de reconnaître la jeune fille du Parc-aux-Grives, la
danseuse enragée de la Closerie des lilas, la bacchante saoűle du bal
de l'Opéra.
«C'est elle; c'est vous! C'est toi! O mon Dieu! Tant de beauté
radieuse! Je t'aurais payée de ma vie, et tu ne vaux pas une pičce de
cent sous!»
Elle restait devant lui, immobile et silencieuse comme une statue de
marbre, les yeux allumés, la bouche flétrie, les joues ravagées, sans
un battement de coeur.
«Non, ce n'est plus toi, je ne te reconnais plus,» dit Georges
effrayé.
Elle lui tourna le dos et s'en alla ŕ un autre. Il suivit des yeux sa
robe soutachée, dont les couleurs criardes attiraient tous les yeux.
«Et pourtant, si j'allais ŕ elle, si je l'entraînais chez moi, si
je l'interrogeais? Il faut que je sache toute l'histoire de cette
douloureuse décadence; mon coeur saigne devant une chute si profonde;
cette jeune fille n'avait donc pas de mčre! Mais il reste toujours un
peu de place dans le coeur pour le repentir: Madeleine avait encore
des larmes pour laver les pieds de Jésus-Christ.»
Il rejoignit la fille de joie, qui, une seconde fois, s'arręta
silencieuse devant lui. Elle lui montra un magnifique collier de
perles fines, un camée antique du plus haut prix, des bagues allumées
de diamants.
«O pauvre folle! dit Georges avec abattement, tu crois donc que la
beauté s'achčte avec de l'or? Je t'ai connue plus belle il y a huit
ans dans le Parc-aux-Grives, quand tu n'avais que des marguerites pour
diamants.»
Elle sourit et pencha sa tęte.
«Autres temps, autres moeurs, reprit-il. Du reste, ta beauté est
encore vivante et glorieuse. Quelle opulence de corsage!»
Georges avança la main sans façon. Le corsage se dégrafa, et un
poignard ensanglanté tomba ŕ terre. La fille de joie le ramassa et
s'enfuit en toute hâte.
«La coquine, dit une de ses pareilles en passant, elle cache son
crime, mais elle sera guillotinée.»
Georges crut sentir passer sur son cou le froid du couteau.
«De quoi est-elle coupable? demanda-t-il ŕ celle qui passait.
--Qui! quoi! que dites-vous? je ne comprends pas.
Georges ne comprenait pas lui-męme. Il parla du poignard ensanglanté,
mais on lui rit au nez.
Dans son épouvante, il marcha d'un pas rapide vers l'hôtel du Louvre.
Il se coucha, mais il eut toutes les peines du monde ŕ s'endormir.
«Que se passera-t-il donc demain? se demandait-il. Est-ce que ma
destinée veille et travaille cette nuit? Aprčs tout, si le comte est
empoisonné, c'est la fatalité qui aura versé le poison.»
II
LE LENDEMAIN
Quand Georges se réveilla, huit heures sonnaient ŕ
Saint-Germain-l'Auxerrois.
«Un beau jour,» dit-il, en voyant jouer gaiement un rayon de soleil.
Il pensa au comte et ŕ la comtesse de Xaintrailles,--ŕ l'eau de
laurier-cerise et au rendez-vous.
Un beau jour, en effet, car ŕ la męme heure il y avait du nouveau rue
de la Pépiničre, chez le comte de Xaintrailles. Le docteur Tardieu
avait été appelé au point du jour. Je ne puis mieux faire que de
donner mot ŕ mot son procčs-verbal, que je trouve dans la _Gazette
médicale_:
«J'arrivai ŕ cinq heures du matin chez le comte de Xaintrailles qui
venait d'ętre empoisonné.
«Le comte avait bu ŕ peu prčs soixante grammes d'eau de
laurier-cerise, si j'ai bien jugé par la fiole qui était sur la table
de nuit.
«Il tomba tout de suite saisi de vertige, selon le rapport de la femme
de chambre.
«Déjŕ le médecin du malade avait voulu agir par les contre-poisons.
Mais il venait de s'éloigner pour une visite forcée. Je prodiguai au
comte les soins les plus rapides. Il bégaya et me regarda d'un air
étrange, quoiqu'il me connűt bien. Je le fis porter sur son canapé, en
pleine lumičre. Il ne pouvait plus se tenir assis. Sa tęte pendait en
avant; il me fallait me baisser pour lui regarder la figure, qui avait
déjŕ la pâleur mortelle. Déjŕ aussi, il était froid. J'essayai de
combattre la paralysie générale du mouvement; mais quand je vis les
pupilles dilatées, quand je sentis le pouls lent, mou et régulier, je
compris qu'il était trop tard.
«Survinrent alors deux docteurs amis de la maison. Il semblait nous
reconnaître, mais déjŕ les mots étaient brouillés dans son cerveau. On
ne pouvait savoir, d'ailleurs, si la raison l'avait ou non abandonné,
puisque le malade ne pouvait parler, ni montrer sa langue, ni donner
la main, ni faire aucun geste. De cinq minutes en cinq minutes, il
subissait des convulsions internes qui altéraient encore sa figure,
déjŕ frappée de l'effroi de la mort. Les dents étaient serrées avec
une telle force qu'il nous fut impossible de lui faire rien prendre.
Nous ne pűmes agir que par les médicaments externes.
«L'agonie dura cinq heures, mais quand il mourut, il y avait déjŕ cinq
heures qu'il n'existait plus.
«Vingt-quatre heures aprčs, nous fîmes la dissection, par ordre du
parquet; il s'exhala, au premier coup de scalpel, une odeur d'amandes
amčres qui se répandit jusque dans le salon voisin. Le sang était
foncé et liquide; le coeur droit était hypérémique; le diaphragme
était coloré en noir; la langue était blanche et l'épithélium se
détachait facilement; le pharynx et l'oesophage étaient gris, mais
encore fermes.»
C'en est assez, ne suivons pas la science jusqu'au bout.
Voici l'interrogatoire de la femme de chambre, par M. Macé, le futur
commissaire aux délégations judiciaires des drames parisiens:
«D'oů vient que cette eau de laurier-cerise a été donnée au malade?
--Le comte avait demandé une potion pour dormir, car il avait de
cruelles insomnies; il passait la nuit ŕ se retourner par-ci par-lŕ,
sans jamais se trouver bien; il avait męme demandé un masque
chloroformé; mais le docteur s'était récrié, parce qu'on en a vu plus
d'un s'endormir pour tout de bon.
--Mais qui a eu l'idée du laurier-cerise?
Ici, nous avons remarqué qu'avant de répondre, la femme de chambre
avait regardé le comte comme si elle craignait d'ętre démentie.
Toutefois ce fut d'une voix ferme qu'elle répondit:
--C'est monsieur!
--Comment le comte a-t-il pu avoir l'idée de boire de l'eau de
laurier-cerise?
--C'est parce que l'eau de pavot ne réussissait plus. Le médecin avait
parlé d'opium, mais monsieur disait que l'opium le réveillait au lieu
de l'endormir. Demandez plutôt au valet de chambre.
Le valet de chambre appelé a répondu qu'il n'était pas lŕ, mais que le
comte avait horreur de l'opium.
--Et dans quelle boisson avez-vous versé l'eau de laurier-cerise?
--Dans du lait; monsieur ne buvait que du lait.
Le docteur vous avait dit combien vous en pouviez mettre de gouttes?
--Oui, quelques gouttes.
--D'oů vient que la fiole est vide?
--C'est monsieur lui-męme qui, ŕ la seconde fois, voulant ŕ toute
force dormir, a versé le reste de la fiole dans une tasse de lait;
mais il ne buvait qu'une gorgée de temps en temps. Aussi a-t-il bu ŕ
peine la moitié de la seconde tasse. Voyez plutôt: il a renversé le
reste sur le lit.
--Il ne vous a rien dit?
--Non! il s'est endormi, mais en s'agitant beaucoup comme s'il avait
le délire. Il a appelé la comtesse ŕ voix haute; j'ai pris peur et
j'ai crié au valet de chambre de venir.
Le valet de chambre interrogé a dit que le comte semblait dormir,
quoiqu'il eűt les yeux entr'ouverts et quoiqu'il parlât tout haut. La
femme de chambre ajouta que c'était le cauchemar.
Cette fille en était lŕ de sa déposition quand arriva le docteur ***,
médecin ordinaire de M. de Xaintrailles.
Le docteur dit qu'il avait ordonné de l'eau de laurier-cerise, mais
demanda l'ordonnance et la fiole.
La fille Émilie donna la fiole qui était sur la table de nuit et
sembla chercher l'ordonnance. Puis, indiquant la cheminée:
--J'ai peut-ętre jeté cela au feu.
On trouva du verre cassé dans les cendres.
--Pourquoi avez-vous fait cela?
--C'est que monsieur lui-męme jetait tout cela au feu.
La femme de chambre s'est troublée, en disant que cette ordonnance
était sans doute restée chez le pharmacien.
--Mais qui a porté l'ordonnance?
--Je ne sais pas. C'est la cuisiničre ou le valet de chambre.
On appela la cuisiničre. Cette femme venait de sortir.
Le valet de chambre déclara que ce n'était pas lui.
--Peut-ętre bien, a dit cet homme, en regardant du coin de l'oeil la
femme de chambre, que l'eau de laurier-cerise aura été ordonnée par un
monsieur qui a fait une visite ŕ Mlle Émilie, car j'ai entendu qu'ils
parlaient entre eux de l'eau de laurier-cerise.
--Quel est ce monsieur?
Aprčs un silence la femme de chambre s'est décidée ŕ dire que c'était
un ami du comte, un de ses anciens médecins, lequel avait en effet
conseillé de l'eau de laurier-cerise pour la nuit si le malade ne
pouvait pas dormir.
--Mais le nom de ce médecin?
--Ah! ni moi non plus. Je ne connais pas par leur nom tous les amis
de monsieur, surtout depuis le séjour ŕ Rome. Mais qu'est-ce que cela
fait, puisque c'est le médecin du comte qui a signé l'ordonnance?
--Mais encore une fois, s'il a signé cette ordonnance, elle doit se
retrouver.
Je l'ai remise ŕ la cuisiničre.
--Qui a ouvert la porte ŕ l'autre médecin?
Le valet de chambre a répondu que c'était lui.
--Aviez-vous déjŕ vu ce médecin?
--Oui, mais je ne lui ai pas parlé. Il a demandé Mlle Émilie.
--C'est donc son médecin?
Ici la femme de chambre prit la parole.
--Dieu merci! je n'ai pas besoin de médecin pour mon mal de dents.
--Enfin, celui-lŕ venait-il pour vous ou pour le comte?
--Cette question! il venait pour le comte. Seulement le comte ne
voulait pas que son médecin ordinaire apprît que celui-lŕ fűt venu.
Vous savez, tous les malades ont leurs lubies.
--Mademoiselle, puisque vous ne retrouvez pas l'ordonnance, on va vous
tenir en état d'arrestation.
La femme de chambre perdit un peu de son aplomb. Elle s'écria d'un air
indigné:
--Me prenez-vous pour une empoisonneuse?
--Si vous n'ętes pour rien dans tout ceci, soyez sans inquiétude: la
lumičre se fera.
--On n'a toujours pas le droit de m'arręter!
--Oů demeure le médecin en question?
--Ah! ma foi, il ne m'a pas donné son numéro.
La cuisiničre rentra ŕ cet instant. Elle déclara avoir remis
l'ordonnance et la fiole dans les mains de Mlle Émilie.
--Vous voyez bien, mademoiselle, que vous aviez l'ordonnance.
--J'en ai eu bien d'autres dans les mains. Je ne pouvais pourtant pas
les garder comme des billets de banque.
--C'est bien! tout ŕ l'heure quand viendra le médecin, on saura ŕ quoi
s'en tenir.
--Et si le médecin ne vient pas, est-ce qu'on a la prétention de me
retenir prisonničre bien longtemps?
--Oui! bien longtemps, si le médecin ne vient pas.
--C'est une rude injustice! S'il fallait rechercher tous les amis de
monsieur, on n'y parviendrait pas.
--Oui, mais cet ami de monsieur paraît ętre de vos amis, puisque c'est
vous qu'il a demandé.
--Il a demandé la garde-malade, pour ne pas déranger monsieur, si
monsieur dormait.
--Vous vous défendez trop bien.
--Faut-il donc que je me laisse faire sans rien dire?
Pendant tout cet interrogatoire, M. de Xaintrailles ne fit que les
mouvements d'un convulsionnaire. Quoiqu'on parlât haut et qu'on fűt
tourné de son côté, il ne dormait pas, signe d'intelligence. Le
cerveau avait été atteint avant tout le reste.
Il expira ŕ dix heures.
On se mit en campagne pour trouver le docteur introuvable. La femme de
chambre, gardée ŕ vue dans l'appartement, faisait bonne contenance.
Mais, quand on l'avertit qu'elle allait partir pour la Conciergerie,
elle éclata comme une tempęte, et jura qu'elle attendait celui qui
avait conseillé l'eau de laurier-cerise.
Le commissaire de police voulut qu'elle le conduisît ŕ l'instant męme
chez cet homme. Elle refusa en disant qu'elle ne savait pas oů il
demeurait; mais elle était bien sűre qu'il viendrait le jour męme,
parce qu'il l'avait promis au comte.
Dčs que la femme de chambre se crut libre de ses mouvements, elle
écrivit ŕ Georges du Quesnoy, qui, on le sait, n'était connu ŕ l'Hôtel
du Louvre que sous le nom d'Edmond Lebrun.
Voici la lettre:
_Je dirai ŕ M. Edmond Lebrun que monsieur le comte s'est fort mal
trouvé de l'eau de laurier-cerise. On m'a mise en état d'arrestation,
venez bien vite prouver que ce n'est pas ma faute, ni la vôtre non
plus._ _ÉMILIE._
On ne pouvait pas écrire une lettre plus habile, car, tout en disant ŕ
Georges de venir, elle le mettait sur ses gardes.
Mais cette lettre fut saisie au moment męme oů Émilie la voulait
mettre ŕ la poste.
III
LE DÉJEUNER AUX FRAISES
On se souvient que Valentine avait promis de venir ce jour-lŕ dire
adieu une derničre fois ŕ son amant, ŕ l'hôtel du Louvre, dans cette
chambre oů ils s'étaient tant aimés.
On avait servi ŕ Georges un déjeuner frugal: une aile de poulet, des
fraises et du thé. Il n'avait pu se résigner ŕ se mettre ŕ table dans
l'anxiété de l'attente.
Quand deux heures sonnčrent, il désespérait de la voir venir, mais
elle entra bientôt, tout de noir habillée, comme si elle portait déjŕ
le deuil de son mari.
«Tu vois, dit-elle ŕ son amant qui s'était jeté dans ses bras et qui
soulevait son double voile, tu vois que je porte le deuil de mon
bonheur.
--De mon bonheur! dit Georges. C'est moi seul qui serai malheureux.
--Pourquoi dire cela? Je souffrirai plus que toi, mais j'ai déjŕ
appris la résignation.
Ils s'embrassčrent avec des sanglots étouffés.
--Je n'aurai pas le courage de vivre une heure si tu me quittes, dit
Georges.
--Est-ce que tu aurais le courage de mourir?»
Georges montra son revolver.
«Mon ami, dit Valentine, je n'aime pas ces raisons-lŕ.»
Elle saisit le revolver et le mit dans sa poche.
«Et toi, aurais-tu le courage de mourir?
--Non. Je t'aime, mais j'ai horreur de la nuit.
--Tu es trop belle pour mourir.
--Peut-ętre. Et puis, j'ai soif de vivre.
--Si tu m'aimais encore, tu ne dirais pas cela; moi, je n'ai que la
soif de ton amour.
--Ne me parlez pas ainsi, Georges, dit tristement Valentine. Je
ne veux plus de cette vie impossible oů il faut se cacher. Je n'y
retomberai pas.»
Georges l'attaqua par l'esprit comme par le coeur. Il lui dit qu'il
n'était pas un héros de roman, mais que jamais ces amoureux transis
qui s'appellent Saint-Preux et Werther, ces amoureux affolés qui
s'appellent des Grieux et Ravensvood n'aimaient pas comme lui d'un
amour profond, mystérieux, invincible et fatal.
«Des ręveries,» dit Valentine voulant cacher son coeur.
Elle prit une fraise, et la mangea.
«Oh! les admirables dents de crocodile, murmura son amant.
--Tu veux dire que je me nourris de tes larmes. Je te jure que j'aime
mieux tes fraises.
La comtesse prit une seconde fraise, puis une autre encore.
--Tu vois qu'il y a de bonnes choses sur la terre.
--O sublime gourmande!»
Et Georges présenta lui-męme une fraise aux lčvres de Valentine.
«Ta bouche n'est pas assez grande.»
Madame de Xaintrailles coupa sa fraise en deux.
«Pour toi,» dit-elle.
Georges le comprenait ainsi.
«Et tu aurais le coeur, dit-il, de manger désormais des fraises sans
moi?
--Oh! mon Dieu, oui. Je vais devenir plus gourmande que jamais pour me
consoler. Mais tu sais que je n'ai qu'une heure ŕ te donner: l'heure
du diable. Nous avons déjŕ perdu une demi-heure.»
Les deux amants étaient redevenus presque gais.
Ni l'un ni l'autre ne pouvait croire que c'était lŕ leur rendez-vous
d'adieu. Georges espérait vaguement que le comte n'en reviendrait pas,
et Valentine, toujours légčre, ne s'imaginait pas que la séparation
serait éternelle, quoiqu'elle fűt de bonne foi dans son repentir.
«Georges, dit-elle tout ŕ coup, vous n'ętes pas sérieux; vous voulez
me perdre encore; mais j'ai un ami qui me sauvera.
--Un ami?
--Oui, Dieu.»
Georges tressaillit. Il ne croyait plus ŕ Dieu; mais ŕ ce seul mot, un
grand trouble se fit en lui.
«Dieu, c'est mon ennemi!» dit-il.
On sonna sur ce mot.
«N'ouvre pas!» dit la comtesse.
Un pressentiment l'empęcha de mordre la fraise qu'elle avait aux
lčvres.
On sonna encore.
«Cache-toi,» dit Georges ŕ Valentine en lui montrant le balcon.
On sonna une troisičme fois.
«Est-ce que mon mari recommencerait déjŕ sa comédie?
--Passe sur le balcon, je vais ouvrir.»
«Au nom de la loi, ouvrez la porte,» dit une voix ferme.
Georges alla ouvrir la porte sans bien savoir ce qu'il faisait.
Un commissaire de police entra, suivi de deux agents. C'était celui
qui avait arręté la femme de chambre.
«Vous ętes monsieur Edmond Lebrun?
--Oui, monsieur.
--Monsieur, reprit le commissaire ŕ brűle-pourpoint, vous avez
empoisonné M. le comte de Xaintrailles.»
Georges du Quesnoy subit le choc avec fermeté.
«Monsieur, je ne vous donne pas le droit de venir m'accuser ici.
--Monsieur, je vous accuse au nom de la justice.
--Monsieur, pas un mot de plus.»
Jusque-lŕ, Georges n'avait pas vu les agents de police, il se sentait
de taille a lutter avec le commissaire.
Mais dčs qu'il vit ces deux hommes s'approcher, il pâlit et perdit sa
force de résistance.
Le commissaire avait vu flotter sur le balcon la robe de Valentine.
Pendant que Georges s'était retourné vers la cheminée croyant trouver
son revolver, car il oubliait déjŕ que la comtesse le lui avait pris,
le commissaire courut au balcon et ramena la comtesse au salon.
Mme de Xaintrailles, tout épouvantée, tomba anéantie sur un fauteuil.
«Ne craignez rien, dit Georges en lui prenant la main, il y a lŕ un
fatal malentendu, ŕ moins que ce ne soit une mauvaise plaisanterie.
--Monsieur, reprit le commissaire de police, si vous n'ętes pas
coupable, la vérité se fera bien vite dans votre confrontation avec la
femme de chambre de Mme la comtesse de Xaintrailles, car cette fille a
été arrętée aussitôt la mort du comte.
--M. de Xaintrailles est mort!» s'écria la comtesse.
Un cri de surprise et d'épouvante!
Il était trop tard pour jeter un cri de délivrance.
Elle fut abîmée dans son désespoir.
«La chose a été mal faite,» murmura Georges.
Il fit semblant de suivre le commissaire sans plus opposer la moindre
résistance, mais bien décidé ŕ s'échapper en route s'il le pouvait. Il
se rappela tout ŕ coup que Valentine avait mis son revolver dans sa
poche.
«Monsieur, dit-il avec douceur au commissaire, permettez-moi de dire
adieu ŕ madame pour le cas, peu probable d'ailleurs, oů je serais
retenu en prévention.
--Faites, monsieur, répondit le commissaire, mais je ne puis vous
laisser seul avec madame.»
Georges vit bien qu'il ne gagnerait rien par ses pričres.
Il se contenta de s'approcher de Mme de Xaintrailles, tout en lui
cachant la figure par la sienne.
«Je n'y comprends pas un mot, lui dit-il. De grâce, donnez-moi mon
petit revolver.»
La comtesse pria le commissaire de police de permettre ŕ Georges
d'écrire un mot.
«Un mot que vous lirez,» se hâta de dire le jeune homme.
Ceci permit ŕ la comtesse de passer son mouchoir ŕ son amant.
Le commissaire tendit la main pour le saisir, mais déjŕ Georges avait
pris le revolver avec la dextérité d'un prestidigitateur, quoiqu'il
fűt trčs-agité.
Pour mieux cacher cette action, il se mit ŕ écrire sans bien savoir ŕ
qui il écrirait et ce qu'il écrirait.
«Aprčs tout, dit-il tout ŕ coup, il est impossible que je sois arręté,
ce n'est pas la peine d'écrire.»
Et se rapprochant une derničre fois de la comtesse:
«Adieu, Valentine, lui dit-il en l'embrassant, aimez-moi jusqu'ŕ la
fin.»
Mme de Xaintrailles se croyait dans un ręve. Elle ne voulait pas voir
la réalité.
Enfin Georges du Quesnoy sortit, suivi de prčs par le commissaire.
Aprčs avoir descendu un étage, comme il passait devant le grand
corridor, il s'y précipita avec la rapidité du vertige. Les deux
hommes de la police couraient bien, mais il parvint ŕ se jeter dans
une chambre entr'ouverte dont il eut le temps de refermer la porte
avant qu'on ne le vit entrer.
C'était beaucoup pour se sauver, mais c'était trop peu. En un clin
d'oeil, la police avertit la police: on cerna l'hôtel du Louvre. On
décida qu'aucune chambre n'échapperait ŕ la visite domiciliaire.
Georges du Quesnoy s'imagina pourtant qu'il ne serait pas repris. La
chambre oů il était entré était occupée par une dame étrangčre sortie
pour la messe ŕ Saint-Roch. Il se nicha dans une montagne de robes qui
avaient été essayées le matin.
En effet, ŕ premičre vue, on jugea qu'il n'y avait personne, car un
des agents de police aprčs ętre entré, ressortit en disant: «Ce n'est
pas lŕ.»
Ce fut la dame elle-męme qui le perdit.
Elle revint de la messe cinq minutes aprčs, pendant qu'on cherchait ŕ
l'étage supérieur.
Un grand bruit s'était fait dans tout l'hôtel, elle s'imagina qu'on
poursuivait un voleur. Elle entra chez elle avec quelque inquiétude.
A ce moment, Georges, se croyant ŕ demi sauvé, était sorti du lot de
chiffons pour tenter de gagner la rue. L'impatience est imprudente. La
dame poussa un cri en voyant Georges.
«Madame, de grâce, sauvez-moi; je ne suis pas un voleur, je suis un
amoureux.»
La dame était une provinciale pour qui un amoureux était bien plus
dangereux qu'un voleur. Elle s'imagina que l'amoureux était lŕ pour
elle, et elle cria de plus belle.
Le jeune homme furieux faillit lui tirer un coup de revolver.
Elle finit par se calmer ŕ moitié, mais il était trop tard: ses cris
avaient ramené un autre agent de police.
Celui-lŕ passa, comme on dit, un mauvais quart d'heure, car Georges le
tint ŕ distance par le revolver.
«Si tu dis un mot et si tu t'approches, je te tue comme un chien.»
L'agent de police se tint en respect, mais sans vouloir s'en aller.
«Va-t'en, lui dit Georges.
--A moi,» dit l'agent de police, en criant trčs-haut.
Ce cri fut couvert par une détonation. La petite balle du revolver qui
devait le frapper au coeur le frappa ŕ l'épaule, parce qu'il fit un
mouvement rapide.
Georges renversa la provinciale, repoussa l'agent qui n'était pas
tombé et s'enfuit ŕ tout hasard. Mais les cris de l'agent jetčrent
au-devant de Georges un autre agent et deux domestiques de l'hôtel.
Il tira un coup en l'air pour jeter l'épouvante, mais cet autre agent
se précipita dans ses jambes pour le jeter ŕ terre.
Il passa outre, se croyant encore sauvé, mais cette fois il se jeta
ŕ la tęte du commissaire lui-męme, qui avait avec lui toute une
escouade.
Puisqu'il avait engagé la lutte, il ne voulut pas se rendre; il fit
feu une troisičme fois.
Il n'atteignit pas le commissaire, mais la balle blessa une curieuse
par ricochet.
Il eűt fait feu une quatričme fois si on ne l'eűt frappé d'un coup de
canne sur le bras.
Il comprit qu'il était perdu; le revolver venait de tomber; il se
jeta ŕ terre, le ressaisit de sa main gauche et se tira ŕ lui-męme le
quatričme coup en pleine poitrine.
«Un peu plus tôt, un peu plus tard, c'est un homme mort,» dit le
commissaire.
IV
LA COUR D'ASSISES
On n'a pas encore oublié le bruit que fit cette arrestation; mais
comme les journaux ne donnčrent que les initiales ou les noms de
guerre des deux amants, M. Lebrun et Mme Duflot, on ne s'intéressa pas
beaucoup ŕ leur cause. C'était un monsieur quelconque et une
femme adultčre de plus. Bien plus, comme on disait que c'était
un empoisonneur, le roman de ces amours mal connues n'émut que
médiocrement.
Quoique la balle eűt fait une lésion ŕ la poitrine, Georges du Quesnoy
ne mourut point de sa blessure. A trois mois de lŕ il comparaissait
devant le juge d'instruction.
Dčs son premier interrogatoire, il déclara que s'il y avait un
coupable c'était lui seul, sans toutefois avouer qu'il fűt coupable.
Il jura que la femme de chambre était inconsciente. Il lui avait en
effet conseillé l'eau de laurier-cerise pour calmer un malade qu'il ne
connaissait pas; mais si elle avait donné contre ses prescriptions le
remčde ŕ trop forte dose, c'est qu'elle ne savait pas sans doute que
ce remčde eűt quelque danger.
Comme cette déclaration s'accordait avec les dires de la femme de
chambre, on avait donné la liberté ŕ cette fille, tout en la gardant ŕ
vue jusqu'aux assises.
Aux assises, Georges du Quesnoy ne fut connu que sous le nom d'Edmond
Lebrun, chimiste ŕ Londres. Le hasard le servit: un agent français ŕ
Londres déclara qu'en effet un sieur Lebrun, fabricant de produits
chimiques, avait passé le détroit vers l'époque du crime. Les amis de
Georges ne devaient pas le reconnaître, non plus que les témoins du
comte dans son duel avec M. le comte de Xaintrailles. Il avait coupé
sa barbe et ses cheveux. Il s'était marqué le front et les joues par
cinq points de pierre infernale. Il avait achevé de se défigurer par
un clignement d'yeux et une grimace perpétuelle.
Il n'avait pas męme dit son nom ŕ son avocat, par respect pour son
pčre, quoique son pčre l'eűt depuis longtemps abandonné.
Sa grande préoccupation aux assises ne fut ni l'éloquence de son
avocat,--c'était Me Lachaud,--ni l'idée de la condamnation, ni la
curiosité publique, c'était le vague espoir de voir apparaître dans la
foule, ne fűt-ce qu'un instant, cette femme qu'il avait adorée et pour
laquelle il allait mourir.
Elle ne vint pas.
Pendant les trois jours que dura l'affaire, ce fut en vain qu'il la
chercha dans toutes les curieuses; Mme de Xaintrailles ne voulut point
se hasarder jusque-lŕ, quoiqu'elle eűt tout donné pour le revoir. Elle
espérait d'ailleurs qu'il ne serait pas condamné.
Condamné, il le fut, et sans circonstances atténuantes.
On le déclara coupable d'avoir empoisonné le comte de Xaintrailles,
et, par aggravation, d'avoir, pour échapper ŕ la justice, blessé un
homme et une femme de deux coups de revolver.
Pendant tout le procčs, il avait fait bonne contenance, dédaignant
de répondre aux questions trop précises, jouant quelquefois trop au
désillusionné qui se moque de la vie; s'écoutant avec complaisance
dans quelque période éloquente; jetant çŕ et lŕ un mot de raillerie ŕ
travers la gravité des débats.
Il remercia Me Lachaud d'avoir si bien plaidé une si mauvaise cause.
«Je vous donne tout ce que j'ai,» lui dit-il en lui passant au doigt
un petit camée antique, représentant plus ou moins Démosthčne.
Pour les condamnés ŕ mort, le moment le plus terrible n'est pas la
condamnation, c'est l'entrée ŕ la Roquette. La Roquette! un tombeau oů
l'on vit, d'oů l'on ne sortira que pour monter sur l'échafaud. Le jour
oů on entre ŕ la Roquette est plus triste que le jour oů l'on en sort.
«Et pourtant, dit Georges du Quesnoy en franchissant le seuil, Dante
n'écrirait pas ici ses mortelles paroles: Moi je n'y attends pas la
vie, mais j'y attends encore un rayon d'amour.»
Il ne doutait pas que Valentine ne lui écrivît. Qui sait? Peut-ętre
męme viendrait-elle; l'amour a des inspirations sublimes: pourquoi ne
se dirait-elle pas sa soeur pour avoir le droit de venir le voir?
V
LA ROQUETTE
Dčs qu'il fut dans sa cellule, Georges appela un prętre. Un prętre,
c'est le dernier ami sérieux de ceux qui vont mourir, condamnés ou
non.
Le prętre--c'était l'abbé----, le prętre des condamnés ŕ mort--vint le
jour męme.
«Vous voulez que je vous parle de Dieu, mon enfant.
---Non, mon pčre, je veux que vous me parliez _d'elle_.»
Et dčs ce jour-lŕ Georges fit toute sa confession. Ce fut avec un
allégement de coeur qui le rasséréna. Un ami était entré dans la
cellule, ce fut un frčre qui en sortit. Le prętre comprit que ce
condamné ŕ mort n'était pas le premier venu. Il allait mourir de sa
passion, dans le crime et le repentir de sa passion, mais non pas dans
les terreurs d'un criminel vulgaire.
Le premier coupable, n'était-ce pas cette femme trop aimée qui avait
sacrifié son coeur ŕ son orgueil? Si Valentine eűt obéi résolument ŕ
sa premičre inspiration, elle eűt décidé son pčre ŕ la donner pour
femme ŕ Georges du Quesnoy; c'eűt été un mariage d'amour qui fűt
devenu un mariage de raison, car chez lui comme chez elle il y avait
un coeur et une âme.
Combien de fois le mariage n'est-il pas la préface du crime! combien
de fois, l'enfer du mariage a-t-il conduit dans l'autre!
Le prętre de la Roquette prit Georges en grande sympathie, parce que
le condamné se confessa en toute abondance de coeur, comme un chrétien
qui dépouille l'orgueil du _Moi_, qui foule aux pieds les vanités
humaines et ne reconnaît plus que Dieu sur la terre. Aussi Georges
pria l'abbé---- de lui accorder tous les jours une demi-heure de
son temps; ce que fit l'abbé avec une bonne grâce évangélique.
Naturellement le sujet de la conversation était l'immortalité de
l'âme. La grâce n'avait pas encore touché Georges. C'était donc par la
raison et non par la foi qu'il voulait voir Dieu. Il ne doutait pas
d'ailleurs du réveil de son âme dans la mort, mais il ne croyait pas
au pardon. Selon lui, tout crime devait s'expier, non pas seulement
par les larmes du repentir, mais par la punition du lendemain. Chaque
pas que faisait vers lui le curé de la Roquette le rapprochait
d'ailleurs du catholicisme.
«Voyons, lui disait l'abbé----, puisque vous avez cru nagučre aux
esprits, puisque vous avez cru au diable, pourquoi refuser de croire
ŕ ce miracle supręme qui a fait de Jésus le fils de Dieu? Et si vous
croyez ŕ l'Évangile, pourquoi ne pas entrer dans l'Église, qui est la
porte du ciel?
--Pourquoi? lŕ est le grand mot. Il m'est impossible de croire que
parce que je me serai humilié ŕ vos pieds en m'accusant de mon crime,
je serai pardonné par Dieu. A quoi servirait la Vertu, si le dernier
des coquins peut aller s'asseoir ŕ côté d'elle au paradis, aprčs avoir
été absous sur la terre? Dieu ne vous a pas donné le droit de faire
grâce.»
Le prętre lui répliquait:
«Vous soulevez des questions résolues depuis longtemps. Si vous étiez
plus savant en théologie, vous verriez que les plus grands esprits de
l'Église ont tous fini par soumettre la raison ŕ la foi, parce que la
foi c'est la lumičre. Abandonnez-moi votre âme rebelle pendant toute
une semaine, et le dimanche, ŕ la messe, vous sentirez que Dieu est
lŕ. Vous comprendrez que ce n'est pas le prętre qui pardonne, que
c'est Dieu lui-męme; car il est le trčs-humble serviteur de Dieu, et
c'est Dieu qui parle par sa bouche. Mais ne croyez pas pourtant que
quand je vous aurai pardonné au nom de Dieu, vous entrerez au paradis
avec la quiétude des blanches âmes qui n'ont connu sur la terre que le
devoir, le sacrifice, la vertu! Non; vous ne passerez pas par l'enfer,
puisque vous aurez cru ŕ la miséricorde de Dieu, et que Dieu ne trahit
pas ceux qui espčrent en lui; mais vous emporterez vous-męme votre
enfer en paradis. Vous serez admis parmi les élus, mais vous
souffrirez longtemps encore de votre indignité. Votre âme ne s'épurera
peu ŕ peu qu'aux flammes de l'amour divin.»
Georges du Quesnoy n'était toujours pas convaincu.
«Vous ne croyez pas ma parole, reprenait le prętre, parce que vous ne
m'écoutez qu'ŕ demi.
--C'est vrai, mon pčre, vous voulez m'entraîner au ciel, mais mon
coeur bat toujours pour la terre. Cette femme que j'ai adorée, je
l'aime toujours. Ah! que ne donnerais-je pas pour la revoir avant de
mourir!»
Un jour, l'abbé---- dit ŕ Georges du Quesnoy:
«Mon enfant, ce que je n'ai pu faire pour votre salut, puisque votre
esprit est toujours rebelle ŕ votre foi, la femme que vous avez tant
aimée le fera mieux que moi. J'ai appris hier qu'elle allait entrer en
religion; j'ai couru ŕ elle, je l'ai décidée ŕ un adieu supręme.
--Elle viendra! s'écria Georges transporté.
--Oui, mon enfant, elle viendra.»
Le condamné embrassa le prętre avec une effusion filiale et
religieuse.
«O mon pčre! O mon ami! elle viendra!»
VI
LA CONFESSION
Dans les conversations de la derničre heure, Georges du Quesnoy
demanda ŕ l'abbé---- s'il était décidément indispensable que le mal
fűt imposé ŕ la terre pour la plus grande gloire de Dieu?
Il lui parla de son frčre. Dans ses plus mauvais jours, il n'avait
pas oublié cet enfant tué en duel, qu'il aimait de toute l'amitié des
vingt ans. Il répétait souvent que, si Pierre avait vécu, il se fűt
mieux contenu dans le devoir, car Pierre était un esprit mieux trempé
que le sien, qui ne devait pas bifurquer pour aboutir ŕ toutes les
déchéances.
Georges avait déjŕ raconté au curé de la Roquette les étranges
prédictions de Mlle de Lamarre.
«Je ne puis nier, avait dit l'abbé----, que c'étaient lŕ des
avertissements du ciel. Puisque cette dame vous prédisait la mort
violente ŕ tous les deux, il fallait réagir, lutter et vaincre le
démon. Mlle de Lamarre fut une voyante qui se mit en sentinelle pour
vous défendre vous et votre frčre. Il fallait écouter le cri de la
sentinelle et ne pas vous laisser surprendre.
--Pourquoi Dieu jette-t-il au coeur de chacun de ses enfants la
semence du mal? Le mal, comme les mauvaises herbes, envahit le bon
grain et l'étouffe le plus souvent. Le sage et le juste sont toujours
vaincus sur la terre.
--C'est une vallée de larmes, parce que les hommes sont méchants.
--Pourquoi ce jeu cruel du Créateur?
--C'est que pour aimer le bien, il faut connaître le mal. Il y a des
berceaux dorés et couverts de guipure; il y a des berceaux d'osier et
couverts d'étoupe. Des deux côtés c'est la męme âme. Celui-lŕ qui vit
dans le travail comme, celui-lŕ qui vit dans l'oisiveté auront un jour
le męme juge. Mais déjŕ, sur la terre, ils ont le męme ange gardien
qui s'appelle la Conscience.»
Une vague idée traversa l'esprit de Georges, mais dans la pénombre
elle ne put se faire lumineuse. Il parla des inquiétudes de sa
conscience, tout en voulant la nier.
«C'est peut-ętre une image, dit-il, mais c'est peut-ętre un mot.»
Et, sans se rendre bien compte de la logique des sentiments, des
réflexions et des ręveries, il en vint ŕ parler de cette jeune fille
qui lui était apparue trois fois dans les trois périodes de sa vie.
«Figurez-vous, mon pčre, qu'il y a cinq ou six ans, comme je sortais
ŕ peine du collčge, je vis dans le parc de Margival, dont je vous
ai souvent parlé, apparaître une jeune fille mystérieuse, avec des
marguerites dans les cheveux, robe blanche toute flottante, yeux
couleur du temps, effeuillant des roses avec un sourire angélique.
C'était une bénédiction de la voir si belle, si fraîche, si pure: un
ange descendu et non un ange tombé. Quand j'ai voulu m'approcher de
cette jeune fille, elle s'est évanouie comme une vision. Je ne l'ai
jamais retrouvée ni dans le parc ni dans le voisinage; on m'a traité
de visionnaire, mais pourtant je l'ai bien vue.»
Le prętre écoutait sans mot dire.
«Ce n'est pas tout, reprit le condamné, trois ans aprčs, j'avais jeté
ma jeunesse ŕ tous les vents, j'avais trahi tous mes devoirs: devoirs
de fils, devoirs de citoyen; l'orgueil du corps avait tué l'orgueil de
l'âme; je courais les filles, j'étais ruiné par l'argent qui était
ŕ moi et par l'argent qui était aux autres. Ne vous l'ai-je pas dit
déjŕ, j'étais un fanfaron de vices et je n'avais pas de honte de vivre
dans le monde des filles galantes sans payer ma part du festin! Je ne
saurais trop confesser ces hontes douloureuses aujourd'hui, mais dont
je riais en ces mauvais jours. Eh bien, un soir, cette jeune fille du
parc de Margival m'apparut dans un mauvais lieu, oů toutes les
filles plus ou moins ŕ la mode, vont perdre une heure dans leur
désoeuvrement. On appelle cela la _Closerie des lilas_ ou le champ
de bataille de la danse. Eh bien, lŕ, je l'ai revue; mais la figure
angélique s'était changée en tęte de bacchante. C'était la męme
créature, mais avec tous les signes des mauvaises passions. Elle
valsait éperdument, les yeux égarés par la débauche. Elle jetait des
roses fanées et des poignées d'argent. Je courus ŕ elle pour lui
demander raison de cette chute profonde; mais, comme la premičre fois,
elle s'évanouit dčs que je voulus lui saisir la main. Une autre fois
encore je l'ai revue au bal de l'Opéra, plus folle que jamais, et
jetant l'or ŕ pleines mains. Ce fut la męme vision plus accentuée et
plus réelle encore.»
Le prętre gardait toujours le silence.
«Et la troisičme vision? demanda-t-il ŕ Georges.
--Oh! la troisičme vision, c'est horrible ŕ dire. C'était la nuit du
crime; j'errais sur le boulevard. J'avais dîné gaiement; les fumées
du vin de Champagne me couronnaient la tęte. Je me croyais maître du
monde, parce que je défiais la société. Je pressentais mon crime du
lendemain, et je le regardais en face sans broncher. Je me voyais déjŕ
épousant la femme et la fortune du comte de Xaintrailles. Voilŕ
que tout ŕ coup une fille de joie, une courtisane ŕ sa derničre
incarnation, passe devant moi dans toute l'insolence de la femme qui
brave la femme elle-męme. Or, dans cette derničre des filles, je
reconnus trčs-distinctement la figure du parc de Margival et de la
Closerie des lilas. C'était la męme femme, mais elle n'avait plus rien
de la femme, sinon le masque, avec tous les stigmates des passions qui
se cachent. Elle les montrait sans honte au grand jour, car il ne fait
jamais nuit sur le boulevard des Italiens. Que lui importait ŕ elle,
qui ne rougissait plus? J'allai ŕ elle, frappé au coeur, effrayé de
cette déchéance. «Comment! lui dis-je, c'est toi, encore toi, toujours
toi!» Elle leva la tęte avec arrogance, elle éclata de rire et
frappa de sa main sur son coeur. Sa robe se dégrafa, et un poignard
ensanglanté tomba ŕ ses pieds. Je n'étais plus maître de moi; la peur
me prit, je m'enfuis ŕ l'hôtel du Louvre.»
Le prętre avait écouté ces trois histoires avec un vif intéręt.
«Vous n'avez pas compris? dit-il ŕ Georges.
--Vous comprenez donc vous-męme?»
Le prętre s'était levé.
«Peut-ętre,» dit-il en serrant la main du condamné.
Et souriant avec mélancolie:
«La suite ŕ demain,» ajouta-t-il de sa voix douce.
Quand Georges fut seul, il pensa qu'il ne pourrait plus dire
longtemps: _la suite ŕ demain_.
VII
L'ADIEU
Valentine vint le surlendemain. Le prętre avait vaincu tous les
obstacles. La comtesse de Xaintrailles n'était pas encore vętue en
religieuse, mais elle était accompagnée d'une soeur de charité.
Georges du Quesnoy avait été averti la veille. Aussi ce jour-lŕ fut un
jour de fęte.
L'horrible cellule fut remplie de fleurs.
Le matin, le condamné salua le soleil comme il ne l'avait jamais fait.
Il demanda un miroir, comme s'il eűt eu peur d'ętre devenu trop laid
pour paraître devant Valentine.
Il se trouva plus beau que jamais, parce que sa figure avait pris
plus de caractčre dans la gravité. Il y avait maintenant en lui
du religieux, du cénobite, de l'ascčte. Toute la tęte s'était
spiritualisée. Il pouvait sourire encore ŕ sa maîtresse, puisqu'il
avait la blancheur des dents et la flamme humide des yeux.
Valentine arriva ŕ midi.
Que de choses ils se dirent avant de se parler dans ces premičres
larmes et ces premiers soupirs qui arrętčrent les mots de leurs
lčvres!
Et, d'ailleurs, que pouvaient-ils se dire qu'ils ne sussent déjŕ?
Mme de Xaintrailles n'avait-elle pas compris toutes les douleurs de
celui qui n'avait accompli un crime qu'ŕ force d'amour? Georges du
Quesnoy n'avait-il pas compris que puisque Mme de Xaintrailles allait
prendre le voile, c'est que son coeur mourait pour lui pour ne revivre
qu'en Dieu?
La premičre parole de Georges fut celle-ci:
«Madame, donnez-moi une heure; puisque vous devenez soeur de charité,
regardez-moi comme un malade qui va mourir. Vos mains pieuses me
feront l'oreiller plus doux.»
Il saisit les deux mains de Valentine.
Le prętre, la soeur de charité et le geôlier se mirent ŕ chuchoter
ensemble comme pour ne pas entendre et pour ne pas voir.
Georges, en regardant Valentine, tout détaché qu'il fűt des biens
périssables, ne put s'empęcher de penser ŕ cette beauté souveraine,
tout épanouie hier, s'effaçant déjŕ aujourd'hui dans la pričre et le
repentir. Quoi! ces beaux cheveux odorants, il ne les baiserait plus!
ces épaules somptueuses, il n'y cacherait plus son front tout enivré
des altičres voluptés! ces beaux bras aux étreintes passionnées ne se
fermeraient plus sur lui! Mais quelle joie déjŕ pour son amour jaloux,
de penser que ces beautés corporelles seraient perdues pour le
monde! Nul ne viendrait s'abreuver ŕ cette source de délices, nul
n'imprimerait ses lčvres sur cette chair de pęche, de lis et de roses.
Cette voix timbrée ŕ l'or ne résonnerait plus pour les confidences
amoureuses. Valentine ne partait pas avec lui, mais elle faisait un
pas sur le męme chemin. Elle ne mourait pas, mais elle fuyait le
monde.
Que se dirent-ils?
Elle pleurait et il pleurait.
Ils évoqučrent le passé; ils rappelčrent les jours coupables, mais
charmants, les ivresses, les éperduments, les abîmes roses oů ils
s'étaient précipités sans voir le fond dans le vertige des vertiges.
Dieu les séparait violemment, mais n'avaient-ils pas pendant toute une
année escaladé vingt fois le septičme ciel?
Georges parla ŕ Valentine de leur premičre rencontre au château
de Sancy, de la marguerite effeuillée devant l'église, de leurs
promenades dans le parc de Margival. Ce n'étaient que les aubes
déjŕ lumineuses de leur amour. La passion était venue dans toute sa
luxuriance quand Georges s'était jeté dans les bras de Valentine
ŕ l'hôtel du Louvre. Quels divins battements de coeur! C'était le
paradis retrouvé. Ils avaient bu ŕ pleine coupe toutes les délices?
Georges du Quesnoy se rejetait aveuglément dans le passé, mais
Valentine le rappela malgré lui aux douleurs du présent.
«Je vous ai promis une heure, lui dit-elle, nous avons dévoré trois
quarts d'heure. Ne parlons plus de nous, parlons de Dieu. Ne parlons
plus d'hier ni d'aujourd'hui, parlons de demain.
--Demain, dit Georges, je mourrai en vous, parce que je mourrai en
Dieu.
--Et moi, dit Valentine, je ne veux vivre que pour prier pour vous;
mais jurez-moi de passer vos derniers jours humilié dans les grandeurs
de la religion. Si vous saviez comme c'est bon de se tourner vers
Dieu! Le jour oů vous m'avez quittée j'ai voulu mourir. Un rayon du
ciel a traversé mon âme. C'était la grâce. Je me suis agenouillée,
j'ai pleuré, j'ai prié. Quand je me suis relevée, mon désespoir
s'était fait héroďsme. Je me suis vue dans la psyché et j'ai condamné
ma beauté ŕ disparaître. Dčs ce jour-lŕ, j'ai juré que je mourrais
soeur de charité. Certes, je suis fičre de mon sacrifice, puisque
toute ma fortune, sinon celle de M. de Xaintrailles, me revenait
par sa mort. Eh bien, je donnerai ma fortune aux pauvres, comme je
donnerai ma beauté ŕ la cellule. Si j'ai attendu pour entrer en
religion, c'est que je voulais vous revoir. L'abbé---- est un saint
homme; il a compris que je vous apporterais l'amour de Dieu, voilŕ
pourquoi je suis venue.
--C'est irrévocable? dit Georges en mesurant toute la grandeur du
sacrifice.
--Oui, maintenant que je vous ai vu, je n'attends plus que le jour
terrible....
--Je comprends, dit Georges.
--Oui, vous avez compris, mon ami. Ce jour-lŕ, ŕ l'heure oů Dieu vous
recevra, je me jetterai au pied de l'autel, et je ne retournerai plus
la tęte.
Georges et Valentine s'embrassčrent dans les sanglots.
La soeur prit Valentine et l'entraîna, le prętre prit le condamné et
lui montra le crucifix.
Mais la passion était encore la plus forte: Georges ne baisa pas le
crucifix, il se précipita comme un lion vers Valentine.
Elle-męme s'était retournée.
Ils se jetčrent éperdument dans les bras l'un de l'autre, comme s'ils
cherchaient la mort dans cette derničre et solennelle étreinte.
VIII
LA GUILLOTINE.
Je ne sais si le pressentiment avait frappé, l'esprit de Georges:
trois jours aprčs cette visite, quand on alla le prendre pour la mort,
on le trouva tout éveillé qui crayonnait quelques pages. On s'imagina
que c'était une lettre: c'était les feuillets volants d'un manuscrit
sur le _Libre Arbitre_.
«Tenez, mon pčre, dit-il, en embrassant le prętre des condamnés; vous
lirez ceci en souvenir de moi. Ce n'est pas trčs-orthodoxe, mais,
rassurez-vous, je vais mourir en Dieu.»
Et aprčs un silence:
«Quand vous reverrez Mme de Xaintrailles, remettez-lui ces fleurs
fanées; cueillies avec elle dans le Parc-aux-Grives. Je les ai brűlées
sur mon coeur, je les ai sanctifiées par mes larmes et par mes
pričres.»
Georges se confessa et communia.
Dans sa confession il dit au prętre:
«Vous n'imaginez pas comme j'ai passé une bonne nuit! J'étais libre
et je courais comme un enfant les sentiers de mon pays. Mais je ne
pouvais franchir le saut-de-loup du Parc-aux-Grives.»
Pendant la «toilette des condamnés», l'abbé---- lut la premičre page
volante crayonnée par Georges:
«Les âmes en peine, ces âmes voyageuses qui ne sont ni du paradis ni
de l'enfer, parce qu'elles ne sont détachées ni du bien ni du mal, ont
été condamnées ŕ représenter l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan
devant les âmes de la terre.
«Nous sommes tous les jouets de ces âmes en peine. Nous avons chacun
la nôtre.
«On s'imagine qu'on vit en liberté et qu'on fait ce qu'on veut; mais
on obéit sans le savoir--et sans le vouloir--ŕ cette âme en peine qui
a veillé sur notre berceau et qui nous conduira jusqu'ŕ la tombe.»
Le prętre dit ŕ Georges:
«Ce que vous avez écrit, c'est la légende du Mal dominant le Bien.
Mais il n'y a sur la terre qu'une volonté: c'est celle de Dieu. Tout
homme qui marche dans l'esprit de Dieu est maître de ses passions.»
Ce jour-lŕ, quoiqu'on n'eűt pas annoncé la veille le spectacle, il y
avait foule pour la tragédie devant la place de la Roquette, quand
cinq heures sonnčrent ŕ Sainte-Marguerite. C'était l'heure. Les
premičres représentations sont presque toujours en retard. Le théâtre
était disposé avec ses décors funčbres, mais les acteurs n'arrivaient
pas. Les gamins grimpés sur les murs, sur les arbres, jusque sur les
toits, commençaient ŕ siffler.
«La toile! ou mes six sous! dit un gavroche.
--Patience, cria un de ses camarades, voilŕ le gaz allumé.»
Le soleil venait de jeter sur la guillotine son premier baiser du
matin.
Une grande rumeur s'éleva: la porte de la Roquette venait de s'ouvrir.
On vit s'avancer, pâle, mais fier, mais ferme, un jeune homme qui
regarda sans émotion visible l'horrible machine de mort.
«Dieu est au delŕ,» lui dit un prętre plus pâle encore.
--Je le crois, mon pčre, dit le condamné; quand j'aurai monté ces
degrés, je n'aurai plus qu'un pas ŕ faire.
Georges du Quesnoy embrassa l'abbé---- et sourit au bourreau.
M. de Paris s'inclina devant lui pour passer le premier.
«Faites, monsieur, vous ętes chez vous, dit le condamné.»
Le prętre mit un pied sur la premičre marche comme pour montrer le
chemin au condamné, qui devança l'abbé---- et monta deux marches sans
chanceler.
«Adieu, mon pčre. Voyez souvent Mme de Xaintrailles. Dites-lui bien
que c'est elle qui m'a fait croire ŕ Dieu.
Avant de monter sur le dernier théâtre de sa vie, il pencha la tęte
vers le crucifix que lui présentait l'abbé----. Il y appuya ses lčvres
avec onction. Deux larmes de foi et de repentir tombčrent de ses yeux.
Quand Georges fut sur la seconde marche, il jeta un regard autour de
lui, comme pour dire adieu au ciel et aux hommes.
Il vit passer dans la foule,--dans l'horrible foule en haillons,--qui
la veille s'était enivrée de vin et qui allait s'enivrer de sang, une
figure qu'il connaissait bien.
«Valentine!» cria-t-il.
Mais, en regardant mieux, il vit bien que ce n'était pas la comtesse
de Xaintrailles.
C'était une jeune fille vętue de blanc, les pieds nus, les bras levés,
les mains jointes, la chevelure flottante, ceinte d'un cercle d'or,
dans l'attitude de la pričre.
Georges du Quesnoy se retourna vers le prętre:
«Voyez-vous? lui dit-il d'une voix étouffée.
--Que voulez-vous dire, mon enfant? dit le prętre en montant sur la
premičre marche.
--Ne voyez-vous pas lŕ-bas celle dont je vous ai si souvent parlé,
lŕ-bas, dans ce groupe noir, toute blanche?....»
A cet instant le bourreau fit un signe d'impatience.
«Le bourreau a failli attendre! dit le condamné. Une seconde encore,
monsieur de Paris, et je suis ŕ vous.»
Et penchant la tęte vers le groupe qu'il avait indiqué ŕ l'abbé.
«Voyez, c'est elle, toujours elle. Mais quelle étrange métamorphose!
Il semble qu'elle ait perdu jusqu'au souvenir de ses mauvaises
passions. Elle a repris comme par miracle sa robe d'innocence et sa
candeur de seize ans. Voyez! elle vient de me sourire avec la bouche
d'un ange!»
Cette fois le condamné se sentit chanceler.
«Finissons-en, dit le bourreau,» avec une grâce onctueuse.
Mais le condamné voulait voir encore.
«Regardez bien! dit-il ŕ l'abbé----, la voilŕ qui monte ... qui monte
... qui monte encore ... Elle s'est envolée au ciel.
--Mon enfant, dans un instant vous la retrouverez. Vous avez compris,
n'est-ce pas, que celle que vous avez vue aux quatre époques de votre
vie,
Celle qui a été belle, pure, suave, divine,
Celle qui a été folle de son corps,
Celle qui a vendu son âme et qui a trempé ses mains dans le sang,
Celle qui s'est repentie et s'est envolée toute blanche au ciel:
C'est votre _âme_ qui vous est apparue!»
IX
LE DERNIER RENDEZ-VOUS
Ce fut un horrible frisson dans la foule, quand on vit cette belle
tęte couronnée d'un rayon de supręme intelligence, couchée sous le
couteau et tombant dans le panier.
Les spectateurs se souviennent encore que l'horrible coupe-tęte mal
machinée ce jour-lŕ résista cinq secondes au bourreau, ce qui donna le
temps au condamné de tourner ŕ demi la tęte par curiosité. Cette fois
il aurait pu dire ŕ monsieur de Paris: «J'ai failli attendre!»
A la męme heure, puisque cinq heures sonnaient ŕ la chapelle des
Missions-Étrangčres, la comtesse de Xaintrailles se jeta le front sur
les marches de l'autel, pour s'abîmer dans la pričre, en attendant
l'heure d'entrer en religion.
«Mon Dieu! mon Dieu! dit Valentine tout en larmes, c'est moi qui l'ai
tué.»
FIN
TABLE
A Madame----
Les nouveaux romans d'Arsčne Houssaye, par Jules Janin
LIVRE PREMIER
LES MAINS PLEINES DE ROSES
I. La Vision du château de Margival
II. Tout et rien
III. Il était une fois
IV. Mlle Valentine de Margival
V. Le Monde des esprits
VI. Les Bucoliques
VII. Point du tout
VIII. Les Étoiles
IX. Daphnis et Chloé
X. L'Amour qui raisonne
XI. Desesperanza
XII. Qu'il ne faut pas toujours aller ŕ la messe
XIII. Le dernier Coup de minuit
XIV. La Lune de miel
LIVRE II
LES MAINS PLEINES D'OR
I. Le Portrait fatal
II. Comment Georges du Quesnoy étudia le droit
III. Le Coeur maître de l'Esprit
IV. Vision ŕ la Closerie des lilas
V. Comment Pierre du Quesnoy mourut de mort violente
VI. La Voyante
VII. Les Déchéances
VIII. Le _Miserere_ du piano
IX. Voyage sentimental
X. La Chimie et l'Alchimie
XI. Le Miracle du jeu
XII. La Bacchante
XIII. La Destinée
XIV. La Baigneuse
XV. Promenade au bois
XVI. Que le bonheur est un ręve quand on n'a pas d'argent
XVII. Le Mari et l'Amant
XVIII. La Préface du crime
XIX. Le Crime
LIVRE III
LES MAINS PLEINES DE SANG
I. La troisičme Vision
II. Le Lendemain
III. Le Déjeuner aux fraises
IV. La Cour d'assises
V. La Roquette
VI. La Confession
VII. L'Adieu
VIII. La Guillotine
IX. Le dernier Rendez-vous
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK, LES MAINS PLEINES DE ROSE, PLEINES D'OR ET PLEINES DE SANG ***
This file should be named 8541-8.txt or 8541-8.zip
Project Gutenberg eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the US
unless a copyright notice is included. Thus, we usually do not
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
We are now trying to release all our eBooks one year in advance
of the official release dates, leaving time for better editing.
Please be encouraged to tell us about any error or corrections,
even years after the official publication date.
Please note neither this listing nor its contents are final til
midnight of the last day of the month of any such announcement.
The official release date of all Project Gutenberg eBooks is at
Midnight, Central Time, of the last day of the stated month. A
preliminary version may often be posted for suggestion, comment
and editing by those who wish to do so.
Most people start at our Web sites at:
https://gutenberg.org or
http://promo.net/pg
These Web sites include award-winning information about Project
Gutenberg, including how to donate, how to help produce our new
eBooks, and how to subscribe to our email newsletter (free!).
Those of you who want to download any eBook before announcement
can get to them as follows, and just download by date. This is
also a good way to get them instantly upon announcement, as the
indexes our cataloguers produce obviously take a while after an
announcement goes out in the Project Gutenberg Newsletter.
http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext05 or
ftp://ftp.ibiblio.org/pub/docs/books/gutenberg/etext05
Or /etext04, 03, 02, 01, 00, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 92,
91 or 90
Just search by the first five letters of the filename you want,
as it appears in our Newsletters.
Information about Project Gutenberg (one page)
We produce about two million dollars for each hour we work. The
time it takes us, a rather conservative estimate, is fifty hours
to get any eBook selected, entered, proofread, edited, copyright
searched and analyzed, the copyright letters written, etc. Our
projected audience is one hundred million readers. If the value
per text is nominally estimated at one dollar then we produce $2
million dollars per hour in 2002 as we release over 100 new text
files per month: 1240 more eBooks in 2001 for a total of 4000+
We are already on our way to trying for 2000 more eBooks in 2002
If they reach just 1-2% of the world's population then the total
will reach over half a trillion eBooks given away by year's end.
The Goal of Project Gutenberg is to Give Away 1 Trillion eBooks!
This is ten thousand titles each to one hundred million readers,
which is only about 4% of the present number of computer users.
Here is the briefest record of our progress (* means estimated):
eBooks Year Month
1 1971 July
10 1991 January
100 1994 January
1000 1997 August
1500 1998 October
2000 1999 December
2500 2000 December
3000 2001 November
4000 2001 October/November
6000 2002 December*
9000 2003 November*
10000 2004 January*
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation has been created
to secure a future for Project Gutenberg into the next millennium.
We need your donations more than ever!
As of February, 2002, contributions are being solicited from people
and organizations in: Alabama, Alaska, Arkansas, Connecticut,
Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts,
Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New
Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West
Virginia, Wisconsin, and Wyoming.
We have filed in all 50 states now, but these are the only ones
that have responded.
As the requirements for other states are met, additions to this list
will be made and fund raising will begin in the additional states.
Please feel free to ask to check the status of your state.
In answer to various questions we have received on this:
We are constantly working on finishing the paperwork to legally
request donations in all 50 states. If your state is not listed and
you would like to know if we have added it since the list you have,
just ask.
While we cannot solicit donations from people in states where we are
not yet registered, we know of no prohibition against accepting
donations from donors in these states who approach us with an offer to
donate.
International donations are accepted, but we don't know ANYTHING about
how to make them tax-deductible, or even if they CAN be made
deductible, and don't have the staff to handle it even if there are
ways.
Donations by check or money order may be sent to:
PROJECT GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FOUNDATION
809 North 1500 West
Salt Lake City, UT 84116
Contact us if you want to arrange for a wire transfer or payment
method other than by check or money order.
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation has been approved by
the US Internal Revenue Service as a 501(c)(3) organization with EIN
[Employee Identification Number] 64-622154. Donations are
tax-deductible to the maximum extent permitted by law. As fund-raising
requirements for other states are met, additions to this list will be
made and fund-raising will begin in the additional states.
We need your donations more than ever!
You can get up to date donation information online at:
https://www.gutenberg.org/donation.html
***
If you can't reach Project Gutenberg,
you can always email directly to:
Michael S. Hart <[email protected]>
Prof. Hart will answer or forward your message.
We would prefer to send you information by email.
**The Legal Small Print**
(Three Pages)
***START**THE SMALL PRINT!**FOR PUBLIC DOMAIN EBOOKS**START***
Why is this "Small Print!" statement here? You know: lawyers.
They tell us you might sue us if there is something wrong with
your copy of this eBook, even if you got it for free from
someone other than us, and even if what's wrong is not our
fault. So, among other things, this "Small Print!" statement
disclaims most of our liability to you. It also tells you how
you may distribute copies of this eBook if you want to.
*BEFORE!* YOU USE OR READ THIS EBOOK
By using or reading any part of this PROJECT GUTENBERG-tm
eBook, you indicate that you understand, agree to and accept
this "Small Print!" statement. If you do not, you can receive
a refund of the money (if any) you paid for this eBook by
sending a request within 30 days of receiving it to the person
you got it from. If you received this eBook on a physical
medium (such as a disk), you must return it with your request.
ABOUT PROJECT GUTENBERG-TM EBOOKS
This PROJECT GUTENBERG-tm eBook, like most PROJECT GUTENBERG-tm eBooks,
is a "public domain" work distributed by Professor Michael S. Hart
through the Project Gutenberg Association (the "Project").
Among other things, this means that no one owns a United States copyright
on or for this work, so the Project (and you!) can copy and
distribute it in the United States without permission and
without paying copyright royalties. Special rules, set forth
below, apply if you wish to copy and distribute this eBook
under the "PROJECT GUTENBERG" trademark.
Please do not use the "PROJECT GUTENBERG" trademark to market
any commercial products without permission.
To create these eBooks, the Project expends considerable
efforts to identify, transcribe and proofread public domain
works. Despite these efforts, the Project's eBooks and any
medium they may be on may contain "Defects". Among other
things, Defects may take the form of incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged
disk or other eBook medium, a computer virus, or computer
codes that damage or cannot be read by your equipment.
LIMITED WARRANTY; DISCLAIMER OF DAMAGES
But for the "Right of Replacement or Refund" described below,
[1] Michael Hart and the Foundation (and any other party you may
receive this eBook from as a PROJECT GUTENBERG-tm eBook) disclaims
all liability to you for damages, costs and expenses, including
legal fees, and [2] YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE OR
UNDER STRICT LIABILITY, OR FOR BREACH OF WARRANTY OR CONTRACT,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE
OR INCIDENTAL DAMAGES, EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
If you discover a Defect in this eBook within 90 days of
receiving it, you can receive a refund of the money (if any)
you paid for it by sending an explanatory note within that
time to the person you received it from. If you received it
on a physical medium, you must return it with your note, and
such person may choose to alternatively give you a replacement
copy. If you received it electronically, such person may
choose to alternatively give you a second opportunity to
receive it electronically.
THIS EBOOK IS OTHERWISE PROVIDED TO YOU "AS-IS". NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE MADE TO YOU AS
TO THE EBOOK OR ANY MEDIUM IT MAY BE ON, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
Some states do not allow disclaimers of implied warranties or
the exclusion or limitation of consequential damages, so the
above disclaimers and exclusions may not apply to you, and you
may have other legal rights.
INDEMNITY
You will indemnify and hold Michael Hart, the Foundation,
and its trustees and agents, and any volunteers associated
with the production and distribution of Project Gutenberg-tm
texts harmless, from all liability, cost and expense, including
legal fees, that arise directly or indirectly from any of the
following that you do or cause: [1] distribution of this eBook,
[2] alteration, modification, or addition to the eBook,
or [3] any Defect.
DISTRIBUTION UNDER "PROJECT GUTENBERG-tm"
You may distribute copies of this eBook electronically, or by
disk, book or any other medium if you either delete this
"Small Print!" and all other references to Project Gutenberg,
or:
[1] Only give exact copies of it. Among other things, this
requires that you do not remove, alter or modify the
eBook or this "small print!" statement. You may however,
if you wish, distribute this eBook in machine readable
binary, compressed, mark-up, or proprietary form,
including any form resulting from conversion by word
processing or hypertext software, but only so long as
*EITHER*:
[*] The eBook, when displayed, is clearly readable, and
does *not* contain characters other than those
intended by the author of the work, although tilde
(~), asterisk (*) and underline (_) characters may
be used to convey punctuation intended by the
author, and additional characters may be used to
indicate hypertext links; OR
[*] The eBook may be readily converted by the reader at
no expense into plain ASCII, EBCDIC or equivalent
form by the program that displays the eBook (as is
the case, for instance, with most word processors);
OR
[*] You provide, or agree to also provide on request at
no additional cost, fee or expense, a copy of the
eBook in its original plain ASCII form (or in EBCDIC
or other equivalent proprietary form).
[2] Honor the eBook refund and replacement provisions of this
"Small Print!" statement.
[3] Pay a trademark license fee to the Foundation of 20% of the
gross profits you derive calculated using the method you
already use to calculate your applicable taxes. If you
don't derive profits, no royalty is due. Royalties are
payable to "Project Gutenberg Literary Archive Foundation"
the 60 days following each date you prepare (or were
legally required to prepare) your annual (or equivalent
periodic) tax return. Please contact us beforehand to
let us know your plans and to work out the details.
WHAT IF YOU *WANT* TO SEND MONEY EVEN IF YOU DON'T HAVE TO?
Project Gutenberg is dedicated to increasing the number of
public domain and licensed works that can be freely distributed
in machine readable form.
The Project gratefully accepts contributions of money, time,
public domain materials, or royalty free copyright licenses.
Money should be paid to the:
"Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
If you are interested in contributing scanning equipment or
software or other items, please contact Michael Hart at:
[email protected]
[Portions of this eBook's header and trailer may be reprinted only
when distributed free of all fees. Copyright (C) 2001, 2002 by
Michael S. Hart. Project Gutenberg is a TradeMark and may not be
used in any sales of Project Gutenberg eBooks or other materials be
they hardware or software or any other related product without
express permission.]
*END THE SMALL PRINT! FOR PUBLIC DOMAIN EBOOKS*Ver.02/11/02*END*
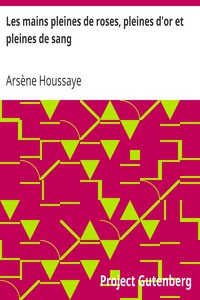
Les mains pleines de roses, pleines d'or et pleines de sang
Subjects:
Download Formats:
Excerpt
The Project Gutenberg EBook of Les mains pleines de rose, pleines d'or et pleines de sang
by Eugčne Houssaye
Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the
copyright laws for your country before downloading or redistributing
this or any other Project Gutenberg eBook.
This header should be the first thing seen when viewing this Project
Gutenberg file. Please do not remove it. Do not change or edit the
header without written permission.
Please read the "legal...
Read the Full Text
— End of Les mains pleines de roses, pleines d'or et pleines de sang —
Book Information
- Title
- Les mains pleines de roses, pleines d'or et pleines de sang
- Author(s)
- Houssaye, Arsène
- Language
- French
- Type
- Text
- Release Date
- July 1, 2005
- Word Count
- 60,911 words
- Library of Congress Classification
- PQ
- Bookshelves
- FR Littérature, Browsing: Literature, Browsing: Fiction
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books
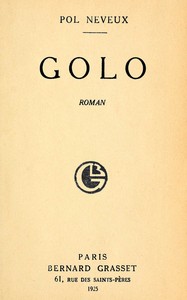
Golo
by Neveux, Pol (Pol Louis)
French
1037h 39m read
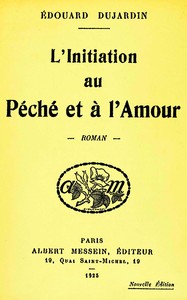
L'initiation au péché et à l'amour
by Dujardin, Edouard
French
661h 42m read
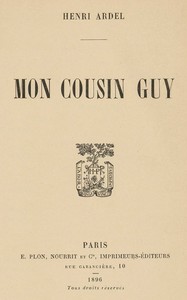
Mon cousin Guy
by Ardel, Henri
French
1267h 30m read
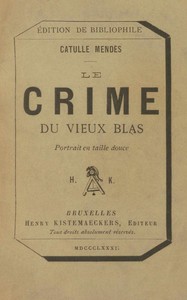
Le crime du vieux Blas
by Mendès, Catulle
French
250h 18m read
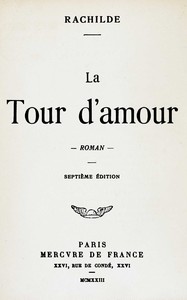
La tour d'amour
by Rachilde
French
707h 38m read
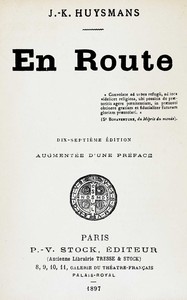
En route
by Huysmans, J.-K. (Joris-Karl)
French
2210h 58m read