The Project Gutenberg EBook of Cours Familier de Littťrature (Volume 3), by
Alphonse de Lamartine
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Cours Familier de Littťrature (Volume 3)
Un Entretien par Mois
Author: Alphonse de Lamartine
Release Date: May 1, 2008 [EBook #25276]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COURS FAMILIER ***
Produced by Mireille Harmelin, Christine P. Travers and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the BibliothŤque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
[Notes au lecteur de ce ficher digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont ťtť
corrigťes.]
COURS FAMILIER
DE
LITT…RATURE
UN ENTRETIEN PAR MOIS
PAR
M. A. DE LAMARTINE
TOME TROISI»ME.
PARIS
ON S'ABONNE CHEZ L'AUTEUR,
RUE DE LA VILLE L'…V QUE, 43.
1857
L'auteur se rťserve le droit de traduction et de reproduction ŗ
l'ťtranger.
COURS FAMILIER
DE
LITT…RATURE
REVUE MENSUELLE.
III.
Paris.--Typographie de Firmin Didot frŤres, fils et Cie, rue Jacob, 56.
XIIIe ENTRETIEN.
Premier de la deuxiŤme Annťe.
RACINE.--ATHALIE.
I
Nous avons dit, en commenÁant, que la littťrature ťtait l'expression de
la pensťe humaine sous toutes ses formes.
Il y a cinq maniŤres principales d'exprimer sa pensťe pour la
communiquer aux hommes:
La chaire sacrťe qui parle aux hommes, dans les temples, de leurs
premiers intťrÍts: la Divinitť et la morale;
La tribune aux harangues qui parle aux hommes, dans les assemblťes
publiques, de leurs intťrÍts temporels de patrie, de libertť, de lois,
de formes de gouvernement, d'aristocratie ou de dťmocratie, de monarchie
ou de rťpublique, et qui remue leurs idťes ou leurs passions par
l'ťloquence de discussion, l'ťloquence parlementaire;
La place publique, oý, dans les temps de tempÍte, de rťvolution, de
sťdition, le magistrat, le tribun, le citoyen monte sur la borne ou sur
les marches du premier ťdifice qu'il rencontre, parle face ŗ face et
directement au peuple soulevť, le gourmande, l'attendrit, le persuade,
le modŤre et fait tomber de ses mains les armes du crime pour lui faire
reprendre les armes du patriotisme et des lois. Ce n'est plus lŗ ni
l'ťloquence sacrťe, ni l'ťloquence parlementaire, c'est l'ťloquence
hťroÔque, l'ťloquence d'action qui prťsente sa poitrine nue ŗ ses
auditeurs et qui offre son sang en gage de ses discours;
Le livre qui, par l'ingťnieux procťdť de l'ťcriture ou de l'impression,
reproduit, pour tous et pour tous les temps, la pensťe conÁue et
exprimťe par un seul, et qui communique, sans autre intermťdiaire
qu'une feuille de papier, l'idťe, le raisonnement, la passion, l'image,
l'harmonie mÍme empreinte sur la page;
Enfin le thť‚tre, scŤne artificielle sur laquelle le poŽte fait monter,
aux yeux du peuple, ses personnages, pour les faire agir et parler dans
des actions historiques ou imaginaires, imitation des actions tragiques
ou comiques de la vie des hommes.
De tous ces modes de communiquer sa pensťe ŗ ses semblables par la
parole, c'est le thť‚tre qui nous paraÓt le plus indirect, le plus
compliquť d'accessoires ťtrangers ŗ la pensťe elle-mÍme, et par
consťquent le moins parfait. La pensťe cesse, pour ainsi dire, d'Ítre
pensťe, c'est-ŗ-dire immatťrielle, en montant sur le thť‚tre; elle est
obligťe de prendre un corps rťel et de s'adresser aux sens autant qu'ŗ
l'‚me. De tous les plaisirs intellectuels, le thť‚tre devient
vťritablement ainsi le plus sensuel: voilŗ pourquoi sans doute il est le
plus populaire.
Ce noble plaisir populaire du thť‚tre est inconnu par sa nature aux
ťpoques de barbarie ou mÍme de jeunesse des peuples. Il ne peut naÓtre
et se dťvelopper qu'en pleine et opulente civilisation.
Les premiers poŽtes sont des poŽtes sacrťs; les seconds sont des poŽtes
ťpiques; les troisiŤmes sont des poŽtes lyriques; les quatriŤmes sont
des poŽtes dramatiques.
La raison en est simple: les peuples, avant leur ‚ge de parfaite
civilisation, n'ont ni assez de loisir, ni assez de richesse, ni assez
de luxe public pour ťlever ŗ leurs poŽtes ces ťdifices vastes et
splendides, ces institutions de plaisir public qu'on appelle des
thť‚tres et des scŤnes. La multitude elle-mÍme n'est pas assez riche
pour se donner ŗ prix d'or, tous les soirs, ces heures dťlicieuses de
rassemblement, d'oisivetť et de reprťsentations scťniques. Les acteurs
eux-mÍmes ne manquent pas moins aux poŽtes pour jouer leurs oeuvres que
les ťdifices, les dťcorations et les spectateurs. Comment ces acteurs et
ces actrices nťcessaires en grand nombre ŗ la reprťsentation de la scŤne
se consacreraient-ils, dŤs leur enfance, ŗ un art difficile qui ne leur
promettrait ni pain, ni gloire, ni compensation ŗ tant d'ťtudes? Or,
sans acteurs consommťs dans leur art, que devient le drame le mieux
conÁu et le mieux ťcrit?--L'ennui de ceux qu'il a pour objet de charmer
par la perfection de la langue, de l'attitude, du geste, de l'action.
Ce n'est qu'aprŤs de longs siŤcles de grossiŤres ťbauches thť‚trales
pareilles ŗ celles de _Thespis_ en GrŤce, ou de nos _mystŤres_ en
France, que s'ťlŤvent des thť‚tres permanents dignes de la majestť du
trŰne ou du peuple. Ce n'est qu'alors aussi que se forment ces grands
acteurs aussi rares que les grands poŽtes, qui, comme _Roscius_,
_Garrick_, _Talma_, _Rachel_, _Ristori_, personnifient, dans un corps et
dans une diction modelťs sur la nature par l'art, les grandes ou
touchantes figures que l'histoire ou l'imagination groupent sur la scŤne
dans des poŽmes dialoguťs pťtris de sang et de pleurs. L'imagination
recule devant les prodigieuses difficultťs qu'un grand acteur ou une
grande actrice ont ŗ vaincre pour se transfigurer ainsi ŗ volontť dans
le personnage qu'ils sont chargťs de revÍtir, depuis la physionomie
jusqu'ŗ la passion et ŗ l'accent.
Il faut que, non-seulement la nature morale, mais encore la nature
physique leur obťisse comme la note obťit au musicien sur l'instrument,
comme la teinte obťit au peintre sur la palette. Visage, regard,
lŤvres, fibres sourdes ou ťclatantes de la voix, stature, dťmarche,
orteils crispťs sur la planche, gesticulation serrťe au corps ou
s'ťlevant avec la passion jusqu'au ciel, rougeurs, p‚leurs, frissons,
frťmissements ou convulsions de l'‚me communiquťs de l'‚me ŗ l'ťpiderme
et de l'ťpiderme de l'acteur ŗ celle d'un auditoire transformť dans le
personnage, cris qui dťchirent la voŻte du thť‚tre et l'oreille du
spectateur pour y faire entrer la foudre de la colŤre, gťmissements qui
sortent des entrailles et qui se rťpercutent par la vťritť de l'ťcho du
coeur, sanglots qui font sangloter toute une foule, tout ŗ l'heure
impassible ou indiffťrente, gamme entiŤre des passions parcourue en une
heure et qui fait rťsonner, sous la touche forte ou douce, le clavier
sympathique du coeur humain: voilŗ la puissance de ces hommes et de ces
femmes, mais voici aussi leur gťnie!
De telles puissances et de tels gťnies artificiels supposent, dans ces
acteurs indispensables ŗ la scŤne, des miracles d'efforts, d'ťtudes,
d'ťducation spťciale ŗ cette profession, des sentiments fantastiques qui
ne se produisent que dans un ťtat trŤs-lettrť, trŤs-oisif et
trŤs-opulent des nations. Les poŽtes dramatiques ne sont pas seuls dans
leurs oeuvres, ils n'existent tout entiers que par leurs acteurs; ils
dťpendent ainsi du temps oý ils vivent et ne peuvent naÓtre qu'ŗ la
consommation des nations policťes. Que serait devenu le grand HomŤre,
qui allait rťcitant lui-mÍme ses poŽmes sur les chemins de Chio ou de
Samos, s'il avait ťcrit ses divins ouvrages en scŤnes et en dialogues,
et s'il lui avait fallu trouver des interprŤtes de ses vers parmi les
pasteurs ou les matelots de l'Ionie?
ņ chaque ‚ge son genre de poťsie, mais le plus parfait, sinon le plus
ťmouvant de ces genres, est certainement celui qui n'a pas besoin de
tous ces auxiliaires et de tous ces accessoires ťtrangers ŗ la poťsie
elle-mÍme et qui ne demande, comme le poŽte ťpique ou le poŽte lyrique,
qu'une goutte d'encre au bout d'une plume de roseau.
Cela dit, remettons ŗ un autre moment l'ťtude que nous ferons rapidement
du thť‚tre grec, le plus accompli des thť‚tres, du thť‚tre romain,
presque nul dans un peuple trop fťroce pour goŻter les plaisirs purement
intellectuels de l'esprit, des thť‚tres espagnols, anglais, allemands,
et enfin du thť‚tre franÁais, le plus correct et le plus sensť des
thť‚tres modernes dans la plus sensťe et dans la plus communicative des
langues, et commenÁons par son chef-d'oeuvre Athalie.
II
Il faut tuer ici, par un mot dur, mais vrai, la vanitť de l'homme. Un
grand homme n'est pas seulement, comme on dit, fils de ses oeuvres: un
grand homme est avant tout fils de son siŤcle, ou plutŰt un siŤcle se
fait homme en lui: voilŗ la vťritť.
Jamais ce mot ne fut plus visiblement vťrifiť que dans Racine et dans
les cinq ou six grands poŽtes ou grands ťcrivains qui furent avec lui
comme la floraison et la fructification de ce beau siŤcle de Louis XIV.
Tout concourait, depuis cent cinquante ans, dans la religion, dans la
politique, dans les armes, dans l'ťducation publique, dans la direction
des lettres et des arts, ŗ ťlever la France ŗ une de ces ťpoques de
civilisation, de gloire, de paix, de loisir et de luxe d'esprit oý les
nations font halte un instant, comme le soleil ŗ son zťnith, pour
concentrer tous leurs rayons en un foyer de splendeur active et pour
montrer au monde ce que peut Ítre un peuple parvenu ŗ sa derniŤre
perfection de croissance d'unitť et de gťnie.
La religion et la monarchie, ces deux principes d'autoritť absolue, l'un
sur les ‚mes, l'autre sur les esprits, s'ťtaient embrassťes dans une
indissoluble ťtreinte. Elles avaient donnť ŗ la France tout ce que peut
donner le despotisme: la concentration et la rŤgle de toutes ses forces
intellectuelles et matťrielles dans un effort universel des
intelligences disciplinťes sous l'…glise et sous le roi. La libertť a
autre chose ŗ donner un jour aux peuples, mais on peut dťfier l'…glise
et la monarchie de donner plus qu'elles n'avaient donnť au siŤcle de
Louis XIV, le gťnie disciplinť par le despotisme.
Voyez comme tout y avait providentiellement concouru! Les guerres de
religion, atroces mais saintes, dans les deux partis, avaient remuť et
exercť jusqu'au fond des ‚mes le plus fort, le plus noble, le plus divin
des hťroÔsmes humains, l'hťroÔsme de la conscience, non pas celui qui
fait les hťros, mais celui qui fait les martyrs. Les caractŤres
s'ťtaient vigoureusement retrempťs dans ce sang et dans ce feu des
guerres sacrťes.
Le sort et la dťfection d'Henri IV, ce dupeur de Dieu et des hommes,
avaient donnť la victoire au parti de l'…glise romaine. Ce parti avait
persťcutť et proscrit les vaincus obstinťs. C'ťtait atroce, mais c'ťtait
logique. On avait combattu pour l'unitť, on devait triompher pour elle.
Le crime de libertť de pensťe n'ťtait plus seulement un crime contre le
ciel, c'ťtait un crime contre l'…tat. Le roi n'ťtait que la main du
pontife, il vengeait l'…glise, et l'…glise, ŗ son tour, vengeait le
prince; car ces deux autoritťs se confondaient en une. Ce qui ťchappait
ŗ l'…glise tombait sous le glaive du roi, et ce qui s'insurgeait dans
son coeur contre le roi tombait sous l'excommunication de l'…glise. Il
ne fallait pas seulement obťir ŗ cette double autoritť combinťe entre le
roi et Dieu, il fallait l'adorer. La servitude ťtait devenue vertu. Ce
n'est pas assez; elle ťtait devenue honneur selon le monde.
Un mot historique de Racine dans une de ses lettres ŗ madame de
Maintenon caractťrise mieux que mille pages l'excŤs vťritablement impie
et cependant consciencieux d'asservissement ŗ la personne divinisťe du
prince dont on se glorifiait ŗ cette ťpoque: ęDieu m'a fait la gr‚ce,
Madame, de ne jamais rougir de l'…vangile ni du roi dans tout le cours
de ma vie.Ľ
Ainsi Dieu et le prince ťtaient placťs au mÍme niveau d'adoration et
d'adulation par ces sujets agenouillťs devant les deux puissances. Ce
mot qui paraÓtrait abject et sacrilťge aujourd'hui aux plus vils des
courtisans d'un trŰne, paraissait sublime alors; c'ťtait la dťvotion ŗ
la tyrannie.
III.
Voilŗ ce qu'avait fait l'esprit du temps pour l'unitť de ce peuple. La
guerre et la politique n'avaient pas fait moins. Deux grands ministres:
l'un, le Machiavel franÁais, Richelieu; l'autre, le politique italien,
Mazarin, maÓtres de deux rŤgnes et d'une rťgence, avaient fait le reste.
L'un, par ses fťrocitťs implacables, avait ťmancipť complťtement le
trŰne des restes de la grande fťodalitť qui rťsistaient et qui
embarrassaient son action souveraine. La faux de Tarquin dans la main
de Richelieu, cruel par goŻt autant au moins que par politique, avait
abattu toutes les tÍtes qui tendaient ŗ se relever ŗ la cour ou dans les
provinces. Ce grand niveleur ŗ tout prix avait fait une proscription de
Marius pour crime de supťrioritť. Malheur aux grands, c'ťtait sa maxime.
Il ne voulait qu'un seul grand, le roi, et c'ťtait lui qui ťtait le roi
sous sa pourpre. Cette terreur d'en haut avait rťussi.
L'autre, Mazarin, le plus doux, le plus temporiseur et le plus habile de
tous les politiques qui aient jamais maniť les fils compliquťs d'une
rťgence de royaume pendant une longue minoritť, avait rejetť loin de lui
la hache sanglante de Richelieu son maÓtre. Il avait compris que la
nation, intimidťe et abattue, n'avait plus besoin que d'Ítre relevťe,
caressťe et sťduite par les manťges et par les bienfaits d'une politique
de nťgociation. Il avait commencť son systŤme de sťduction par le coeur
de la reine, mŤre de Louis XIV. Cette charmante veuve d'un roi imbťcile
avait tremblť elle-mÍme sous Richelieu, elle s'ťtait prťcipitťe avec
confiance dans l'esprit et dans le coeur d'un ministre qu'elle ne
pouvait plus trahir sans se trahir elle-mÍme.
L'histoire, envenimťe par les pamphlets du temps pleins des animositťs
de la Fronde et des parlements, a dťfigurť cette reine habile. En
rťalitť, c'ťtait une femme intrťpide, une mŤre accomplie, une amie
constante de son ministre jusqu'ŗ la mort, une politique aussi consommťe
et plus magnanime qu'…lisabeth d'Angleterre. Son seul tort, dans
l'histoire, c'est de s'Ítre effacťe et tenue dans le demi-jour derriŤre
la pourpre de Mazarin.
Mais cette rťserve mÍme ťtait dans son vrai rŰle de femme, de reine et
de mŤre. En apparaissant trop, elle aurait assumť sur elle et sur son
fils les impopularitťs dangereuses qui s'attachaient ŗ Mazarin. En se
tenant dans l'ombre et dans une habile neutralitť, entre le ministre
odieux, mais nťcessaire, et les grands rťvoltťs, Anne d'Autriche
conservait pour les grands pťrils ce rŰle d'intermťdiaire irresponsable
et de nťgociatrice couronnťe qui rťtablissait la paix et qui sauvait ŗ
la fois le jeune roi, la monarchie et le ministre.
C'est un rŤgne mal ťtudiť de l'histoire de France, c'est une histoire
ťcrite par l'opposition de la Fronde et par des factieux en robe du
parlement. La vťritable reine Blanche de ce grand rŤgne fut Anne
d'Autriche.
IV
Richelieu, Anne d'Autriche et Mazarin avaient fait d'avance le rŤgne de
Louis XIV. Il n'eut qu'ŗ le saisir et ŗ le conserver. Il fit bien l'un
et l'autre; c'ťtait le prťdestinť du despotisme. La nature lui en avait
donnť ŗ la fois les vices et les vertus: un orgueil de dieu et un
commandement de roi.
Mais ce n'ťtait pas tout encore; il faut un instrument au gťnie des
lettres. Cet instrument, c'est une langue. La langue poťtique et la
langue oratoire de la France se trouvaient prťcisťment ŗ ce confluent
des diffťrents ruisseaux des idiomes oý le gťnie des langues, un moment
indťcis, s'arrÍte comme embarrassť de ses richesses, tente diffťrentes
voies, puis, prenant tout ŗ coup son parti dťcisif, forme ce grand
courant original de la langue nationale, qui entraÓne tout en purifiant
tout dans son cours.
C'est le moment oý l'on dit que les poŽtes crťent les langues. Crťer est
un mot impropre; il n'est donnť ŗ personne de crťer l'idiome d'une
nation: c'est le travail et la gloire de tous; mais il est vrai de dire
que c'est le moment oý les grands poŽtes et les grands ťcrivains
faÁonnent la langue, lui donnent le pli, la forme, la flexibilitť, la
sonoritť, la couleur, et l'approprient aux usages intellectuels auxquels
cette langue est prťdestinťe par cette providence qui assigne leur
mission aux peuples. Les peuples donnent le lingot aux poŽtes, et les
poŽtes frappent de leur empreinte ce lingot: voilŗ la vťritť.
Or, tout avait concouru aussi, dans les moeurs et dans les rŤgnes, ŗ
enrichir la langue franÁaise d'alluvions d'idiomes ou antiques ou
modernes, qui la rendaient propre ŗ devenir ŗ son tour monumentale.
L'…glise, qui maintenait l'usage du latin, l'avait remplie de latinitť.
La latinitť lui constituait un nerf, une soliditť, une briŤvetť
concentrťe de construction qui presse les mots, comme Tacite, pour leur
faire rendre avec plus d'ťnergie le sens.
La pompe du grec, rťimportťe en Italie par _Lascaris_ sous les premiers
Mťdicis, et rťimportťe d'Italie en France par Ronsard et ses
disciples, lui avait donnť l'ampleur, l'image et la gr‚ce refusťes par
la nature au latin.
L'Italie moderne, qui l'avait inondťe, par le midi et par nos guerres de
FranÁois Ier, de ses poťsies, lui avait donnť, par _Dante_ et par
_Pťtrarque_, par le _Tasse_ et par l'_Arioste_, la fluiditť, l'harmonie
et l'abondance, qui sont les caractŤres du gťnie italien du moyen ‚ge.
La maison de Mťdicis, si souvent confondue avec la maison rťgnante de
France sous les Valois, avait rťgnť au Louvre et aux Tuileries autant
qu'ŗ Florence par ses artistes et par ses poŽtes presque naturalisťs
franÁais.
Enfin, dans ces derniers temps, les liaisons de la dynastie franÁaise
avec l'Espagne avaient inoculť ŗ la langue de Louis XIII, sous Anne
d'Autriche, princesse plus espagnole qu'allemande, le gťnie hťroÔque,
chevaleresque, maure, plus grand que nature, emphatique, enflť, qui
touchait au sublime par sa hauteur, et au ridicule par son exagťration.
Corneille ťtait la contre-ťpreuve de ce gťnie espagnol en France. Il
nous avait fait une langue de hťros, presque de matamores; la langue qui
montait avec lui jusqu'aux cieux allait se perdre dans les nuages. Si
nous avions eu une sťrie de Corneilles, nous aurions perdu le naturel,
et nous nous serions enflťs jusqu'ŗ la dťclamation. C'ťtait assez d'un.
L'hťbreu enfin, elliptique et concassť comme ses rochers du SinaÔ, avait
ťtť calquť par les orateurs religieux et par Bossuet surtout, et cette
langue avait donnť au franÁais l'ťclair lyrique et l'autoritť
prophťtique qui ťcrivent en lueurs et qui parlent en foudres.
Quels plus riches matťriaux de langue un grand poŽte ťclectique comme
Racine pouvait-il trouver sous la main pour construire ŗ sa gloire et ŗ
la gloire de sa nation le chef-d'oeuvre achevť et insurpassable de la
langue poťtique franÁaise, si ce poŽte surtout savait choisir avec la
sŻretť de bon sens, la dťlicatesse de goŻt et le tact infaillible du
caractŤre franÁais ce qui convenait le mieux dans ces matťriaux
ťtrangers au gťnie sensť, clair, simple et naturel de la nation?
C'est cette heureuse coÔncidence de bonnes fortunes littťraires qui vit
et qui fit naÓtre Racine, c'est-ŗ-dire la perfection incarnťe de la
langue poťtique en France! Nous plaignons ceux qui ne sentent pas cette
perfection de la langue dans un homme providentiel pour notre
littťrature. Mais aussi remarquez bien une chose: c'est que tous ceux
qui lui reprochent d'Ítre trop exclusivement franÁais sont des
critiques, des ťcrivains ou des poŽtes, qui sont eux-mÍmes trop
ťtrangers dans leurs tendances poťtiques et qui touchent, par quelques
exagťrations de leur gťnie, ŗ ces vices et ŗ ces excŤs du grec, du
latin, de l'hťbreu, de l'italien et surtout de l'espagnol, que Racine a
su, avec un art sťvŤre, corriger et exclure de la langue dans laquelle
nous chantons pour nous et pour la postťritť de la France.
C'est cette mÍme coÔncidence de religion achevťe, de moeurs faites, de
politique ťtablie, de loisir national conquis par les armes, et de
langue crťťe par le temps qui fait, comme nous le disions tout ŗ
l'heure, qu'un grand siŤcle se fait homme tout ŗ coup dans un groupe
prťdestinť de grands hommes.
Ainsi, au moment dont nous vous entretenons, la monarchie s'ťtait faite
homme dans Louis XIV, la Bible s'ťtait faite homme dans Bossuet,
l'…vangile s'ťtait fait homme dans Fťnelon, la comťdie s'ťtait faite
homme dans MoliŤre, la langue poťtique moderne s'ťtait faite homme dans
Racine. _Athalie_ allait tomber de son gťnie, comme le fruit mŻr tombe ŗ
son heure de l'arbre fertilisť par un sol, par une culture et par une
saison de choix.
V
Nous ne voulons pas ťcrire ici la vie de Racine, malgrť la corrťlation
intime qui, pour le regard clairvoyant du philosophe, existe entre le
poŽte et ses oeuvres. Nous rťservons cette vie que nous avons
profondťment ťtudiťe pour la vie des grands hommes ŗ laquelle nous
travaillons dans un autre recueil. Toutefois nous en dirons assez ici
pour faire bien comprendre la naissance et la perfection de l'oeuvre
d'_Athalie_ ŗ nos lecteurs.
Jean Racine ťtait nť ŗ la Fertť-Milon, petite ville de l'ancienne
province de Valois. Sa famille appartenait ŗ cette vieille bourgeoisie
franÁaise qui avait la distinction des moeurs de la noblesse sans en
avoir les lťgŤretťs et les vices. Son pŤre occupait un de ces modestes
emplois publics du fisc royal, apanage habituel de ces familles. Son
aÔeul maternel remplissait un emploi de magistrature. Les deux familles
ťtaient lettrťes de profession, religieuses de coeur.
Une circonstance fortuite nourrit cette double disposition aux lettres
et ŗ la religion dans la maison. Une tante de l'enfant ťtait religieuse
dans cette cťlŤbre maison de Port-Royal. Port-Royal ťtait le berceau et
le cťnacle du jansťnisme. Le jansťnisme prťoccupait gravement alors de
la menace d'un schisme l'…glise et le gouvernement de Louis XIV. Les
jansťnistes ťtaient les stoÔciens du christianisme.
Les jťsuites, leurs implacables ennemis, ťtaient beaucoup moins sťvŤres.
En hommes aussi politiques que religieux, ils redoutaient l'exagťration
de foi et de moeurs des jansťnites. Cette exagťration de foi et de
moeurs aurait fini par rťvolter la faiblesse humaine et par rťduire le
christianisme ŗ un petit groupe de chrťtiens forcenťs qui auraient damnť
le monde en sauvant quelques sectaires. Les jťsuites appropriaient, avec
un art consommť, la religion au temps, au pays, aux usages, aux vices
mÍme tolťrťs du prince et du peuple; ils nťgociaient, comme des
diplomates accrťditťs ŗ la fois au ciel et sur la terre, entre le Christ
et le monde.
Cette profonde habiletť de conduite leur avait valu, ŗ la fin, la
confiance absolue d'un roi qui avait besoin de foi pour son esprit et de
tolťrance pour ses faiblesses. Sa conscience ťtait dans leurs mains.
Ils la maniaient ŗ leur fantaisie dans leurs intťrÍts et dans les
intťrÍts de l'…glise. Ils lui avaient ordonnť de persťcuter les
religieux et les religieuses de Port-Royal. Louis XIV leur obťissait
d'autant plus volontiers qu'un soupÁon de rťvolte contre l'…glise ťtait
ŗ ses yeux un soupÁon d'opposition contre la monarchie, et qu'un levain
de rťpublicanisme lui semblait cachť dans ces doctrines d'obťissance ŗ
Dieu seul, de stoÔcisme romain et de mťpris de la persťcution terrestre.
VI
Ces religieux et ces religieuses de Port-Royal, expulsťs pour la
premiŤre fois de leur solitude, avaient cherchť un refuge dans une
sauvage abbaye des forÍts de la Fertť-Milon, la Chartreuse de
Bourg-Fontaine. Leur mťrite et leur saintetť rťpandaient leur bonne
odeur jusque dans les familles pieuses de la Fertť-Milon. On s'attacha ŗ
eux pour leur vertu, pour leur science et pour leur persťcution.
La famille maternelle du jeune Racine fut particuliŤrement ťdifiťe de la
piťtť de ces saints et de ces saintes anachorŤtes. Trois de ses tantes,
entraÓnťes par la contagion de l'exemple, entrŤrent dans leur ordre
religieux, s'y distinguŤrent par leur zŤle et y persťvťrŤrent jusqu'ŗ la
mort. C'est ainsi que le futur poŽte d'_Athalie_ fut imbibť dŤs sa
tendre enfance de ces ťmanations de foi et de piťtť chrťtienne qui
s'ťvaporŤrent un moment au vent du siŤcle, mais qui se retrouvŤrent
comme un premier parfum au fond de son coeur quand il repassait les
jours de sa jeunesse dans la maturitť de ses annťes.
AprŤs de premiŤres ťtudes classiques et sťvŤres faites ŗ la Fertť-Milon,
sous la direction de son tuteur, le crťdit de ses tantes religieuses au
monastŤre de Port-Royal, prŤs Paris, le fit entrer au nombre des
disciples de cette savante et sainte maison. La colŤre du roi s'ťtait
encore une fois calmťe devant la rťsignation de ces pieux solitaires.
Racine y acheva sous eux ses ťtudes d'antiquitť et de thťologie. ņ seize
ans il vint les terminer ŗ Paris, au collťge d'Harcourt. Un des associťs
libres de Port-Royal, M. le Maistre, lui prÍtait sa chambre ŗ Paris, et
le traitait en fils plus qu'en disciple.
La correspondance de ce second pŤre avec le jeune homme pendant les
absences de M. le Maistre de Paris, est pleine de ces naÔvetťs ŗ la fois
tendres et austŤres qui caractťrisent ces paternitťs intellectuelles.
ęMandez-moi si mes vieux livres sont bien en ordre sur les tablettes et
si mes onze volumes de saint Chrysostome y sont; voyez-les de temps en
temps pour en enlever la poussiŤre. Mettez de l'eau dans les ťcuelles
au-dessus desquelles ils sont rangťs afin que les rats ne puissent les
ronger. Suivez bien en tout les conseils de votre sainte tante. La
jeunesse doit toujours se laisser conduire et t‚cher de ne point
s'ťmanciper. Peut-Ítre que Dieu vous fera revenir ŗ Port-Royal. T‚chez
que les ťvťnements vous dťtachent du monde si ennemi de la piťtť. Adieu,
mon cher fils, aimez en moi votre pŤre comme il vous aime. Envoyez-moi
aussi mon Tacite in-folio.Ľ
VII
Le jeune homme rťpondait ŗ ces soins pour son avancement dans les
lettres au delŗ de ce que dťsiraient ses vťnťrables maÓtres. Revenant
sans cesse ŗ Port-Royal pendant les vacances du collťge d'Harcourt
comme dans un foyer paternel, il s'y livrait avec une ardeur fiťvreuse
aux trois goŻts que la nature et l'ťducation avaient dťveloppťs comme
des instincts en lui: le goŻt de l'histoire qu'il satisfaisait dans
Plutarque, le goŻt de la poťsie qu'il nourrissait d'HomŤre et de
Virgile, et enfin le goŻt de la tragťdie, cette histoire poťtique en
drame dont il puisait les exemples dans les deux tragiques Sophocle et
Euripide. Il passait des journťes entiŤres enfoncť dans les forÍts qui
entourent le monastŤre de Port-Royal, ces volumes ŗ la main. Sa mťmoire,
aussi heureuse que son imagination ťtait ťmue, s'imprťgnait de ces
belles harmonies de la poťsie grecque, de cette musique passionnťe du
coeur humain.
Rien cependant n'indiquait encore en lui, par des explosions trop
prťcoces de gťnie, une de ces natures qui font violence au temps et qui
jaillissent d'elles-mÍmes en ťclairs de talent, rťvťlateurs de hautes
destinťes. C'ťtait un fruit de la culture plus encore que de la nature,
un de ces esprits bien constituťs, mais nullement prodigues, qui ont
besoin d'exemples pour imiter et qui empruntent leur sťve ŗ toute
l'antiquitť pour grandir ŗ la proportion des chefs-d'oeuvre antiques.
Les premiers vers qu'il composa, ŗ l'imitation des lyriques grecs et
latins, sur la solitude des forÍts, sur les charmes de la nature, sur la
paix religieuse du monastŤre de Port-Royal; sur les hymnes traduites du
Brťviaire, et enfin son ode sur le mariage du roi, intitulťe la _Nymphe
de la Seine_, sont des exercices trŤs-ordinaires d'un novice de l'art,
et des imitations trŤs-p‚les des odes de David ou de Pindare. L'oreille
a dťjŗ son harmonie, la conception n'a pas sa force, l'image n'a pas sa
nouveautť, son relief et son coloris. Ce sont des balbutiements d'un
disciple qui n'aura pas de longtemps l'accent de ses maÓtres. L'ťtude
attentive de ces premiŤres poťsies rťvŤle le Racine futur tout entier,
un fils de l'antiquitť, non un fils de son siŤcle, un homme de
renaissance, non de crťation, original plus tard, mais original
seulement par la perfection.
Voilŗ ce qui a donnť tant de prise contre cette gloire, dans ces
derniers temps, ŗ ses dťnigreurs. Oui, son originalitť la plus rare de
toutes ne fut pas d'Ítre neuf, elle fut d'Ítre parfait. Mais le
chef-d'oeuvre en tout genre n'est-il pas la plus merveilleuse des
nouveautťs, la nouveautť ťternelle et suprÍme du beau, celle de Phidias,
celle de RaphaŽl, celle de Racine? Passons:
VIII
Le roi et la cour avaient goŻtť son ode de poŽte laurťat sur la _Nymphe
de la Seine_. Les solitaires de Port-Royal furent plus alarmťs que
flattťs de ce succŤs de leur ťlŤve. Ils avaient la faiblesse, ainsi
qu'on le voit dans les pensťes de _Pascal_, de mťpriser la poťsie, sans
doute comme une voluptť de l'esprit qui avait trop d'attrait pour Ítre
innocente. Ils se h‚tŤrent d'ťloigner le jeune Racine de la scŤne de ses
premiers succŤs, de peur qu'il ne prÓt goŻt ŗ ces vaines gloires, et de
l'envoyer chez un de ses oncles, chanoine ŗ UzŤs, nommť le pŤre Sionin.
Cet oncle, chanoine et grand vicaire d'UzŤs, possťdait de riches
bťnťfices et se proposait d'en rťsigner un ŗ son neveu aussitŰt que ce
neveu serait entrť dans l'…glise.
Racine se prÍta pendant quelque temps, en apparence, ŗ l'ťtude de la
thťologie, mais sa nature mondaine, lťgŤre et passionnťe rťpugnait
invinciblement ŗ l'austťritť de la vie sacerdotale. Il prit en aversion
l'habit noir que son oncle lui faisait porter, les moeurs claustrales et
la ville mÍme d'UzŤs. Il se renferma dans la solitude de ses pensťes et
de ses poŽtes grecs, et il ťbaucha, ŗ l'insu de son oncle, la tragťdie
de la _ThťbaÔde_ ou des _FrŤres ennemis_; il mťditait de la donner au
thť‚tre ŗ son retour ŗ Paris. Les obstacles qu'il trouva dans le clergť
d'UzŤs et le refus d'un petit bťnťfice ecclťsiastique rťsignť en sa
faveur par son oncle l'aigrirent de plus en plus contre l'…glise et
prťcipitŤrent son retour ŗ Paris.
C'ťtait le moment de la gloire et de la faveur de MoliŤre, gťnie
jusque-lŗ inconnu et avili par la mauvaise fortune. Racine se fit
recommander ŗ lui. MoliŤre, incapable de jalousie et capable de toutes
les bontťs du coeur, le recommanda et l'introduisit ŗ la cour. Une ode
mťdiocre intitulťe la _Renommťe aux Muses_ lui valut des louanges de la
bouche du roi et une gratification de sa main. L'adulation dans cette
cour ťtait plus vite reconnue et plus libťralement rťcompensťe que le
talent. Boileau, ŗ qui MoliŤre porta l'ode de son jeune protťgť,
l'estima assez pour y faire de sa main des corrections. Racine devint,
par MoliŤre, le disciple favori et l'ami de Boileau. La Fontaine, esprit
naÔf, gracieux, _discinctus_, pour nous servir de l'expression latine
qui rend seule le dťbraillement de ce caractŤre, faisait dťjŗ partie,
souvent inaperÁue, toujours muette, de cette sociťtť de grands esprits.
Leur crťdit et surtout l'intervention amicale de MoliŤre, directeur de
thť‚tre, obtinrent la reprťsentation de la _ThťbaÔde_ ou des _FrŤres
ennemis_. Cette tragťdie, toute composťe de lambeaux mal cousus
d'_Eschyle_, d'_Euripide_ et de _SťnŤque_, qui avaient traitť avant
Racine le mÍme sujet, ne fut excusťe qu'ŗ cause des beaux vers et de la
jeunesse du poŽte. On y sent la tension pťnible d'un talent naissant qui
veut s'ťlever, malgrť la nature, ŗ la concision hťroÔque et ŗ l'enflure
espagnole de Corneille. Mais c'ťtait un enfant roidissant ses faibles
muscles pour rappeler l'hercule du thť‚tre. Le nom de Racine se rťpandit
par ce premier essai: cependant rien n'indiquait encore qu'un rival
ťtait nť au poŽte vieilli du _Cid_.
IX
L'annťe suivante, 1665, Racine donna au thť‚tre la tragťdie d'_Alexandre
le Grand_, tirťe de Quinte-Curce et imitťe de Corneille et du roman
chevaleresque de Mlle de Scudťri. L'ťlťgance de la versification et les
allusions adulatrices ŗ Louis XIV, hťros toujours rťel de ces piŤces
hťroÔques, donnŤrent ŗ l'ouvrage un succŤs qu'il ťtait loin de mťriter
par lui-mÍme.
Tout le gťnie grec et tragique de Racine n'ťclata dans sa plťnitude que
dans _Andromaque_. Le poŽte franÁais y ťgale, comme poŽte ťpique, HomŤre
et Virgile, chantres des mÍmes catastrophes. Dans _Britannicus_, qu'il
donna en 1669, il rivalisa de gťnie historique avec Tacite: il ne
rivalisa plus de poťsie qu'avec lui-mÍme. _Bťrťnice_, qui suivit
_Britannicus_, n'est qu'une ťlťgie hťroÔque pleine d'allusions aux
amours du roi. Le poŽte cesse d'Ítre tragique ŗ force d'effťminer
l'amour et le langage d'un hťros. _Bajazet_ offre des beautťs
supťrieures, mais corrompues par la ridicule application des moeurs
galantes d'une cour franÁaise aux moeurs des Ottomans. _Mithridate_,
_Iphigťnie_, _PhŤdre_ enfin, son chef-d'oeuvre profane, ťlevŤrent le nom
du poŽte au zťnith de sa gloire. Nous analyserons ailleurs _PhŤdre_, la
plus immortelle de ces oeuvres. Nous montrerons ce que ce gťnie
ťclectique et appropriateur a empruntť ŗ ses ťmules de l'antiquitť
grecque et latine, et en quoi le sublime imitateur a ťgalť et surpassť
ses modŤles.
Mais ici nous reprenons notre rťcit, puisque ce sont les circonstances
de sa vie qui furent l'occasion de ses derniŤres et de ses meilleures
oeuvres.
X
Racine, il faut le dire, puisque c'est la vťritť de son caractŤre,
n'avait ni la bienveillance cordiale et sans envie de MoliŤre, ni le
m‚le dťsintťressement de soi-mÍme de Corneille, ni la simplicitť puťrile
et nonchalante de la Fontaine, ni mÍme l'‚pre et loyale probitť d'esprit
de Boileau son ami.
Le vieux Corneille, ŗ qui il avait demandť des conseils en lui
soumettant la tragťdie d'_Alexandre_, lui avait rťpondu ce que nous lui
aurions rťpondu nous-mÍme aujourd'hui que nous jugeons de sang-froid et
ŗ distance la nature de son gťnie: ęqu'il avait un admirable talent de
poŽte ťpique, mais qu'il ne lui trouvait pas le nerf vibrant et
concentrť de la tragťdie.Ľ
Cette rťponse, faite de bonne foi par un maÓtre souverain de l'art ŗ un
jeune homme, avait irritť et comme dťfiť Racine. Il avait eu le tort de
vouloir ťclipser, en l'imitant dans les mÍmes sujets, le grand
Corneille. Il avait ravalť l'ťmulation ŗ une inconvenante rivalitť. Il
n'avait pas assez respectť la majestť du gťnie au repos ni la saintetť
de la vieillesse; il avait oubliť qu'il vieillirait lui-mÍme un jour, et
que la pire des insultes est de comparer sa force naissante ŗ la
faiblesse d'un homme hors de combat.
Corneille cependant avait raison selon nous; et en assignant au jeune
Racine le rŰle de poŽte ťpique, il ne lui assignait certes pas une
gloire infťrieure ŗ la sienne, car on lit et relit avec dťlices le
poŽme; et la lecture des tragťdies, dťpourvue des fantasmagories de la
scŤne, est une lecture difficile, ingrate, tronquťe, souvent
fastidieuse.
Il y a ŗ cela trois causes qui sont dans la nature mÍme du drame ou de
la tragťdie.
La premiŤre de ces causes, c'est la briŤvetť nťcessaire de la tragťdie
ou du drame, qui, devant Ítre rťcitť avec un grand appareil de
dťcoration et une grande lenteur de dťclamation devant le peuple
rassemblť pendant une soirťe, ne comporte pas la vaste ťtendue et
l'ampleur indťfinie du poŽme ťpique. C'est de la poťsie en abrťgť
pressťe par l'heure et par l'impatience d'une foule.
La seconde de ces causes, c'est que le poŽte tragique est privť, par la
nature mÍme de son sujet et par le dialogue pressť qu'il ťtablit entre
ses personnages, de toute la partie descriptive de la poťsie,
c'est-ŗ-dire d'un des plus grands charmes du poŽme. Le poŽte tragique
est comme le sculpteur en bronze ou en marbre: il ne montre que des
statues ou des groupes en action. Le paysage, le lieu, le ciel, les
rťflexions, les peintures, n'existent pas et ne peuvent pas exister pour
lui; ses tableaux ne peuvent avoir ni horizon, ni premier plan; le
spectacle de la nature et les analogies de cette nature avec l'homme lui
sont ŗ peu prŤs interdits. Lacune immense dans son oeuvre! Que feraient
HomŤre, Virgile, le Tasse, le Dante, Milton, CamoŽns, si vous leur
retranchiez leurs descriptions et leur paysage?
Enfin la troisiŤme de ces causes, c'est que le poŽte dramatique ou
tragique ne peut, par la concentration forcťe de son drame, saisir ses
hťros ou ses personnages que dans un accŤs de passion extrÍme de leur
vie et de leur destinťe, au point culminant de leurs sentiments, au
moment oý leur ‚me ťclate ou se dťchire en larmes, en cris ou en sang,
sous la main de la pitiť ou de la terreur.
Qu'en rťsulte-t-il? C'est que le poŽte tragique est conduit ŗ ne peindre
que des pťripťties ou des convulsions suprÍmes de l'‚me de ses
personnages, et que tous les sentiments doux, habituels, modťrťs du
coeur humain, sont retranchťs forcťment de sa poťsie. Or, les sentiments
doux, habituels, modťrťs, heureux, de l'‚me humaine, sont cependant des
notes dťlicieuses de la poťsie, cette musique de l'‚me. Elles sont
interdites au poŽte tragique: il ne prend l'homme qu'en flagrant dťlit
de passions brŻlantes, et il n'en montre que les muscles torturťs par la
douleur comme ceux du Laocoon.
Peut-on dire qu'avec ces trois causes d'infťrioritť relative dans le
cadre mÍme de son oeuvre, le poŽte ťpique, qui peint et qui chante la
nature entiŤre et l'homme tout entier, n'est pas supťrieur, non pas en
gťnie, mais en genre et en charme au poŽte de thť‚tre?
Racine avait donc tort d'Ítre humiliť du mot de Corneille. Corneille lui
assignait en rťalitť la meilleure part du gťnie.
XI
Sa conduite avec MoliŤre, son premier protecteur, son introducteur ŗ la
cour, son introducteur au thť‚tre, ne fut pas plus exempte d'excŤs
d'amour-propre, de personnalitť et mÍme d'ingratitude. C'ťtait MoliŤre
qui avait fait reprťsenter les premiŤres tragťdies de son ami sur son
propre thť‚tre, en rťpondant, pour ainsi dire, au public, de la chute ou
du succŤs de ces tragťdies. C'ťtait lŗ un de ces services qui lient pour
jamais un poŽte reconnaissant ŗ son protecteur.
MoliŤre avait le droit d'espťrer que la gloire de son protťgť
deviendrait la fortune de sa scŤne. Cependant Racine n'ayant pas ťtť
satisfait dans sa vanitť de la maniŤre dont les comťdiens de MoliŤre
jouaient son _Alexandre_, retira brusquement sa tragťdie de ce thť‚tre.
Il la porta au thť‚tre rival de l'hŰtel de Bourgogne, et ce qu'il y eut
de plus cruel pour le pauvre MoliŤre dans ce procťdť, c'est que Racine
lui enleva, en mÍme temps que sa piŤce, la meilleure de ses actrices.
Elle passa, avec la tragťdie, du thť‚tre de MoliŤre au thť‚tre de
Bourgogne, enlevant ainsi ŗ MoliŤre la curiositť d'une piŤce nouvelle et
la popularitť d'une comťdienne accomplie.
L'amitiť entre MoliŤre et Racine fut ŗ jamais rompue par cette
dťfection. MoliŤre, qui ťtait incapable de vengeance, ťtait capable
d'une profonde affliction et d'un amer souvenir. Il ne parla plus de
Racine qu'avec peine, en louant toujours son gťnie, mais en se taisant
sur son coeur. La blessure ne pouvait plus se fermer. Ces deux hommes
laissŤrent la froideur de la faute et du souvenir s'ťtablir entre leurs
‚mes.
XII
Une faute de coeur plus grave et plus ťclatante encore, ŗ la mÍme
ťpoque, signala tristement l'excŤs de personnalitť et la facilitť
d'oubli des services reÁus dans le coeur du poŽte devenu le favori de la
cour et de la scŤne. On a vu que Port-Royal avait ťtť le foyer presque
paternel, et pour ainsi dire, le berceau de l'‚me et du gťnie de Racine.
Les vťnťrables religieux de cette maison considťraient le thť‚tre, qui
remue les passions, comme une institution entiŤrement opposťe au
christianisme, qui les corrige ou les supprime. Ils s'affligŤrent de
voir le jeune Racine, leur ťlŤve bien-aimť, prÍter son talent de poŽte
au thť‚tre.
Nicole, aprŤs Pascal, le plus rude ťcrivain moraliste de cette ťcole,
avait ťcrit dans une de ses polťmiques, ęqu'un faiseur de romans ou un
poŽte de thť‚tre ťtait un empoisonneur public, non du corps, mais des
‚mes; il avait ajoutť qu'un tel poŽte devait s'accuser de la mort d'une
multitude d'‚mes qu'il avait perdues ou qu'il avait pu perdre par ses
vers.Ľ
Une lettre sťvŤre et touchante que la tante de Racine, religieuse ŗ
Port-Royal, ťcrivit ŗ son neveu dans le mÍme temps, fit croire ŗ Racine
que la rťprobation gťnťrale de Nicole s'adressait surtout ŗ lui. Rien
n'ťtait plus faux; Nicole s'adressait au poŽte Saint-Sorlin, espŤce de
fou qui se donnait pour prophŤte.
La lettre de la tante au neveu mťrite d'Ítre citťe ici.
ęAyant appris que vous aviez dessein de faire ici un voyage, j'avais
demandť permission ŗ notre mŤre de vous voir, parce que quelques
personnes nous avaient assurťes que vous ťtiez dans la pensťe de songer
sťrieusement ŗ vous; et j'aurais ťtť bien aise de l'apprendre par
vous-mÍme, afin de vous tťmoigner la joie que j'aurais s'il plaisait ŗ
Dieu de vous toucher; mais j'ai appris depuis peu de jours une nouvelle
qui m'a touchťe sensiblement. Je vous ťcris dans l'amertume de mon coeur
et en versant des larmes que je voudrais pouvoir rťpandre en assez
grande abondance devant Dieu pour obtenir de lui votre salut, qui est la
chose du monde que je souhaite avec le plus d'ardeur. J'ai donc appris
avec douleur que vous frťquentiez plus que jamais des gens dont le nom
est abominable ŗ toutes les personnes qui ont tant soit peu de piťtť, et
avec raison, puisqu'on leur interdit l'entrťe de l'…glise et la
communion des fidŤles, mÍme ŗ la mort, ŗ moins qu'ils ne se
reconnaissent. Jugez donc, mon cher neveu, dans quel ťtat je puis Ítre,
puisque vous n'ignorez pas la tendresse que j'ai toujours eue pour vous,
et que je n'ai jamais rien dťsirť, sinon que vous fussiez tout ŗ Dieu
dans quelque emploi honnÍte. Je vous conjure donc, mon cher neveu,
d'avoir pitiť de votre ‚me, et de rentrer dans votre coeur pour y
considťrer sťrieusement dans quel abÓme vous vous Ítes jetť. Je souhaite
que ce qu'on m'a dit ne soit pas vrai; mais si vous Ítes assez
malheureux pour n'avoir pas rompu un commerce qui vous dťshonore devant
Dieu et devant les hommes, vous ne devez pas penser ŗ nous venir voir;
car vous savez bien que je ne pourrais pas vous parler, vous sachant
dans un ťtat si dťplorable et si contraire au christianisme. Cependant
je ne cesserai point de prier Dieu qu'il vous fasse misťricorde, et ŗ
moi en vous la faisant, puisque votre salut m'est si cher.Ľ
Racine, pour toute rťponse ŗ ses torts de piťtť et de tendresse envers
ses anciens maÓtres, leur adressa deux lettres imprimťes oý la
rťfutation trŤs-aigre de leur doctrine ťtait assaisonnťe par les plus
odieuses incriminations contre leur prťtendue vanitť de corps.
ęIl est aisť de connaÓtre,Ľ dit-il ŗ la fin d'une de ces diatribes, ępar
le soin qu'ils ont pris d'immortaliser ces rťponses, qu'ils y avaient
plus de part qu'ils ne disaient. ņ la vťritť, ce n'est pas leur coutume
de laisser rien imprimer pour eux qu'ils n'y mettent quelque chose du
leur. Ils portent aux docteurs les approbations toutes dressťes. Les
avis de l'imprimeur sont ordinairement des ťloges qu'ils se donnent ŗ
eux-mÍmes; et l'on scellerait ŗ la chancellerie des privilťges fort
ťloquents, si leurs livres s'imprimaient avec privilťge.Ľ
Ces outrages ŗ ses seconds pŤres ťtaient d'autant plus impardonnables
que ces solitaires ťtaient en ce moment en suspicion et en persťcution
devant la cour, et que l'injure littťraire pouvait se transformer contre
eux en sťvices du gouvernement. Pascal indignť prit la plume des
_Provinciales_ pour rťpondre; on ťtouffa la querelle, heureusement pour
Racine. Pascal, l'hercule de la polťmique, aurait ťcrasť le poŽte aussi
tťmťraire qu'ingrat dans son injure. L'immortalitť de la vengeance
aurait immortalisť l'agression.
La facilitť du poŽte ŗ oublier les amitiťs et les services quand sa
gloire ou quand sa fortune ťtaient en jeu n'ťclata pas moins envers Mme
de Montespan. Il avait ťtť le courtisan sans scrupule de cette favorite
tant qu'elle avait rťgnť dans le coeur du roi; il la sacrifia, comme
nous l'allons voir, ŗ Mme de Maintenon, quand cette austŤre favorite se
fut insinuťe entre sa maÓtresse et Dieu dans la faveur de Louis XIV. Il
ťtait temps que la religion de son enfance, qui n'ťtait qu'assoupie sous
les vanitťs et sous les voluptťs de la vie mondaine du grand poŽte, se
rťveill‚t dans son ‚me, et qu'elle vÓnt lui imposer ses rŤgles sťvŤres
de probitť d'esprit et d'abnťgation de vaine gloire qu'il ne trouvait
pas assez dans son caractŤre. Mais Racine ťtait dťjŗ tellement corrompu
par l'esprit des cours, qu'il fallut que cette religion se confondÓt
avec la faveur du monarque pour reprendre sur lui le double empire de la
cour et de la foi.
Ce fut l'ťpoque de sa conversion; elle fut opportune pour sa faveur
auprŤs du roi, mais elle fut sincŤre devant Dieu et efficace pour la
rťforme de ses moeurs. Ses torts lui apparurent au jour de la
conscience: il rougit de son ingratitude envers ses maÓtres de
Port-Royal; il se condamna lui-mÍme plus sťvŤrement peut-Ítre qu'ils ne
l'auraient condamnť; il se repentit d'avoir employť au plaisir profane
du public et ŗ la conquÍte d'une gloire pťrissable les admirables
talents qu'il avait reÁus de la nature et des lettres. Il fit ŗ Dieu et
ŗ ses maÓtres la promesse de ne plus ťcrire pour le thť‚tre; il rťpudia
ses amours; il se maria ŗ une femme vertueuse et sainte qui ne connut
jamais de lui que l'ťpoux et le pŤre, et qui ne lut pas mÍme ses
chefs-d'oeuvre de poŽte. Il ťleva dans l'ombre et dans la piťtť une
famille chrťtienne ŗ laquelle il ne songea ŗ laisser pour hťritage que
sa religion pour toute gloire.
Sa femme, fille d'un trťsorier des finances d'Amiens, s'appelait
Catherine de Romanet; elle avait apportť en dot une fortune modeste ŗ
peu prŤs ťgale ŗ celle de son mari. Les bienfaits du roi, qui se
renouvelaient sous la forme de gratification littťraire ŗ chacune de ses
piŤces, et qui se convertirent bientŰt aprŤs en une pension de 2,000
livres, somme considťrable pour le temps, donnaient une grande aisance ŗ
la famille. ęIl est juste,Ľ ťcrivait-il ŗ cette ťpoque, ęque l'auteur
laborieux tire de son travail une rťmunťration lťgitime.Ľ
Le roi ajouta ŗ cette aisance des gratifications annuelles s'ťlevant de
500 jusqu'ŗ 1,000 louis pendant huit ans et plus, une charge de
gentilhomme ordinaire de sa chambre avec une nouvelle pension de 4,000
livres, et enfin la charge ŗ la fois politique et littťraire
d'historiographe de son rŤgne et de ses campagnes, avec Boileau, son
collŤgue et son ami. Les ťmoluments de cette charge ťtaient
proportionnťs aux dťpenses que les deux historiographes avaient ŗ faire
pour suivre le roi aux armťes. Louis XIV payait largement ses plaisirs
et sa gloire. Versailles et l'immortalitť de son nom, ses monuments et
sa renommťe ne lui paraissaient jamais trop chers; il voulait, comme
Alexandre, des tťmoins des exploits de son rŤgne, et il choisissait ses
tťmoins parmi les poŽtes, ces ťchos ťternels du temps.
La vie de Racine, depuis cette faveur ainsi consolidťe par ses charges,
ne fut plus celle d'un poŽte, mais celle d'un saint dans sa maison et
d'un courtisan accompli ŗ la cour. De toutes ses faiblesses passťes, il
ne lui en restait qu'une, l'adulation aux vertus et jusqu'aux caprices
du roi. C'est de cette faiblesse qu'il vivait et qu'il devait mourir.
Mais cette faiblesse ťtait alors si gťnťrale et si consacrťe, qu'elle se
confondait presque avec une vertu.
XIII
Cependant ses maÓtres sťvŤres de Port-Royal, avec lesquels il s'ťtait
rťconciliť, et dont il goŻtait, plus que le roi ne l'aurait voulu, les
doctrines, rťsistaient seuls ŗ cette contagion servile du temps; ils
conservaient la sainte indťpendance de leur rigorisme au milieu de la
prostration de l'…glise et du siŤcle. Racine, entraÓnť vers eux par son
estime, retenu ŗ la cour par le prestige du roi et par les caresses de
Mme de Maintenon, flottait dans une pťnible ambiguÔtť entre les
exigences de sa conscience jansťniste et les complaisances de situations
qu'il devait au roi.
Il ťtait tout occupť alors, avec Boileau, d'exercer sa plume au style
historique, pour ťlever au rŤgne le monument qu'on attendait de lui. Il
y rťussit mal; la poťsie lui avait g‚tť la main pour la prose: trop
prťoccupť de la forme du rhythme et de l'harmonie des pťriodes, il
manquait de nerf et de pensťe pour consolider sa phrase historique. Dans
ses fragments d'histoire comme dans ses lettres, on ne retrouve, selon
moi, rien du gťnie de l'auteur de _PhŤdre_ et d'_Athalie_; quand il n'y
avait plus ni passion, ni pompe, ni harmonie de thť‚tre sous sa plume,
tout s'ťvaporait, et tout se glaÁait sur sa page. Entre Euripide et
Tacite, il n'y avait qu'un abÓme de mťdiocritť ťlťgante; on en peut dire
autant de Boileau.
Pendant que ces deux poŽtes rťunissaient leurs forces pour ťcrire, ŗ la
gloire du roi, ces pages couvertes d'or, Saint-Simon, seul, gravait dans
l'ombre l'histoire. L'histoire et la poťsie sont deux talents bien
rarement rťunis. Tacite, parmi les historiens, aurait pu Ítre poŽte;
Dante, parmi les poŽtes, aurait pu Ítre historien; cela ne fut donnť ni
ŗ Boileau ni ŗ Racine. Ils ne furent qu'historiographes, c'est-ŗ-dire
les annotateurs d'un rŤgne, prenant des notes pour la postťritť. Mais la
postťritť ne les lit pas.
XIV
Racine ne se montra pas, dans ses essais de discours, plus ťgal ŗ la
haute ťloquence qu'ŗ la grande histoire. Le discours qu'il prononÁa ŗ
l'ťpoque de sa rťception ŗ l'Acadťmie franÁaise ne fut qu'une harangue
vulgaire et mal balbutiťe. Celui qu'il prononÁa aprŤs la mort de
Corneille, son rival, ne fut pas digne de ce deuil, menť par l'ťmule
d'Euripide devant la tombe de l'ťmule de Sophocle. Quelle plus
magnifique occasion d'ťloquence, cependant, que l'apothťose de Corneille
dans la bouche de l'auteur d'_Athalie_! Mais le souffle de l'ťloquence,
qui vient du caractŤre et du coeur, ne soulevait pas aussi ťnergiquement
cette poitrine que le souffle poťtique qui vient de l'imagination.
D'ailleurs, exceptť l'ťloquence de la chaire qui ťblouissait alors les
temples dans la parole et dans la personne de Bossuet, l'ťloquence
civique et littťraire n'ťtait pas nťe alors en France; elle ne devait
naÓtre qu'avec la libertť.
Le roi alors se faisait lire ces morceaux d'histoire de son rŤgne ŗ
Versailles, dans la chambre de Mme de Montespan, sa favorite en titre,
bien que son coeur appartÓnt dťjŗ ŗ Mme de Maintenon. Ce fut ŗ une de
ces lectures que Racine et Boileau s'aperÁurent, pour la premiŤre fois,
du dťclin de l'une et de l'ascendant de l'autre. Racine le fils, sur le
rťcit de son pŤre, raconte ainsi cette rťvolution de palais, qui devait
donner tant de gloire et tant d'amertume ensuite ŗ son pŤre:
ęCes lectures se faisaient chez Mme de Montespan. Tous deux avaient leur
entrťe chez elle aux heures que le roi y venait jouer, et Mme de
Maintenon ťtait ordinairement prťsente ŗ la lecture. Elle avait, au
rapport de Boileau, plus de goŻt pour mon pŤre que pour lui, et Mme de
Montespan avait, au contraire, plus de goŻt pour Boileau que pour mon
pŤre; mais ils faisaient toujours ensemble leur cour, sans aucune
jalousie entre eux. Lorsque le roi arrivait chez Mme de Montespan, ils
lui lisaient quelque chose de son histoire; ensuite le jeu commenÁait,
et lorsqu'il ťchappait ŗ Mme de Montespan, pendant le jeu, des paroles
un peu aigres, ils remarquŤrent, quoique fort peu clairvoyants, que le
roi, sans lui rťpondre, regardait en souriant Mme de Maintenon, qui
ťtait assise vis-ŗ-vis de lui sur un tabouret, et qui, enfin, disparut
tout ŗ coup de ces assemblťes. Ils la rencontrŤrent dans la galerie, et
lui demandŤrent pourquoi elle ne venait plus ťcouter leur lecture. Elle
leur rťpondit fort froidement:--Je ne suis plus admise ŗ ces
mystŤres.--Comme ils lui trouvaient beaucoup d'esprit, ils en furent
mortifiťs et ťtonnťs. Leur ťtonnement fut bien plus grand lorsque le
roi, obligť de garder le lit, les fit appeler, avec ordre d'apporter ce
qu'ils avaient ťcrit de nouveau sur son histoire, et qu'ils virent, en
entrant, Mme de Maintenon assise dans un fauteuil prŤs du chevet du roi,
s'entretenant familiŤrement avec Sa Majestť. Ils allaient commencer leur
lecture, lorsque Mme de Montespan, qui n'ťtait point attendue, entra, et
aprŤs quelques compliments au roi, en fit de si longs ŗ Mme de
Maintenon, que, pour les interrompre, le roi lui dit de s'asseoir,
ęn'ťtant pas juste, ajouta-t-il, qu'on lise sans vous un ouvrage que
vous avez vous-mÍme commandť.Ľ Son premier mouvement fut de prendre une
bougie pour ťclairer le lecteur; elle fit ensuite rťflexion qu'il ťtait
plus convenable de s'asseoir, et de faire tous ses efforts pour paraÓtre
attentive ŗ la lecture. Depuis ce jour le crťdit de Mme de Maintenon
alla en augmentant d'une maniŤre si visible, que les deux historiens lui
firent leur cour, autant qu'ils la savaient faire.
ęMon pŤre, dont elle goŻtait la conversation, ťtait beaucoup mieux reÁu
que son ami qu'il menait toujours avec lui. Ils s'entretenaient un jour
avec elle de la poťsie; et Boileau, dťclamant contre le goŻt de la
poťsie burlesque, qui avait rťgnť autrefois, dit dans sa colŤre:
ęHeureusement ce misťrable goŻt est passť, et on ne lit plus Scarron,
mÍme dans les provinces.Ľ Son ami chercha promptement un autre sujet de
conversation, et lui dit, quand il fut seul avec lui: ęPourquoi
parlez-vous devant elle de Scarron? Ignorez-vous l'intťrÍt qu'elle y
prend?--Hťlas! non, reprit-il; mais c'est toujours la premiŤre chose que
j'oublie quand je la vois!Ľ
ęMalgrť la remontrance de son ami, il eut encore la mÍme distraction au
lever du roi. On y parlait de la mort du comťdien Poisson:--ęC'est une
perte, dit le roi, il ťtait bon comťdien...--Oui, reprit Boileau, pour
faire un D. Japhet: il ne brillait que dans ces misťrables piŤces de
Scarron.Ľ Mon pŤre lui fit signe de se taire, et lui dit en particulier:
ęJe ne puis donc paraÓtre avec vous ŗ la cour, si vous Ítes toujours si
imprudent.--J'en suis honteux, lui rťpondit Boileau; mais quel est
l'homme ŗ qui il n'ťchappe une sottise?Ľ
Racine n'avait pas, comme on le voit, la rudesse ťtourdie ou la
franchise dťsintťressťe de Boileau. Il lui fallait la faveur ou la mort.
Une suprÍme occasion de consolider cette faveur et de river sa fortune
dans le coeur mÍme de la nouvelle favorite ne tarda pas ŗ se prťsenter.
Il fait ainsi lui-mÍme, dans un de ses conseils ŗ son fils, l'ťloge de
son aptitude au rŰle de courtisan. On y sent l'homme achevť du monde
plus que le poŽte; il voulait dťgoŻter son fils des vers:
ęNe croyez pas que ce soient mes vers qui m'attirent toutes ces
caresses. Corneille fait des vers cent fois plus beaux que les miens, et
cependant personne ne le regarde. On ne l'aime que dans la bouche de ses
acteurs; au lieu que, sans fatiguer les gens du monde du rťcit de mes
ouvrages, dont je ne leur parle jamais, je me contente de leur tenir des
propos amusants et de les entretenir de choses qui leur plaisent. Mon
talent avec eux n'est pas de leur faire sentir que j'ai de l'esprit,
mais de leur apprendre qu'ils en ont. Ainsi, quand vous voyez M. le Duc
passer souvent des heures entiŤres avec moi, vous seriez ťtonnť, si vous
ťtiez prťsent, de voir que souvent il en sort sans que j'aie dit quatre
paroles: mais peu ŗ peu je le mets en humeur de causer, et il sort de
chez moi encore plus satisfait de lui que de moi.Ľ
Mme de Maintenon avait triomphť de sa rivale; Mme de Montespan ťtait
relťguťe loin de la cour, dans un de ces splendides oublis qui sont le
supplice des favorites-mŤres. La religion avait triomphť avec Mme de
Maintenon. Un mariage secret mit en repos la conscience agitťe du roi.
Ce mariage suffisait ŗ Louis XIV pour calmer ses scrupules, mais il ne
suffisait pas ŗ la pieuse ambition de la nouvelle favorite pour ťlever
son rang au niveau du miracle de ses rÍves; elle aspirait ŗ conquťrir
dans l'esprit de la cour, du clergť, de la noblesse franÁaise, des
titres de considťration et de reconnaissance capables de justifier son
ťlťvation jusqu'au trŰne.
Dans cette vue, elle faisait rťgner par elle l'…glise et l'aristocratie
ŗ Versailles; pour flatter ces deux esprits de corps, elle avait fondť ŗ
Saint-Cyr, dans le voisinage de ce palais, une maison royale d'ťducation
gratuite pour les filles de la haute noblesse militaire et dťshťritťes
de la fortune. Saint-Cyr ťtait un splendide noviciat de futures mŤres de
familles nobles qui devaient perpťtuer, par les exemples et les
enseignements domestiques, le zŤle envers la religion de l'…tat, le
dťvouement au roi, et la reconnaissance envers la nouvelle Esther de ce
nouvel Assuťrus. La cour ťtait ŗ cette ťpoque trŤs-lettrťe; et la
plupart de ces jeunes personnes ťtant destinťes, par leur naissance ou
par leur mariage, ŗ vivre ŗ la cour, les lettres saintes et profanes,
les arts d'agrťment et principalement la dťclamation thť‚trale des plus
beaux vers de la langue, entraient dans ce plan d'ťducation.
Mais il entrait de plus dans les vues personnelles de Mme de Maintenon
d'attacher le roi ŗ cet ťtablissement royal par l'innocent plaisir que
lui procureraient les exercices presque publics de ces jeunes et belles
novices. Louis XIV, sevrť par la piťtť que Mme de Maintenon nourrissait
en lui, des amours et des fÍtes mondaines de sa jeunesse, ťtait
trŤs-susceptible d'ennui, comme les ‚mes vides. Il fallait compenser
pour lui les pompes et les plaisirs de ses belles annťes par les pompes
saintes et par des plaisirs sacrťs qui lui fissent retrouver dans la
religion quelque chose des sensualitťs profanes retranchťes de sa vie.
Mme de Maintenon imagina donc de transporter le thť‚tre ŗ Saint-Cyr, de
faire de ses belles ťlŤves des actrices naÔves de ces reprťsentations
thť‚trales, et d'illustrer ces reprťsentations de Saint-Cyr par la
prťsence de la cour et par le gťnie empruntť aux plus grands poŽtes de
son siŤcle. La reprťsentation d'_Andromaque_ de Racine, donnťe sur le
thť‚tre de Saint-Cyr, ne tarda pas ŗ dťmontrer le contraste f‚cheux et
presque corrupteur entre l'innocence de ces jeunes actrices et les rŰles
d'amour et de passion qui juraient avec leur puretť et avec leur ‚ge. On
y renonÁa par respect pour leur pudeur; mais Mme de Maintenon, qui ne
renonÁait pas ŗ son plan d'amuser le roi, supplia Racine de composer
exprŤs pour Saint-Cyr quelques-uns de ces chefs-d'oeuvre irrťprochables
oý la sťvťritť de son gťnie n'ťclaterait que dans l'expression de
passions pures et de sentiments pieux adaptťs ŗ l'‚ge, au lieu et ŗ la
saintetť de ces jeunes ‚mes.
Il ne fallait rien moins que ce dťsir du roi et de Mme de Maintenon pour
faire rompre au grand poŽte un silence qu'il gardait depuis dix ans par
scrupule de conscience, et pour rallumer en lui cette flamme du gťnie
qui n'ťtait point morte, mais qui dormait sous les cendres de sa
pťnitence. L'occasion ťtait unique, Racine pouvait enfin consacrer ŗ la
religion un talent qu'elle lui avait commandť d'ťtouffer avant l'‚ge,
et sanctifier sa gloire en ne se glorifiant que pour Dieu. Aussi il
n'hťsita pas; son inspiration, si longtemps rťprimťe, lui rťvťla des
chefs-d'oeuvre: tout se rťunissait pour l'ťlever cette fois au-dessus de
lui-mÍme. La nature, qui se rťvoltait souvent en lui contre cette
abstention de la scŤne; son talent, qui avait mŻri et qui ne demandait
qu'ŗ porter des fruits plus consommťs dans la maturitť de ses annťes; la
passion de complaire au roi, qui ťtait sa derniŤre et sa plus grande
faiblesse; le dťsir de mťriter la faveur de Mme de Maintenon, dont il
estimait l'esprit et dont il vťnťrait la piťtť; sa fortune ŗ consolider
ŗ la cour par des triomphes poťtiques qui retentiraient plus loin que
Saint-Cyr; enfin la satisfaction de conscience qu'il ťprouvait ŗ mettre
son gťnie dans sa foi, sa foi dans son gťnie, et ŗ faire son salut pour
le ciel en faisant sa grandeur pour ce monde: tous ces motifs combinťs
tendaient son ‚me jusqu'ŗ l'exaltation et concentraient toutes ses
facultťs dťjŗ si puissantes en un de ces efforts suprÍmes qui produisent
les miracles de la volontť et du gťnie.
Ce furent lŗ les inspirations de Racine; le monde seul ne lui en aurait
pas donnť de pareilles. Aussi ce n'ťtait plus une oeuvre mondaine,
c'ťtait une oeuvre divine qu'il roulait dans sa pensťe.
XV
Il n'hťsita pas davantage sur la source dans laquelle il allait puiser
ses sujets de tragťdie. La religion ŗ illustrer ťtait son but; c'est
dans la religion qu'il devait chercher son texte. Il ferma l'histoire
profane, Sophocle, Euripide, SťnŤque, tout ce monde fabuleux, olympien,
paÔen, dans lequel il avait jusque-lŗ paganisť son gťnie; il ouvrit les
livres sacrťs pleins d'un autre ciel, d'une autre histoire, d'un autre
style; il ne souffla pas, pour les rallumer, sur les charbons ťteints du
trťpied et du lyrisme grecs, mais il prit hardiment les charbons vivants
dans le foyer du tabernacle juif et chrťtien pour en rťchauffer son ‚me;
il s'inspira de ce qu'il croyait et non de ce qu'il imaginait ou de ce
qu'il imitait.
De ce moment il devint un autre homme. Imitateur jusque-lŗ tant qu'il
avait ťtť paÔen, du jour oý il fut biblique et chrťtien, il fut
original. C'est qu'un peuple ne prend jamais son originalitť que dans
sa foi.
L'originalitť littťraire de l'Europe moderne, c'est la Bible et le
christianisme. Le hasard dťcouvrit ce mystŤre ŗ Racine; il avait ťtť
jusque-lŗ Sophocle, Euripide, SťnŤque; mais de ce jour-lŗ il fut Racine.
Ce sont ses imitations qui l'avaient fait homme de style; c'est sa foi
qui le fit homme de gťnie.
Jusqu'ŗ _Esther_ et _Athalie_, nous concevons qu'on accuse ce grand
poŽte de n'avoir ťtť qu'un sublime plagiaire de l'antiquitť; mais aprŤs
_Esther_ et _Athalie_, nous ne concevons pas qu'on lui conteste la
personnalitť poťtique la plus neuve et la plus caractťrisťe: c'est le
christianisme fait poťsie, c'est l'oeil qui voit, c'est le zŤle qui
parle, c'est la foi qui chante, c'est l'ťcho des deux temples qui
rťsonne dans l'‚me du poŽte convaincu, et qui de son ‚me se rťpercute
dans ses vers.
La langue n'est pas moins transformťe que l'idťe; de molle et de
langoureuse qu'elle ťtait dans _Andromaque_, dans _Bajazet_ ou dans
_PhŤdre_, elle devient nerveuse comme le dogme, majestueuse comme la
prophťtie, laconique comme la loi, simple comme l'enfance, tendre comme
la componction, embaumťe comme l'encens des tabernacles; ce ne sont plus
des vers qu'on entend, c'est la musique des anges; ce n'est plus de la
poťsie qu'on respire, c'est de la saintetť.
Voilŗ l'immense originalitť de Racine ŗ dater d'_Esther_ et d'_Athalie_;
le gťnie n'est plus un gťnie, cet art n'est plus un art: c'est une
religion.
XVI
DŤs qu'il eut pris la rťsolution d'obťir au voeu du roi et de Mme de
Maintenon, il s'enferma dans sa retraite, il parcourut la Bible. Elle
est pleine de meurtres et de catastrophes tragiques; mais ces grands
sujets de larmes ou de terreur, tels que _SaŁl_, par exemple, l'Oreste
biblique, ne concordaient pas assez avec la naÔvetť du sexe de ses
actrices: il y avait lŗ des mystŤres de haute politique et des ťclats de
voix tragiques qui ne pouvaient pas avoir pour interprŤtes et pour
organes des jeunes filles de seize ans.
D'ailleurs, il faut l'avouer, et cet aveu n'est pas cette fois ŗ la
gloire du poŽte chrťtien, Racine voulait que son sujet mÍme, tout
biblique qu'il ťtait, fŻt une adulation indirecte, mais comprise, ŗ la
nouvelle favorite et au roi. Cette adulation ŗ Mme de Maintenon, trop
clairement dťsignťe sous la figure et sous le triomphe d'Esther, ťtait
mÍme une offense et une ingratitude envers la favorite rťpudiťe, Mme de
Montespan, l'_altiŤre Vasthi_. Elle avait goŻtť, aimť, protťgť la
fortune du poŽte, il n'ťtait pas beau ŗ lui de cťlťbrer, dans sa chute,
le triomphe de sa rivale.
On voudrait effacer d'une vie si sainte ces impiťtťs du coeur qui
dťgradent l'‚me en relevant le talent. Mais Racine ťtait malheureusement
aussi courtisan qu'il ťtait religieux, et la religion mÍme, intťressťe ŗ
la disgr‚ce de Mme de Montespan, entraÓnait tout dans le parti de Mme de
Maintenon. Racine trouvait donc son excuse dans sa piťtť, excuse sainte,
mais mauvaise excuse, qui lave la foi, mais qui n'innocente pas le
coeur. On rougit de voir la religion et le gťnie oublier ainsi jusqu'ŗ
la pudeur de la reconnaissance, et triompher avec ce qui s'ťlŤve, en
secouant la poussiŤre de leurs souliers sur ce qui tombe. Malheur ŗ
l'historien qui amnistierait de telles faiblesses de caractŤre: le
gťnie ne fait qu'illustrer l'ingratitude, il ne l'absout pas.
XVII
Avant de choisir le sujet d'_Esther_, Racine, qui ťtait restť toujours
plein de dťfťrence pour Boileau, alla le consulter sur son projet de
chercher des tragťdies dans la Bible. Boileau, ŗ qui la moindre
originalitť faisait peur, ne comprenait de route vers la gloire que sur
les traces des poŽtes olympiens. Il dťtourna de toutes ses forces son
ami de cette idťe: l'auteur des Satires n'avait pas assez d'‚me pour
avoir beaucoup de religion.
De la foi des chrťtiens les mystŤres terribles
D'ornements ťgayťs ne sont point susceptibles.
Ces deux mauvais vers de son _Art poťtique_ ťtaient toute sa thťorie;
toute nouveautť semblait sacrilťge ŗ cet esprit timide et ťtroit qui
n'avait foi que dans la routine.
L'inspiration souveraine de Racine n'en fut point ťbranlťe. Il sortit de
la chambre de Boileau pour ťcrire le plan et les scŤnes d'_Esther_.
L'esprit de la Bible avait soufflť sur lui comme il soufflait sur les
prophŤtes. Le plan d'_Esther_ fut conÁu en quelques nuits. Ce n'ťtait
point, ŗ proprement parler, une tragťdie, c'ťtait une idylle hťroÔque
sur le modŤle du _Pastor Fido_ de _Guarini_ ou de l'_Aminta du Tasse_.
Ce genre de composition avait ťtť inventť par les poŽtes italiens du
seiziŤme siŤcle et importť en France par les Mťdicis. Ce genre tenait le
milieu entre l'ťglogue et le drame, il participait ťgalement de
Thťocrite et d'Euripide, des ťglogues de Virgile et des scŤnes de
Sophocle: seulement ici c'ťtait non-seulement une idylle hťroÔque, mais
une idylle sainte. Racine, sans y penser, avait inventť un genre. Ce
genre ťtait admirablement appropriť ŗ la scŤne moitiť royale, moitiť
monastique, sur laquelle _Esther_ ťtait destinťe ŗ Ítre reprťsentťe, et
aux jeunes actrices qui devaient la reprťsenter devant le moderne
Assuťrus.
XVIII
Racine toutefois, avant de se lancer ŗ plein gťnie dans son oeuvre,
voulut s'assurer que cette oeuvre serait suivant la pensťe et suivant le
coeur de Mme de Maintenon. Il ťtait bien sŻr d'avance qu'elle serait
suivant l'ambition toute royale de cette favorite, car la favorite ne
pouvait manquer de se reconnaÓtre, comme le public la reconnaÓtrait,
dans le personnage d'Esther. Les traits cruels qui tomberaient sur sa
rivale, Mme de Montespan, sous le nom de Vasthi, ne pouvaient que
rťjouir secrŤtement sa jalousie de faveur: c'est ici la l‚che
complaisance du poŽte: il convertissait, dans le sanctuaire mÍme,
l'encens qu'il faisait respirer ŗ l'une en poison pour l'autre; il
employait l'esprit saint du poŽte ŗ flatter la haine d'une femme.
Mais l'intťrÍt de la religion ťtait tellement confondu dans sa pensťe
avec l'intťrÍt de Mme de Maintenon et avec sa propre gloire, qu'il ťtait
servile, adulateur et ingrat en conscience, et que son caractŤre ťtait
corrompu par son zŤle pour le trŰne et pour la foi. Terrible leÁon pour
les hommes qui consultent, dans leurs actes, leur esprit de parti, au
lieu de consulter l'infaillibilitť de leur propre coeur.
XIX
ęRacine, dit Mme de Caylus, une des jeunes actrices de Saint-Cyr qui
joua le rŰle d'Esther, Racine ne fut pas longtemps sans apporter ŗ Mme
de Maintenon, non-seulement le plan de sa piŤce (car il avait accoutumť
de les faire en prose, scŤne pour scŤne, avant que d'en faire les vers),
il porta le premier acte tout fait. Mme de Maintenon en fut charmťe, et
sa modestie ne put l'empÍcher de trouver dans le caractŤre d'Esther, et
dans quelques circonstances de ce sujet, des choses flatteuses pour
elle. La Vasthi avait ses applications, Aman des traits de ressemblance;
et, indťpendamment de ces idťes, l'histoire d'Esther convenait
parfaitement ŗ Saint-Cyr. Les choeurs, que Racine, ŗ l'imitation des
Grecs, avait toujours en vue de remettre sur la scŤne, se trouvaient
placťs naturellement dans _Esther_; et il ťtait ravi d'avoir eu cette
occasion de les faire connaÓtre et d'en donner le goŻt. Enfin, je crois
que, si l'on fait attention au lieu, au temps et aux circonstances, on
trouvera que Racine n'a pas moins marquť d'esprit en cette occasion que
dans d'autres ouvrages plus beaux en eux-mÍmes.
ę_Esther_ fut reprťsentťe un an aprŤs la rťsolution que Mme de Maintenon
avait prise de ne plus laisser jouer de piŤces profanes ŗ Saint-Cyr.
Elle eut un si grand succŤs, que le souvenir n'en est pas encore
effacť.
ęJusque-lŗ il n'avait point ťtť question de moi, et on n'imaginait pas
que je dusse y reprťsenter un rŰle; mais me trouvant prťsente aux rťcits
que M. Racine venait faire ŗ Mme de Maintenon de chaque scŤne ŗ mesure
qu'il les composait, j'en retenais des vers; et comme j'en rťcitai un
jour ŗ M. Racine, il en fut si content qu'il demanda en gr‚ce ŗ Mme de
Maintenon de m'ordonner de faire un personnage, ce qu'elle fit. Mais je
ne voulus point de ceux qu'on avait dťjŗ destinťs, ce qui l'obligea de
faire, pour moi, le prologue de sa piŤce. Cependant, ayant appris, ŗ
force de les entendre, tous les autres rŰles, je les jouai
successivement, ŗ mesure qu'une actrice se trouvait incommodťe: car on
reprťsenta _Esther_ tout l'hiver; et cette piŤce qui devait Ítre
renfermťe dans Saint-Cyr, fut vue plusieurs fois du roi et de toute la
cour, toujours avec le mÍme applaudissement.
ęDes applications particuliŤres, ajoute-t-on, contribuŤrent encore au
succŤs de la tragťdie d'_Esther_: _ces jeunes et tendres fleurs
transplantťes_ ťtaient reprťsentťes par les demoiselles de Saint-Cyr.Ľ
La Vasthi, comme dit Mme de Caylus, avait quelque ressemblance avec Mme
de Montespan. Cette Esther, qui a _puisť ses jours_ dans la race
proscrite par Aman, avait aussi sa ressemblance avec Mme de Maintenon
nťe protestante.
XX
Le succŤs fut immense; on peut le mesurer aujourd'hui aux exclamations
de Mme de Sťvignť, qui jusque-lŗ, n'avait pas ťtť favorable ŗ Racine:
ęToutes les personnes de la cour, ťcrit-elle ŗ sa fille, sont charmťes
d'_Esther_. M. le prince de Condť a pleurť. Mme de Maintenon et huit
jťsuites, dont ťtait le pŤre Gaillard, ont honorť de leur personne la
derniŤre reprťsentation. Enfin c'est le chef-d'oeuvre de Racine. Il
s'est surpassť: il aime Dieu comme il aimait ses maÓtresses; il est pour
les choses saintes comme il ťtait pour les profanes. L'…criture sainte
est suivie exactement, tout est beau, tout est grand, tout est ťcrit
avec sublimitť!Ľ
Mme de la Fayette, femme d'un goŻt sŻr, parle avec le mÍme sentiment,
mais avec plus de sang-froid, de l'effet d'_Esther_ sur la cour et sur
le public; mais on voit qu'elle en attribue le succŤs ŗ la passion des
applications religieuses et politiques qui en ťtaient faites ouvertement
ŗ la cour:
ęCe succŤs ne se comprend pas, car il n'y eut ni petit ni grand qui n'y
voulŻt aller; et ce qui devait Ítre regardť comme une comťdie de
couvent, devint l'affaire la plus sťrieuse de la cour. Les ministres,
pour faire leur cour en allant ŗ cette comťdie, quittaient leurs
affaires les plus pressťes. ņ la premiŤre reprťsentation oý fut le roi,
il n'y mena que les principaux officiers qui le suivent ŗ la chasse. La
seconde fut consacrťe aux personnes pieuses, telles que le pŤre
Lachaise, et douze ou quinze jťsuites auxquels se joignit Mme de
Miramion, et beaucoup d'autres dťvots et dťvotes; ensuite elle se
rťpandit aux courtisans. Le roi crut que ce divertissement serait du
goŻt du roi d'Angleterre; il l'y mena et la reine aussi. Il est
impossible de ne point donner de louanges ŗ la maison de Saint-Cyr et ŗ
l'ťtablissement; aussi ils ne s'y ťpargnŤrent pas, et y mÍlŤrent celles
de la comťdie.Ľ La marťchale d'Estrťes, qui n'avait pas louť _Esther_,
fut obligťe de se justifier de son silence comme d'un crime. Le carÍme
de 1689 interrompit les reprťsentations d'_Esther_; elles furent
reprises le 5 janvier de l'annťe suivante; et dans le cours de ce mois
il y en eut cinq qui furent aussi brillantes que les premiŤres.
Nous ne jetterons qu'un coup d'oeil rapide sur cette idylle hťroÔque et
sacrťe d'_Esther_, qui n'est remarquable que parce qu'elle est la
premiŤre inspiration originale et biblique de Racine, et le premier
prťlude ŗ son style sacrť.
Le prologue, rťcitť devant le roi et sa cour par une des jeunes ťlŤves
de Saint-Cyr, respire tout entier la religieuse nouveautť de ce style.
C'est la piťtť qui parle par la bouche de Mme de Caylus.
LA PI…T….
Du sťjour bienheureux de la Divinitť
Je descends dans ce lieu par la Gr‚ce habitť;
L'Innocence s'y plaÓt, ma compagne ťternelle,
Et n'a point sous les cieux d'asile plus fidŤle.
Ici, loin du tumulte, aux devoirs les plus saints
Tout un peuple naissant est formť par mes mains:
Je nourris dans son coeur la semence fťconde
Des vertus dont il doit sanctifier le monde.
Un roi qui me protťge, un roi victorieux,
A commis ŗ mes soins ce dťpŰt prťcieux.
C'est lui qui rassembla ces colombes timides,
…parses en cent lieux, sans secours et sans guides.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Tu le vois tous les jours, devant toi prosternť,
Humilier ce front de splendeur couronnť.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Grand Dieu! juge ta cause, et dťploie aujourd'hui
Ce bras, ce mÍme bras qui combattait pour lui,
Lorsque des nations ŗ sa perte animťes
Le Rhin vit tant de fois disperser les armťes.
Des mÍmes ennemis je reconnais l'orgueil;
Ils viennent se briser contre le mÍme ťcueil.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Mais, tandis qu'un grand roi venge ainsi mes injures,
Vous qui goŻtez ici des dťlices si pures,
S'il permet ŗ son coeur un moment de repos,
ņ vos jeux innocents appelez ce hťros;
Retracez-lui d'Esther l'histoire glorieuse,
Et sur l'impiťtť la foi victorieuse.
Et vous, qui vous plaisez aux folles passions
Qu'allument dans vos coeurs les vaines fictions,
Profanes amateurs de spectacles frivoles,
Dont l'oreille s'ennuie au son de mes paroles,
Fuyez de mes plaisirs la sainte austťritť:
Tout respire ici Dieu, la paix, la vťritť.
XXI
Ce drame n'a que trois actes; le premier acte n'a que deux grandes
scŤnes et deux choeurs de gťmissements lyriques chantťs par les jeunes
juives compagnes d'Esther. Dans la premiŤre scŤne Esther raconte ŗ sa
confidente …lise comment Assuťrus l'a choisie pour ťpouse, sans
connaÓtre sa race, ŗ la place d'une premiŤre ťpouse ennemie des Juifs et
disgraciťe pour son orgueil. Ici Racine a faussť l'histoire par esprit
d'adulation ŗ Mme de Maintenon: car Vasthi, cette premiŤre ťpouse, n'a
point ťtť rťpudiťe par Assuťrus pour son orgueil, mais pour sa vertu.
Elle a refusť d'obťir ŗ un inf‚me caprice du roi ivre, qui, ŗ la suite
d'une orgie, lui avait ordonnť de paraÓtre nue aux yeux de ses
compagnons de dťbauche. Mais pour que Mme de Maintenon, sous le nom
d'Esther, fŻt justifiťe, il fallait que sa rivale fŻt coupable. Racine
sacrifie sans hťsiter l'histoire et l'innocence ŗ la flatterie.
…coutons Esther racontant son triomphe et se prťsageant ŗ elle-mÍme de
hautes destinťes devant sa confidente. Qui peut douter que ces beaux
vers ne fussent un encouragement ŗ Mme de Maintenon d'aspirer au trŰne,
et une insinuation au roi d'oser l'y faire asseoir. Jamais la politique
ne s'insinua au coeur des rois dans un si divin langage.
ESTHER ņ …LISE.
Peut-Ítre on t'a contť la fameuse disgr‚ce
De l'altiŤre Vasthi dont j'occupe la place,
Lorsque le roi, contre elle enflammť de dťpit,
La chassa de son trŰne ainsi que de son lit.
Mais il ne put si tŰt en bannir la pensťe:
Vasthi rťgna longtemps dans son ‚me offensťe.
Dans ses vastes …tats il fallut donc chercher
Quelque nouvel objet qui pŻt l'en dťtacher.
On m'ťlevait alors, solitaire et cachťe,
Sous les yeux vigilants du sage Mardochťe.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Du triste ťtat des Juifs nuit et jour agite,
Il me tira du sein de mon obscuritť,
Et, sur mes faibles mains fondant leur dťlivrance,
_Il me fit d'un empire accepter l'espťrance_.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Le fier Assuťrus couronna sa captive,
Et le Persan superbe est aux pieds de la juive.
Par quels secrets ressorts, par quel enchaÓnement
Le ciel a-t-il conduit ce grand ťvťnement?
La captivitť de son peuple cependant trouble sa joie pendant son
triomphe:
Esther, disais-je, Esther dans la pourpre est assise;
La moitiť de la terre ŗ son sceptre est soumise,
Et de Jťrusalem l'herbe cache les murs!
Sion, repaire affreux de reptiles impurs,
Voit de son temple saint les pierres dispersťes,
Et du Dieu d'IsraŽl les fÍtes sont cessťes.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Cependant, mon amour pour notre nation
A rempli ce palais de filles de Sion,
Jeunes et tendres fleurs par le sort agitťes,
Sous un ciel ťtranger comme moi transplantťes.
Dans un lieu sťparť de profanes tťmoins
Je mets ŗ les former mon ťtude et mes soins;
Et c'est lŗ que, fuyant l'orgueil du diadŤme,
Lasse de vains honneurs et me cherchant moi-mÍme,
Aux pieds de l'…ternel je viens m'humilier,
Et goŻter le plaisir de me faire oublier.
Mme de Maintenon, sa haute fortune, sa modestie apparente, ses soins
pour les jeunes filles de Saint-Cyr transpercent presque sans voile sous
ces allusions.
Esther appelle ces filles de Sion ses compagnes. Elles chantent devant
elle, en strophes mťlodieuses et mťlancoliques comme les gťmissements
des harpes juives suspendues aux saules de l'Euphrate, les cantiques de
la captivitť.
Mardochťe paraÓt ŗ leur voix, les chants cessent. Il raconte ŗ Esther le
plan du massacre des Juifs conÁu par le ministre Aman. Il encourage
Esther ŗ tout oser pour renverser ce ministre et sauver le sang de son
peuple. L'idylle ici s'ťlŤve au ton de la tragťdie.
MARDOCH…E.
Quoi! lorsque vous voyez pťrir votre patrie,
Pour quelque chose, Esther, vous comptez votre vie!
Dieu parle, et d'un mortel vous craignez le courroux!
Que dis-je? votre vie, Esther, est-elle ŗ vous?
N'est-elle pas au sang dont vous Ítes issue?
N'est-elle pas ŗ Dieu dont vous l'avez reÁue?
Et qui sait, lorsqu'au trŰne il conduisit vos pas,
Si pour sauver son peuple il ne vous gardait pas?
Songez-y bien: ce Dieu ne vous a pas choisie
Pour Ítre un vain spectacle aux peuples de l'Asie,
Ni pour charmer les yeux des profanes humains:
Pour un plus noble usage il rťserve ses saints.
S'immoler pour son nom et pour son hťritage,
D'un enfant d'IsraŽl voilŗ le vrai partage:
Trop heureuse pour lui de hasarder vos jours!
Et quel besoin son bras a-t-il de nos secours?
Que peuvent contre lui tous les rois de la terre?
En vain ils s'uniraient pour lui faire la guerre:
Pour dissiper leur ligue il n'a qu'ŗ se montrer;
Il parle, et dans la poudre il les fait tous rentrer.
Au seul son de sa voix la mer fuit, le ciel tremble;
Il voit comme un nťant tout l'univers ensemble;
Et les faibles mortels, vains jouets du trťpas,
Sont tous devant ses yeux comme s'ils n'ťtaient pas.
Esther n'hťsite plus. Mardochťe s'ťloigne. Le choeur des jeunes filles
reprend sur un mode plus grave et finit par une invocation au Dieu des
combats.
TOUT LE CHOEUR.
Tu vois nos pressants dangers:
Donne ŗ ton nom la victoire;
Ne souffre point que ta gloire
Passe ŗ des dieux ťtrangers.
UNE ISRA…LITE, _seule_.
Arme-toi, viens nous dťfendre:
Descends, tel qu'autrefois la mer te vit descendre!
Que les mťchants apprennent aujourd'hui
ņ craindre ta colŤre:
Qu'ils soient comme la poudre et la paille lťgŤre
Que le vent chasse devant lui.
XXII
Le second acte, trŤs-faible d'intťrÍt tragique, n'est rempli que par des
conversations entre Assuťrus, son confident Hydaspe et son ministre
Aman, conversations dans lesquelles Assuťrus apprend que le Juif
Mardochťe lui a sauvť la vie en lui rťvťlant une conjuration de ses
sujets contre sa personne. Esther, suivie de ses compagnes, paraÓt ŗ la
derniŤre scŤne de cet acte devant le roi. Le seul motif poťtique de
cette visite paraÓt Ítre de faire manifester par le roi, ŗ sa favorite,
des adorations et des ťloges qui retombent directement sur Mme de
Maintenon:
Croyez-moi, chŤre Esther, ce sceptre, cet empire,
Et ces profonds respects que la terreur inspire
ņ leur pompeux ťclat mÍlent peu de douceur,
Et fatiguent souvent leur triste possesseur.
Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle gr‚ce
Qui me charme toujours et jamais ne me lasse.
De l'aimable vertu doux et puissants attraits!
Tout respire en Esther l'innocence et la paix.
Du chagrin le plus noir elle ťcarte les ombres,
Et fait des jours sereins de mes jours les plus sombres;
Que dis-je? sur ce trŰne assis auprŤs de vous,
Des astres ennemis j'en crains moins le courroux.
Esther a obtenu de ce roi passionnť pour elle les plus grands honneurs
pour Mardochťe.
Le troisiŤme acte s'ouvre par une scŤne dans laquelle le ministre Aman,
sous le nom de qui tout le monde lisait Louvois, dťjŗ disgraciť dans le
coeur de Louis XIV, gťmit et s'indigne d'Ítre obligť d'accompagner le
triomphe d'un vil Hťbreu. La seconde scŤne entre Assuťrus amoureux et
Esther enhardie par tant d'amour rťvŤle ŗ ce roi la naissance juive de
sa favorite. Elle plaide en vers admirables la gr‚ce de sa race. Elle
accuse Aman, elle exalte Mardochťe, elle l'avoue pour son oncle; le roi
s'ťloigne irritť contre son ministre Aman. Celui-ci accourt implorer la
misťricordieuse intervention d'Esther; elle est inflexible. Aman tombe ŗ
ses pieds et porte sur elle ses mains suppliantes.
Assuťrus rentre, et, voyant Aman porter ses mains sur son ťpouse, croit
ou affecte de croire ŗ un outrage. Sans l'entendre, il l'envoie ŗ la
mort. Il ťlŤve Mardochťe ŗ sa place, il rťvoque l'ordre d'immoler la
nation juive. Le choeur ťclate en strophes d'admiration pour Esther et
en reconnaissance au Dieu des Juifs.
Relevez, relevez les superbes portiques
Du temple oý notre Dieu se plaÓt d'Ítre adorť;
Que de l'or le plus pur son autel soit parť,
Et que du sein des monts le marbre soit tirť.
Liban, dťpouille-toi de tes cŤdres antiques!
PrÍtres, prťparez vos cantiques!
Que son nom soit bťni, que son nom soit chantť;
Que l'on cťlŤbre ses ouvrages
Au delŗ du temps et des ‚ges,
Au delŗ de l'ťternitť!...
XXIII
Voilŗ _Esther_, ce prťlude d'_Athalie_. Comme adulation, c'est un
chef-d'oeuvre; comme drame, rien de plus faiblement conÁu, de plus
misťrablement nouť et de plus ridiculement dťnouť! Mais ce n'ťtait pas,
dans l'esprit de Racine, une tragťdie: c'ťtait une idylle simple ŗ la
portťe des jeunes filles et des enfants qui devaient en Ítre les
acteurs; comme poťsie de style, images, langue, sonoritť, douceur et
majestť, c'est la Bible elle-mÍme non traduite, mais transvasťe comme un
rayon de miel d'Oreb sur la langue des femmes et des enfants d'une autre
Sion! Racine se transfigure complŤtement en David franÁais. Il dťpouille
le vieil homme. Ce n'est plus le poŽte de l'ťcole classique: c'est le
poŽte de la foi; ce n'est plus le poŽte du roi: c'est le prophŤte de
Dieu. Son gťnie, transformť par sa piťtť, ne sort plus de son
imagination, mais de son ‚me. Donnez-lui maintenant un sujet, et il va
devenir l'Euripide et le Sophocle chrťtien.
Ce sujet, il le couvait dťjŗ dans _Athalie_.
Nous allons vous faire assister ŗ ce chef-d'oeuvre comme on doit
assister ŗ un tel drame, non pas dans une froide lecture, mais dans une
sublime et unique reprťsentation sur la premiŤre scŤne du monde, ŗ
Paris, et par la voix du premier des tragťdiens modernes, Talma!
Le hasard nous fit assister, dans notre jeunesse, ŗ cette scŤne, et la
mťmoire nous la reproduit comme si les pompes de cette fÍte d'esprit
ťblouissaient encore nos yeux, comme si l'accent du sublime acteur
vibrait encore dans nos oreilles.
Regardez et ťcoutez!
LAMARTINE.
(_La suite au numťro du mois prochain._)
XIVe ENTRETIEN.
2e de la deuxiŤme Annťe.
RACINE.--ATHALIE.
(SUITE.)
I
Nous disions, ŗ la fin du dernier de ces Entretiens, que, pour bien
juger d'une oeuvre dramatique, il ne suffisait pas de la lire (chose en
gťnťral ingrate, souvent fastidieuse, toujours incomplŤte), mais qu'il
fallait assister, en corps et en ‚me, ŗ sa reprťsentation. OEuvre d'art
faite pour la scŤne et pour la dťclamation, c'est du point de vue de la
scŤne et de la dťclamation qu'il convient d'en jouir.
Nous voulons donc, autant qu'il est en nous, vous faire assister ŗ la
plus solennelle reprťsentation d'_Athalie_ qui ait jamais ťtť donnťe ŗ
l'Europe, sans en excepter mÍme la premiŤre de ces reprťsentations ŗ
Versailles, ŗ laquelle assistaient Racine et Louis XIV.
Mais permettez-moi d'abord, pour bien vous faire comprendre dans quel
esprit la France monarchique, religieuse et littťraire de 1819, assista
ŗ cette reprťsentation unique, dont Talma ťtait le grand intťrÍt aprŤs
Racine, permettez-moi de vous raconter comment, et par quelles
circonstances, et dans quelles dispositions poťtiques il me fut donnť ŗ
moi-mÍme d'y assister; et permettez-moi enfin de vous dire comment je
garde, de cette reprťsentation, une si longue et si vive mťmoire. Je me
souviens aussi du jour et de l'heure oý je vis, pour la premiŤre fois,
au soleil levant d'AthŤnes, les bas-reliefs de Phidias resplendir et se
mouvoir, pour ainsi dire, sous les rayons ambiants de la lumiŤre dorťe
sur le fronton du Parthťnon! Il y a des beautťs de la nature et de
l'art qui s'incorporent tellement en nous par la force de l'impression
reÁue qu'elles pťtrifient en quelque sorte notre esprit d'admiration, et
que nous les portons ŗ jamais en nous comme la pierre taillťe porte son
empreinte. Le jour de cette reprťsentation royale d'_Athalie_ fut pour
moi une de ces commotions de l'‚me qui se rťpercutent sur toute une vie.
II
De 1815 ŗ 1818, dans la mansarde solitaire de la maison paternelle, ŗ la
campagne et dans les langueurs d'une premiŤre jeunesse inoccupťe,
j'avais ťcrit plusieurs tragťdies sur le mode banal et classique de la
scŤne franÁaise. La premiŤre ťtait une tragťdie de _Mťdťe_, dans le
genre de celle qui vient de donner rťcemment une triple gloire ŗ M.
Legouvť, ŗ M. Montanelli, son poťtique traducteur, et ŗ madame Ristori,
leur pathťtique interprŤte. La seconde ťtait une tragťdie d'imagination
imitťe de _ZaÔre_, et dont le sujet ťtait pris dans les croisades. La
troisiŤme ťtait une tragťdie biblique, intitulťe _SaŁl_, pastiche,
assez bien versifiť, de Racine et d'Alfieri. Je les ai encore; elles
restent livrťes justement aux intempťries de l'air et aux insectes, qui
font justice du papier noirci par une main novice, dans un coffre de mon
grenier de Milly.
Je n'ťtais ťvidemment pas nť pour cette poťsie ŗ personnages et ŗ
combinaisons savantes qu'on appelle le drame. L'art, et le mťcanisme, et
le coup de thť‚tre, et la briŤvetť laconique qui concentre une situation
dans un mot, me manquaient. Le thť‚tre parle et ne chante pas assez pour
moi. J'aurais peut-Ítre chantť un poŽme ťpique si c'eŻt ťtť le siŤcle de
l'ťpopťe; mais qui est-ce qui fait ce qu'il aurait pu faire dans ce
monde oý tout est construit contre nature? Ce n'est pas moi. Nous rÍvons
des pyramides, et nous ťbauchons quelques taupiniŤres.
Rien n'est que fragments dans notre destinťe, et nous ne sommes
nous-mÍme qu'une rognure de ces fragments: tout homme, quelque bien douť
qu'il paraisse Ítre, n'est qu'une statue tronquťe.
III
Mais je me flattais secrŤtement alors, au bruit des brises d'hiver dans
le toit de ma mansarde et au pťtillement du sarment de vigne dans
l'‚tre, que quelqu'une de ces tragťdies, amusement de mes ennuis de
jeunesse, aurait le bonheur de parvenir jusque sur la scŤne par la
protection de quelque acteur de gťnie ou de quelque actrice en faveur.
J'entrevoyais dans ce succŤs, non-seulement une prťcoce cťlťbritť pour
mon nom inconnu du monde, mais un peu de fortune ŗ ajouter pour mon
pŤre, ma mŤre et mes soeurs, ŗ la mťdiocritť de notre vie des champs.
Que de beaux rÍves ne faisais-je pas, la nuit, sur mon oreiller, quand
j'avais dťposť la plume aprŤs une scŤne dont les vers sonores
retentissaient aprŤs coup dans ma mťmoire! Quelles scŤnes illuminťes
m'apparaissaient toutes pleines des personnages crťťs par mon
imagination! Quelles masses de spectateurs ondoyants au parterre sous le
vent de mes inspirations! Quelles femmes en larmes, penchťes sur les
galeries et sur les bords des loges! Quels applaudissements au milieu
desquels Talma s'avanÁait et proclamait mon nom! Je m'endormais au bruit
de ces ovations dans mon oreille; je les retrouvais le matin ŗ mon
rťveil. Elles m'excitaient ŗ reprendre patiemment au lever du jour le
travail commencť.
Je ne me doutais guŤre alors que, ces applaudissements passionnťs que je
rÍvais dans une salle, je les entendrais dans tout un peuple, et qu'au
lieu de faire jouer un rŰle ŗ des acteurs dans mes tragťdies idťales,
j'en jouerais un moi-mÍme dans la tragťdie civile des ťvťnements de mon
temps.
IV
Un beau jour de 1818, au printemps, mes tragťdies terminťes et
soigneusement recopiťes par moi sur du papier ŗ tranches dorťes,
l'impatience de la cťlťbritť et de la fortune me saisit comme une fiŤvre
de vťgťtation saisit la nature en ce temps-lŗ. Je ne dis ni ŗ mon pŤre
ni ŗ ma mŤre pourquoi je quittais la chambre et la douce table de
famille, et je partis pour Paris par les carrioles du Bourbonnais,
appelťes _pataches_, en compagnie des marchands de vin du vignoble et
des marchands de boeufs des herbages de mon pays, qui causaient de leur
commerce aux cahots inharmonieux de ces voitures. Je n'emportais que mon
_SaŁl_, ma meilleure espťrance, dans ma valise de cuir.
Je logeais, comme ŗ l'ordinaire, dans une chambre ťtroite et haute du
cinquiŤme ťtage du grand hŰtel du _Marťchal de Richelieu_, rue
Neuve-Saint-Augustin, sur un vaste jardin qui confinait avec le
boulevard.
Le lendemain de mon arrivťe ŗ Paris, je pris hťroÔquement, et sans me
donner le temps de la rťflexion et du repentir, la rťsolution d'aborder
d'assaut le Thť‚tre-FranÁais. Je me levai; j'ťcrivis ŗ Talma, sur du
joli papier vťlin, un billet dont j'ai conservť encore l'ťbauche raturťe
et que voici:
ęMonsieur et illustre Acteur,
ęJe suis un jeune homme inconnu, sans protection, et mÍme sans
relations ŗ Paris. J'ai ťcrit une tragťdie intitulťe _SaŁl_.
J'en ai pris le sujet dans la Bible. J'ai tentť d'en dťrober
quelquefois, et autant qu'il convient ŗ ma faiblesse, le style ŗ
Racine. Je dťsire ardemment la soumettre ŗ votre jugement. Ma
fortune et peut-Ítre mon talent dťpendent d'un moment d'attention
que vous accorderez ou que vous refuserez ŗ mon oeuvre. Je n'ai
pour me recommander ŗ vous que ma jeunesse, mon isolement, et ma
confiance dans votre bontť, ťgale ŗ mon admiration pour votre
gťnie. Votre rťponse ou votre silence dťcidera de mon sort.
ęRecevez, Monsieur et illustre Acteur, l'expression de mon
respect,
ęAlphonse de LAMARTINE.Ľ
Grand hŰtel de Richelieu, rue Neuve-Saint-Augustin, 15, ŗ Paris.
V
Ce billet ťcrit, recopiť de ma plus ťlťgante ťcriture et cachetť, je le
portai moi-mÍme ŗ l'adresse de Talma. Le concierge du Thť‚tre-FranÁais
me l'avait donnťe; c'ťtait rue de Rivoli, 16 ou 26. Je remis ma lettre
d'une main toute tremblante dans la loge du portier de Talma, et je
rentrai dans mon hŰtel pour y attendre ou le silence de mort, ou la
rťponse de vie du grand tragťdien.
Je n'attendis pas longtemps. Au moment oý j'allais sortir de ma chambre
pour aller dÓner chez le restaurateur Doyen, oý je prenais mes repas,
dans la mÍme rue, prŤs de la rue de la Paix, un domestique en riche
livrťe de fantaisie frappa ŗ ma porte et me remit un billet de Talma. Il
me rťpondait de sa main, avec une bontť aussi parfaite qu'elle ťtait
prompte: ęQu'il jouait ce soir-lŗ dans _Britannicus_, qu'il partait le
lendemain, ŗ midi, pour sa campagne de Brunoy; mais que, si je n'ťtais
pas effrayť de l'heure matinale, il me recevrait ŗ huit heures du matin
le lendemain, et qu'il entendrait avec intťrÍt la lecture de mon
ouvrage.Ľ
La cordialitť et la promptitude d'une rťponse si gracieuse, faite de la
main du grand homme de la scŤne ŗ un jeune homme inconnu, m'attachŤrent
instantanťment et pour jamais ŗ Talma. Soit que le style ferme et
modeste de mon billet l'eŻt prťvenu machinalement en ma faveur, soit
que mes caractŤres ťlťgants et mon nom semi-aristocratique eussent eu un
attrait non raisonnť pour ses yeux, il ne m'avait pas fait faire
antichambre une heure aux portes de sa gloire. Sa rťponse respirait
d'avance son accueil. On peut penser que je dormis peu cette nuit-lŗ. Le
lendemain je croyais livrer la bataille de ma vie.
VI
Avant huit heures j'ťtais ŗ la porte de Talma. Je montrai mon billet
d'introduction au concierge; je montai, le coeur palpitant, les cinq
ťtages d'escaliers de bois cirť et luisant qui conduisaient au seuil du
grand homme. Je sonnai doucement, comme un visiteur qui tremble d'Ítre
importun et qui ne veut pas donner un sursaut pťnible ŗ l'oreille du
maÓtre de la maison.
Une trŤs-belle femme, en peignoir d'indienne ŗ fleurs bleues, les
cheveux ťpars sur un cou de Clytemnestre et la ceinture dťnouťe laissant
entrevoir des ťpaules et un sein de statue antique, m'ouvrit la porte.
Ses traits ťtaient imposants de forme, mais bons d'expression; ses
regards rťpandaient comme des ombres de velours noir sur ses joues. Elle
souriait ŗ demi, mais sans malice, en me regardant: on voyait qu'elle
ťtait habituťe ŗ introduire bien des rÍves et ŗ ťconduire bien des
illusions.
ęVous voulez voir Talma?Ľ me dit-elle; ęvous Ítes sans doute le jeune
homme qu'il attend? Voulez-vous bien me dire votre nom?Ľ ajouta-t-elle
en tenant toujours sa belle et large main sur la serrure. Je lui dis mon
nom. ęEntrez, Monsieur,Ľ me dit-elle. Puis, ouvrant une autre porte qui
donnait sur le cabinet de Talma: ęMon ami,Ľ lui dit-elle d'une voix de
caresse et de familiaritť, ęc'est ce jeune homme que tu as commandť de
laisser entrer.Ľ Elle disparut aprŤs ces mots, en retirant les plis de
son peignoir sur ses pantoufles traÓnantes, et je restai seul en
prťsence de Talma.
VII
Talma ťtait alors un homme assez massif, mais trŤs-noble dans sa force,
de cinquante ŗ soixante ans. Une robe de chambre de bazin blanc, nouťe
par un foulard l‚che, lui servait de ceinture. Son cou ťtait nu et
laissait se gonfler librement ŗ l'oeil ses muscles saillants et ses
fortes veines, signes d'une charpente solide et d'une m‚le ťnergie de
structure. Sa physionomie, qui est connue de tout le monde, ťtait dťjŗ
mťdaille; elle rappelait par la forme et par la teinte les bronzes
impťriaux des empereurs du Bas-Empire. Mais ce masque romain, qui
semblait moulť sur ses traits quand il ťtait sur la scŤne, tombait de
lui-mÍme quand il ťtait en robe de chambre, et ne laissait voir qu'un
front large, des yeux grands et doux, une bouche mťlancolique et fine,
des joues un peu pendantes et un peu flasques, d'une blancheur mate, des
muscles au repos comme les ressorts d'un instrument dťtendus.
L'ensemble de cette physionomie ťtait imposant, l'expression simple et
attirante. On sentait l'excellent coeur sous le merveilleux gťnie. Il
ne cherchait ŗ produire aucun effet: il ťtait las d'en produire sur la
scŤne; il se reposait et il reposait les yeux dans sa maison. Je me
sentis ŗ l'instant rassurť et pris au coeur par la bonhomie sincŤre et
grandiose ŗ la fois de cette figure.
Talma habitait alors un petit appartement au cinquiŤme ťtage des faÁades
de la rue de Rivoli, en face du jardin des Tuileries et trŤs-prŤs du
palais. Une belle lumiŤre du matin, un peu verdie par le reflet des
marronniers en fleurs, se jouait sur les rideaux, sur les glaces et sur
les reliures rouges des livres de son cabinet. Il me fit asseoir entre
la cheminťe et la fenÍtre, et il s'assit en face de moi dans un fauteuil
de forme grecque. Une petite table ŗ guťridon nous sťparait. Je tirai du
pan boutonnť de mon habit mon manuscrit reliť en album et je le posai
timidement sur la table. Il l'ouvrit, le parcourut rapidement du doigt,
et me fit compliment sur la nettetť et sur l'ťlťgance de mon ťcriture.
ęLisez,Ľ me dit-il en me le rendant, ęet, pour ťpargner votre fatigue et
notre temps, lisez seulement les scŤnes qui sont de nature ŗ me donner
une idťe nette du style et de l'ouvrage.Ľ J'ouvris le manuscrit et je
lus.
VIII
DŤs la premiŤre scŤne il parut frappť, malgrť le tremblement de ma voix,
de l'harmonie et de la puretť des vers. ęOn voit que vous avez beaucoup
lu Racine, peut-Ítre trop,Ľ me dit-il ŗ la fin de la scŤne. ęContinuez.Ľ
Je lus pendant environ trois quarts d'heure, sans que sa vaste tÍte,
appuyťe sur sa main, donn‚t aucun signe ni de lassitude ni
d'approbation. Cette immobilitť et ce silence me glaÁaient un peu. Aux
derniŤres scŤnes, ma voix flťchissante et entrecoupťe trahissait mon
inquiťtude: je me repentais d'Ítre venu chercher si loin une rude
vťritť. Quand j'eus terminť ma lecture, Talma, dans la mÍme attitude,
continua de se taire et de rťflťchir longtemps. Je respirais ŗ peine. ņ
la fin, se levant de son siťge et s'avanÁant vers moi avec un sourire
affectueux: ęJeune homme,Ľ me dit-il de sa voix la plus grave et la plus
ťmue, ęj'aurais voulu vous connaÓtre il y a vingt ans: vous auriez ťtť
mon poŽte; maintenant il est trop tard; vous venez au monde, et je m'en
vais. Vos vers sont vraiment des vers, votre piŤce est bien conÁue et
bien conduite; il y a des scŤnes susceptibles de produire de grands
effets, et, avec quelques corrections que je vous indiquerai ŗ loisir,
je me charge de la rťception, du rŰle et du succŤs. Seulement il y a Áŗ
et lŗ trop de jeunesse et trop de dťclamation poťtique, au lieu d'art
dramatique. Ce n'est rien; ce sont des feuilles ŗ ťlaguer pour laisser
nouer et mŻrir le fruit. Quel ‚ge avez-vous? D'oý Ítes-vous? Quelle est
votre famille? votre situation dans le monde? et ŗ quoi vous
destinez-vous? Parlez-moi comme ŗ un pŤre; je me sens un vťritable
intťrÍt pour vous.Ľ
ę--Je suis de province,Ľ lui rťpondis-je; ęma famille est considťrťe
dans notre pays; elle habite ses terres dans les environs de M‚con et
dans les montagnes du Jura, patrie de ma grand'mŤre paternelle; ma
famille est riche, mais mon pŤre ne l'est pas. AprŤs avoir servi Louis
XVI dans ses armťes, il vit en gentilhomme oisif, mais lettrť, dans une
petite terre, apanage d'un cadet de famille. Il a beaucoup d'enfants;
je suis son seul fils. Ma mŤre, qui est de Paris et qui a ťtť ťlevťe ŗ
la cour, nous a transmis les goŻts et les sentiments dťlicats du monde
oý elle a vťcu dans son premier ‚ge. J'ai fait de bonnes ťtudes chez les
jťsuites; j'ai servi quelque temps comme mon pŤre dans la maison
militaire du roi; cette vie monotone, sans guerre et sans gloire, m'a
dťgoŻtť. J'ai voyagť, puis je suis rentrť dans la maison paternelle ŗ la
campagne, oý l'ennui et l'oisivetť me rongent, et oý j'essaye d'ťvaporer
en poťsie cet ennui de mon ‚me. Je voudrais agir, je voudrais sortir de
mon obscuritť. Je voudrais rapporter quelque honneur au nom de mon pŤre,
quelque consolation au coeur de ma mŤre. J'ai pensť ŗ vous. J'ai ťcrit
trois ou quatre tragťdies; vous venez d'en entendre une. Seriez-vous
assez bon pour me tendre cette main et pour m'aider ŗ parvenir sur la
scŤne?Ľ
IX
Il avait des larmes, en m'ťcoutant, dans ses beaux yeux bleus.
ęDťjeunons,Ľ me dit-il du ton avec lequel Auguste dit ŗ Cinna: ę_Prends
un siťge, Cinna!_Ľ Puis il essuya ses yeux d'un revers de main. ęVous
m'attendrissez,Ľ me dit-il, ęavec ces images de pŤre, de mŤre, de
soeurs, plus encore qu'avec vos beaux vers bibliques. _Soyons amis_,
ajouta-t-il en souriant.Ľ
Il sonna. La belle personne qui m'avait introduit entr'ouvrit la porte
du cabinet contigu au salon. Elle avait fait sa toilette pour sortir,
pendant ma lecture. Elle me parut plus ťclatante, mais non plus
gracieuse que le matin.
ęQue veux-tu? mon ami,Ľ dit-elle ŗ Talma. Puis, voyant ŗ ses yeux
humides qu'il avait ťtť ťmu plus que d'habitude: ęLa tragťdie de
monsieur est donc bien touchante,Ľ lui demanda-t-elle avec hťsitation,
ępuisqu'elle te fait pleurer?Ľ
ę--Oui, oui,Ľ rťpondit-il entre ses dents, ęmais ce n'est pas la
tragťdie qui me fait monter des larmes aux yeux; c'est ce jeune homme.
Fais-nous servir le dťjeuner, sur ce guťridon, dans mon cabinet.
Monsieur veut bien se contenter de mes oeufs frais, de mon beurre et de
mon chocolat. Nous causerons plus ŗ l'aise jusqu'ŗ l'heure de Brunoy.Ľ
ę--Eh bien! on va te servir. Adieu!Ľ dit-elle, ęje sors jusqu'ŗ midi.Ľ
Puis, embrassant Talma et me saluant ŗ demi, elle sortit en me jetant un
long regard de curiositť et de bienveillance.
X
On apporta le dťjeuner sur un guťridon, et, tout en dťjeunant lentement
et frugalement aux rayons du soleil levant sur les arbres et aux
roucoulements des tourterelles sur les toits de la maison, Talma me
disait: ęLa nature vous a donnť le sentiment et l'harmonie des beaux
vers; vous ferez ce que vous voudrez faire. Mais, si vous vous destinez
au thť‚tre, venez souvent me voir ŗ Brunoy; nous ferons la poťtique de
ce temps-ci ŗ l'ombre de mes allťes. Lŗ j'ai tout mon temps ŗ moi; je le
dťpense dťlicieusement avec quelques amis; soyez de ce nombre. Je serai
fier que votre avenir, dont j'espŤre bien, ait commencť dans mon
jardin. N'y mettez point de fausse discrťtion; venez souvent, venez ŗ
toute heure: Brunoy sera toujours ouvert pour vous. J'aime la nature, et
je me sens meilleur quand je suis dans mes bois.Ľ
Puis, reprenant la question de ma tragťdie ŗ jouer: ęVoyez, me dit-il,
c'est trŤs-bien. ęSi nous ťtions au siŤcle de Louis XIV, oý la tragťdie
franÁaise, fille de la tragťdie grecque et latine, n'ťtait qu'une
sublime conversation, un dialogue des morts en action sur la scŤne, je
n'hťsiterais pas ŗ vous jouer demain et ŗ vous garantir un grand
applaudissement au thť‚tre; mais entre Corneille, Racine et ce
siŤcle-ci, il est nť une autre tragťdie, d'un homme de gťnie moderne,
antťrieure ŗ eux, nommťe Shakspeare (connaissez-vous Shakspeare?). Eh
bien! ce Shakspeare a rťvolutionnť la scŤne. Corneille est l'hťroÔsme,
Racine est la poťsie, Shakspeare est le drame. C'est par lui que je suis
devenu ce que je suis. Si vous voulez sťrieusement devenir un grand
poŽte thť‚tral, vous en Ítes le maÓtre; mais ne faites plus de tragťdie,
faites le drame; oubliez l'art franÁais, grec ou latin, et n'ťcoutez
que la nature. Je n'ai pas eu d'autre maÓtre, et voilŗ pourquoi on
m'aime.Ľ
XI
ņ ces mots, un vigoureux coup de sonnette retentit comme un tocsin dans
la petite antichambre de Talma; la porte s'ouvrit avec fracas, et une
femme toute tumultueuse et toute familiŤre entra sans se faire annoncer
dans le cabinet. Elle ťtait grande, maigre, p‚le, trŤs-laide, avec
quelques traces de sensibilitť fťminine dans les yeux et sur les joues.
Elle jeta avec un geste de dťgoŻt son vieux chapeau de soie noire sur un
meuble; elle dťcouvrit de longs cheveux noirs roulťs en bandeaux comme
un diadŤme sur son front.
ęAh! c'est toi, Duchesnois!Ľ lui dit Talma d'une voix creuse. ęJ'aurais
dŻ le deviner ŗ ton coup de sonnette: tu entres comme un ouragan, et tu
sors souvent comme une pluie,Ľ ajouta-t-il en riant, en faisant allusion
ŗ l'ťternelle pleurnicherie de sa camarade sur la scŤne.
ę--Ah! c'est que je suis rťvoltťe, indignťe, furieuse,Ľ rťpondit
mademoiselle Duchesnois en prenant un siťge et en s'asseyant entre Talma
et moi.
Et, prenant alors la parole avec une volubilitť turbulente, elle raconta
ŗ Talma je ne sais quel grief thť‚tral ridicule et sanglant qu'elle
avait contre les gentilshommes de la chambre chargťs de la discipline du
Thť‚tre-FranÁais et contre les Bourbons qui autorisaient ces iniquitťs
et ces humiliations. ęCela ne peut pas durer, cela ne durera pas!Ľ
criait-elle sans faire attention ŗ moi, et sans savoir si je n'ťtais pas
un de ces royalistes contre lesquels elle se rťpandait en malťdictions
et en menaces. ęNon, cela ne durera pas! Il y faudra du sang; mais
n'importe, il faut qu'on nous en dťlivre ŗ tout prix, mÍme au prix du
sang!Ľ
--Ah! Duchesnois,Ľ interrompit Talma d'un ton de modťration grandiose et
humaine, ętu ne penses pas, tu ne penses pas ce que tu dis lŗ. Je
connais ton coeur, il vaut mieux que ton humeur. Tout ce qui coŻte du
sang coŻte trop cher. Tais-toi! D'ailleurs,Ľ en me montrant du doigt,
ęsais-tu seulement devant qui tu parles, et si tu ne blesses pas les
opinions et le coeur de ce jeune homme, qui a ťtť ťlevť dans le culte
des Bourbons par sa famille?Ľ
En effet, j'ťtais muet par convenance, mais la rougeur de la honte
colorait mes joues en entendant blasphťmer ainsi ce que mon devoir ťtait
de respecter et de dťfendre.
Mademoiselle Duchesnois s'en aperÁut. Son bon coeur prťvalut ŗ l'instant
sur sa petite colŤre.
ęAh! Monsieur,Ľ me dit-elle, ęje vous demande pardon si je vous ai
affligť; oubliez ce que j'ai dit. Je n'aime pas les Bourbons, mais je ne
veux la mort de personne. C'est que, voyez-vous, je suis reine aussi, et
je ne puis tolťrer les humiliations dont on nous abreuve!Ľ
AprŤs ces mots elle se retira avec la mÍme fougue qu'elle avait montrťe
en entrant.
Nous achev‚mes la matinťe dans un entretien prolongť avec Talma. Je
sortis pťnťtrť de sa bontť, et lui promettant d'aller passer quelques
jours ŗ Brunoy. Et je tins parole; mais je ne donnai pas suite ŗ mes
projets de reprťsentations thť‚trales. Je repartis bientŰt aprŤs pour
les Alpes, oý de nouveaux sites et de nouvelles impressions
m'inspirŤrent de nouvelles pensťes.
XII
Un an aprŤs, je revins passer l'hiver ŗ Paris. Je revis Talma; il me
provoqua lui-mÍme, cette fois, ŗ ťcrire pour la scŤne. Je n'y songeais
dťjŗ plus; ma vie avait pris un autre cours: j'aspirais ŗ entrer dans la
diplomatie. On rťcitait dťjŗ dans Paris mes vers ťlťgiaques,
philosophiques ou religieux; mon nom rayonnait dans le demi-jour; je ne
voulais plus, pour quelques ovations de scŤnes, renoncer ŗ la carriŤre
politique, bien plus conforme qu'on ne le croit ŗ mes instincts
naturels. Je prťfťrais, comme je prťfŤre encore, la pensťe rťalisťe en
action ŗ des rÍves flottants sur des pages! Mais je mourrai ŗ cet ťgard
incompris. Le prťjugť de mon siŤcle aura ťtť plus fort que moi: il m'a
relťguť au rang des poŽtes. C'est un bel exil, mais ce n'ťtait pas ma
place. Que faire? Se rťsigner, et dire comme Galilťe: _E pur si muove!_
Mais revenons ŗ _Athalie_.
Talma me dit qu'on allait la reprťsenter avec une solennitť digne des
thť‚tres antiques, et qu'il ťtudiait dťjŗ pour cette reprťsentation le
rŰle du grand-prÍtre.
ę--C'est prodigieusement beau,Ľ me dit-il en passant sa large main sur
son front, ęmais c'est prodigieusement difficile. Si je suis trop
prophŤte dans ma diction, je tombe dans le prÍtre fanatique, et je
refoule dans les ‚mes l'intťrÍt qui s'attache au petit Joas, pupille du
temple et du pontificat. Si je suis trop politique dans ma physionomie
et dans mon geste, j'enlŤve ŗ ce rŰle le caractŤre d'inspiration et
d'intervention divine qui fait la grandeur et la saintetť de cette
tragťdie. Tenez,Ľ ajouta-t-il, ęque pensez-vous de cet accent?Ľ
Et il me rťcita en robe de chambre et en pantoufles trente ou quarante
vers du rŰle du grand-prÍtre qui auraient fait tressaillir le temple de
Jťrusalem!
ę--C'en est fait,Ľ lui dis-je, ęRacine vous attendait pour Ítre
interprťtť selon son esprit. ņ chaque chef-d'oeuvre de la scŤne il faut
un chef-d'oeuvre de la nature pour le personnifier aux yeux et ŗ
l'oreille d'un siŤcle. Vous avez ťtť _Tacite_ dans _Britannicus_, vous
serez la _Bible_ dans _Athalie_.Ľ
Il m'offrit sa loge pour m'y faire assister. L'Europe entiŤre m'aurait
enviť, ŗ moi, pauvre jeune homme ignorť, cette faveur. J'acceptai avec
reconnaissance, mais je ne fis point usage de cette obligeance de Talma.
Le point de vue latťral d'une loge d'acteur n'ťtait pas favorable ŗ
l'illusion de l'ensemble. La faveur d'une femme illustre et pieuse m'en
procura une autre bien plus centrale aux premiŤres loges en face,
presque ŗ cŰtť de l'amphithť‚tre prťparť, pour cette solennitť, ŗ la
famille des rois.
XIII
Les Bourbons ťtaient rentrťs rťcemment en France aprŤs un long exil, et
par la brŤche de nos dťsastres militaires. Ils n'avaient point ouvert
cette brŤche; ils venaient au contraire pour la fermer et pour la
rťparer; mais l'esprit d'un peuple vaincu et humiliť est injuste envers
ceux qui prennent la rude t‚che de le relever de ses ruines. Il
attribue injustement ses malheurs au gouvernement qui en porte le
premier le poids. Il n'y a point de justice ŗ espťrer d'une nation qui a
ťtť dix ans ivre de gloire, et qui vient, par un retour nťcessaire des
choses humaines, d'Ítre abattue sous le poids des revers et des
humiliations.
Tel ťtait alors l'ťtat de la France. Les Bourbons ťtaient dans ce moment
son seul salut, mais ce salut mÍme lui rappelait qu'elle avait besoin
d'Ítre sauvťe; elle les subissait en grondant, comme le malade subit le
remŤde.
Les Bourbons, de leur cŰtť, se rendaient parfaitement compte de cette
impopularitť de contre-coup qui leur faisait porter la responsabilitť de
Moscou, de Waterloo, du 20 mars et des deux invasions de la France. Ils
ne pouvaient pas offrir ŗ leur patrie un second Bonaparte pour illustrer
ses armťes dťtruites par vingt victoires ou pour renverser par toute
l'Europe les trŰnes lťgitimes que leur retour venait au contraire de
relever ou de raffermir. Les gloires modestes et les humbles fťlicitťs
de la paix ťtaient les seuls prestiges qu'ils pussent opposer au
prestige qui rayonnait de Marengo, d'Austerlitz et de Sainte-HťlŤne. Il
fallait, de ce peuple militaire, refaire ŗ contre-coeur un peuple
civil. La libertť parlementaire, qui ennoblit l'obťissance, les
industries, qui honorent et multiplient le travail, la lťgalitť, les
arts, les lettres, la religion, toutes ces puissances morales ťtaient
leur seul moyen de gouvernement. Il fallait confondre leur nom avec tous
ces bienfaits et toutes ces gloires de la paix qui attachent un peuple ŗ
ses princes par le bien-Ítre, et qui lui font oublier, dans la sťrťnitť
d'un rŤgne pacifique, les ťblouissements d'une dictature de hťros.
XIV
Louis XVIII, prince infiniment plus ťclairť et plus philosophe qu'on ne
le suppose, sentait profondťment cette nťcessitť. Convaincu que la
restauration de sa dynastie ne pouvait se naturaliser que par la libertť
des discussions parlementaires et par le concours ťlectif de la nation
elle-mÍme ŗ son gouvernement, il s'en rapportait ŗ la Constitution qu'il
avait donnťe de la soliditť de son trŰne.
Mais ce trŰne, il ne voulait pas seulement le consolider, il voulait
lui rendre son antique prestige. Depuis FranÁois Ier, les lettres
ťtaient un des caractŤres de la France; elles brillaient sur la tÍte de
ses rois comme la plus belle pierre prťcieuse de leur diadŤme. C'ťtait,
depuis les Grecs de l'antiquitť et depuis les Italiens de la
Renaissance, le peuple littťraire entre tous les peuples. Richelieu lui
avait donnť l'Acadťmie, la religion lui avait donnť la chaire, Louis XIV
lui avait donnť sa cour de poŽtes, d'orateurs, de moralistes. Le rŤgne
de Louis XV lui avait donnť Montesquieu, Voltaire, Buffon, J.-J.
Rousseau, l'Encyclopťdie, la philosophie du dix-huitiŤme siŤcle toute
pťtrie du gťnie des lettres. Le rŤgne de Louis XVI lui avait donnť la
politique littťraire et oratoire, dans cette foule d'ťcrivains dont
Mirabeau avait ťtť la derniŤre voix; il lui avait donnť enfin la
Rťvolution, qui n'ťtait au fond qu'une derniŤre explosion des lettres
franÁaises. Les noms des rois de nos dynasties et la gloire des lettres
se trouvaient partout confondus dans une insťparable solidaritť de
rayons. Les rois faisaient corps avec les poŽtes, et les poŽtes
faisaient aurťole avec les rois.
XV
Louis XVIII, en prince habile, voulait rappeler cette grandeur nationale
de sa maison ŗ la nation par tous ses sens. Racine, selon lui, faisait
partie de la dynastie de Louis XIV; en popularisant Racine il
repopularisait son ancÍtre. Il chercha quelle ťtait l'oeuvre de Racine
dans laquelle le gťnie du poŽte, la majestť de la monarchie, la saintetť
de la religion nationale ťtaient le mieux rassemblťs, pour restituer ŗ
ces trois institutions, la religion, la monarchie des Bourbons et les
lettres, le prestige dont il voulait ťblouir la France pour la rattacher
par un lťgitime orgueil national ŗ son passť monarchique. Il trouva
_Athalie_. Il ordonna ŗ ses ministres et ŗ ses gentilshommes de la
chambre de prťparer une reprťsentation fťerique et politique
d'_Athalie_.
On choisit la salle de l'Opťra comme la scŤne des prodiges. Cette salle
immense et monumentale s'ťlevait alors dans la rue de Richelieu, ŗ la
place oý une fontaine funťraire lave ťternellement la trace du sang de
l'infortunť duc de Berry, assassinť sous le vestibule de ce thť‚tre si
peu de mois aprŤs cette fÍte. On devait, pour complťter l'enchantement
de l'esprit par l'enchantement de tous les sens, reprťsenter _Athalie_
avec les choeurs, qui sont le cadre prophťtique et musical du drame.
Tous les grands artistes de la France, musiciens, dťcorateurs, peintres,
chorťgraphes, exťcutants, danseurs, danseuses, acteurs et actrices
furent invitťs par le gouvernement ŗ concourir, sous la direction
poťtique de Talma, ŗ la dignitť, ŗ la splendeur, aux dťlices de cette
reprťsentation. C'ťtait l'apothťose du siŤcle de Louis XIV sous
l'apothťose de Racine. La France entiŤre se pressa et se recueillit pour
y assister.
XVI
J'y ťtais. Une famille illustre par le gťnie autant que par la naissance
m'avait jugť digne de contempler un tel spectacle, pour me donner
l'ťmulation d'une gloire dont elle avait, dans sa bienveillance, le
pressentiment pour ma jeunesse. J'entrai dans la salle comme je serais
entrť dans un siŤcle illuminť parmi les siŤcles pour se donner ŗ
lui-mÍme en reprťsentation ťclatante dans la nuit des temps. Les gerbes
de lumiŤre, jaillissant des lustres, de la rampe, des candťlabres, et
rťpercutťes par les diamants des femmes de la cour, m'ťblouirent un
moment comme d'une cťcitť lumineuse. La salle, dont le rideau ťtait
encore baissť, ťtait pleine de spectateurs. Le parterre ondoyait, les
galeries se mouvaient, les loges dťbordaient, comme des corbeilles trop
pleines, de tÍtes et de fleurs.
La famille royale occupait, au milieu de la salle, en face de la scŤne,
un amphithť‚tre avancť comme un promontoire sur un ocťan. Les regards y
cherchaient avec respect le roi, qui ressemblait, par sa coiffure et son
costume, ŗ l'apparition posthume d'un autre ‚ge; le comte d'Artois, son
frŤre, protecteur de l'abbť Delille, ce laurťat de l'exil; le duc
d'AngoulÍme, le duc de Berry, ses fils, et la fille de Louis XVI, cette
princesse plus tragique par ses malheurs que la tragťdie ŗ laquelle elle
venait assister. Des symphonies sourdes et lointaines comme l'ťcho des
cantiques d'un temple, sortant par les pores de l'ťdifice,
remplissaient l'air d'un bourdonnement, harmonieux qui prťparait l'‚me ŗ
de mystiques sensations. Tout ŗ coup le rideau de la scŤne se leva comme
si le vent de l'inspiration cťleste eŻt dťchirť le voile du Temple.
XVII
Le Temple apparut dans la lumiŤre dorťe dont je l'ai vu plus tard
baignť, par un beau jour, sur la montagne dont le prťcipice est la
_vallťe des Lamentations_. On sait que le Temple n'ťtait pas seulement
la maison du Dieu Jťhova, mais l'habitation d'une foule innombrable de
lťvites, de prÍtres, de pontifes, de prophŤtes, habitant, avec leurs
familles consacrťes, les immenses dťpendances, portiques, cours,
jardins, sťminaires dont il ťtait entourť. Ces jardins, ces cours, ces
portiques, ces galeries, d'une architecture hťbraÔque et persane
semblable au tombeau d'Absalon dans la vallťe de Josaphat, avaient ťtť
fantastiquement imitťs ou inventťs par l'artifice des dťcorateurs. Les
regards, dťpaysťs par l'illusion, transportaient l'‚me au milieu des
pompes religieuses de Sion.
Un profond silence rťgnait dans la foule; chacun se recueillait dans
l'attente d'un drame dťjŗ aussi rťel qu'un ťvťnement. On se demandait en
soi-mÍme quelle serait la voix qui oserait s'ťlever sur cette scŤne en
consonnance avec cette grandeur et cette antiquitť du spectacle. On se
demandait surtout quelle serait la langue assez majestueuse, assez
grave, assez prophťtique, assez divine, pour profťrer des paroles
franÁaises dans ces portiques de David, d'IsaÔe, de Jťhova. On
s'alarmait d'avance de la dissonance qu'on allait entendre; on craignait
le premier accent, le premier vers des acteurs; on ne se souvenait plus
que Racine avait retrouvť un jour, pour ťcrire _Athalie_, les foudres
d'IsaÔe, les larmes de David, les illuminations du SinaÔ.
Enfin Talma parut; ou plutŰt ce n'ťtait plus Talma, c'ťtait le sacerdoce
hťbraÔque personnifiť dans ce roi des sacrifices; le chef ŗ la fois
politique et inspirť d'une thťocratie souveraine, qui rťgnait, comme en
…gypte, par la main des rois auxquels il intimait les ordres de Dieu.
Son costume et sa physionomie le transfiguraient en prophŤte. Nulle
pensťe ne se pťtrifiait aussi complŤtement sur les traits du visage que
celle de Talma. Son visage devenait ŗ volontť sa pensťe.
Il ťtait accompagnť d'un guerrier hťbreu, Abner, sous les traite de
Lafon, son rivai de la scŤne. Lafon, qui avait le front noble, l'oeil
brave, le geste hťroÔque, l'accent martial, ťtait trŤs-apte aux rŰles de
hťros. Un peu plus grand que nature, il plaisait dans les sentiments
surhumains; il ťtait l'art, Talma ťtait la nature. Il ťtait, de plus, un
homme justement aimť et estimť pour son coeur. Ce fut lui seul qui, en
parlant de l'‚me et en pleurant des larmes sincŤres sur le cercueil de
son rival Talma, arracha des larmes ŗ cent mille spectateurs que les
discours acadťmiques des poŽtes et des orateurs avaient laissťs froids.
XVIII
L'acteur qui reprťsentait Abner entr'ouvrit les lŤvres aprŤs avoir
promenť un long regard de tristesse sur la solitude du temple. Il y
avait toute une conjuration et toute une lamentation dans ce seul
regard. Sa voix, concentrťe comme celle du deuil sur un sťpulcre, laissa
tomber ces vers, qui ťtaient dans la mťmoire de tout le monde et que
tout le monde entendit pour la premiŤre fois.
ABNER.
Oui, je viens dans son temple adorer l'…ternel;
Je viens, selon l'usage antique et solennel,
Cťlťbrer avec vous la fameuse journťe
Oý sur le mont Sina la loi nous fut donnťe.
Que les temps sont changťs! SitŰt que de ce jour
La trompette sacrťe annonÁait le retour,
Du temple, ornť partout de festons magnifiques,
Le peuple saint en foule inondait les portiques.
Et tous, devant l'autel avec ordre introduits,
De leurs champs dans leurs mains portant les nouveaux fruits,
Au Dieu de l'univers consacraient ces prťmices.
Les prÍtres ne pouvaient suffire aux sacrifices.
L'audace d'une femme, arrÍtant ce concours,
En des jours tťnťbreux a changť ces beaux jours.
D'adorateurs zťlťs ŗ peine un petit nombre
Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre.
Il poursuivit, et il exposa dans cet entretien ŗ demi-voix la situation
religieuse et politique de Jťrusalem et du peuple de Dieu sous la reine
impie et usurpatrice qui occupait le trŰne de Juda.
Il y avait deux royaumes dans IsraŽl: l'un composť de dix tribus et
gouvernť par Achab et sa femme Jťzabel; l'autre composť des tribus de
Juda et de Benjamin seulement. Ce second royaume siťgeait ŗ Jťrusalem,
possesseur privilťgiť du Temple et gouvernť par Joram, roi de Juda de la
race lťgitime de David. Joram, par un mariage politique qui rťtablissait
la paix entre les deux …tats, avait ťpousť Athalie, fille d'Achab et de
Jťzabel. Athalie, princesse impťrieuse et sťduisante, avait dominť son
mari Joram; elle l'avait entraÓnť dans l'idol‚trie; elle avait mÍme
obtenu de lui la tolťrance du culte de Baal, dieu syrien, ennemi de
Jťhova, ŗ cŰtť du temple de Jťhova. Joram ťtait mort; son fils Ochosias
lui avait succťdť. Athalie, sa mŤre et sa tutrice, rťgnait sous son nom.
Ce malheureux roi, dans une visite qu'il alla faire au roi Achab, son
aÔeul, fut massacrť par un nommť _Jťhu_, tribun ou prophŤte (c'ťtait
alors la mÍme chose), qui avait eu mission des autres prophŤtes
d'exterminer la race d'Achab. Jťhu avait fait jeter par les fenÍtres du
palais de Samarie Jťzabel, femme d'Achab et mŤre d'Athalie. Il avait
fait dťfendre d'ensevelir ses restes, et les avait fait dťvorer par les
chiens dans une vigne.
Athalie, pour venger son pŤre et sa mŤre des cruautťs des prophŤtes,
avait fait immoler ŗ son tour tous les enfants de son fils Ochosias, de
peur que ces rejetons de la famille de David par Joram ne prťvalussent
un jour sur la maison d'Achab. Pendant ce massacre, une soeur
d'Ochosias, qui vivait dans l'intťrieur du temple, ťtait parvenue ŗ
sauver un de ses neveux, le petit Joas, encore ŗ la mamelle. On avait
mal comptť les cadavres en les jetant aux chiens. Joas, ťlevť dans
l'ombre du temple par Josabeth sous un autre nom, n'ťtait connu que
d'elle et du grand-prÍtre Joad.
Voilŗ toute l'exposition faite en vers si ťpiques par Joad au guerrier
Abner. Il ne lui rťvŤle pas encore cependant l'existence de l'enfant; il
se contente de le sonder artificieusement, et de le prťparer ŗ la
dťfection de la cause d'Athalie par le murmure. Abner n'y paraÓt que
trop disposť de lui-mÍme; il parle dťjŗ d'Athalie en traÓtre plutŰt
qu'en serviteur. Il rťvŤle ŗ Joad les inimitiťs secrŤtes de cette reine
contre lui.
JOAD.
D'oý vous vient aujourd'hui ce noir pressentiment?
ABNER.
Pensez-vous Ítre saint et juste impunťment?
DŤs longtemps elle hait cette fermetť rare
Qui rehausse en Joad l'ťclat de la tiare;
DŤs longtemps votre amour pour la religion
Est traitť de rťvolte et de sťdition.
Du mťrite ťclatant cette reine jalouse
Hait surtout Josabeth, votre fidŤle ťpouse.
Si du grand-prÍtre Aaron Joad est successeur,
De notre dernier roi Josabeth est la soeur.
Mathan, d'ailleurs, Mathan, ce prÍtre sacrilťge,
Plus mťchant qu'Athalie, ŗ toute heure l'assiťge;
Mathan, de nos autels inf‚me dťserteur,
Et de toute vertu zťlť persťcuteur.
C'est peu que, le front ceint d'une mitre ťtrangŤre,
Ce lťvite ŗ Baal prÍte son ministŤre;
Ce temple l'importune, et son impiťtť
Voudrait anťantir le Dieu qu'il a quittť.
Pour vous perdre il n'est point de ressorts qu'il n'invente;
Quelquefois il vous plaint, souvent mÍme il vous vante.
Il affecte pour vous une fausse douceur,
Et par lŗ, de son fiel colorant la noirceur,
TantŰt ŗ cette peine il vous peint redoutable,
TantŰt, voyant pour l'or sa soif insatiable,
Il lui feint qu'en un lieu, que vous seul connaissez,
Vous cachez des trťsors par David amassťs.
Enfin, depuis deux jours, la superbe Athalie
Dans un sombre chagrin paraÓt ensevelie.
Je l'observais hier, et je voyais ses yeux
Lancer sur le lieu saint des regards furieux;
Comme si dans le fond de ce vaste ťdifice
Dieu cachait un vengeur armť pour son supplice.
Croyez-moi; plus j'y pense et moins je puis douter
Que sur vous son courroux ne soit prÍt d'ťclater,
Et que de Jťzabel la fille sanguinaire
Ne vienne attaquer Dieu jusqu'en son sanctuaire.
Ces confidences d'Abner amŤnent ces vers, restťs monuments de parole,
dans la bouche du grand-prÍtre.
Celui qui met un frein ŗ la fureur des flots
Sait aussi des mťchants arrÍter les complots.
Soumis avec respect ŗ sa volontť sainte,
Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte.
Cependant je rends gr‚ce au zŤle officieux
Qui sur tous mes pťrils vous fait ouvrir les yeux.
Je vois que l'injustice en secret vous irrite,
Que vous avez encor le coeur israťlite.
Le Ciel en soit bťni!... Mais ce secret courroux,
Cette oisive vertu, vous en contentez-vous?
La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincŤre?
Huit ans dťjŗ passťs, une impie ťtrangŤre
Du sceptre de David usurpe tous les droits,
Se baigne impunťment dans le sang de nos rois,
Des enfants de son fils dťtestable homicide,
Et mÍme contre Dieu lŤve son bras perfide;
Et vous, l'un des soutiens de ce tremblant …tat,
Vous, nourri dans les camps du saint roi Josaphat,
Qui sous son fils Joram commandiez nos armťes,
Qui rassur‚tes seul nos villes alarmťes
Lorsque d'Ochosias le trťpas imprťvu
Dispersa tout son camp ŗ l'aspect de Jťhu:
ęJe crains Dieu, dites-vous, sa vťritť me touche!Ľ
Voici comme ce Dieu vous rťpond par ma bouche:
ęDu zŤle de ma loi que sert de vous parer?
Par de stťriles voeux pensez-vous m'honorer?
Quel fruit me revient-il de tous vos sacrifices?
Ai-je besoin du sang des boucs et des gťnisses?
Le sang de vos rois crie, et n'est point ťcoutť.
Rompez, rompez tout pacte avec l'impiťtť;
Du milieu de mon peuple exterminez les crimes,
Et vous viendrez alors m'immoler vos victimes.Ľ
La scŤne continue; le secret de l'existence d'un roi lťgitime, ŗ peine
retenu sur les lŤvres du grand-prÍtre, se laisse percer par Abner. Ce
guerrier s'ťloigne, la dťfection dťjŗ dans le coeur.
Josabeth, qui a sauvť et nourri de son lait le fils d'Ochosias sous le
nom d'…liacin, paraÓt ŗ la place d'Abner sur la scŤne; le grand-prÍtre
lui dit que l'heure est venue de dťclarer le rang de l'orphelin aux
lťvites rassemblťs par ses soins pour restaurer par les armes ce jeune
prince.
Josabeth s'alarme comme une mŤre; elle rappelle au grand-prÍtre, son
ťpoux, combien lui a coŻtť le salut de cet enfant. Ni HomŤre, ni Virgile
ne donnent ŗ Hťcube et ŗ Andromaque des accents si maternels et si
ťpiques.
Hťlas! l'ťtat horrible oý le Ciel me l'offrit
Revient ŗ tout moment effrayer mon esprit.
De princes ťgorgťs la chambre ťtait remplie;
Un poignard ŗ la main, l'implacable Athalie
Au carnage animait ses barbares soldats,
Et poursuivait le cours de ses assassinats.
Joas, laissť pour mort, frappa soudain ma vue.
Je me figure encor sa nourrice ťperdue,
Qui devant les bourreaux s'ťtait jetťe en vain,
Et, faible, le tenait renversť sur son sein.
Je le pris tout sanglant. En baignant son visage,
Mes pleurs du sentiment lui rendirent l'usage;
Et, soit frayeur encore ou pour me caresser,
De ses bras innocents je me sentis presser...
Grand Dieu! que mon amour ne lui soit point funeste!
Du fidŤle David c'est le prťcieux reste:
Nourri dans ta maison en l'amour de ta loi,
Il ne connaÓt encor d'autre pŤre que toi.
Sur le point d'attaquer une reine homicide,
ņ l'aspect du pťril si ma foi s'intimide,
Si la chair et le sang, se troublant aujourd'hui,
Ont trop de part aux pleurs que je rťpands pour lui,
Conserve l'hťritier de tes saintes promesses,
Et ne punis que moi de toutes mes faiblesses!
JOAD.
Vos larmes, Josabeth, n'ont rien de criminel;
Mais Dieu veut qu'on espŤre en son soin paternel.
Il ne recherche point, aveugle en sa colŤre,
Sur le fils qui le craint l'impiťtť du pŤre.
Tout ce qui reste encor de fidŤles Hťbreux
Lui viendront aujourd'hui renouveler leurs voeux.
Autant que de David la race est respectťe,
Autant de Jťzabel la fille est dťtestťe.
Joas les touchera par sa noble pudeur
Oý semble de son rang reluire la splendeur;
Et Dieu, par sa voix mÍme appuyant notre exemple,
De plus prŤs ŗ leur coeur parlera dans son temple.
Deux infidŤles rois tour ŗ tour l'ont bravť:
Il faut que sur le trŰne un roi soit ťlevť
Qui se souvienne un jour qu'au rang de ses ancÍtres
Dieu l'a fait remonter par la main de ses prÍtres,
L'a tirť par leur main de l'oubli du tombeau,
Et de David ťteint rallumť le flambeau...
Grand Dieu! si tu prťvois qu'indigne de sa race,
Il doive de David abandonner la trace,
Qu'il soit comme le fruit en naissant arrachť
Ou qu'un souffle ennemi dans sa fleur a sťchť!
Mais si ce mÍme enfant, ŗ tes ordres docile,
Doit Ítre ŗ tes desseins un instrument utile,
Fais qu'au juste hťritier le sceptre soit remis!
Livre en mes faibles mains ses puissants ennemis!
Confonds dans ses conseils une reine cruelle!
Daigne, daigne, mon Dieu! sur Mathan et sur elle
Rťpandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,
De la chute des rois funeste avant-coureur!...
La voix de Talma, dans ces derniers vers, grondait, comme le destin des
rois, derriŤre le mystŤre des rťvolutions prochaines. Il sortit de la
scŤne comme le prophŤte des calamitťs royales.
L'acte ťtait fini; des choeurs mťlodieux remplirent l'entr'acte; mais
les choeurs, il faut en convenir, bien qu'immensťment louťs par les
rhťteurs sur parole, n'ťtaient ni ŗ la hauteur du temple de Sion, ni ŗ
la hauteur des grands lyriques sacrťs ou profanes. Racine s'ťtait trop
ťpuisť de gťnie dans ce premier acte pour se retrouver, dans le choeur,
ťgal ŗ lui-mÍme. Cependant, comme la musique emportait les paroles sur
l'aile des mťlodies, l'effet de ce choeur rťpandait un parfum de
recueillement, d'espťrance et de priŤre dans la salle. L'Opťra n'ťtait
plus un thť‚tre; c'ťtait un sanctuaire: Racine et Talma l'avaient
purifiť.
XIX
Le second acte s'ouvrit sous ces impressions. Personne n'avait ni parlť
ni respirť entre ces deux actes. La grandeur de la scŤne, la majestť du
pontificat, l'intervention divine pressentie dans le grand-prÍtre, la
divinitť surtout de la langue des vers dont la perfection faisait
oublier le rhythme pour ne penser qu'au sens, enfin la voix et la
prononciation de Talma, qui rťsumait dans son accent tous les ťchos
souterrains ou cťlestes du Temple, suspendaient la vie des auditeurs. La
prťsence du roi et des princes, cette autre maison de Juda pour la
France restaurťe, et restaurant avec elle la religion et la poťsie de
Louis XIV, ajoutait ŗ la puissance de l'impression quelque chose de
tendre, d'antique, de miraculeux.
ņ la premiŤre scŤne, des femmes et un enfant ťperdus s'ťlancent des
profondeurs du temple sur la scŤne: c'est Josabeth, la nourrice de Joas
sauvť, les femmes et les filles des lťvites, et Zacharie, fils de
Josabeth, ťlevť avec Joas dans le temple, mais ne connaissant encore ni
le vrai nom ni le rang de son frŤre de lait. Zacharie annonce ŗ sa mŤre
la prťsence inattendue et sacrilťge d'Athalie dans le temple.
ZACHARIE.
... Dans un des parvis aux hommes rťservť,
Cette femme superbe entre, le front levť,
Et se prťparait mÍme ŗ passer les limites
De l'enceinte sacrťe, ouverte aux seuls lťvites.
Le peuple s'ťpouvante et fuit de toutes parts.
Mon pŤre... Ah! quel courroux animait ses regards!
MoÔse ŗ Pharaon parut moins formidable.
ęReine, sors, a-t-il dit, de ce lieu redoutable,
D'oý te bannit ton sexe et ton impiťtť.
Viens-tu du Dieu vivant braver la majestť?Ľ
La reine, alors sur lui jetant un oeil farouche,
Pour blasphťmer sans doute ouvrait dťjŗ la bouche.
J'ignore si de Dieu l'ange se dťvoilant
Est venu lui montrer un glaive ťtincelant;
Mais sa langue en sa bouche ŗ l'instant s'est glacťe,
Et toute son audace a paru terrassťe.
Ses yeux, comme effrayťs, n'osaient se dťtourner;
Surtout …liacin paraissait l'ťtonner.
JOSABETH.
Quoi donc! …liacin a paru devant elle?
Athalie, suivie de son gťnťral Abner, paraÓt; elle rťvŤle en une langue
digne de Corneille sa politique; mais le remords l'agite sous la figure
de ses songes.
C'ťtait pendant l'horreur d'une profonde nuit;
Ma mŤre Jťzabel devant moi s'est montrťe,
Comme au jour de sa mort pompeusement parťe;
Ses malheurs n'avaient point abattu sa fiertť;
MÍme elle avait encor cet ťclat empruntť
Dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage,
Pour rťparer des ans l'irrťparable outrage.
ę Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi;
Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi.
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables,
Ma fille.Ľ En achevant ces mots ťpouvantables,
Son ombre vers mon lit a paru se baisser;
Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser...
Mais je n'ai plus trouvť qu'un horrible mťlange
D'os et de chair meurtris, et traÓnťs dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux,
Que des chiens dťvorants se disputaient entre eux.
ABNER.
Grand Dieu!
ATHALIE.
Dans ce dťsordre ŗ mes yeux se prťsente
Un jeune enfant couvert d'une robe ťclatante,
Tels qu'on voit des Hťbreux les prÍtres revÍtus.
Sa vue a ranimť mes esprits abattus;
Mais lorsque, revenant de mon trouble funeste,
J'admirais sa douceur, son air noble et modeste,
J'ai senti tout ŗ coup un homicide acier
Que le traÓtre en mon sein a plongť tout entier...
De tant d'objets divers le bizarre assemblage
Peut-Ítre du hasard vous paraÓt un ouvrage.
Moi-mÍme, quelque temps honteuse de ma peur,
Je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur;
Mais de ce souvenir mon ‚me possťdťe
ņ deux fois, en dormant, revu la mÍme idťe.
Deux fois mes tristes yeux se sont vu retracer
Ce mÍme enfant, toujours tout prÍt ŗ me percer.
Lasse enfin des horreurs dont j'ťtais poursuivie,
J'allais prier Baal de veiller sur ma vie,
Et chercher du repos au pied de ses autels...
Que ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels!
Dans le temple des Juifs un instinct m'a poussťe,
Et d'apaiser leur Dieu j'ai conÁu la pensťe;
J'ai cru que des prťsents calmeraient son courroux,
Que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus doux.
Pontife de Baal, excusez ma faiblesse.
J'entre: le peuple fuit, le sacrifice cesse;
Le grand-prÍtre vers moi s'avance avec fureur.
Pendant qu'il me parlait, Ű surprise! Ű terreur!
J'ai vu ce mÍme enfant dont je suis menacťe,
Tel qu'un songe effrayant l'a peint ŗ ma pensťe.
Je l'ai vu: son mÍme air, son mÍme habit de lin,
Sa dťmarche, ses yeux, et tous ses traits enfin;
C'est lui-mÍme. Il marchait ŗ cŰtť du grand-prÍtre;
Mais bientŰt ŗ ma vue on l'a fait disparaÓtre.
Voilŗ quel trouble ici m'oblige ŗ m'arrÍter,
Et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter...
La scŤne qui suit, une des plus tragiques et des plus naÔves en mÍme
temps qui soit sur aucun thť‚tre, place face ŗ face Athalie et l'enfant
vengeur encore inconnu de David. Il faut remonter ŗ la Bible des
patriarches et aux scŤnes entre Joseph enfant et ses frŤres pour
retrouver de tels accents. Cette scŤne ne peut s'analyser; il faut la
lire tout entiŤre.
ATHALIE.
‘ ciel! plus j'examine, et plus je le regarde!...
C'est lui!... D'horreur encor tous mes sens sont saisis...
(_Montrant Joas._)
…pouse de Joad, est-ce lŗ votre fils?
JOSABETH.
Qui, lui, madame?
ATHALIE.
Lui?
JOSABETH.
Je ne suis point sa mŤre.
(_Montrant Zacharie._)
Voilŗ mon fils.
ATHALIE, _ŗ Joas_.
Et vous, quel est donc votre pŤre?
Jeune enfant, rťpondez.
JOSABETH.
Le Ciel jusque aujourd'hui...
ATHALIE.
Pourquoi vous pressez-vous de rťpondre pour lui?
C'est ŗ lui de parler.
JOSABETH.
Dans un ‚ge si tendre,
Quel ťclaircissement en pouvez-vous attendre?
ATHALIE.
Cet ‚ge est innocent; son ingťnuitť
N'altŤre point encor la simple vťritť.
Laissez-le s'expliquer sur tout ce qui le touche.
JOSABETH, _tout bas_.
Daigne mettre, grand Dieu! ta sagesse en sa bouche!
ATHALIE.
Comment vous nommez-vous!
JOAS.
J'ai nom …liacin.
ATHALIE.
Votre pŤre?
JOAS.
Je suis, dit-on, un orphelin,
Entre les bras de Dieu jetť dŤs ma naissance,
Et qui de mes parents n'eus jamais connaissance.
ATHALIE.
Vous Ítes sans parents?
JOAS.
Ils m'ont abandonnť.
ATHALIE.
Comment! et depuis quand?
JOAS.
Depuis que je suis nť.
ATHALIE.
Ne sait-on pas au moins quel pays est le vŰtre?
JOAS.
Ce temple est mon pays; je n'en connais point d'autre.
ATHALIE.
Oý dit-on que le sort vous a fait rencontrer?
JOAS.
Parmi des loups cruels prÍts ŗ me dťvorer.
ATHALIE.
Qui vous mit dans ce temple?
JOAS.
Une femme inconnue,
Qui ne dit point son nom, et qu'on n'a point revue.
ATHALIE.
Mais de vos premiers ans quelles mains ont pris soin?
JOAS.
Dieu laissa-t-il jamais, ses enfants au besoin?
Aux petits des oiseaux il donne leur p‚ture,
Et sa bontť s'ťtend sur toute la nature.
Tous les jours je l'invoque; et, d'un soin paternel,
Il me nourrit des dons offerts sur son autel.
ATHALIE.
Quel prodige nouveau me trouble et m'embarrasse!
La douceur de sa voix, son enfance, sa gr‚ce
Font insensiblement ŗ mon inimitiť
Succťder... Je serais sensible ŗ la pitiť!
ABNER.
Madame, voilŗ donc cet ennemi terrible?
De vos songes menteurs l'imposture est visible,
ņ moins que la pitiť, qui semble vous troubler,
Ne soit ce coup fatal qui vous faisait trembler.
ATHALIE, _ŗ Joas et ŗ Josabeth_.
Vous sortez?
JOSABETH.
Vous avez entendu sa fortune.
Sa prťsence ŗ la fin pourrait Ítre importune.
ATHALIE, _ŗ Joas_.
Non; revenez... Quel est tous les jours votre emploi?
JOAS.
J'adore le Seigneur; on m'explique sa loi;
Dans son livre divin on m'apprend ŗ la lire,
Et dťjŗ de ma main je commence ŗ l'ťcrire.
ATHALIE.
Que vous dit cette loi?
JOAS.
Que Dieu veut Ítre aimť;
Qu'il venge tŰt ou tard son saint nom blasphťmť;
Qu'il est le dťfenseur de l'orphelin timide;
Qu'il rťsiste au superbe et punit l'homicide.
ATHALIE.
J'entends. Mais tout ce peuple enfermť dans ce lieu,
ņ quoi s'occupe-t-il?
JOAS.
Il loue, il bťnit Dieu.
ATHALIE.
Dieu veut-il qu'ŗ toute heure on prie, on le contemple?
JOAS.
Tout profane exercice est banni de son temple.
ATHALIE.
Quels sont donc vos plaisirs?
JOAS.
Quelquefois ŗ l'autel
Je prťsente au grand-prÍtre ou l'encens ou le sel;
J'entends chanter de Dieu les grandeurs infinies;
Je vois l'ordre pompeux de ces cťrťmonies.
ATHALIE.
Hť quoi! vous n'avez point de passe-temps plus doux?
Je plains le triste sort d'un enfant tel que vous!
Venez dans mon palais, vous y verrez ma gloire.
JOAS.
Moi! des bienfaits de Dieu je perdrais la mťmoire?
ATHALIE.
Non, je ne vous veux pas contraindre ŗ l'oublier.
JOAS.
Vous ne le priez point.
ATHALIE.
Vous pourrez le prier.
JOAS.
Je verrais cependant en invoquer un autre.
ATHALIE.
J'ai mon dieu que je sers; vous servirez le vŰtre;
Ce sont deux puissants dieux.
JOAS.
Il faut craindre le mien;
Lui seul est Dieu, Madame, et le vŰtre n'est rien.
ATHALIE.
Les plaisirs prŤs de moi vous chercheront en foule.
JOAS.
Le bonheur des mťchants comme un torrent s'ťcoule.
ATHALIE.
Ces mťchants, qui sont-ils?
JOSABETH.
Eh, Madame! excusez
Un enfant.
ATHALIE, _ŗ Josabeth_.
J'aime ŗ voir comme vous l'instruisez...
Enfin, …liacin, vous avez su me plaire;
Vous n'Ítes point sans doute un enfant ordinaire.
Vous voyez, je suis reine, et n'ai point d'hťritier.
Laissez lŗ cet habit, quittez ce vil mťtier;
Je veux vous faire part de toutes mes richesses.
Essayez, dŤs ce jour, l'effet de mes promesses.
ņ ma table, partout ŗ mes cŰtťs assis,
Je prťtends vous traiter comme mon propre fils.
JOAS.
Comme votre fils!
ATHALIE.
Oui... Vous vous taisez?
JOAS.
Quel pŤre
Je quitterais! Et pour...
ATHALIE.
Hť bien?
JOAS.
Pour quelle mŤre!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
On conÁoit la fureur d'Athalie ŗ cette rťponse; elle se retire pour
aller prťparer la vengeance contre les chefs lťvites instigateurs de ce
dangereux enfant. Le choeur, cette fois, fait partie lyrique du drame;
il chante, dans des strophes enfantines et pieuses, les bonheurs de
l'innocence, la protection de Dieu sur les siens, sa vengeance sur ses
ennemis. Racine s'y rapproche, autant que les temps et la langue le
permettent, de la componction de David. Il est vťritablement le David
chrťtien.
XX
Au troisiŤme acte, le ministre d'Athalie, Mathan, vient pour arracher du
temple l'enfant, terreur de la reine. Il dťvoile ŗ son confident les
voies par lesquelles il est parvenu au pouvoir. Racine ici fait parler
Machiavel dans la langue de Tacite. …coutez, vous qui connaissez les
ambitieux de cour ou de popularitť; est-ce Sťjan qui parle?
Qu'est-il besoin, Nabal, qu'ŗ tes yeux je rappelle
De Joad et de moi la fameuse querelle,
Quand j'osai contre lui disputer l'encensoir;
Mes brigues, mes combats, mes pleurs, mon dťsespoir?
Vaincu par lui, j'entrai dans une autre carriŤre,
Et mon ‚me ŗ la cour s'attacha tout entiŤre.
J'approchai par degrťs de l'oreille des rois,
Et bientŰt en oracle on ťrigea ma voix.
J'ťtudiai leur coeur, je flattai leurs caprices;
Je leur semai de fleurs le bord des prťcipices;
PrŤs de leurs passions rien ne me fut sacrť;
De mesure et de poids je changeais ŗ leur grť.
Autant que de Joad l'inflexible rudesse
De leur superbe oreille offensait la mollesse,
Autant je les charmais par ma dextťritť,
Dťrobant ŗ leurs yeux la triste vťritť,
PrÍtant ŗ leurs fureurs des couleurs favorables,
Et prodigue surtout du sang des misťrables.
Enfin au dieu nouveau qu'elle avait introduit
Par les mains d'Athalie un temple fut construit.
Jťrusalem pleura de se voir profanťe;
Des enfants de Lťvi la troupe consternťe
En poussa vers le Ciel des hurlements affreux.
Moi seul, donnant l'exemple aux timides Hťbreux,
Dťserteur de leur loi, j'approuvai l'entreprise,
Et par lŗ de Baal mťritai la prÍtrise.
Par lŗ je me rendis terrible ŗ mon rival;
Je ceignis la tiare, et marchai son ťgal.
Toutefois, je l'avoue, en ce comble de gloire,
Du Dieu que j'ai quittť l'importune mťmoire
Jette encore en mon ‚me un reste de terreur,
Et c'est ce qui redouble, et nourrit ma fureur.
Heureux si, sur son temple achevant ma vengeance,
Je puis convaincre enfin sa haine d'impuissance,
Et, parmi les dťbris, le ravage et les morts,
ņ force d'attentats perdre tous mes remords!...
Mais voici Josabeth.
Josabeth refuse …liacin ŗ Athalie; le grand-prÍtre, ŗ sa vue, laisse
ťclater sa colŤre en imprťcations cťlestes. Il rejette tous les secours
humains que la faiblesse maternelle de Josabeth lui suggŤre pour sauver
l'enfant. Il passe en revue les femmes, les vieillards, les lťvites.
L'inspiration le saisit ŗ la vue de cette faiblesse derriŤre laquelle il
voit tout ŗ coup la force de Dieu. Ici Talma se transfigura
vťritablement en prophŤte; on crut voir la lueur divine se rťpandre
comme une losange de foudre sur les traits de son visage et jusque sur
les plis de ses draperies.
JOAD.
Voilŗ donc quels vengeurs s'arment pour ta querelle:
Des prÍtres, des enfants, Ű Sagesse ťternelle!
Mais, si tu les soutiens, qui peut les ťbranler?
Du tombeau, quand tu veux, tu sais nous rappeler;
Tu frappes et guťris, tu perds et ressuscites.
Ils ne s'assurent point en leurs propres mťrites,
Mais en ton nom sur eux invoquť tant de fois,
En tes serments, jurťs au plus saint de leurs rois,
En ce temple oý tu fais ta demeure sacrťe,
Et qui doit du soleil ťgaler la durťe!...
Mais d'oý vient que mon coeur frťmit d'un saint effroi?
Est-ce l'esprit divin qui s'empare de moi?
C'est lui-mÍme. Il m'ťchauffe, il parle; mes yeux s'ouvrent,
Et les siŤcles obscurs devant moi se dťcouvrent...
Lťvites, de vos sons prÍtez-moi les accords,
Et de ses mouvements secondez les transports.
LE CHOEUR _chante au son de toute la symphonie des instruments_.
Que du Seigneur la voix se fasse entendre,
Et qu'ŗ nos coeurs son oracle divin
Soit ce qu'ŗ l'herbe tendre
Est, au printemps, la fraÓcheur du matin!
JOAD.
Cieux! ťcoutez ma voix; terre! prÍte l'oreille.
Ne dis plus, Ű Jacob, que ton Seigneur sommeille!
Pťcheurs, disparaissez: le Seigneur se rťveille.
(Ici commence la symphonie, et Joad aussitŰt reprend la parole.)
Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changť?
Quel est dans le lieu saint ce pontife ťgorgť?
Pleure, Jťrusalem! pleure, citť perfide!
Des prophŤtes divins malheureuse homicide!
De son amour pour toi ton Dieu s'est dťpouillť;
Ton encens ŗ ses yeux est un encens souillť!
Oý menez-vous ces enfants et ces femmes?
Le Seigneur a dťtruit la reine des citťs:
Ses prÍtres sont captifs, ses rois sont rejetťs;
Dieu ne veut plus qu'on vienne ŗ ses solennitťs.
Temple! renverse-toi; cŤdres! jetez des flammes.
Jťrusalem, objet de ma douleur,
Quelle main en un jour t'a ravi tous tes charmes?
Qui changera mes yeux en deux sources de larmes
Pour pleurer ton malheur?
AZARIAS.
‘ saint temple!
JOSABETH.
‘ David!
LE CHOEUR.
Dieu de Sion! rappelle,
Rappelle en sa faveur tes antiques bontťs.
(La symphonie recommence encore; et Joad, un moment aprŤs,
l'interrompt.)
JOAD.
Quelle Jťrusalem nouvelle
Sort du fond du dťsert, brillante de clartťs,
Et porte sur le front une marque immortelle?
Peuples de la terre, chantez.
Jťrusalem renaÓt plus charmante et plus belle!
D'oý lui viennent, de tous cŰtťs,
Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portťs?
LŤve, Jťrusalem, lŤve ta tÍte altiŤre;
Regarde tous ces rois de ta gloire ťtonnťs!
Les rois des nations, devant toi prosternťs,
De tes pieds baisent la poussiŤre;
Les peuples ŗ l'envi marchent ŗ ta lumiŤre.
Heureux qui pour Sion d'une sainte ferveur
Sentira son ‚me embrasťe!
Cieux, rťpandez votre rosťe,
Et que la terre enfante son Sauveur!
L'acte finit au milieu du chant des choeurs agitťs de terreur et
d'espťrance. L'inspiration d'en haut est restťe sur la scŤne avec
l'esprit et la voix de Talma.
XXI
La plus belle scŤne du quatriŤme acte est celle oý le grand-prÍtre,
avant de couronner Joas dans le temple, sonde l'esprit de l'enfant, et
lui enseigne, dans un langage bien hardi devant Louis XIV, les devoirs
des rois devant Dieu et devant leur peuple. Ici c'est l'esprit de vťritť
et de libertť qui soulŤve le poŽte et qui lui fait braver le despotisme
d'un prince ťgoÔste et impťrieux. Nous pensons que cette scŤne fut pour
davantage dans la rancune cachťe de Louis XIV et dans la mort de Racine
que son obscur Mťmoire sur quelques vices de l'administration, ťcrit par
lui pour complaire ŗ Mme de Maintenon.
Jugez-en!
‘ mon fils, de ce nom j'ose encor vous nommer,
Souffrez cette tendresse, et pardonnez aux larmes
Que m'arrachent pour vous de trop justes alarmes.
Loin du trŰne nourri, de ce fatal honneur,
Hťlas! vous ignorez le charme empoisonneur;
De l'absolu pouvoir vous ignorez l'ivresse,
Et des l‚ches flatteurs la voix enchanteresse.
BientŰt ils vous diront que les plus saintes lois,
MaÓtresses du vil peuple, obťissent aux rois;
Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volontť mÍme;
Qu'il doit immoler tout ŗ sa grandeur suprÍme;
Qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamnť,
Et d'un sceptre de fer veut Ítre gouvernť;
Que, s'il n'est opprimť, tŰt ou tard il opprime.
Ainsi, de piťge en piťge et d'abÓme en abÓme,
Corrompant de vos moeurs l'aimable puretť,
Ils vous feront enfin haÔr la vťritť,
Vous peindront la vertu sous une affreuse image.
Hťlas! ils ont des rois ťgarť le plus sage.
Promettez sur ce livre, et devant ces tťmoins,
Que Dieu fera toujours le premier de vos soins;
Que, sťvŤre aux mťchants, et des bons le refuge,
Entre le pauvre et vous vous prendrez Dieu pour juge,
Vous souvenant, mon fils, que, cachť sous ce lin,
Comme eux vous fŻtes pauvre et comme eux orphelin.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
AprŤs ces paroles il rťvŤle sa naissance ŗ l'enfant et le proclame roi
dans un sublime discours aux lťvites.
Le choeur se mÍle ŗ un transport des deux tribus.
UNE VOIX, _seule_.
Triste reste de nos rois,
ChŤre et derniŤre fleur d'une tige si belle,
Hťlas! sous le couteau d'une mŤre cruelle
Te verrons-nous tomber une seconde fois?
Prince aimable, dis-nous si quelque ange au berceau
Contre tes assassins prit soin de te dťfendre,
Ou si dans la nuit du tombeau
La voix du Dieu vivant a ranimť ta cendre?
Tout finit au milieu des larmes des femmes, des frissons des enfants,
des acclamations des lťvites. Le noeud se resserre, et Dieu seul peut le
dťnouer. L'intervention divine apparaÓt au cinquiŤme acte par un
miracle de zŤle dans Joad, de fidťlitť dans les tribus de Juda et de
Benjamin.
XXII
Au moment oý l'enfant, placť sur son trŰne, est saluť roi par
l'acclamation des lťvites, Athalie entre avec ses troupes, le rideau du
temple se dťchire; elle voit l'enfant, son successeur, couronnť.
JOAD.
Paraissez, cher enfant, digne sang de nos rois!
Connais-tu l'hťritier du plus saint des monarques,
Reine? De ton poignard connais du moins ces marques.
Voilŗ ton roi, ton fils, le fils d'Ochosias.
Peuples, et vous, Abner, reconnaissez Joas.
ABNER.
Ciel!
ATHALIE, ŗ Joas.
Perfide!
JOAD.
Vois-tu cette Juive fidŤle
Dont tu sais bien qu'alors il suÁait la mamelle?
Il fut par Josabeth ŗ ta rage enlevť;
Ce temple le reÁut et Dieu l'a conservť.
Des trťsors de David voilŗ ce qui me reste.
ATHALIE.
Ta fourbe ŗ cet enfant, traÓtre, sera funeste.
D'un fantŰme odieux, soldats, dťlivrez-moi!
JOAD.
Soldats du Dieu vivant, dťfendez votre roi.
(Le fond du thť‚tre s'ouvre: on voit le dedans du temple, et les
lťvites armťs entrent de tous cŰtťs sur la scŤne.)
ATHALIE.
Oý suis-je? ‘ trahison! Ű reine infortunťe!
D'armes et d'ennemis je suis environnťe!
JOAD.
Tes yeux cherchent en vain, tu ne peux ťchapper,
Et Dieu de toutes parts a su t'envelopper,
Ce Dieu que tu bravais en nos mains t'a livrťe:
Rends-lui compte du sang dont tu t'es enivrťe.
ATHALIE.
Quoi! la peur a glacť mes indignes soldats!
L‚che Abner, dans quel piťge as-tu conduit mes pas?
ABNER.
Reine, Dieu m'est tťmoin...
ATHALIE.
Laisse lŗ ton Dieu, traÓtre,
Et venge-moi.
ABNER, _se jetant aux pieds de Joas_.
Sur qui? Sur Joas! sur mon maÓtre!
C'en est fait ŗ ce mot; l'ťpťe d'Athalie s'est brisťe dans sa main.
Dieu des Juifs, tu l'emportes!
Elle exhale sa fureur impuissante en imprťcations et meurt derriŤre la
scŤne, sous le glaive des lťvites.
L'impitoyable grand-prÍtre s'adresse ŗ Joas, dont il va gouverner
l'enfance:
Apprenez, roi des Juifs, et n'oubliez jamais
Que les rois dans le ciel ont un juge sťvŤre,
L'innocent un vengeur et l'orphelin un pŤre.
Le rideau tombe, et Dieu reste prťsent dans sa toute-puissance, dans sa
providence, dans sa bontť, dans sa vengeance, ŗ l'‚me des spectateurs
ťdifiťs par le poŽte sacrť et transportťs d'un thť‚tre profane dans le
sanctuaire de la Divinitť. Les applaudissements succŤdent lentement au
silence transi du coeur et se partagent entre la Bible, Racine et le
grand interprŤte qui vient de leur prÍter sa voix.
AprŤs ce jour, Talma ne grandit plus. Il parut rester aussi grand, mais
stationnaire, comme un astre ŗ son apogťe.
La mort le cueillit avant son dťclin.
XXIII
Quant ŗ Racine, son sort fut celui de tous les hommes plus grands que
leur siŤcle par leur gťnie.
Croirait-on aujourd'hui que la faible idylle d'_Esther_ fut prťfťrťe ŗ
la plus auguste des tragťdies saintes, et qu'aprŤs une ou deux
reprťsentations ŗ Versailles, devant Louis XIV et sa cour, on la laissa
ensevelie pendant soixante ans dans l'oubli? Le poŽte qui avait
concentrť dans cette oeuvre toute sa foi dans sa religion, tout son zŤle
pour le roi, tout son gťnie dramatique et toutes ses splendeurs
lyriques, fut accablť par le dťdain de la cour, par les moqueries de la
critique, par l'indiffťrence du roi. Racine ne protesta pas; ŗ quoi
bon? Il renonÁa pour jamais aux vers, juste vengeance d'un temps assez
corrompu par le gťnie enflť des Espagnols, pour ne pas comprendre le
gťnie biblique! Le poŽte brisa sa plume.
Mais en cessant d'Ítre poŽte, il resta malheureusement courtisan.
Froidement reÁu par le roi, ŗ qui les leÁons du grand-prÍtre avaient
paru renfermer quelques allusions irrťvťrencieuses ŗ sa royale divinitť,
Racine s'attacha de plus en plus ŗ madame de Maintenon. Il voulait faire
de madame de Maintenon son bouclier contre deux soupÁons qui le
rendaient suspect ŗ Louis XIV: le soupÁon d'avoir introduit la satire
dans la parole de Dieu par le discours du grand-prÍtre dans _Athalie_,
et le soupÁon de dťvouement secret aux jansťnistes de Port-Royal, ce nid
d'hťrťsie. Les plus beaux chants n'ťtaient, aux yeux du roi, que des
sťductions ŗ l'erreur ou ŗ la libertť d'esprit.
Ce bouclier ťtait mal choisi dans le coeur de madame de Maintenon, qui
n'avait couvert ni Fťnelon, ni madame Guyon, ni aucun de ses amis, du
moment que son crťdit pouvait Ítre compromis par ses amitiťs. Elle avait
l'amitiť agrťable, mais pťrilleuse; tout ce qui s'y fiait ťtait, tŰt ou
tard, dťÁu; le roi lui-mÍme, sur son lit de mort, n'ťchappa pas ŗ cette
loi commune: dŤs qu'il fut dans un ťtat dťsespťrť, elle le quitta pour
Dieu.
XXIV
On a rťvoquť en doute la cause de la mort prťmaturťe de Racine et
l'ingratitude de madame de Maintenon. Son propre fils, le second Racine,
ne laisse aucun doute ŗ cet ťgard dans le rťcit qu'il fait des derniers
moments de son pŤre.
ęRacine ťtait dťjŗ abattu par le mauvais succŤs d'_Athalie_. Il aimait
la gloire prťsente, et il ne savait pas l'attendre. Sa sensibilitť, dit
son fils, abrťgea ses jours. Il ťtait d'ailleurs naturellement
mťlancolique, et s'entretenait plus longtemps des sujets capables de le
chagriner que des sujets propres ŗ le rťjouir. Il avait ce caractŤre que
se donne Cicťron dans une de ses lettres, plus portť ŗ craindre les
ťvťnements malheureux qu'ŗ espťrer d'heureux succŤs: _Semper magis
adversos rerum exitus metuens quam sperans secundos._ L'ťvťnement que
je vais rapporter le frappa trop vivement, et lui fit voir comme prťsent
un malheur qui ťtait fort ťloignť. Les marques d'attention de la part du
roi, dont il fut honorť pendant sa derniŤre maladie, durent bien le
convaincre qu'il avait toujours le bonheur de plaire ŗ ce prince. Il
s'ťtait cependant persuadť que tout ťtait changť pour lui, et n'eut,
pour le croire, d'autre sujet que ce qu'on va lire.
ęMadame de Maintenon, qui avait pour lui une estime particuliŤre, ne
pouvait le voir trop souvent, et se plaisait ŗ l'entendre parler de
diffťrentes matiŤres, parce qu'il ťtait propre ŗ parler de tout. Elle
l'entretenait un jour de la misŤre du peuple; il rťpondit qu'elle ťtait
une suite ordinaire des longues guerres, mais qu'elle pourrait Ítre
soulagťe par ceux qui ťtaient dans les premiŤres places si on avait soin
de la leur faire connaÓtre. Il s'anima sur cette rťflexion; et comme,
dans les sujets qui l'animaient, il entrait dans cet enthousiasme dont
j'ai parlť, qui lui inspirait une ťloquence agrťable, il charma madame
de Maintenon, qui lui dit que, puisqu'il faisait des observations si
justes sur-le-champ, il devait les mťditer encore, et les lui donner par
ťcrit, bien assurť que l'ťcrit ne sortirait pas de ses mains. Il
accepta malheureusement la proposition, non par une complaisance de
courtisan, mais parce qu'il conÁut l'espťrance d'Ítre utile au public.
Il remit ŗ madame de Maintenon un Mťmoire aussi solidement raisonnť que
bien ťcrit. Elle le lisait un jour, lorsque le roi, entrant chez elle,
le prit, et, aprŤs en avoir parcouru quelques lignes, lui demanda avec
vivacitť quel en ťtait l'auteur. Elle rťpondit qu'elle avait promis le
secret. Elle fit une rťsistance inutile; le roi expliqua sa volontť en
termes si prťcis qu'il fallut obťir. L'auteur fut nommť.
ęLe roi, en louant son zŤle, parut dťsapprouver qu'un homme de lettres
se mÍl‚t de choses qui ne le regardaient pas. Il ajouta mÍme, non sans
quelque air de mťcontentement: ęParce qu'il sait faire parfaitement des
vers, croit-il tout savoir? Et parce qu'il est grand poŽte, veut-il Ítre
ministre?Ľ Si le roi eŻt pu prťvoir l'impression que firent ces paroles,
il ne les eŻt point dites; mais il ne pouvait soupÁonner que ces paroles
tomberaient sur un coeur si sensible.
ęMadame de Maintenon, qui fit instruire l'auteur du Mťmoire de ce qui
s'ťtait passť, lui fit dire en mÍme temps de ne la pas venir voir
jusqu'ŗ nouvel ordre. Cette nouvelle le frappa vivement. Il craignit
d'avoir dťplu ŗ un prince dont il avait reÁu tant de marques de bontť.
Il ne s'occupa plus que d'idťes tristes, et, quelque temps aprŤs, il fut
attaquť d'une fiŤvre assez violente.
ęHťlas! Madame, ťcrivait-il ŗ celle qui l'avait provoquť, puis
abandonnť, je vous avoue que, quand je faisais chanter devant vous dans
Esther: _Roi, chassez la calomnie!_ je ne m'attendais pas ŗ Ítre attaquť
moi-mÍme par la calomnie dans ma fidťlitť ŗ Dieu et au roi. Ayez la
bontť de vous souvenir combien de fois vous m'avez dit que, la meilleure
qualitť que vous trouviez en moi, c'ťtait ma fidťlitť d'enfant pour tout
ce que l'…glise croit et ordonne, mÍme dans les plus petites choses!
J'ai fait par votre ordre plus de trois mille vers sur des sujets de
piťtť; vous est-il jamais revenu qu'on y ait trouvť un seul vers qui
sentÓt l'hťrťsie? Je ne vois aucun homme qui, soit moins suspect de la
moindre nouveautť!...Ľ
Tout fut vain; il expira d'une disgr‚ce mortelle ŗ un courtisan, d'une
amitiť trahie par une femme ingrate, d'un chef-d'oeuvre mťconnu par son
temps. Tous les temps sont coupables de pareils crimes envers la
postťritť. Avant d'Ítre glorifiť, il faut Ítre suppliciť: c'est la loi
des grands hommes.
XXV
Quant ŗ _Athalie_, c'est Racine tout entier. Il revivra ťternellement
dans cette oeuvre, qui place son auteur non-seulement au rang des
poŽtes, mais au rang des prophŤtes bibliques. Il n'y a point de
parallŤle, selon nous, possible entre _Athalie_ et aucun des drames
antiques ou modernes d'aucun thť‚tre profane. Sophocle, Euripide,
SťnŤque, GŲthe, Schiller, Shakspeare lui-mÍme, cŤdent ŗ jamais la
premiŤre place ŗ cette oeuvre. Pourquoi? C'est que leurs tragťdies ne
sont que des oeuvres d'art, et que celle de Racine est une inspiration
de foi. Ils sont des poŽtes profanes, mais Racine ici est un poŽte
sacrť.
Mais l'art y est aussi parfait que l'inspiration y est divine.
Comme conception, ce drame est simple comme l'histoire, grand comme
l'empire qu'on s'y dispute et que Dieu transporte d'une branche ŗ
l'autre de la maison de David pour que cette branche produise un jour un
fruit de salut pour son peuple,
ET QUE LA TERRE ENFANTE SON SAUVEUR,
selon l'expression de Racine.
Comme intťrÍt, le poŽte ne va pas chercher l'intťrÍt dans ces vaines
curiositťs surexcitťes par des aventures laborieusement combinťes et par
des pťripťties fantastiques; il le place tout entier dans ce que la
nature a fait de plus intťressant et de plus pathťtique pour le coeur
des mŤres, dans l'innocence, dans la candeur et dans les pťrils d'un
enfant suspendu entre le trŰne et la mort!
Il n'y a pas d'amour, dit-on: c'est vrai; mais qui peut douter que, si
la piŤce eŻt ťtť susceptible d'un amour profane, celui qui fit parler
PhŤdre et Bťrťnice n'eŻt su faire parler un amour hťbraÔque dans la
langue de Salomon?
La vertu de ce drame est de n'avoir pas d'amour; cette passion eŻt ťtť
dťplacťe dans le Temple; ce sont les grandes et saintes passions
divines qu'on veut y voir et y entendre. L'ombre visible de Jťhova eŻt
fait p‚lir toutes les autres. Un amour ici eŻt ťtť une petitesse et une
profanation. Mais comme les autres passions divines y parlent une langue
supťrieure aux langueurs de la passion des sens! La maternitť dans
Josabeth, le courage dans Abner, l'hťroÔsme dans le grand-prÍtre, la
haine dans Athalie, l'ambition dans Mathan, l'innocence et la foi dans
…liacin, la piťtť dans les choeurs, Dieu lui-mÍme enfin dans les
prophťties!... Quelle place resterait-il ŗ une passion secondaire au
milieu de ces passions surhumaines? que sont des soupirs devant ces
foudres?
Quant ŗ la langue, ce n'est plus du franÁais, ce n'est plus du grec, ce
n'est plus du latin comme dans ces autres piŤces profanes et classiques:
c'est de l'hťbreu transfigurť en un idiome qui ne fut jamais parlť
qu'entre Jťhova, ses prophŤtes et son peuple, parmi les ťclairs du
SinaÔ. Les mots fulgurent, les accents terrifient, les strophes
transportent, les vers respirent; les rimes elles-mÍmes, ces
consonnances pťnibles, laborieuses, ordinairement puťriles et cherchťes,
chantent et prient. Elles viennent s'appliquer sans effort,
d'elles-mÍmes, aux vers comme les ailes se collent ŗ la flŤche pour la
faire voler plus haut dans le ciel, pour les faire percer plus avant
l'oreille et dans le coeur. Il est impossible, en lisant _Athalie_, de
songer seulement ŗ la rime ou ŗ la versification. Le style n'est ni
prose, ni vers, ni rťcitatif, ni mťlodie: c'est de la pensťe fondue au
feu du sanctuaire d'un seul jet avec la forme; c'est le mťtal de
Corinthe de la langue moderne. Ce franÁais-lŗ n'est d'aucune origine et
n'aura aucune fin. Il date du ciel, et il est digne d'y Ítre parlť.
XXVI
On a affectť, dans ces derniŤres annťes, de subalterniser Racine et de
lui prťfťrer Shakspeare et ses imitateurs allemands et franÁais. Nous
vous parlerons bientŰt de Shakspeare, et nous en parlerons avec
l'ťtonnement sublime qu'on ťprouve ŗ l'aspect du gťant du drame moderne.
Il est la grandeur, mais Racine est la beautť. La masse, quelque
ťtonnante qu'elle soit, peut-elle jamais se comparer ŗ la perfection?
Shakspeare, selon nous, prend l'homme dans ses mains puissantes et lui
fait plonger ses regards dans les abÓmes tantŰt sublimes, tantŰt
vertigineux du coeur humain. Racine, lui, prend l'homme dans ses mains
sanctifiťes par sa piťtť et lui fait tourner ses regards vers les
profondeurs et les sťrťnitťs du firmament plein de la Divinitť. L'un
regarde en bas, l'autre en haut; mais en bas sont les tťnŤbres, en haut
la lumiŤre, fille et splendeur de l'…ternel.
Voilŗ la diffťrence entre ces deux hommes. L'un ťmeut et passionne,
l'autre ťdifie et divinise; l'un est terrible, l'autre est beau. Or,
souvenez-vous de la dťfinition que nous avons admise en commenÁant ces
Entretiens: LA PO…SIE EST L'…MOTION PAR LE BEAU.
Voilŗ ce qui nous distingue et ce qui distingue la France de ceux qui se
sont appelťs hier les _romantiques_, et qui s'appellent aujourd'hui les
_rťalistes_; deux hťrťsies pleines de talents ťgarťs, mais qui, en
rentrant dans la vťritť, feront faire de nouvelles conquÍtes ŗ la
religion du goŻt et des lettres. Ces hťrťsiarques ne veulent que
l'_ťmotion_, ils oublient que l'_ťmotion par le laid_ s'appelle tout
simplement l'horreur. Nous voulons, nous, de l'_ťmotion et du beau_.
Voilŗ pourquoi Shakspeare est leur idole, et pourquoi Racine est notre
orgueil.
Quand nous ne voudrons qu'Ítre ťmus, nous irons au pied d'un ťchafaud,
et nous regarderons tomber la tÍte d'un suppliciť sous le couteau qui
glisse et qui tue; mais quand nous voudrons de l'ťmotion par le beau,
nous irons assister ŗ _Athalie_, ťcrite par Racine, rťcitťe par Talma ou
par Mlle Rachel.
Ajoutons que dans _Athalie_ ce n'est pas seulement le beau qui ťmeut
l'esprit, c'est le divin qui pťnŤtre le coeur. Ainsi Racine, pour qui
_Athalie_ fut un acte de foi plus qu'une oeuvre d'art, n'est pas
seulement arrivť ŗ la beautť, ce ravissement de l'intelligence, mais ŗ
la saintetť, ce ravissement de l'‚me.
Glorifions-nous donc ŗ jamais d'Ítre d'une nation qui a produit Racine,
et de parler une langue oý l'on a pu ťcrire _Athalie_.
LAMARTINE.
XVe ENTRETIEN.
3e de la deuxiŤme Annťe.
…PISODE.
Dans les derniers jours de l'automne qui vient de finir j'allai assister
seul aux vendanges d'octobre, dans le petit village du M‚connais oý je
suis nť. Pendant que les bandes de joyeux vendangeurs se rťpondaient
d'une colline ŗ l'autre par ces cris de joie prolongťs qui sont les
actions de gr‚ce de l'homme au sillon qui le nourrit ou qui l'abreuve,
pendant que les sentiers rocailleux du village retentissaient sous le
gťmissement des roues qui rapportaient, au pas lent des boeufs couronnťs
de sarments en feuilles, les grappes rouges aux pressoirs, je me couchai
sur l'herbe, ŗ l'ombre de la maison de mon pŤre, en regardant les
fenÍtres fermťes, et je pensai aux jours d'autrefois.
Ce fut ainsi que ce chant me monta du coeur aux lŤvres, et que j'en
ťcrivis les strophes au crayon sur les marges d'un vieux _Pťtrarque
in-folio_, oý je les reprends pour les donner ici aux lecteurs.
LA VIGNE ET LA MAISON
PSALMODIES DE L'¬ME.
DIALOGUE ENTRE MON ¬ME ET MOI.
MOI.
Quel fardeau te pŤse, Ű mon ‚me!
Sur ce vieux lit des jours par l'ennui retournť?
Comme un fruit de douleurs qui pŤse aux flancs de femme
Impatient de naÓtre et pleurant d'Ítre nť?
La nuit tombe, Ű mon ‚me! un peu de veille encore!
Ce coucher d'un soleil est d'un autre l'aurore.
Vois comme avec tes sens s'ťcroule ta prison!
Vois comme aux premiers vents de la prťcoce automne
Sur les bords de l'ťtang oý le roseau frissonne,
S'envole brin ŗ brin le duvet du chardon!
Vois comme de mon front la couronne est fragile!
Vois comme cet oiseau dont le nid est la tuile
Nous suit pour emporter ŗ son frileux asile
Nos cheveux blancs pareils ŗ la toison que file
La vieille femme assise au seuil de sa maison!
Dans un lointain qui fuit ma jeunesse recule,
Ma sťve refroidie avec lenteur circule,
L'arbre quitte sa feuille et va nouer son fruit:
Ne presse pas ces jours qu'un autre doigt calcule,
Bťnis plutŰt ce Dieu qui place un crťpuscule
Entre les bruits du soir et la paix de la nuit!
Moi qui par des concerts saluai ta naissance,
Moi qui te rťveillai neuve ŗ cette existence
Avec des chants de fÍte et des chants d'espťrance,
Moi qui fis de ton coeur chanter chaque soupir,
Veux-tu que, remontant ma harpe qui sommeille,
Comme un David assis prŤs d'un SaŁl qui veille,
Je chante encor pour t'assoupir?
L'¬ME.
Non! Depuis qu'en ces lieux le temps m'oublia seule,
La terre m'apparaÓt vieille comme une aÔeule
Qui pleure ses enfants sous ses robes de deuil.
Je n'aime des longs jours que l'heure des tťnŤbres,
Je n'ťcoute des chants que ces strophes funŤbres,
Que sanglote le prÍtre en menant un cercueil.
MOI.
Pourtant le soir qui tombe a des langueurs sereines
Que la fin donne ŗ tout, aux bonheurs comme aux peines;
Le linceul mÍme est tiŤde au coeur enseveli:
On a vidť ses yeux de ses derniŤres larmes,
L'‚me ŗ son dťsespoir trouve de tristes charmes
Et des bonheurs perdus se sauve dans l'oubli.
Cette heure a pour nos sens des impressions douces
Comme des pas muets qui marchent sur des mousses:
C'est l'amŤre douceur du baiser des adieux.
De l'air plus transparent le cristal est limpide,
Des monts vaporisťs l'azur vague et liquide
S'y fond avec l'azur des cieux.
Je ne sais quel lointain y baigne toute chose,
Ainsi que le regard l'oreille s'y repose,
On entend dans l'ťther glisser le moindre vol;
C'est le pied de l'oiseau sur le rameau qui penche,
Ou la chute d'un fruit dťtachť de la branche
Qui tombe du poids sur le sol.
Aux premiŤres lueurs de l'aurore frileuse,
On voit flotter ces fils dont la vierge fileuse
D'arbre en arbre au verger a tissť le rťseau:
Blanche toison de l'air que la brume encor mouille,
Qui traÓne sur nos pas, comme de la quenouille
Un fil traÓne aprŤs le fuseau.
Aux prťcaires tiťdeurs de la trompeuse automne,
Dans l'oblique rayon le moucheron foisonne,
PrÍt ŗ mourir d'un souffle ŗ son premier frisson;
Et sur le seuil dťsert de la ruche engourdie,
Quelque abeille en retard qui sort et qui mendie,
Rentre lourde de miel dans sa chaude prison.
Viens, reconnais la place oý ta vie ťtait neuve,
N'as-tu point de douceur, dis-moi, pauvre ‚me veuve,
ņ remuer ici la cendre des jours morts?
ņ revoir ton arbuste et ta demeure vide,
Comme l'insecte ailť revoit sa chrysalide,
Balayure qui fut son corps?
Moi, le triste instinct m'y ramŤne:
Rien n'a changť lŗ que le temps;
Des lieux oý notre oeil se promŤne,
Rien n'a fui que les habitants.
Suis-moi du coeur pour voir encore,
Sur la pente douce au midi,
La vigne qui nous fit ťclore
Ramper sur le roc attiťdi.
Contemple la maison de pierre,
Dont nos pas usŤrent le seuil:
Vois-la se vÍtir de son lierre
Comme d'un vÍtement de deuil.
…coute le cri des vendanges
Qui monte du pressoir voisin,
Vois les sentiers rocheux des granges
Rougis par le sang du raisin.
Regarde au pied du toit qui croule:
Voilŗ, prŤs du figuier sťchť,
Le cep vivace qui s'enroule
ņ l'angle du mur ťbrťchť!
L'hiver noircit sa rude ťcorce;
Autour du banc rongť du ver,
Il contourne sa branche torse
Comme un serpent frappť du fer.
Autrefois, ses pampres sans nombre
S'entrelaÁaient autour du puits,
PŤre et mŤre goŻtaient son ombre,
Enfants, oiseaux, rongeaient ses fruits.
Il grimpait jusqu'ŗ la fenÍtre,
Il s'arrondissait en arceau;
Il semble encor nous reconnaÓtre
Comme un chien gardien d'un berceau.
Sur cette mousse des allťes
Oý rougit son pampre vermeil,
Un bouquet de feuilles gelťes
Nous abrite encor du soleil.
Vives glaneuses de novembre,
Les grives, sur la grappe en deuil,
Ont oubliť ces beaux grains d'ambre
Qu'enfant nous convoitions de l'oeil.
Le rayon du soir la transperce
Comme un alb‚tre oriental,
Et le sucre d'or qu'elle verse
Y pend en larmes de cristal.
Sous ce cep de vigne qui t'aime,
‘ mon ‚me! ne crois-tu pas
Te retrouver enfin toi-mÍme,
Malgrť l'absence et le trťpas?
N'a-t-il pas pour toi le dťlice
Du brasier tiŤde et rťchauffant
Qu'allume une vieille nourrice
Au foyer qui nous vit enfant?
Ou l'impression qui console
L'agneau tondu hors de saison,
Quand il sent sur sa laine folle
Repousser sa chaude toison!
L'¬ME.
Que me fait le coteau, le toit, la vigne aride?
Que me ferait le ciel, si le ciel ťtait vide?
Je ne vois en ces lieux que ceux qui n'y sont pas!
Pourquoi ramŤnes-tu mes regrets sur leur trace?
Des bonheurs disparus se rappeler la place,
C'est rouvrir des cercueils pour revoir des trťpas!
I
Le mur est gris, la tuile est rousse,
L'hiver a rongť le ciment;
Des pierres disjointes la mousse
Verdit l'humide fondement;
Les gouttiŤres que rien n'essuie,
Laissent en rigoles de suie,
S'ťgoutter le ciel pluvieux,
TraÁant sur la vide demeure
Ces noirs sillons par oý l'on pleure
Que les veuves ont sous les yeux;
La porte oý file l'araignťe
Qui n'entend plus le doux accueil,
Reste immobile et dťdaignťe
Et ne tourne plus sur son seuil;
Les volets que le moineau souille,
Dťtachťs de leurs gonds de rouille,
Battent nuit et jour le granit;
Les vitraux brisťs par les grÍles
Livrent aux vieilles hirondelles
Un libre passage ŗ leur nid!
Leur gazouillement sur les dalles
Couvertes de duvets flottants
Est la seule voix de ces salles
Pleines des silences du temps.
De la solitaire demeure
Une ombre lourde d'heure en heure
Se dťtache sur le gazon:
Et cette ombre, couchťe et morte,
Est la seule chose qui sorte
Tout le jour de cette maison!
II
Efface ce sťjour, Ű Dieu! de ma paupiŤre,
Ou rends-le-moi semblable ŗ celui d'autrefois,
Quand la maison vibrait comme un grand coeur de pierre
De tous ces coeurs joyeux qui battaient sous ses toits!
ņ l'heure oý la rosťe au soleil s'ťvapore
Tous ces volets fermťs s'ouvraient ŗ sa chaleur,
Pour y laisser entrer, avec la tiŤde aurore,
Les nocturnes parfums de nos vignes en fleur.
On eŻt dit que ces murs respiraient comme un Ítre
Des pampres rťjouis la jeune exhalaison;
La vie apparaissait rose, ŗ chaque fenÍtre,
Sous les beaux traits d'enfants nichťs dans la maison.
Leurs blonds cheveux, ťpars au vent de la montagne,
Les filles se passant leurs deux mains sur les yeux,
Jetaient des cris de joie ŗ l'ťcho des montagnes,
Ou sur leurs seins naissants croisaient leurs doigts pieux.
La mŤre, de sa couche ŗ ces doux bruits levťe,
Sur ces fronts inťgaux se penchait tour ŗ tour,
Comme la poule heureuse assemble sa couvťe,
Leur apprenant les mots qui bťnissent le jour.
Moins de balbutiements sortent du nid sonore,
Quand, aux rayons d'ťtť qui vient la rťveiller
L'hirondelle au plafond qui les abrite encore,
ņ ses petits sans plume apprend ŗ gazouiller.
Et les bruits du foyer que l'aube fait renaÓtre,
Les pas des serviteurs sur les degrťs de bois,
Les aboiements du chien qui voit sortir son maÓtre,
Le mendiant plaintif qui fait pleurer sa voix.
Montaient avec le jour; et, dans les intervalles,
Sous des doigts de quinze ans rťpťtant leur leÁon,
Les claviers rťsonnaient ainsi que des cigales
Qui font tinter l'oreille au temps de la moisson!
III
Puis ces bruits d'annťe en annťe
BaissŤrent d'une vie, hťlas! et d'une voix.
Une fenÍtre en deuil, ŗ l'ombre condamnťe,
Se ferma sous le bord des toits.
Printemps aprŤs printemps de belles fiancťes
Suivirent de chers ravisseurs,
Et, par la mŤre en pleurs sur le seuil embrassťes,
Partirent en baisant leurs soeurs.
Puis sortit un matin pour le champ oý l'on pleure
Le cercueil tardif de l'aÔeul,
Puis un autre, et puis deux, et puis dans la demeure
Un vieillard morne resta seul!
Puis la maison glissa sur la pente rapide
Oý le temps entasse les jours;
Puis la porte ŗ jamais se ferma sur le vide,
Et l'ortie envahit les cours!...
IV
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
‘ famille! Ű mystŤre! Ű coeur de la nature!
Oý l'amour dilatť dans toute crťature
Se resserre en foyer pour couver des berceaux,
Goutte de sang puisťe ŗ l'artŤre du monde
Qui court de coeur en coeur toujours chaude et fťconde,
Et qui se ramifie en ťternels ruisseaux!
Chaleur du sein de mŤre oý Dieu nous fit ťclore,
Qui du duvet natal nous enveloppe encore
Quand le vent d'hiver siffle ŗ la place des lits,
ArriŤre-goŻt du lait dont la femme nous sŤvre,
Qui mÍme en tarissant nous embaume la lŤvre,
…treinte de deux bras par l'amour amollis!
Premier rayon du ciel vu dans des yeux de femmes,
Premier foyer d'une ‚me oý s'allument nos ‚mes,
Premiers bruits de baisers au coeur retentissants!
Adieux, retours, dťparts pour de lointaines rives,
Mťmoire qui revient pendant les nuits pensives
ņ ce foyer des coeurs, univers des absents!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Ah! que tout fils dise anathŤme
ņ l'insensť qui vous blasphŤme!
RÍveur du groupe universel,
Qu'il embrasse, au lieu de sa mŤre,
Sa froide et stoÔque chimŤre
Qui n'a ni coeur, ni lait, ni sel!
Du foyer proscrit volontaire,
Qu'il cherche en vain sur cette terre
Un pŤre au visage attendri;
Que tout foyer lui soit de glace,
Et qu'il change ŗ jamais de place
Sans qu'aucun lieu lui jette un cri!
Envieux du champ de famille,
Que, pareil au frelon qui pille
L'humble ruche adossťe au mur,
Il maudisse la loi divine
Qui donne un sol ŗ la racine
Pour multiplier le fruit mŻr!
Que sur l'herbe des cimetiŤres
Il foule, indiffťrent, les pierres
Sans savoir laquelle prier!
Qu'il rťponde au nom qui le nomme
Sans savoir s'il est nť d'un homme
Ou s'il est fils d'un meurtrier!...
V
Dieu! qui rťvŤle aux coeurs mieux qu'ŗ l'intelligence!
Resserre autour de nous, faits de joie et de pleurs,
Ces groupes rťtrťcis oý de ta providence
Dans la chaleur du sang nous sentons les chaleurs;
Oý, sous la porte bien close,
La jeune nichťe ťclose
Des saintetťs de l'amour,
Passe du lait de la mŤre
Au pain savoureux qu'un pŤre
Pťtrit des sueurs du jour;
Oý ces beaux fronts de famille,
Penchťs sur l'‚tre et l'aiguille,
Prolongent leurs soirs pieux:
‘ soirs! Ű douces veillťes
Dont les images mouillťes
Flottent dans l'eau de nos yeux!
Oui, je vous revois tous, et toutes, ‚mes mortes!
‘ chers essaims groupťs aux fenÍtres, aux portes!
Les bras tendus vers vous, je crois vous ressaisir,
Comme on croit dans les eaux embrasser des visages
Dont le miroir trompeur rťflťchit les images,
Mais glace le baiser aux lŤvres du dťsir.
Toi qui fis la mťmoire, est-ce pour qu'on oublie?...
Non, c'est pour rendre au temps ŗ la fin tous ses jours,
Pour faire confluer, lŗ-bas, en un seul cours
Le passť, l'avenir, ces deux moitiťs de vie
Dont l'une dit jamais et l'autre dit toujours.
Ce passť, doux …den dont notre ‚me est sortie,
De notre ťternitť ne fait-il pas partie?
Oý le temps a cessť tout n'est-il pas prťsent?
Dans l'immuable sein qui contiendra nos ‚mes
Ne rejoindrons-nous pas tout ce que nous aim‚mes
Au foyer qui n'a plus d'absent?
Toi qui formas ces nids rembourrťs de tendresses
Oý la nichťe humaine est chaude de caresses,
Est-ce pour en faire un cercueil?
N'as-tu pas dans un pan de tes globes sans nombre
Une pente au soleil, une vallťe ŗ l'ombre
Pour y reb‚tir ce doux seuil?
Non plus grand, non plus beau, mais pareil, mais le mÍme,
Oý l'instinct serre un coeur contre les coeurs qu'il aime,
Oý le chaume et la tuile abritent tout l'essaim,
Oý le pŤre gouverne, oý la mŤre aime et prie,
Oý dans ses petits-fils l'aÔeule est rťjouie
De voir multiplier son sein!
Toi qui permets, Ű pŤre! aux pauvres hirondelles
De fuir sous d'autres cieux la saison des frimas,
N'as-tu donc pas aussi pour tes petits sans ailes
D'autres toits prťparťs dans tes divins climats?
‘ douce Providence! Ű mŤre de famille
Dont l'immense foyer de tant d'enfants fourmille,
Et qui les vois pleurer souriante au milieu,
Souviens-toi, coeur du ciel, que la terre est ta fille
Et que l'homme est parent de Dieu!
MOI.
Pendant que l'‚me oubliait l'heure
Si courte dans cette saison,
L'ombre de la chŤre demeure
S'allongeait sur le froid gazon;
Mais de cette ombre sur la mousse
L'impression funŤbre et douce
Me consolait d'y pleurer seul,
Il me semblait qu'une main d'ange
De mon berceau prenait un lange
Pour m'en faire un sacrť linceul!
FIN.
Ne voulant pas mÍler ŗ cet entretien tout familier et tout poťtique un
autre sujet littťraire, j'insŤre en note, ŗ la suite de ces vers, un
morceau en prose ťcrit en 1848, ŗ peu prŤs sous les mÍmes impressions,
et qui n'a jamais ťtť imprimť dans mes oeuvres gťnťrales.
LE P»RE DUTEMPS
LETTRE ņ M. D'ESGRIGNY.
Saint-Point, novembre 1848.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Vous savez que je suis venu dans le pays de ma naissance, il y a
quelques semaines, pour rťtablir ma santť, atteinte jusqu'ŗ la sťve, et
pour respirer le vieil air toujours jeune des coteaux oý nous avons
respirť notre premiŤre haleine, comme on renvoie ŗ sa nourrice, bien
qu'elle n'ait plus le mÍme lait, l'enfant maladif que le rťgime des
villes a ťnervť. Vous savez que j'y suis venu aussi, et surtout, pour de
pťnibles dťracinements domestiques de terres, de maisons paternelles, de
sťjours, d'affections, d'habitudes, comme on va une derniŤre fois dans
la demeure vťnťrťe de ses pŤres, pour la dťmeubler avant de secouer la
poussiŤre de ses pieds sur le seuil chťri, et de lui dire un pieux
adieu. Je suis sous ma tente, en un mot, pour enlever ma tente, pour la
replier, et pour aller la replanter, dťchirťe et rťtrťcie, je ne sais
oý. C'est ŗ cela que je suis occupť pendant le court loisir que m'ont
donnť par force la nature et les affaires politiques, d'accord pour me
congťdier de Paris. Je passe ce congť au centre de mes occupations de
vendeur de terre, et ŗ proximitť des hommes de loi, des hommes de banque
et des hommes de trafic rural, auprŤs de la petite ville de M‚con. Je
commence ŗ reprendre des forces dans les membres, pas encore assez dans
le coeur: cependant vous connaissez ce coeur; il est ťlastique, il
flťchit, il ne rompt pas. ęLe coeur est un muscle,Ľ disent les
physiologistes. Quel muscle! leur dirai-je ŗ mon tour: c'est lui qui
porte la destinťe!
Ce matin, je me sentais mieux; j'avais ŗ faire un voyage obligť ŗ
quelques lieues de ma demeure temporaire, une course dans cette vallťe
reculťe de _Saint-Point_, dont vous connaissez la route. Quelques-uns de
mes vers ont emportť ce nom sur leurs ailes, comme les colombes qui
portent sur leur collier, au delŗ des bois, le nom ou le chiffre des
enfants qui les ont apprivoisťes.
Je dis au vieux jardinier de rappeler ma jument noire, qui paissait en
libertť dans un verger voisin, et de la seller pour moi. La jument
privťe, depuis longtemps oisive, voyant la selle que le jardinier
portait sur sa tÍte, secoua sa criniŤre, enfla ses naseaux, tendit le
nerf de sa queue en panache, galopa un moment autour du verger, en
faisant partir les alouettes et jaillir la rosťe de l'herbe sous ses
sabots; puis, s'approchant joyeusement de la barriŤre, elle tendit
d'elle-mÍme ses beaux flancs luisants ŗ la selle, et ouvrit sa petite
bouche au mors, comme si elle eŻt ťtť aussi impatiente de me porter que
j'ťtais impatient de la remonter moi-mÍme. Nul ne sait, ŗ moins d'avoir
ťtť bouvier, pasteur, soldat, chasseur ou solitaire comme moi, combien
il y a d'amitiť entre les animaux et leur maÓtre. Ce monde est un ocťan
de sympathies dont nous ne buvons qu'une goutte, quand nous pourrions en
absorber des torrents. Depuis le cheval et le chien jusqu'ŗ l'oiseau, et
depuis l'oiseau jusqu'ŗ l'insecte, nous nťgligeons des milliers d'amis.
Vous savez que moi je ne nťglige pas ces amitiťs, et que de la loge du
dogue de basse-cour ŗ l'ťtable du chevrier, et de l'ťtable au mur du
jardin oý je m'assieds au soleil, connu des souris d'espalier, des
belettes au museau flaireur, des rainettes ŗ la voix d'argent, ces
clochettes du troupeau souterrain, et des lťzards, ces curieux aux
fenÍtres qui sortent la tÍte de toutes les fentes, j'ai des relations et
des sentiments partout. Honni soit qui mal y pense! je suis comme le
vicaire de Goldsmith, j'aime ŗ aimer!
Je partis seul, suivi de mes trois chiens. Je franchis rapidement la
plaine dťjŗ ondulťe qui sťpare les bords de la SaŰne de la chaÓne des
hautes montagnes noires derriŤre lesquelles se creuse la vallťe de
_Saint-Point_.
Quand j'arrivai au pied de ces montagnes, je mis la jument au petit pas.
La journťe ťtait une journťe d'automne, indťcise, comme la saison, entre
la mťlancolie et la splendeur, entre la brume et le soleil. Quelques
brouillards sortaient, comme des fumťes d'un feu de bŻcherons, des
gorges hautes entre les troncs des sapins; ils flottaient un moment sur
les prťs en pente au bord des bois; puis, aussitŰt roulťs par le vent en
ballots lťgers de vapeurs, ils s'enlevaient, m'enveloppaient un moment
d'une draperie transparente, et s'ťvaporaient en montant toujours, et en
laissant quelques gouttes d'eau sur les crins de mon cheval. Mais,
au-dessus des premiŤres rampes, toute lutte entre la brume du matin et
l'ťclat du midi cessa. Le soleil avait bu toute l'humiditť de la terre;
les cimes nageaient dans l'ťtť. Un vent du midi tiŤde, sonore,
mťditerranťen, prťlude voluptueux d'ťquinoxe, soufflait de la vallťe du
RhŰne, avec les murmures et les soubresauts alternatifs des lames bleues
de la mer de Syrie, qui viennent de minute en minute heurter et laver
d'ťcume les pieds du Liban. Je savais que ce vent venait en effet de lŗ;
il n'y avait que quelques heures qu'il avait soufflť dans les cŤdres et
gťmi dans les palmiers; il me semblait entendre encore, et presque sans
illusion d'oreille, dans ses rafales chaudes, les palpitations de la
voile des grands m‚ts, le tangage des navires sur les hautes vagues, le
bouillonnement de l'ťcume retombant de la proue, comme de l'eau qui
frťmit sur un fer chaud, quand la proue se relŤve du flot, les
sifflements aigus quand on double un cap, les clapotements du bord, et
les coups sourds et creux de la quille des chaloupes, quand le pÍcheur
les amarre contre les ťcueils de Sidon.
Un petit hameau, tout semblable ŗ un village aride et pyramidal
d'Espagne ou de Calabre, s'ťchelonnait au-dessus de moi avec ses toits
ťtagťs en gradins de tuiles rouges, et avec son clocher de pierre grise,
bronzťe du soleil. Sa cloche, dont on voyait le branle et la gueule ŗ
travers les ogives de la tour, et dont on entendait rugir et grincer le
mťcanisme de poutres et de solives, sonnait l'_Angelus_ du milieu du
jour, et l'heure du repas aux paysans dans le champ et aux bergers dans
la montagne. Des fumťes de sarments sortaient de deux ou trois
cheminťes, et fuyaient chassťes sous le vent comme des volťes de pigeons
bleus. Ce village ťtait le mien, le foyer de mon pŤre aprŤs les orages
de la premiŤre rťvolution, le berceau de nous tous, les enfants de ce
nid maintenant dťsert.
Je passai devant la porte de ma cour sans y entrer; je suivis, sans
lever la tÍte, le pied du mur noir et bossuť de pierres sŤches qui borde
le chemin et qui enclot le jardin; je n'osai pas m'arrÍter mÍme ŗ
l'ombre de sept ŗ huit platanes et de la tonnelle de charmille qui
penchent leurs feuilles jaunes sur le chemin. J'entendais les voix dans
l'enclos: je savais que c'ťtaient les voix d'ťtrangers venus de loin
pour acheter le domaine, qui arpentaient les allťes encore empreintes de
nos pas, qui sondaient les murs encore chauds de nos tendresses de
famille, et qui apprťciaient les arbres, nos contemporains et nos amis,
dont l'ombre et les fruits allaient dťsormais verdir et mŻrir pour
d'autres que pour nous!...
Je baissai le front pour ne pas Ítre aperÁu par-dessus le mur, et je
gravis sans me retourner la montagne de bruyŤres et de buis qui domine
ce village. Je tournai un cap de roche grise oý se plaisent les aigles,
oý se brise toujours le vent, mÍme en temps calme; il me cacha la
maison, et je m'enfonÁai dans d'autres gorges oý le son mÍme de sa
cloche ne venait plus me frapper au coeur.
AprŤs avoir marchť ou plutŰt gravi environ une heure dans les ravins de
sable rouge, ŗ travers des bruyŤres et sous les racines d'immenses
ch‚taigniers qui s'entrelacent comme des serpents endormis au soleil,
j'arrivai au faÓte de la chaÓne de ces montagnes. Il y a lŗ, au point
ťtroit et culminant de ce col ou de ce pertuis, comme on dit dans le
Valais et dans les Pyrťnťes, une arÍte de quelques pas d'ťtendue. On ne
monte plus et l'on ne descend pas encore; on plonge ŗ son grť ses
regards, selon qu'on se retourne au levant ou au couchant, sur l'immense
plaine du M‚connais, de la Bresse et de la SaŰne, ou sur les noires et
profondes vallťes de _Saint-Point_, sur les cimes entre-croisťes, les
pentes ardues et les dťfilťs rocheux, arides ou boisťs, qui
s'amoncellent ou glissent vers le creux du pays.
Toutes les fois qu'il est arrivť ŗ ce sommet, le passant, essoufflť,
fait une courte halte, et ne peut retenir un cri d'admiration. L'‚ne, le
mulet et le cheval eux-mÍmes connaissent ce panorama de Dieu. Ils y
ralentissent le pas sans qu'on retire la bride, et baissent la tÍte pour
flairer la vallťe, et pour brouter quelques touffes d'herbe brŻlťe par
le vent sur le bord du ravin.
Ma jument se souvint de la place et de la halte: elle me laissa un
moment regarder en arriŤre. Il y aurait de quoi regarder tout le jour.
Les cŰnes aigus des montagnes pelťes du M‚connais et du Beaujolais,
groupťs ŗ droite et ŗ gauche comme des vagues de pierre sous un coup de
vent du chaos; sur leurs flancs, de nombreux villages; ŗ leurs pieds,
une immense plaine de prairies semťes d'innombrables troupeaux de vaches
blanches, et traversťes par une large ligne aussi bleue que le ciel, lit
serpentant de la SaŰne, sur lequel flotte, de distance en distance, la
fumťe des navires ŗ vapeur; au delŗ, une terre fertile, la Bresse,
semblable ŗ une large forÍt; plus loin, un premier cadre rťgulier de
montagnes grises, muraille du Jura qui cache le lac Lťman; enfin,
derriŤre ce contre-fort des montagnes du Jura, qui ressemblent d'ici au
premier degrť d'un escalier dressť contre le ciel, toute la chaÓne des
Alpes depuis Nice jusqu'ŗ B‚le, et au milieu le dŰme blanc et rose du
mont Blanc, cathťdrale sublime au toit de neige qui semble rougir et se
fondre dans l'ťther, et devenir transparente comme du sable vitrifiť
sous le foyer du soleil, pour laisser entrevoir, ŗ travers ses flancs
diaphanes, les plaines, les villes, les fleuves, les mers et les Óles
d'Italie.
AprŤs avoir effleurť et touchť cela d'un long coup d'oeil, envoyť du
coeur une pensťe, un souvenir, une adoration ŗ chaque lieu et ŗ chaque
pan de ce firmament, je descendis par un sentier rapide et sombre, bordť
d'un cŰtť de forÍts, de l'autre de prťs ruisselants de sources, le
revers de la chaÓne que je venais de franchir. On n'a pendant longtemps
devant les yeux d'autre horizon que des croupes de montagnes confuses,
noires de sapins, ici ťbrťchťes, lŗ amoindries et comme usťes par le
frŰlement des vents et des pluies. Ce sont les montagnes du Charolais,
qui sťparent l'Auvergne des Alpes. Ces collines, par leur engencement,
leur ťtagement, la mobilitť des ombres qu'elles se renvoient les unes
les autres sur leurs flancs, du jour qu'elles se reflŤtent, par leur
transparence au sommet, et les couches d'or que les rayons glissants du
soleil y mÍlent ŗ la fleur dťjŗ dorťe des genÍts, m'ont toujours rappelť
les montagnes de la _Sabine_ prŤs de Rome, qu'aimait tant _Horace_;
depuis que j'ai vu la GrŤce, elles me reprťsentent davantage les cimes
rondes et ŗ grandes ťchancrures des montagnes de la _Laconie_ et de
l'_Arcadie_. Quelquefois je m'arrÍte pour ťcouter si les vagues de la
mer d'Argos ne bruissent pas ŗ leurs pieds.
ņ mesure que je descendais, la petite vallťe dont je suivais le lit se
creusait plus profondťment devant moi, se cachait sous plus de hÍtres et
de ch‚taigniers, murmurait de plus de ruisseaux dans ses ravines, et,
s'ouvrant davantage sur ses deux flancs, me laissait dťjŗ apercevoir une
plus large ťtendue et une plus creuse profondeur de la vallťe de
_Saint-Point_, dans laquelle elle vient aboutir. ņ l'endroit oý ce ravin
s'ouvre enfin tout ŗ fait, et oý on le quitte pour descendre en
serpentant les flancs de la vallťe principale, il y a un tournant du
chemin qui serre le coeur, et qui fait toujours jeter un cri de joie ou
d'admiration. ņ la droite, on compte neuf ou dix ch‚taigniers aussi
vieux et aussi vťnťrťs que ceux de Sicile; ils rampent, plutŰt qu'ils ne
se dressent, sur une pente de mousse et de gazon tellement rapide, que
leurs feuilles et leurs fruits, en tombant, roulent loin de leurs
racines au moindre vent jusqu'au fond d'un torrent. On ne voit pas ce
torrent; on l'entend seulement ŗ cinq ou six cents pas sous leur nuit de
verdure. ņ la gauche, on descend du regard, de chalets en chalets et de
bocage en chaume, jusqu'au fond d'une vallťe un peu sinueuse, au milieu
de laquelle on aperÁoit sur un mamelon entourť de prťs, voilťes
d'ombres, adossťes ŗ des bois, isolťes des villages, baignťes d'un
ruisseau, deux tours jaun‚tres, dorťes du soleil: c'est mon toit.
Il y a entre l'homme et les murs qu'il a longtemps habitťs mille
secrŤtes intimitťs ŗ se dire, qui ne permettent jamais de se revoir,
aprŤs de longues absences, sans qu'une conversation qui semble
vťritablement animťe et rťciproque ne s'ťtablisse aussitŰt entre eux.
Les murs semblent reconnaÓtre et appeler l'homme, comme l'homme
reconnaÓt et embrasse les murs. Les anciens avaient senti et exprimť ce
mystŤre. Ils disaient: _genius loci, l'‚me du lieu_; ils avaient les
_dieux lares_, la divinitť du foyer. Cette divinitť s'est rťfugiťe
aujourd'hui dans le coeur; mais elle y est, elle y parle, elle y pleure,
elle y chante, elle s'y rťjouit, elle s'y plaint, elle s'y console. Je
ne l'ai jamais mieux entendue et sentie que ce matin.
Cette divinitť du foyer, les animaux eux-mÍmes l'entendent et la
sentent; car au moment oý ma jument aperÁut, quoique de si haut et de si
loin, les tours du ch‚teau et les grands prťs ŗ droite, oý elle avait
galopť et p‚turť tant de fois dans sa jeunesse, un frisson courut en
petits plis de soie sur son encolure; elle tourna ses naseaux ŗ droite
et ŗ gauche en flairant le vent, elle rongea du pied le rocher de granit
sur lequel je l'avais arrÍtťe, elle hennit ŗ ses souvenirs d'enfance,
et, lanÁant deux ou trois ruades de gaietť ŗ mes chiens sans les
atteindre, elle bondit sous moi, en essayant de me forcer la main pour
s'ťlancer vers ses chŤres images.
Je descendis; je l'attachai par la bride l‚che ŗ une branche pliante de
houx couverte de ses graines de pourpre, pour qu'elle pŻt brouter ŗ
l'aise au pied du buisson, et je m'assis un moment sur la racine du
ch‚taignier, le visage tournť vers ma demeure vide.
Le vent du midi avait redoublť d'haleine ŗ mesure que le soleil ťtait
montť sous le ciel; il avait pris les bouffťes et les rafales d'une
tempÍte sŤche; depuis que le soleil avait commencť ŗ redescendre vers le
couchant, il avait balayť comme un cristal le firmament; il faisait
rendre aux bois, aux rochers, et mÍme aux herbes, des harmonies qui
semblaient mÍlťes de notes joyeuses et de notes tristes, d'embrassements
et d'adieux, de terreur et d'enthousiasme; il amoncelait en tourbillons
les feuilles mortes, et puis il les laissait retomber et dormir en
monceaux miroitants au soleil: ce vent avait dans les haleines des
caresses, des tiťdeurs, des sentiments, des mťlancolies et des parfums
qui dilataient la poitrine, qui enivraient les oreilles, qui faisaient
boire par tous les pores la force, la vie, la jeunesse d'un
incorruptible ťlťment. On eŻt dit qu'il sortait du ciel, de la terre,
des bois, des plantes, des fenÍtres de la maison visible lŗ-bas, du
foyer d'enfance, des lŤvres de mes soeurs, de la m‚le poitrine de mon
pŤre, du coeur encore chaud de ma mŤre, pour m'accueillir ŗ ce retour,
et pour me toucher des lŤvres sur la joue et au front. Il faisait battre
les mŤches humides de mes cheveux sur mes tempes, sous le rebord de mon
chapeau, avec des frissons aussi dťlicieux qu'il avait jamais fouettť
mes boucles blondes dans ces mÍmes prťs sur mes joues de seize ans! Je
l'aspirais comme des lŤvres qui se collent ŗ l'embouchure d'une fontaine
d'eau pure; je lui tendais mes deux mains ouvertes, mes doigts ťlargis,
comme un mendiant qu'on a fait entrer au foyer d'hiver, et qui prend,
comme on dit ici, un _air de feu_. J'ouvrais ma veste et ma chemise sur
ma poitrine, pour qu'il pťnťtr‚t jusqu'ŗ mon sang.
Mais cette premiŤre impression toute sensuelle ťpuisťe, je glissai bien
vite dans les impressions plus intimes et plus pťnťtrantes de la mťmoire
et du coeur; elles me poignirent, et je ne pus les supporter ŗ visage
dťcouvert, bien qu'il n'y eŻt lŗ, et bien loin tout alentour, que mes
chiens, ma jument, les arbres, les herbes, le ciel, le soleil et le
vent: c'ťtait trop encore pour que je leur dťvoilasse sans ombre
l'abÓme de pensťes, de mťmoires, d'images, de dťlices et de mťlancolie,
de vie et de mort dans lequel la vue de cette vallťe et de cette demeure
submergeait mon front. Je cachais mon visage dans mes deux mains; je
regardais furtivement entre mes doigts les tours, le balcon, le jardin,
le verger, la fumťe sur le toit, les bois derriŤre bordťs de chaumiŤres
connues, la prairie, la riviŤre, les saules sur le bord de l'ťtang; et,
recevant de chacun de ces objets un souvenir, une image, un son de voix,
une personne, une voix ŗ l'oreille, une vision dans les yeux, un coup au
coeur, je fondis en eau, et je m'abÓmai dans l'impossible passion de ce
qui n'est plus!...
Vouloir ressusciter le passť, ce n'est pas d'un homme, c'est d'un Dieu;
l'homme ne peut que le revoir et le pleurer. Les imaginations puissantes
sont les plus malheureuses, parce qu'elles ont la facultť de recevoir,
sans avoir le don de ranimer. Le gťnie n'est qu'un plus grand deuil.
Je jetai enfin, comme l'‚me fait toujours quand elle est trop chargťe,
mon fardeau dans le sein de Dieu; il reÁoit tout, il porte tout, et il
rend tout. Je me mis ŗ genoux dans l'herbe, le visage tournť vers cette
vallťe principale de ma vie, non ma vallťe de larmes, mais ma vallťe de
paix. Je priai longtemps, je crois, si j'en juge par l'innombrable revue
de choses, de jours, d'heures douces ou amŤres, de visions apparues,
embrassťes et perdues qui passŤrent devant mon esprit. Le soleil avait
baissť sans que je m'en aperÁusse pendant cette halte dans mes
souvenirs: il touchait presque aux petites tÍtes du bois de sapins que
vous connaissez, et qui dentellent le ciel au sommet de la montagne, en
face de moi, en se dťcoupant sur le bleu du ciel comme les m‚ts d'une
flotte ŗ l'ancre dans un golfe d'eau limpide de la mer d'Ionie.
Je fus rťveillť comme en sursaut de ma contemplation par le galop d'un
cheval, par le braiment d'un ‚ne et par les cris d'un homme effrayť.
Tout ce bruit et tout ce mouvement s'entendaient ŗ quelques pas de moi,
derriŤre le buisson qui sťparait le sentier battu de la montagne, du
petit tertre de mousse enclos de pierres sŤches oý j'ťtais venu chercher
le dossier du vieux ch‚taignier. Je m'ťlanÁai, je franchis le mur, et je
me retrouvai dans le sentier; mais je n'y retrouvai plus ma jument: elle
avait ťtť effrayťe par les pierres qu'un ‚ne paissant au-dessus du
sentier, sur une pente de bruyŤre granitique, avait fait rouler sous ses
pieds. Elle avait rompu d'une saccade de tÍte les tiges de houx
auxquelles j'avais enroulť la bride; elle galopait, allant et revenant
sur elle-mÍme dans le chemin creux, arrÍtťe par les cris et par les
gestes ťpouvantťs d'un vieillard qui levait et agitait comme ŗ t‚tons,
d'une main tremblante, un grand b‚ton dont il semblait se couvrir contre
le danger.
J'appelai _Saphir_, c'est le nom de la jument; elle se calma ŗ ma voix,
et revint ťcumer sur mes mains et me remettre les rÍnes. Je criai au
vieillard de se rassurer, et je me rapprochai de lui, la bride sous le
bras.
Dans ce pauvre homme je venais de reconnaÓtre un des plus vieux
_coquetiers_ de ces montagnes, qui louait ŗ notre mŤre des ‚nesses au
printemps pour donner leur lait ŗ ses pauvres femmes malades, qui lui
servait de guide, d'ťcuyer pour promener ses enfants avec elle sur ces
solitudes ťlevťes, oý elle voyait la nature de plus haut, et oý elle
adorait Dieu de plus prŤs.
On appelle ici _coquetier_ un homme qui va de chaumiŤre en chaumiŤre et
de verger en verger acheter des oeufs, des prunes, des pommes, des
petites poires sauvages, des ch‚taignes; qui en remplit les paniers de
ses ‚nes, et qui va les revendre avec un petit bťnťfice aux portes des
ťglises, aprŤs vÍpres, dans les villages voisins.
Ce coquetier des montagnes ťtait dťjŗ vieux et cassť dans mon enfance.
Je le croyais couchť depuis longues annťes sous une de ces pierres de
granit couvertes de mousse, qui parsemaient comme des tombes son petit
champ d'orge et de folle avoine autour de son haut chalet. Il avait dŤs
ce temps-lŗ les yeux chassieux; ma mŤre lui donnait, pour fortifier sa
vue, de petites fioles oý elle recueillait les pleurs de la vigne, sťve
du cep qui sue au printemps une sueur balsamique ayant, dit-on, la vertu
sans avoir les vices du vin. Maintenant plus qu'octogťnaire, il
paraissait tout ŗ fait aveugle, car il tenait une de ses mains en
entonnoir sur ses yeux fixťs vers le soleil, comme pour y concentrer
quelque sentiment de ses rayons; de l'autre main il palpait une ŗ une
les pierres amoncelťes du petit mur ŗ hauteur d'appui qui bordait le
sentier, comme pour reconnaÓtre la place oý il se trouvait sur le
chemin.
ęRassurez-vous, pŤre _Dutemps_!Ľ lui criai-je en me rapprochant de lui;
ęj'ai repris le cheval: il ne fera ni peur ŗ votre ‚ne, ni mal ŗ vous.Ľ
Et je m'arrÍtai ŗ l'ombre d'un poirier sauvage, devant le pauvre homme.
ęVous me connaissez donc, puisque vous avez dit mon nom?Ľ murmura
l'aveugle. ęMais moi, je ne vous connais pas. C'est qu'il y a bien
longtemps,Ľ continua-t-il comme pour s'excuser, ęque je ne puis plus
connaÓtre les hommes qu'ŗ leur voix. Les arbres et les murs, oui; cela
ne change pas de place; mais les hommes, non: cela va, cela vient,
aujourd'hui ici, demain lŗ; cela court comme de l'eau, cela change
comme le vent; ŗ moins de les voir, on ne sait pas ŗ qui l'on parle, et
je ne les vois plus. Par exemple, quand ils m'ont une fois parlť, je les
reconnais toujours au son de leur voix: la voix, c'est comme une
personne dans mon oreille. Mais je ne me souviens pas d'avoir jamais
entendu la vŰtre. Qui Ítes-vous donc, si cela ne vous offense pas?Ľ
--ęHťlas! pŤre Dutemps,Ľ lui dis-je, ęcela prouve que ma voix a bien
changť, comme mon visage; car vous l'avez entendue bien souvent sous le
vieux _sorbier_ de votre cour, quand nous ramassions au pied de l'arbre
les _sorbes_ que la Madeleine votre femme faisait mŻrir sur la paille,
ou quand je rappelais les chiens courants de mon pŤre au bord du grand
bois, au-dessus de votre champ de blť noir.Ľ
Il renversa sa tÍte en arriŤre, Űta son bonnet, d'oý roulŤrent sur ses
joues des ťcheveaux de cheveux blancs et fins comme une toison, et il
recula machinalement en arriŤre, ŗ deux pas.
ęVous Ítes donc monsieur Alphonse?Ľ s'ťcria-t-il (les paysans de ces
contrťes ne savent de mes noms que celui-lŗ). ęIl n'y a que lui qui ait
connu Madeleine, qui ait secouť le sorbier de la cour, qui ait rappelť
les chiens des chasseurs pour leur rompre le pain de seigle devant la
maison. Hťlas! que Madeleine aurait donc de plaisir ŗ le revoir, si elle
vivait!Ľ ajouta-t-il avec un accent de regret attendri.--ęOui, c'est
moi, pŤre Dutemps,Ľ lui dis-je: ęDonnez-moi votre main, que je la serre
encore en reconnaissance des bons services que vous nous avez rendus,
des bons fagots que vous nous avez brŻlťs, des bonnes galettes de
sarrasin que vous nous avez cuites ŗ votre feu, et de l'amitiť que
Madeleine, ses filles et vous, vous aviez pour notre mŤre et pour ses
enfants! Il y a bien longtemps de cela; mais, voyez-vous, la mťmoire
dans les coeurs d'enfants, c'est comme la braise du foyer ťteint pendant
le jour dans la maison: cela tient la cendre chaude, et, quand la nuit
vient, cela se rallume dŤs qu'on la remue!Ľ
--ęEst-ce possible? Quoi! c'est bien vous!Ľ reprit-il avec un ťtonnement
qui commenÁait ŗ s'apaiser. ęAh! oui, il y a bien longtemps que vous
n'ťtiez venu au pays, qu'on ne regardait plus fumer le ch‚teau, qu'on
n'entendait plus aboyer les chiens lŗ-bas dans le grand jardin sous les
tours, qu'on ne voyait plus passer les chevaux blancs qui portaient des
dames et des messieurs dans les chemins ŗ travers les prťs! Ma fille me
disait: ęLe pays est mort; il semble que la cloche pleure au lieu de
carillonner.Ľ On disait aussi que vous ne reviendriez jamais; qu'il y
avait eu du bruit lŗ-bas; qu'on vous avait nommť un des rois de la
rťpublique; et puis qu'on avait voulu vous mettre en prison ou en exil,
comme sous la Terreur. Il est venu au printemps un colporteur qui
vendait des images de vous dans le pays, comme celles d'un grand de la
rťpublique; et puis il en est venu en automne qui vendaient des chansons
contre vous, comme celles de Mandrin. J'ai bien pleurť quand ma fille
m'a racontť cela un dimanche, en revenant de la messe. Est-ce bien
possible, ai-je dit, que ce monsieur ait fait tous ces crimes? et que
lui, qui n'aurait pas fait de mal ŗ une bÍte quand il ťtait petit, il
ait fait couler le sang des hommes dans Paris, par malice? Et puis,
quelques mois plus tard, on dit que ce n'ťtait pas vrai; et puis, on n'a
plus rien dit du tout.Ľ
--ęHťlas! pŤre Dutemps,Ľ lui ai-je rťpondu, il y a du vrai et du faux
dans tous ces bruits de nos agitations lointaines qui sont montťs
jusqu'ŗ ces dťserts, comme le bruit du canon de Lyon y monte quand c'est
le vent du midi, sans que l'on puisse savoir d'ici si c'est le canon
d'alarme ou le canon de fÍte. On ne sait de mÍme que longtemps aprŤs les
rťvolutions si les hommes qui y ont ťtť jetťs sont dignes d'excuse ou de
bl‚me. N'en parlons pas ŗ prťsent. Je viens ici pour tout oublier
pendant quelques jours ŗ ce beau soleil, que le sang et les larmes des
peuples ne ternissent pas. Je ne serai que trop tŰt obligť, par mon
devoir, de retourner oý s'agite le sort des empires, et de me faire
encore des misŤres et des inimitiťs ici-bas, pour me faire un juge
indulgent et compatissant lŗ-haut; car, voyez-vous, chacun a son travail
dans ce monde, et il faut l'accomplir ŗ tout prix. Je suis bien las,
mais je n'ai pas encore le droit de m'asseoir, comme vous, tout le jour
au soleil contre un mur. Et qui sait s'il y aura un mur?... Mais vous,
pŤre Dutemps, parlons de vous. Demeurez-vous toujours seul lŗ-haut dans
cette petite chaumiŤre, ŗ une lieue de tout voisin, dans la bruyŤre, au
bord du bois des hÍtres? Quel ‚ge avez-vous? Qui est-ce qui pioche pour
vous la colline de sable? Qui est-ce qui bat les ch‚taignes? Qui est-ce
qui soigne vos ‚nesses et vos chŤvres? Depuis quand avez-vous perdu tout
ŗ fait la vue? Et comment passez-vous le temps que Dieu vous a mesurť
plus large qu'aux autres hommes? car je crois que vous Ítes le plus
vieux de la vallťe.Ľ
--ęJ'ai quatre-vingts ans,Ľ me rťpondit le vieillard. ęMa femme, la
Madeleine, est morte il y a sept ans; elle ťtait bien plus jeune que
moi. Tous mes enfants sont morts, exceptť la _Marguerite_, qui ťtait la
derniŤre de mes filles, et que vous appeliez la _Pervenche des bois_,
parce qu'elle avait les yeux bleus comme ces fleurs qui croissent ŗ
l'ombre, vers la source; elle a ťtť veuve ŗ vingt-huit ans, et elle a
refusť de se remarier pour venir me soigner et me nourrir dans la petite
cabane lŗ-haut, oý elle est nťe et oý elle restera jusqu'ŗ ma mort; elle
a une petite fille et un petit garÁon, qui mŤnent les bÍtes au champ, et
qui continuent ŗ servir mes pratiques d'oeufs et de pommes. Ce petit
commerce, dont nous leur laissons les gros _sous_ pour eux, servira
pour leur acheter des habits, du linge et une armoire quand ils seront
en ‚ge et en idťe de se marier. Marguerite pioche le champ de pommes de
terre et de sarrasin, ramasse le bois mort pour l'hiver; elle fait le
pain de seigle; et moi je ne fais rien que ce que vous voyez,
ajouta-t-il en laissant tomber ses deux mains sur ses genoux comme un
homme oisif. Je garde l'‚ne, ou plutŰt l'‚ne me garde quand les enfants
n'y sont pas; car il est vieux pour un animal presque autant que je suis
vieux pour un homme; il sait que je n'y vois pas, il ne s'ťcarte jamais
trop des chemins; et quand il veut s'en aller, il se met ŗ braire, ou
bien il vient frotter sa tÍte contre moi tout comme un chien, jusqu'ŗ ce
que nous revenions ensemble ŗ la cabane.Ľ
--ęMais le jour ne vous paraÓt-il pas bien long ainsi, tout seul dans
les sentiers de la montagne?Ľ lui demandai-je.
--ęOh! non, jamais,Ľ dit-il; ęjamais le temps ne me dure. Quand il fait
beau, hors de la maison, je m'assois ŗ une bonne place au soleil, contre
un mur, contre une roche, contre un ch‚taignier; et je vois en idťe la
vallťe, le ch‚teau, le clocher, les maisons qui fument, les boeufs qui
p‚turent, les voyageurs qui passent et qui devisent en passant sur la
route, comme je les voyais autrefois des yeux. Je connais les saisons
tout comme dans le temps oý je voyais verdir les avoines, faucher les
prťs, mŻrir les froments, jaunir les feuilles du ch‚taignier, et rougir
les prunes des oiseaux sur les buissons. J'ai des yeux dans les
oreilles,Ľ continua-t-il en souriant; ęj'en ai sur les mains, j'en ai
sous les pieds. Je passe des heures entiŤres ŗ ťcouter prŤs des ruches
les mouches ŗ miel qui commencent ŗ bourdonner sous la paille, et qui
sortent une ŗ une, en s'ťveillant, par leur porte, pour savoir si le
vent est doux et si le trŤfle commence ŗ fleurir. J'entends les lťzards
glisser dans les pierres sŤches, je connais le vol de toutes les mouches
et de tous les papillons dans l'air autour de moi, la marche de toutes
les petites _bÍtes du bon Dieu_ sur les herbes ou sur les feuilles
sŤches au soleil. C'est mon horloge et mon almanach ŗ moi, voyez-vous.
Je me dis: voilŗ le coucou qui chante? c'est le mois de mars, et nous
allons avoir du chaud; voilŗ le merle qui siffle? c'est le mois d'avril;
voilŗ le rossignol? c'est le mois de mai; voilŗ le hanneton? c'est la
Saint-Jean; voilŗ la cigale? c'est le mois d'aoŻt; voilŗ la grive? c'est
la vendange, le raisin est mŻr; voilŗ la bergeronnette, voilŗ les
corneilles? c'est l'hiver. Il en est de mÍme pour les heures du jour. Je
me dis parfaitement l'heure qu'il est ŗ l'observation des chants
d'oiseaux, du bourdonnement des insectes et des bruits de feuilles qui
s'ťlŤvent ou qui s'ťteignent dans la campagne, selon que le soleil
monte, s'arrÍte ou descend dans le ciel. Le matin, tout est vif et gai;
ŗ midi, tout baisse; au soir, tout recommence un moment, mais plus
triste et plus court; puis tout tombe et tout finit. Oh! jamais je ne
m'ennuie; et puis, quand je commence ŗ m'ennuyer, n'ai-je pas cela?Ľ me
dit-il en fouillant dans sa poche, et en tirant ŗ moitiť son chapelet.
ęJe prie le bon Dieu jusqu'ŗ ce que mes lŤvres se fatiguent sur son
saint nom et mes doigts sur les grains. Qui est-ce qui s'ennuierait en
parlant tout le jour ŗ son Roi, qui ne se lasse pas de l'ťcouter?Ľ
dit-il avec une physionomie de saint enthousiasme. ęEt puis la cloche de
Saint-Point ne monte-t-elle pas cinq fois par jour jusqu'ici? Elle me
dit que Dieu aussi pense ŗ moi.Ľ
--ęMais l'hiver?Ľ lui dis-je, afin de m'instruire pour moi-mÍme de tous
ces mystŤres de la solitude, de la cťcitť et de la vieillesse.
--ęOh! l'hiver,Ľ me rťpondit-il, ęil y a le feu dans le foyer, le bruit
des sabots des enfants dans la maison, les ch‚taignes qu'on ťcorce, les
pois qu'on ťcosse, le maÔs qu'on ťgrŤne, le chanvre qu'on tille: tous
ces travaux n'ont pas besoin des yeux. Je travaille tout l'hiver au coin
du feu en jasant avec les enfants ou avec les chŤvres et les poules qui
vivent avec nous, et je me repose tout l'ťtť. Oh! non, le temps ne me
dure pas; seulement quelquefois je voudrais bien, comme ŗ prťsent,
revoir le visage de ceux qui me rencontrent sur le chemin, et que j'ai
connus dans les vieux temps. Par exemple, dites-moi donc, Monsieur,Ľ
poursuivit-il timidement, ęsi vous avez toujours ces longs cheveux
ch‚tains qui sortaient de dessous votre chapeau, et qui balayaient vos
joues fraÓches comme les joues d'une jeune fille, quand vous
accompagniez votre pŤre ŗ la chasse, et que vous buviez une goutte de
lait en passant dans le cellier de sapin de ma fille?Ľ
--ęHťlas! pŤre Dutemps, il a neigť sur ces cheveux-lŗ depuis. Le visage
de l'enfant, du jeune homme et de l'homme mŻr se ressemblent, comme
l'arbre que vous avez plantť il y a trente ans ressemble ŗ l'arbre qui
vous donne aujourd'hui ses fruits en automne: c'est le mÍme bois, ce ne
sont plus les mÍmes feuilles.Ľ
--ęEt avez-vous toujours ces beaux chevaux blancs qui galopaient dans le
grand prť, auprŤs du ch‚teau, et qu'on disait que vous aviez ramenťs,
aprŤs vos voyages, du pays de notre pŤre Abraham?Ľ
--ęIls sont morts de tristesse et de vieillesse, loin de leur soleil et
loin de moi.Ľ
--ęMais est-il bien vrai que vous allez vendre ces prťs, ces vignes, ces
bois, cette bonne maison que le soleil faisait reluire comme les murs
d'une ťglise au fond du pays?Ľ
--ęNe parlons pas de cela, pŤre Dutemps! Dieu est Dieu; les prťs, les
terres et les maisons sont ŗ lui, et il les change de maÓtre quand il
veut! Je ne sais pas ce qu'il ordonnera de nous; mais souvenez-vous
toujours de mon pŤre, de ma mŤre, de mes soeurs, de ma femme et de moi;
et quand vous direz vos priŤres sur votre chapelet, rťservez toujours
sept ou huit grains en mťmoire d'eux.Ľ
Je serrai de nouveau la main du coquetier, et je continuai mon chemin.
J'ťtais heureux d'avoir retrouvť ce vieillard, comme un homme se
rťjouit, aprŤs un demi-siŤcle, de retrouver dans une bruyŤre les traces
d'un sentier oý il a passť dans ses beaux jours, et qu'il croyait
effacťes pour jamais. Chaque pas de mon cheval, en descendant des
montagnes, me dťcouvrait un pan de plus de la vallťe, du village, des
hameaux enfouis sous les noyers, de mes jardins, de mes vergers, de ma
maison; mon oeil s'ťblouissait et s'humectait de reconnaissance en
reconnaissance. De chaque site, de chaque toit, de chaque arbre, de
chaque repli du sol, de chaque golfe de verdure, de chaque clairiŤre
illuminťe par les rayons rasants du soleil couchant, un ťclair, une
mťmoire, un bonheur, un regret, une figure, jaillissaient de mes yeux et
de mon coeur, comme s'ils eussent jailli du pays lui-mÍme. Je me
rappelais pŤre, mŤre, soeurs, enfance, jeunesse, amis de la maison,
contemporains de mes jours de joie et de fÍte, arbres d'affection,
sources abritťes, animaux chťris, tout ce qui avait jadis peuplť, animť,
vivifiť, enchantť pour moi ce vallon, ces prairies, ces bois, ces
demeures. Je secouais comme un fardeau importun, derriŤre moi, les
annťes intermťdiaires entre le dťpart et le retour; je rejetais plus
loin encore l'idťe de m'en sťparer pour jamais. J'avais douze ans, j'en
avais vingt, j'en avais trente; regards de ma mŤre, voix de mon pŤre,
jeux de mes soeurs, entretiens de mes amis, premiŤres ivresses de ma
vie, aboiements de mes chiens, hennissements de mes chevaux, expansions
ou recueillements de mon ‚me tour ŗ tour rťpandue ou enfermťe dans ses
extases, matinťes de printemps, journťes ŗ l'ombre, soirťes d'automne au
foyer de famille, premiŤres lectures, bťgayements poťtiques, vagues
mťlodies: tout se levait de nouveau, tout rayonnait, tout murmurait,
tout chantait en moi comme ce chant de rťsurrection, comme l'_Alleluia_
trompeur qu'entend _Marguerite_ ŗ l'ťglise le jour de P‚ques dans le
drame de Goethe. Mon ‚me n'ťtait qu'un cantique d'illusions!
Je croyais retrouver, en entrant dans la cour et en passant le seuil,
tout ce que le temps ťtait venu en arracher. Si ce chant eŻt ťtť notť
dans des vers, il serait restť l'hymne de la fťlicitť humaine,
l'holocauste du bonheur terrestre rallumť dans le coeur de l'homme par
la vue des lieux oý il fut heureux!
Ce chant intťrieur tombait peu ŗ peu en approchant davantage. Ma vieille
jument pressait le pas; elle gravissait le chemin creux qui monte du
ruisseau vers le tertre du ch‚teau; les jeunes ťtalons, les mŤres et les
poulains qui paissaient dans les prťs voisins accouraient au bruit de
ses pas sur les pierres; ils passaient leurs tÍtes au-dessus des haies
qui bordent le sentier, ils la saluaient de leurs hennissements et la
suivaient derriŤre les buissons en galopant, comme pour faire fÍte ŗ
leur ancienne compagne de prairies.
Hťlas! personne n'apparaissait au-devant de moi! les feuilles mortes du
jardin que le vent et les torrents balayaient seuls, jonchaient les
pelouses autrefois si vertes, et couvraient le seuil de la barriŤre
entr'ouverte par laquelle on entre dans l'enclos. Un seul vieux chien
invalide se traÓna pťniblement ŗ ma rencontre, et poussa quelques
tendres gťmissements en lťchant les mains de son maÓtre. Une petite
fille de douze ans, qui garde les vaches dans l'enclos, entr'ouvrit la
porte au bruit des pas de mon cheval. Elle courut dire ŗ la vieille
servante, qui filait sa quenouille dans une chambre haute, que j'ťtais
arrivť. La bonne fille descendit, en boitant, l'escalier en spirale, et
m'accueillit avec une triste et tendre familiaritť dans la cuisine
basse, oý la cendre tiŤde recouvrait le foyer. J'Űtai la selle et la
bride ŗ la jument; la petite bergŤre lui ouvrit la barriŤre et la lanÁa
dans le verger.
AprŤs avoir commandť quelques herbages et quelques fruits pour mon
repas, je montai dans les appartements, et j'ouvris les volets, fermťs
depuis trois ans. Mais il n'y entra que plus de tristesse avec plus de
jour, car la lumiŤre, en les remplissant, ne faisait que m'en montrer
davantage le vide. Il n'y eut que quelques oiseaux familiers, ces beaux
paons nourris par nos mains, qui parurent se rťjouir en voyant se
rouvrir les fenÍtres: ils regardŤrent, ils volŤrent lourdement un ŗ
un, comme en hťsitant, du gazon sur le rebord de la galerie gothique, oý
nous avions l'habitude de leur ťgrener des miettes de pain; ils me
suivirent comme autrefois jusque dans les chambres, en cherchant de
l'oeil les femmes et en frappant du bec les parquets retentissants. La
fidťlitť de ces pauvres oiseaux m'attendrit. Je me h‚tai de descendre
dans l'enclos, pour ťchapper ŗ la solitude inanimťe des murs. Mes chiens
seuls me suivaient, et je pensais au jour oý il faudrait aussi les
congťdier.
Pour un homme qui a longtemps habitť en famille un site de prťdilection,
le jardin est une prolongation de l'habitation, c'est une maison sans
toit; le jardin a les mÍmes intimitťs, les mÍmes empreintes, les mÍmes
souvenirs que la maison! Les arbres, les pelouses, les allťes dťsertes
se souviennent, racontent, retracent, causent ou pleurent comme les
murs. C'est un abrťgť de notre passť. J'y retrouvais toutes les heures
au soleil ou ŗ l'ombre que j'y avais passťes, toutes les poťsies de mes
livres et de mon coeur que j'y avais senties, ťcrites ou seulement
rÍvťes, pendant les plus fťcondes et les plus splendides annťes de mon
ťtť d'homme. Chaque source balbutiait, comme autrefois, sa note que
j'avais reproduite; chaque rayon sur l'herbe, son image que j'avais
repeinte; chaque arbre, son ombre, ses nids, ses brises dans ses
feuilles vertes ou ses frissons dans ses feuilles mortes, que j'avais
goŻtťs, recueillis et rťpercutťs dans mes propres harmonies: tout y
ťtait encore, exceptť l'ťcho mort et le miroir terni en moi.
J'arrivai ainsi, traÓnant mes pas sous les branches jaunies et sur les
sables humides, jusqu'ŗ une petite porte percťe dans un vieux mur
tapissť de lierre et de buis. Vous savez que le mur de l'ťglise projette
son ombre sur cette partie du jardin, et que l'on communique, par cette
porte dťrobťe, de l'enclos dans le cimetiŤre du village. Vous savez que
j'ai ajoutť ŗ ce cimetiŤre ombragť de vieux noyers, un petit coin de
terre retranchť au jardin, afin que ce petit coin de terre, dont j'ai
fait don au village, fŻt ŗ la fois la propriťtť de la mort et la
propriťtť de la famille, et que, si la nťcessitť nous dťpouillait un
jour de l'habitation et du domaine de _Saint-Point_, cette nťcessitť ne
fÓt pas du moins passer ce domaine des morts dans les mains d'une
famille ťtrangŤre ou d'un propriťtaire indiffťrent.
C'est sur cette frontiŤre neutre entre le cimetiŤre et le jardin, que
j'ai b‚ti (le seul ťdifice que j'aie b‚ti ici-bas) un petit monument
funŤbre, une chapelle d'architecture gothique, entourťe d'un cloÓtre
surbaissť en pierres sculptťes qui protťgent quelques fleurs tristes, et
qui s'ťlŤvent sur un caveau. C'est lŗ que j'ai recueilli et rapportť de
loin, prŤs de mon coeur, les cercueils de tout ce que j'ai perdu sur la
route de plus aimť et de plus regrettť ici-bas.
Toutes les fois que j'arrive ŗ _Saint-Point_ ou toutes les fois que j'en
pars pour une longue absence, je vais seul, ŗ la chute du jour, dire ŗ
genoux un salut ou un adieu ŗ ces chers hŰtes de l'ťternelle paix, sur
ce seuil intermťdiaire entre leur exil et leur fťlicitť. Je colle mon
front contre la pierre qui me sťpare seule de leurs cendres, je
m'entretiens ŗ voix basse avec elles, je leur demande de nous envelopper
dans nos ariditťs d'un rayon de leur amour, dans nos troubles d'un rayon
de leur paix, dans nos obscuritťs d'un rayon de leur vťritť. J'y suis
restť plus longtemps aujourd'hui et plus absorbť dans le passť et dans
l'avenir, qu'ŗ aucun autre de mes retours ici. J'ai relu, pour ainsi
dire, ma vie tout entiŤre sur ce livre de pierre composť de trois
sťpulcres: enfance, jeunesse, aubes de la pensťe, annťes en fleurs,
annťes en fruits, annťes en chaume ou en cendres, joies innocentes,
piťtťs saintes, attachements naturels, ťtudes ardentes, ťgarements
pardonnťs d'adolescence, passions naissantes, attachements sťrieux,
voyages, fautes, repentirs, bonheurs ensevelis, chaÓnes brisťes, chaÓnes
renouťes de la vie, peines, efforts, labeurs, agitations, pťrils,
combats, victoires, ťlťvations et ťcroulements de l'‚ge mŻr sur les
grandes vagues de l'ocťan des rťvolutions, pour faire avancer d'un degrť
de plus l'esprit humain dans sa navigation vers l'infini! Puis les
refroidissements d'ardeur, les dťchirements de destinťe, les martyres
d'esprit, les pertes de coeur, les dťpouillements obligťs des choses ou
des lieux dans lesquels on s'ťtait enracinť, les transplantations plus
pťnibles pour l'homme que pour l'arbre, les injustices, les
ingratitudes, les persťcutions, les exils, les lassitudes du corps avant
celles de l'‚me, la mort enfin, toujours ŗ moitiť chemin de quelque
chose.
Tout cela a roulť en bruissant pendant je ne sais combien de temps dans
ma tÍte, comme le torrent de ma vie qui serait redescendu tout ŗ coup
aprŤs une pluie d'orage de toutes les montagnes, et qui serait revenu
prendre possession de son lit dessťchť. Le tombeau ťtait pour moi la
pierre de MoÔse d'oý coulaient toutes les eaux; j'ouvris mon coeur comme
une ťcluse, et la priŤre en sortit ŗ grands flots avec la douleur, la
rťsignation et l'espťrance; et mes larmes aussi coulaient; et quand je
retirai mes mains de mes yeux et que je les posai contre le seuil pour
le bťnir, elles firent une marque humide sur la pierre blanche...
Un bruit m'avait fait lever en sursaut.
C'ťtait une sourde et monotone psalmodie qui sortait d'une petite
fenÍtre grillťe au flanc de l'ťglise, tout prŤs de moi. Je m'essuyai le
front et les genoux pour faire le tour de l'ťdifice, et pour y entrer
par la petite porte qui ouvre au midi sur la cŰte opposťe. Je fus arrÍtť
sur la premiŤre marche par un petit cercueil recouvert d'un drap blanc
et de deux bouquets de roses blanches aussi, que portaient quatre jeunes
filles d'un hameau des montagnes. Le vieux curť les suivait en rťcitant
quelques versets de liturgie latine sur la briŤvetť de la vie; un pŤre
et une mŤre pleuraient, en chancelant, derriŤre lui. Je marchai vers la
fosse avec eux, et je jetai ŗ mon tour les gouttes d'eau, image des
gouttes de larmes, sur le cercueil de la jeune fille, et je rentrai sans
avoir osť regarder le pauvre pŤre!
J'ai passť la soirťe ŗ vous ťcrire: ce coeur a besoin de crier quand il
est frappť. Je remercie Dieu de m'avoir laissť dans le vŰtre un ťcho qui
me renvoie jusqu'au bruit de mes larmes sur mon papier. La vie est un
cantique dont toute ‚me heureuse ou malheureuse est une note.--Adieu!
LAMARTINE.
XVIe ENTRETIEN.
4e de la deuxiŤme Annťe.
BOILEAU.
I
Revenons pour un moment au siŤcle littťraire de Louis XIV. Nous aurons ŗ
y revenir bien souvent encore en touchant ŗ Corneille, ŗ MoliŤre, ŗ La
Fontaine, ŗ Bossuet, ŗ Fťnelon, ŗ Pascal, ŗ Mme de Sťvignť, ces ťternels
survivants d'un siŤcle mort.
Nous allons aujourd'hui vous parler de Boileau. Boileau est ŗ lui seul
un procŤs littťraire. Est-ce un grand homme de lettres? Est-ce une p‚le
mťdiocritť? Est-ce un Tarquin de notre littťrature ayant fauchť du
tranchant de ses satires toutes les tiges naissantes de l'esprit
franÁais qui menaÁaient de dťpasser sa platitude? Est-ce un eunuque
_NarsŤs_ de notre beau siŤcle, ayant arrachť ŗ nos poŽtes leur virilitť
et ŗ notre langue sa jeunesse pour les rendre timides, serviles et
stťriles comme lui-mÍme? A-t-il nui ŗ notre croissance comme nation
intellectuelle, ou a-t-il dirigť notre sťve ťgarťe et surabondante vers
une conformation durable de la langue et de la pensťe, en rťprimant
cette sťve de la France et en la contenant dans les rŤgles ťternelles du
bon sens et du bon goŻt, ces deux nťcessitťs premiŤres et ces deux
qualitťs natives du gťnie franÁais?
C'est ce procŤs, si souvent dťbattu de nos jours avec la partialitť et
avec la passion des querelles d'esprit, que nous allons essayer de juger
ŗ notre tour, en comprenant bien et en faisant bien comprendre cet homme
d'achoppement, Boileau.
II
Disons d'abord une vťritť sťvŤre en apparence, mais en rťalitť flatteuse
pour notre pays. Le premier devoir et le premier droit d'un homme qui
ťcrit sur la littťrature universelle du genre humain, c'est d'Ítre
lui-mÍme universel, c'est de s'ťlever par consťquent au-dessus des
amours-propres, des prťjugťs, des superstitions d'esprit, des fanatismes
nationaux de sa patrie et de son temps, pour juger les hommes par leurs
oeuvres et non par leurs prťtentions. Les lettres n'ont pas de
frontiŤres et ne connaissent pas de drapeaux. Ce qu'on pense et ce qu'on
ťcrit de beau ŗ Rome, ŗ Ispahan, ŗ Jťrusalem, ŗ Pťtersbourg, ŗ Vienne, ŗ
Londres, ŗ Madrid, ŗ Calcutta, ŗ Pťkin, grandit l'humanitť pensante ŗ
Paris. Il n'y a pas de droit d'aubaine pour la pensťe: le gťnie est du
domaine commun. Il est comme l'air; il franchit, sans les connaÓtre,
toutes les limites politiques des peuples pour vivifier partout tout ce
qui le respire.
Ce serait un pauvre critique que celui qui se dťclarerait un critique
national et qui arrÍterait les chefs-d'oeuvre de l'intelligence
ťtrangŤre ŗ ces mesquines douanes de la pensťe, en leur demandant leurs
certificats d'origine. Nous n'avons eu que trop de ces critiques
prohibitifs en France et ailleurs. Ce sont eux qui ont stťrilisť les
lettres, en empÍchant, autant qu'il ťtait en eux, ces unions conjugales
entre les esprits de diffťrents climats, qui auraient multipliť leurs
fruits en se rencontrant pour s'unir. Toute fťconditť vient de l'union,
dans la nature morale comme dans la nature matťrielle. Il y a dans
l'esprit humain, comme dans les vťgťtaux, des pensťes m‚les et des
pensťes femelles. Ces hommes d'exclusion ressemblent ŗ ces Arabes des
frontiŤres de Perse qui ťtendent des toiles autour des palmiers m‚les de
leurs tribus, dans le temps de la floraison, pour empÍcher le vent du
dťsert d'aller porter les semences de leurs palmiers aux palmiers
femelles des tribus voisines. Ils tuent le fruit et font la disette au
dťtriment de tous. Mais le vent finit par passer, malgrť les hommes, et
par porter la fťconditť dans les deux partis.
Nous ne sommes pas de ces hommes jaloux de la gloire et de la nourriture
intellectuelle des autres peuples que le nŰtre. Nous aimons ŗ rendre ŗ
toutes les races pensantes ce qui est ŗ ces races, et ŗ Dieu ce qui est
ŗ Dieu.
III
Cela dit, et aprŤs ces prťcautions oratoires, nous allons, ŗ nos risques
et pťrils, exprimer franchement, en quelques mots, notre pensťe sur les
aptitudes naturelles de la France comparťes aux aptitudes des nations
antiques et modernes avec lesquelles notre littťrature nationale peut
rivaliser. Chacune de ces nations a reÁu son lot de la nature.
L'Inde a la supťrioritť dans la thťosophie, cette disposition mystique
admirable et sainte qui voit la Divinitť avec ťvidence dans toute la
nature, qui fait de toute la nature un miroir de cette Divinitť, et qui
contemple avec ravissement dans ce miroir le drame divin et humain de la
crťation.
La Chine a la supťrioritť dans la science qui recueille, qui dťcouvre la
premiŤre les faits; elle a la supťrioritť aussi dans la raison qui
conclut de cette science des faits une grande sagesse pratique et
utilitaire en toute chose, agriculture, morale, lťgislation,
civilisation, politique. Les grandes inventions appartiennent ŗ cette
race expťrimentale. C'est par excellence le peuple inventif.
L'Arabie, en y comprenant les Hťbreux, les Persans et presque tout
l'Orient de la zone rapprochťe de l'Europe, a la supťrioritť dans
l'imagination; c'est la race du merveilleux par excellence, la terre des
songes, le lit de pavots oý l'on rÍve ťveillť avec le plus de charme et
de poťsie. Nulle part on ne conte mieux ces rťcits chimťriques qui
flottent dans l'imagination transparente comme les fumťes du narghilť
dans un ciel serein. Tous les conteurs, ces poŽtes populaires de la
tente, sont Arabes ou Persans, et tous nos contes viennent de Bagdad.
La GrŤce a la supťrioritť dans l'art, cette logique de la pensťe, de
l'imagination et du sentiment. De tout ce que la GrŤce touche, divinitť,
philosophie, politique, poťsie, musique, drame, histoire, architecture,
marbre, pierre, pinceau, elle fait un art accompli. C'est le lapidaire
de l'espŤce; elle taille tout, elle polit tout, elle ench‚sse tout dans
un cadre parfait. Sa littťrature faÁonnťe est l'ťcrin de l'intelligence
humaine.
Rome a la supťrioritť en politique, en guerre, en ťloquence d'action, en
constance dans ses desseins, en caractŤre en un mot. C'est le peuple du
caractŤre; il y en a jusque dans sa littťrature. Lisez Tacite; c'est le
nerf irritť d'un peuple volontaire, libre, humiliť, mais indomptť; c'est
le muscle qui perce la chair. Le caractŤre de sa race y palpite ŗ chaque
mot comme dans le spasme du gladiateur mourant.
L'Italien, fils non dťgťnťrť, mais dťshťritť, du Romain, a la
supťrioritť dans le sentiment du beau. C'est lŗ son gťnie, c'est lŗ sa
vertu, c'est lŗ son signe entre les peuples. Son ‚me a reÁu plus de part
que celle des autres nations dans ce type ťternel et ineffable de
_beautť_ qui est le modŤle intťrieur sur lequel se moulent les actes ou
les oeuvres de l'homme. Beautť dans la forme: voyez ses femmes! Beautť
dans l'architecture: voyez ses temples et ses palais! Beautť dans la
sculpture: voyez son Michel-Ange! Beautť dans la peinture: voyez son
RaphaŽl! Beautť dans la musique: voyez son Rossini! Beautť dans la
poťsie: voyez son Dante, que des pamphlťtaires m'accusent aujourd'hui,
en Italie, d'avoir calomniť, parce que j'ai sťparť, en parlant de lui,
l'oeuvre tťnťbreuse du thťologien du gťnie incomparable du poŽte, et
parce que je l'ai appelť le dieu de la poťsie, tandis que Voltaire
l'appelait le monstre de la barbarie! Voyez sa langue: elle ne pŤche
mÍme que par l'excŤs du beau; elle est trop sonore pour des lŤvres
d'homme, elle ne devrait Ítre parlťe que par des anges ou par des
femmes! Voyez son Tasse! voyez son Arioste! voyez son Pťtrarque, Platon
de l'amour fťminin! voyez mÍme son Machiavel, qui a portť le sentiment
du beau jusque dans les crimes de son style! C'est toujours le peuple du
beau. L'Italien est un amant du beau.
L'Allemand a la supťrioritť dans la philosophie spťculative et dans la
construction presque indienne de sa langue, faite pour incorporer des
rÍves ou pour ťlaborer des idťes. L'Allemand est un philosophe.
L'Espagnol, en littťrature, a la supťrioritť dans l'ťlťvation grandiose
de l'‚me et dans la noblesse souvent exagťrťe du style. C'est cette
ťlťvation de l'‚me qui donne ŗ sa littťrature le caractŤre mystique,
ascťtique, ťrťmitique qu'on trouve dans sa sainte ThťrŤse et dans son
peintre Murillo. C'est cette noblesse exagťrťe des sentiments qui lui a
maintenu longtemps le gťnie chevaleresque poussť jusqu'ŗ la folie et
jusqu'ŗ la caricature, dont son _don Quichotte_, son livre populaire, a
ťtť, sous la plume de CervantŤs, l'amusante et dťplorable dťrision. Ce
sont les vices d'un peuple qu'il faut bafouer; ce ne sont pas ses vertus
nationales. L'Espagnol, qui se transforme aujourd'hui en citoyen, a ťtť
jusqu'ici un chevalier et un moine.
Le Portugais, dont la langue a toutes les magnificences de l'espagnol
sans en avoir les dťfauts, a la supťrioritť dans l'aventure et dans
l'audace; il a jouť sa fortune sur toutes les vagues de l'Ocťan. Jamais
peuple si peu nombreux ne fit et n'ťcrivit de si grandes choses. Son
CamoŽns est le poŽte ťpique de son histoire, de ses dťcouvertes et de
ses conquÍtes dans l'Inde. Son empire, transbordť en six mois de
Lisbonne en Amťrique, sera un jour le texte d'un autre CamoŽns. Le
Portugais est un aventurier, l'aventurier national, hťroÔque et poťtique
des temps modernes.
L'Angleterre, aprŤs l'Allemagne, est en littťrature la seule nation dont
le gťnie vienne du Nord sans avoir passť par la GrŤce et par Rome; elle
a la supťrioritť de l'originalitť. Cette originalitť a un peu ťtť
dťteinte par la Bible dans _Milton_ et par la latinitť d'Horace dans
_Pope_, l'Horace anglais. Mais son vťritable gťant, Shakspeare, est nť,
comme Antťe, de lui-mÍme et de la terre. Il a imprťgnť le gťnie
littťraire saxon anglais d'une sťve septentrionale, sauvage, puissante,
qu'elle ne peut plus perdre. Les institutions libres de cette nation et
sa situation forcťment navale ont donnť ŗ son gťnie incontestable le
caractŤre multiple de ses aptitudes. Il a le besoin de compenser la
petitesse de son territoire par une immense et forte personnalitť. Le
citoyen de la Grande-Bretagne est un patriarche dans sa maison, un poŽte
dans ses forÍts, un orateur sur sa place publique, un marchand dans son
comptoir, un hťros sur son navire, un cosmopolite sur le sol de ses
colonies, mais un cosmopolite emportant sur tous les continents avec lui
son indťlťbile individualitť. Les races antiques n'ont rien qui lui
ressemble. On ne peut le dťfinir, en politique comme en littťrature, que
par son nom: l'Anglais est un Anglais.
L'Amťrique n'a encore que la supťrioritť de la jeunesse. Son gťnie,
s'il lui en vient un autre que celui de la vieille Europe, sa mŤre, est
ŗ l'ťtat de croissance. On ne sait encore ce qu'il produira, peuple sans
ancÍtres sur un continent sans passť:
_Prolem sine matre creatam!_
La France, il faut l'avouer, dussent toutes les fťrules des ťcoles
tomber sur la main qui inscrit ces lignes, la France n'a pas eu
jusqu'ici, parmi ses innombrables aptitudes, la grande imagination
littťraire et poťtique. La meilleure preuve de ceci, c'est qu'elle n'a
ni un grand poŽte ťpique comme HomŤre, Dante, le Tasse, ni un grand
poŽte lyrique sacrť comme David, ni un grand poŽte lyrique profane et
philosophique comme Horace et Pindare, ni un grand dramatiste comme
Eschyle ou Shakspeare. La France a peu d'imagination poťtique; elle
semble rťserver cette qualitť surhumaine de l'humanitť, l'enthousiasme,
pour ses actes plus que pour ses oeuvres.
Elle n'a pas la thťosophie contemplative de l'Inde; elle n'a pas le
rationalisme obstinť, inventif et lťgislateur de la Chine; elle n'a pas
la fťconditť de chimŤres, l'instinct du merveilleux de l'Arabie; elle
n'a pas l'art exquis et universel de la GrŤce; elle n'a pas la constance
et l'austťritť de la vieille Rome; elle n'a pas la gr‚ce et la mollesse
de l'Italie moderne; elle n'a pas la philosophie spťculative et planante
sans toucher terre de l'Allemagne; elle n'a pas le gťnie du grandiose et
du chevaleresque de l'Espagne; elle n'a pas le gťnie des aventures
ťpiques des Portugais; elle n'a pas l'indťlťbile originalitť de
l'Angleterre.
Mais la France rachŤte toutes ces infťrioritťs relatives avec ces
peuples par des qualitťs d'esprit, de caractŤre, et surtout de coeur,
qui lui sont propres, et qui la placent, sinon au-dessus, du moins au
niveau et souvent en avant de ces grandes individualitťs humaines. La
privation relative de ces grandes facultťs de l'imagination prťserve
aussi la France des excŤs et des vices insťparables de ces facultťs trop
dominantes dans certaines races. Son gťnie n'a pas leur puissance, mais
aussi il n'a pas leurs dťfauts; rien n'altŤre, chez le FranÁais, cet
ťquilibre admirable des facultťs qui est la santť de l'esprit, comme
l'ťquilibre des humeurs est la santť du corps. Cet ťquilibre parfait de
l'imagination et de la raison, de l'enthousiasme et de la prudence, de
la force d'impulsion et de la force de rťsistance, de la chaleur d'‚me
et du sang-froid d'esprit, conserve au gťnie franÁais cette qualitť des
qualitťs, le jugement, sans lequel le gťnie devient une maladie mentale.
Le jugement lui donne ce qu'on appelle le goŻt dans les arts, le goŻt,
c'est-ŗ-dire le discernement exquis, irrťflťchi, mais pour ainsi dire
infaillible, de l'esprit, qui lui fait dire: ceci est bon, ceci est
mauvais; ceci est dans la convenance des choses, ceci n'y est pas.
Attrait ou rťpugnance naturelle de l'esprit qui le prťserve des
engouements illogiques et qui lui fait choisir les aliments sains de
l'intelligence, comme la rťpugnance physique du palais ou de l'odorat
prťserve le corps des substances suspectes ou nuisibles. Le goŻt, en
effet, n'est que le choix sous un autre nom; c'est une des facultťs du
gťnie national les plus prťcieuses, et qu'aucun peuple peut-Ítre, ni
parmi les anciens, ni parmi les modernes, n'a possťdť avec autant
d'infaillibilitť et de dťlicatesse que le FranÁais; c'est mÍme par cette
qualitť qu'il est en littťrature et en idťes l'oracle de l'Europe. Le
FranÁais est le dťgustateur intellectuel de toutes les productions de
la pensťe dans le monde. Ce qu'il aime, on l'aime; ce qu'il rejette, on
le rejette; son jugement a l'autoritť d'un instinct.
Or, qu'est-ce que le FranÁais aime par-dessus tout et avant tout dans
les productions de la pensťe? C'est le bon sens. La premiŤre qualitť
qu'il exige, et avec raison, d'une oeuvre de l'esprit et des langues,
c'est d'Ítre conforme au bon sens.
Et qu'est-ce que le bon sens? Le bon sens est: _la moyenne rigoureuse de
l'esprit humain dans tout l'univers et dans tous les temps._ C'est la
meilleure dťfinition que je puisse trouver. Au-dessus du bon sens il y a
le gťnie, apanage exceptionnel d'un trŤs-petit nombre; au-dessous du bon
sens il y a la sottise, la dťmence, la mťdiocritť, apanage dťplorable de
tout ce qui est infťrieur au nom d'homme dans l'espŤce humaine. Mais
entre le gťnie et la mťdiocritť il y a le vaste domaine du bon sens, la
rťgion moyenne des vťritťs reÁues, la terre des heureux et des sages,
qui ne s'ťlŤve pas jusqu'aux rťgions pťrilleuses et inhabitťes du gťnie,
qui ne descend pas jusqu'aux rťgions basses et tťnťbreuses de la
mťdiocritť, mais qui s'ťtend, immense et sereine, entre les deux abÓmes
et qui est le sťjour moral habitť par les bons esprits. C'est lŗ que le
gťnie franÁais rŤgne par le goŻt, qu'il maintient sa royautť par
l'esprit, cette monnaie du gťnie ŗ l'usage d'un plus grand nombre
d'intelligences que le gťnie lui-mÍme.
IV
Et qu'est-ce encore que l'esprit? L'esprit est la gr‚ce du bon sens.
Nous ne pouvons pas non plus trouver une expression plus exacte et plus
concise pour le dťfinir. On voit par cette dťfinition que l'esprit ainsi
entendu ne vient pas seulement de l'intelligence, mais qu'il vient aussi
du caractŤre. Une intelligence juste, vive et fine, un coeur ouvert,
large et bienveillant sont les deux conditions nťcessaires ŗ un peuple
ou ŗ un homme pour avoir ce qu'on appelle de l'esprit. Le mťchant n'en a
pas, car la mťchancetť n'a pas de gr‚ce. Le FranÁais en a, car il est
essentiellement bon; il s'oublie en toute occasion lui-mÍme pour voler
au secours de tout le monde. On l'accuse d'ťtourderie, c'est peut-Ítre
vrai, mais son ťtourderie est toujours l'ťlan de la magnanimitť vers
quelque belle chose. Il y a du vent dans son ‚me, mais ce vent enfle les
voiles du monde vers tout ce qui brille d'ťlevť ou de beau ŗ l'horizon
des idťes.
De tout ceci que conclure? que, si l'Indou est un thťosophe, le Chinois
un raisonneur, le Romain un politique, l'Espagnol un chevalier, l'Arabe
un conteur, le Grec un artiste, le Portugais un aventurier hťroÔque,
l'Allemand un philosophe, l'Anglais un patriote, l'Italien moderne un
amant du beau, le FranÁais, lui, est par excellence un homme d'esprit.
Nous avons dit que le bon sens ťtait _la moyenne de l'esprit humain dans
tout l'univers_; nous avons dit que l'esprit et le goŻt ťtaient les
caractŤres du bon sens franÁais en littťrature; nous avons dit que le
FranÁais ťtait l'homme d'esprit entre tous les peuples; nous ajoutons:
la capitale du bon sens est en France, la moyenne du monde est ŗ Paris.
V
Ce court prťambule ťtait nťcessaire pour arriver ŗ l'inexplicable
influence de Boileau sur les lettres franÁaises. Dans aucun autre pays
du monde un tel homme n'aurait laissť une trace de son nom. Pour le
comprendre il fallait comprendre prťalablement l'esprit franÁais
contemporain.
Boileau n'ťtait certes pas un homme de gťnie; il n'avait aucune de ces
qualitťs qui composent la nature des grands poŽtes, ces foyers
d'enthousiasme brŻlťs les premiers par leur propre feu. La vťritable
poťsie est insťparable de la grandeur d'‚me, des convulsions de la
passion, de l'ťlťvation des idťes, de la chaleur qui atteste la vie dans
l'oeuvre de l'esprit comme celle du coeur atteste la vie dans l'homme
des sens. En mettant la main sur le coeur du vrai poŽte, il faut le
sentir battre, comme celui des hťros, plus vite et plus fort que celui
des autres mortels. La poťsie est l'hťroÔsme de l'esprit et de l'‚me.
Boileau n'avait rien de ces dons ou de ces excŤs de nature qui font
souvent mourir jeunes les grands poŽtes, mais qui les font revivre
ťternellement dans leur nom et dans leurs chants. Ce n'ťtait point un
homme de chant; c'ťtait un homme de chuchotement ingťnieux et ŗ voix
basse, ou plutŰt ŗ peine ťtait-ce un homme.
La nature ou un accident d'enfance, en lui refusant la virilitť qui fait
les grandes passions, les grands malheurs, les grandes gloires, lui
avait aussi refusť cette puissance d'aimer qui est le tourment, mais
aussi qui est la fťconditť de l'‚me. Quand ces grandes passions sont
refusťes ŗ un homme, il faut se dťfier de lui. ņ dťfaut des grandes, il
est rťduit aux petites passions de la sociťtť: de l'envie, de la haine,
de l'amour-propre, quelquefois de l'ambition et de l'intrigue, comme les
NarsŤs de l'antiquitť. Les infirmes naissent jaloux: c'est la loi de la
nature; ils se vengent sur les Ítres complets du malheur et de
l'imperfection de leur Ítre; leur consolation, c'est de ravaler ce qui
les dťpasse. Un sens de moins peut dťtruire toute l'harmonie d'une ‚me;
une infirmitť vicie souvent toute une existence. Si Boileau n'avait pas
ťtť maladif il n'aurait pas ťcrit des satires, et si lord Byron, de nos
jours, n'avait pas ťtť boiteux, il n'aurait pas ťcrit _Don Juan_, cette
vengeance d'un esprit perverti par l'orgueil souffrant contre ceux qui
marchent droit. Le malheur est souvent mťchant, et cette mťchancetť est
la seule excusable; le coeur comprimť par une souffrance se dilate
rarement pour aimer les hommes.
VI
Une prťdisposition naturelle inclina donc Boileau ŗ la satire.
En effet, qu'est-ce que la satire? C'est la mauvaise humeur de l'esprit
chez les hommes qui, comme Boileau ou Horace, ne font que la satire des
oeuvres; c'est la mauvaise humeur de la vertu chez les hommes qui, comme
Juvťnal, font la satire des moeurs; mais toujours c'est la mauvaise
humeur. C'est l'explosion moqueuse ou virulente d'une ‚me plus sensible
aux laideurs qu'aux beautťs intellectuelles ou morales de l'humanitť.
L'enthousiasme et l'amour, ces deux seules vťritables Muses divines, ne
s'abaissent pas ŗ satiriser le genre humain; elles pleurent sur lui s'il
se souille, elles lui chantent le _Sursum corda_, de l'espťrance s'il se
dťcourage ou s'il se dťgrade. Elles croiraient se dťgrader elles-mÍmes
si elles lui prťsentaient le miroir satirique de Boileau ou le miroir
tragique de Juvťnal pour le faire rire de ses ridicules ou pour le
faire frťmir de ses crimes.
La satire procŤde du dťgoŻt ou de la haine, passions peu dignes d'Ítre
exprimťes en vers immortels par les poŽtes. Voilŗ pourquoi nous ne
plaÁons, dans notre opinion personnelle, ce genre de littťrature qu'ŗ un
degrť infťrieur dans les oeuvres de l'esprit humain. Nous exceptons
nťanmoins de ce mťpris les grandes et saintes indignations en vers de
_Juvťnal_, de _Gilbert_ et d'un poŽte unique dans notre temps,
_Barbier_. C'est lui qui, dans une _iambe_ intitulťe _la Curťe_, a ťgalť
Pindare en verve et dťpassť Juvťnal en colŤre, mais verve lyrique aux
images de Phidias comme _la Cavale_, colŤre sainte aux accents d'airain
comme l'_Imprťcation biblique_. Ces satires-lŗ ne sont pas de la haine;
elles sont l'amour du beau et de l'honnÍte poussť jusqu'ŗ la vengeance
contre le laid et le crime. Mais cette vengeance ťlevťe ne supplicie
personne; elle est anonyme, comme le glaive exterminateur dans les mains
de l'ange; elle ne tombe pas sur des tÍtes, mais sur des vices.
C'est ainsi que, dans une de ces satires immortelles, _Barbier_ flagelle
le Paris de 1830 du geste et du ton dont le Dante flagellait la
Florence de 1300. Ce poŽte, sans blesser personne, gourmande les cupides
bassesses de ces foules du lendemain qui se prťcipitent sur tout ce qui
tombe, et flťtrit les faciles victoires de ces fanfarons d'aprŤs coup
qui outragent tout ce qui est dťsarmť. …coutez-en seulement les derniers
vers; ils rappellent, par leur fruste ťnergie, le poil hťrissť et la
gueule sanglante de ce sanglier de Calydon qu'on voit sur la place du
marchť de Florence:
Ainsi, quand, dťsertant sa bauge solitaire,
Le sanglier, frappť de mort,
Est lŗ, tout palpitant, ťtendu sur la terre,
Et sous le soleil qui le mord;
Lorsque, blanchi de bave et la langue tirťe,
Ne bougeant plus en ses liens,
Il meurt, et que la trompe a sonnť la curťe
ņ toute la meute des chiens;
Toute la meute, alors, comme une vague immense,
Bondit; alors chaque m‚tin
Hurle en signe de joie, et prťpare d'avance
Ses larges crocs pour le festin.
Et puis vient la cohue, et les abois fťroces
Roulent de vallons en vallons;
Chiens courants et limiers, et dogues, et molosses,
Tout s'ťlance, et tout crie: Allons!
Quand le sanglier tombe et roule sur l'arŤne,
Allons! allons! les chiens sont rois!
Le cadavre est ŗ nous; payons-nous notre peine,
Nos coups de dents et nos abois.
Allons! nous n'avons plus de valet qui nous fouaille
Et qui se pende ŗ notre cou;
Du sang chaud, de la chair, allons, faisons ripaille,
Et gorgeons-nous tout notre soŻl!
Et tous, comme ouvriers que l'on met ŗ la t‚che,
Fouillent ces flancs ŗ plein museau,
Et de l'ongle et des dents travaillent sans rel‚che,
Car chacun en veut un morceau;
Car il faut au chenil que chacun d'eux revienne
Avec un os demi rongť,
Et que, trouvant au seuil son orgueilleuse chienne,
Jalouse et le poil allongť,
Il lui montre sa gueule encor rouge, et qui grogne,
Son os dans les dents arrÍtť,
Et lui crie, en jetant son quartier de charogne:
ęVoici ma part de royautť!Ľ
1830.
De telles satires sont des coups de foudre, et non des coups de
laniŤres. Cela ne blesse pas, cela ťcrase.
Les autres sont un supplice personnel infligť, comme disent les
satiristes, par le fouet de la satire ŗ des hommes dont ce fouet dťchire
la peau. Eh bien! quelle que soit la justice de ce supplice, nous ne
pouvons ni approuver ni excuser ceux qui se donnent la mission de
l'infliger au ridicule et mÍme au crime de leur temps. On m'apportait,
il y a peu d'annťes, en Italie, une de ces oeuvres de colŤre lťgitime
qui stigmatisent eu vers terribles des noms d'hommes vivants et qui font
saigner ťternellement les coups de verge ou les coups de poignard de la
plume. Comme j'exprimais par ma physionomie ma rťpulsion involontaire
pour ces oeuvres de colŤre, quelqu'un me dit: ęņ quoi pensez-vous? Ne
faut-il pas que justice soit faite de toutes ces iniquitťs? Ne faut-il
pas que toutes les mauvaises fortunes aient leur Nťmťsis?Ľ--ęOui,Ľ
rťpondis-je, ędans les sociťtťs d'hommes un exťcuteur est nťcessaire ŗ
la justice; il faut un bourreau, peut-Ítre, quoique je n'en sois pas
parfaitement convaincu, mais il ne faut pas Ítre le bourreau.Ľ
Le satiriste sanglant est le bourreau des renommťes; il jette au
charnier les noms dťpecťs de ses ennemis littťraires ou de ses ennemis
politiques. Ce n'est pas le mťtier des immortels. Ce sont lŗ de ces
gloires dont on se repent; il faut se les refuser, sinon par respect
pour ses ennemis, du moins par respect pour soi-mÍme.
Prise dans une acception plus vulgaire, la satire n'est qu'une ťpigramme
prolongťe. Une ťpigramme est un coup d'ťpingle ŗ une vie, ŗ un ridicule
ou ŗ un homme. Quand elle s'adresse ŗ un homme, ce n'est pas grand chose
qu'une ťpigramme; c'est une goutte de fiel dans un verre d'eau pour
rendre le breuvage de la raillerie amer ŗ celui qu'on force ŗ le boire.
Mais une satire littťraire, c'est-ŗ-dire une ťpigramme dťlayťe en deux
cents vers, c'est un torrent de fiel dans lequel on s'efforce de noyer
un nom. La masse de l'ťpigramme n'en corrige pas l'intention; c'est
toujours de la haine, de la haine qui rit au lieu de la haine qui tue,
mais enfin de la haine; si on ne veut pas tuer, on veut blesser. Le
principe de la satire ou de l'ťpigramme est mauvais, et ses rťsultats
sont cruels. Voilŗ pourquoi nous n'encourageons jamais les poŽtes ŗ cet
exercice haineux de leur gťnie. On y recueille ce qu'on a semť: on y
sŤme des larmes, on y recueille des larmes; mais celles qu'on rťpand
sont plus amŤres que celles que l'on a fait rťpandre.
VII
Les modŤles de Boileau, ceux qui tentŤrent son gťnie essentiellement
imitateur, furent ťvidemment Horace et Juvťnal, les deux satiristes
romains. Il ne devait jamais ťgaler dans ce genre ni la gr‚ce ŗ peine
maligne du doux, et voluptueux Horace, ni l'‚pre ťnergie de Juvťnal. La
satire d'Horace est un badinage; la satire de Juvťnal est une tragťdie.
Le premier, assis ŗ table entre Auguste, qu'il flatte, et Virgile, qu'il
aime, amuse le festin par quelques railleries dťcentes en vers contre
les mauvais poŽtes de Rome; un autre jour, couchť ŗ l'ombre des chÍnes
verts de sa petite maison de Tibur (aujourd'hui remplacťe par un
gracieux ermitage de capucins), au bruit et ŗ la poussiŤre humide des
cascatelles de l'_Anio_, dans lesquelles ses esclaves font rafraÓchir
son vin de _CadŤs_ ou de _Cťcube_, il ťcrit ŗ quelques amis de Rome une
ťpÓtre familiŤre oý ses vers bondissent et coulent comme les filets
d'ťcume de l'_Anio_ sur la mousse. Si une lťgŤre ironie ou si une
ťpigramme inoffensive contre quelque ennuyeux rťcitateur de vers lourds
de Rome s'y glisse ŗ son insu, il ne court pas aprŤs pour la retenir, il
la laisse rouler comme un caillou poli dans le lit de la cascade ou
comme un flocon d'ťcume sur l'eau transparente. On n'y sent pas la
haine, mais la confidence et la nťgligence d'un esprit souriant dans sa
bontť.
Boileau ne pouvait pas plus malheureusement choisir son modŤle que dans
Horace, l'_Hafiz_ de l'Occident, le _Saint-…vremond_ de Rome, le
_Voltaire_ de la poťsie fugitive; Boileau, l'habile aligneur de vers
travaillťs au marteau et ŗ la lime, le calqueur patient des choses
incalquables de l'antiquitť, le jansťniste de la religion comme du
style, dont toutes les gr‚ces et tous les amours n'ťtaient que des
contrefaÁons de lťgŤretťs lourdes et de voluptťs pťnibles, par un
ťrudit!
VIII
Quant ŗ Juvťnal, c'est autre chose. Boileau aurait pu l'imiter
complťtement et lui dťrober le stylet sanglant de la satire politique:
il avait pour cela assez d'‚cretť dans la bile et de dťgoŻt de
l'humanitť; mais la satire politique ťtait impossible ŗ un poŽte qui ne
voulait pas jouer sa tÍte contre un beau vers sous Louis XIV. Elle est
impossible sous la monarchie. Si on l'ťcrit dans le sens du monarque et
contre ses ennemis, elle est une l‚chetť, et un homme de talent, quelque
courtisan qu'il soit, rougit de la commettre. Si on l'ťcrit contre ce
qui tient le glaive, roi ou peuple, elle est un danger de mort, et on
dťvoue sa tÍte au licteur ou le sang de ses veines au suicide. Voyez
Chťnier. On ne pouvait donc ťcrire sous Louis XIV que des satires tout ŗ
fait insipides et insignifiantes contre les embarras des rues de Paris,
contre un mauvais cuisinier comme Mignot, contre un mauvais rimeur comme
Chapelain, contre un mauvais traducteur comme l'abbť Cottin, tristes
thŤmes pour un vrai gťnie satirique.
IX
Il y avait loin de lŗ ŗ ce Juvťnal ťcrivant dans des intervalles de
libertť sans frein, entre deux proscriptions ou entre deux tyrannies,
pendant l'ťcroulement de Nťron ou pendant l'interrŤgne de Domitien. Et
ťcrivant oý? au fond d'une solitude de Libye dans laquelle il avait ťtť
relťguť pour expier un vers contre le pantomime P‚ris, favori de
l'empereur!
Si Boileau n'avait ni l'‚me, ni le temps convenable pour ťgaler Juvťnal,
on voit par ses beaux vers sur ce poŽte qu'il avait la corde de
l'indignation aussi sonore que celle du Romain:
Juvťnal, ťlevť dans les cris de l'ťcole,
Poussa jusqu'ŗ l'excŤs sa mordante hyperbole.
Ses ouvrages, tout pleins d'affreuses vťritťs,
…tincellent pourtant de sublimes beautťs:
Soit que, sur un ťcrit arrivť de Caprťe,
Il brise de Sťjan la statue adorťe;
Soit qu'il fasse au conseil courir les sťnateurs,
D'un tyran soupÁonneux p‚les adulateurs;
Ou que, poussant ŗ bout la luxure latine,
Aux portefaix de Rome il vende Messaline!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Juvťnal ťtait le _Caton d'Utique_ des poŽtes; Boileau pouvait bien
admirer ce beau rŰle, cette protestation hťroÔque contre la servitude
et contre la corruption de Rome, mais il n'aspirait point ŗ l'imiter.
Il prťfťrait le rŰle d'adulateur dťcent d'un autre Auguste et d'ami d'un
autre MťcŤne.
Il faut Ítre juste envers lui; il n'y avait, depuis le cardinal de
Richelieu, ni TibŤre, ni Sťjan, ni Nťron ŗ supplicier poťtiquement en
France; il n'y avait pas mÍme lieu ŗ ces orgies de style, dans le
tableau des moeurs, dont Juvťnal salit effrontťment ses pages; peintures
plus hideuses du vice que le vice lui-mÍme! D'ailleurs la chastetť du
langage heureusement introduit dans l'histoire et dans la poťsie par une
religion plus pudique, dťfendait ŗ Boileau ces nuditťs de la chair,
scandales de l'esprit comme des yeux. Le christianisme avait jetť un
voile sur ces nuditťs. On s'ťtonne qu'aucun peuple civilisť ait pu
supporter les cynismes de style de ce Juvťnal. Ce n'ťtaient pas
seulement les _hyperboles_, comme les appelle son imitateur, c'ťtaient
les impudicitťs et les ťgouts de la langue.
ņ cela prŤs, Juvťnal, soit dans l'imprťcation contre les vices, soit
dans la peinture des vertus pures et douces qui font contraste aux
horreurs de ces vices, ťtait vťritablement un ťcrivain de premier ordre
dans la force comme dans la gr‚ce. Il a mÍme des sensibilitťs qu'on ne
rencontre jamais dans le satiriste franÁais, telles, par exemple, que ce
tableau des mťlancolies et des isolements de la vieillesse dans la
dixiŤme satire.
ęLors mÍme,Ľ dit-il dans ces beaux vers que Virgile n'aurait pas
dťsavouťs, ęlors mÍme que notre intelligence conserverait, dans l'‚ge
avancť, toute la vigueur de l'‚me, ne faut-il pas, hťlas! mener les
funťrailles de ses enfants? contempler le bŻcher qui consume les
dťpouilles d'une ťpouse longtemps aimťe, ou celles d'un frŤre? ou porter
dans ses mains des urnes pleines des cendres de nos soeurs? Cette
douleur a ťtť rťservťe ŗ ceux qui vivent longtemps, que leur foyer, sans
cesse dťcimť par de nouveaux trťpas, condamne ŗ vieillir dans une
perpťtuelle tristesse et sous des noirs vÍtements de deuil! Le roi de
Pylos, le vieux Nestor, si l'on en doit croire HomŤre, atteignit les
annťes de la corneille dans une constance de fťlicitť sans ťclipse,
heureux, selon le vulgaire, d'avoir ajournť la mort pendant tant de
rťvolutions des jours, et d'avoir bu si souvent le jus nouveau du raisin
qui coule du pressoir aux vendanges. Mais attendez un peu, et ťcoutez
avec quelle amertume il accuse les lois du Destin et la lenteur des
Parques ŗ couper la trame de sa vie, quand il voit la chevelure de son
cher Archiloque pťtiller sous la flamme du bŻcher funŤbre!... Car il
s'adresse ŗ tous ses proches qui l'entourent et leur demande par quel
crime il a mťritť du sort le supplice d'une vie si prolongťe. Ainsi
Pťlťe, quand il pleurait son fils Achille enlevť ŗ sa tendresse... Si,
avant la subversion de sa ville de Troie, Priam fŻt descendu chez les
ombres, Hector, son fils, aurait portť sur ses ťpaules et sur celles de
ses autres frŤres le corps vťnťrť de son pŤre, ŗ travers les Troyennes
gťmissantes, dont les filles du vieillard, Cassandre et PolyxŤne, les
vÍtements dťchirťs, auraient commencť les sanglots funŤbres! Hťlas! que
lui servirent ses longs jours? Il vit tout crouler autour de lui, et
l'Asie renversťe par le fer et par le feu. Alors, guerrier dťbile et
chancelant, il dťpose sa couronne pour prendre ses armes impuissantes,
et succombe au pied de l'autel de Jupiter, tel qu'un boeuf vieilli qui
tend ŗ la hache de son maÓtre un cou mince et dťcharnť par le travail,
pauvre animal devenu maintenant importun ŗ son maÓtre ingrat!Ľ
ę_Ab ingrato jam fastiditus aratro!_Ľ
De tels vers sont bien supťrieurs au style de la satire, et ils
illustreraient les plus pathťtiques ťpopťes. Nous n'en trouverons pas de
semblables dans le satiriste franÁais.
Quelques aspirations touchantes aux dťlices simples de la vie des champs
n'attestent pas moins, dans Juvťnal, une ‚me altťrťe de la nature et de
la retraite si chŤres aux poŽtes.
ęSi tu pouvais t'arracher aux spectacles du Cirque,Ľ dit-il ŗ son
interlocuteur imaginaire, ętu pourrais te construire ŗ _Sora_ ou ŗ
_Frosinone_ une maison convenable, ŗ moindre prix que tu ne payes ŗ Rome
le loyer d'un rťduit tťnťbreux; lŗ tu aurais ŗ toi un petit jardin, un
puits peu profond, dont l'eau, tirťe sans roue et sans corde,
dťsaltťrerait d'une facile ondťe tes plantes naissantes et tendres. Vis
lŗ, amant de la bÍche fourchue et possesseur d'un jardin cultivť de tes
propres mains, dont les lťgumes puissent suffire au repas frugal de cent
disciples de Pythagore! En quelque site, en quelque dťsert qu'il soit
situť, c'est quelque chose de dťlicieux que de s'Ítre fait le
possesseur d'une habitation champÍtre.Ľ
Et ailleurs: ęUn enfant rustique, sans autre parure que le vÍtement
nťcessaire pour le prťserver du froid, nous servira, dans des plats
d'argile, des mets achetťs au prix de peu de piŤces de cuivre. Tu ne
verras aucun de mes esclaves venu de Phrygie ou de Lycie ŗ Rome. Tout ce
que tu auras ŗ leur demander, demande-le-leur simplement en latin. Ils
sont tous vÍtus uniformťment, les cheveux coupťs court, droits et
peignťs seulement avec soin aujourd'hui par respect pour mes convives.
L'un est le fils de mon rude berger, l'autre de mon bouvier. Celui-ci
soupire aprŤs sa mŤre, qu'il n'a pas revue depuis trop longtemps;
triste, il regrette sa pauvre cabane et ses chameaux familiers. Il te
versera du vin pressurť sur les montagnes oý il est nť et sur le
penchant desquelles il fol‚trait naguŤre, car le vin et celui qui le
verse ont tous les deux la mÍme patrie?Ľ
Et ailleurs encore: ęUne si petite terre nourrissait autrefois le pŤre
et toute la foule domestique de son domaine, au milieu de laquelle une
ťpouse enceinte, assise sur le seuil, et quatre enfants, l'un fils de
l'esclave, les trois autres du maÓtre. Mais, aprŤs le repas des maÓtres,
un repas plus abondant attendait les frŤres aÓnťs au retour de la vigne
ou du sillon; la bouillie fumait pour eux dans les vastes chaudiŤres de
cuivre. ‘ mes enfants! ne demandons ŗ la charrue que le pain qui suffit
ŗ notre table. Vivez contents de ces cabanes et de ces collines
agrestes! Celui-lŗ ne fera rien de dťshonnÍte qui ne rougit pas
d'affronter les glaces avec des guÍtres montant jusqu'aux genoux, et de
braver la bise en retournant le poil de son manteau sur ses membres
rťchauffťs.Ľ
X
Nous nous sommes laissť entraÓner au charme de ces citations. On ne
trouve rien de semblable dans la satire franÁaise. On ignore la patrie
et la profession natale de Juvťnal; mais ŗ de tels vers, ŗ des retours
si complaisants vers la simplicitť et vers la frugalitť de la vie
rustique, on peut croire qu'il ťtait, comme Virgile, un enfant de la
glŤbe, et que les agrestes images de la campagne italique obsťdaient sa
belle imagination au milieu des sordiditťs de Rome. Un grand amour des
choses honnÍtes ťclate partout dans ses dťgoŻts mÍme les plus scandaleux
d'expression contre le vice.
XI
Boileau n'avait rien d'une telle origine; c'ťtait un fils du pavť d'une
grande ville; il ťtait nť dans cette sombre cour du Palais, au bruit de
la chicane, d'un pŤre greffier; l'ťcole avait ťtť sa seule nourrice.
Voltaire, ce Boileau transcendant, ce Boileau qui donna au bon sens et
au bon goŻt franÁais des ailes plus vastes, plus hautes et plus lťgŤres,
reconnaissait tout ce qu'il devait ŗ son maÓtre. Nť comme lui et peu de
temps aprŤs lui dans le mÍme quartier de Paris et presque dans les mÍmes
conditions de famille, voici comment il en parle ŗ prŤs de quatre-vingts
ans, dans un de ses plus gracieux accŤs de verve:
Boileau, correct auteur de solides ťcrits,
ZoÔle de Quinault et flatteur de Louis,
Mais oracle du goŻt dans cet art difficile
Oý s'ťgayait Horace, oý travaillait Virgile,
Dans la cour du Palais je naquis ton voisin;
De ton siŤcle ťclatant mes yeux virent la fin:
SiŤcle de grands talents bien plus que de lumiŤre.
Dont Corneille en bronchant sut ouvrir la carriŤre.
Je vis le jardinier de ta maison d'Auteuil,
Qui chez toi, pour rimer, planta le chŤvrefeuil.
Chez ton neveu Dongois je passai mon enfance,
Bon bourgeois, qui se crut un homme d'importance.
Je veux ťcrire un mot sur tes sots ennemis,
ņ l'hŰtel Rambouillet contre toi rťunis,
Qui voulaient, pour loyer de tes rimes sincŤres,
Couronnť de lauriers t'envoyer aux galŤres;
Ces petits beaux esprits craignaient la vťritť,
Et du sel de tes vers la piquante ‚cretť.
Louis avait du goŻt, Louis aimait la gloire;
Il voulut que ta muse assur‚t sa mťmoire,
Et, satirique heureux, par ton prince avouť,
Tu pus censurer tout, pourvu qu'il fŻt louť!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Et moi je fais trembler dans mes derniers moments
Et les pťdants jaloux, et les petits tyrans.
J'ose agir sans rien craindre, ainsi que j'ose ťcrire;
Je fais le bien que j'aime, et voilŗ ma satire!
Nous nous verrons, Boileau! tu me prťsenteras
Chapelain, Scudťry, Perrin, Pradon, Coras.
Mais je veux avec toi baiser dans l'…lysťe
La main qui nous peignit l'ťpouse de Thťsťe.
Tandis que j'ai vťcu, l'on m'a vu hautement
Aux badauds effarťs dire mon sentiment;
Je veux le dire encor dans les royaumes sombres:
S'ils ont des prťjugťs j'en guťrirai les ombres!
ņ table avec VendŰme, et Chapelle, et Chaulieu,
M'enivrant du nectar qu'on boit dans ce beau lieu,
Secondť de Ninon, dont je fus lťgataire.
J'adoucirai les traits de ton humeur austŤre.
Partons! dťpÍche-toi, curť de mon hameau;
Viens de ton eau bťnite asperger mon caveau!
On sent plus, dans ces vers du premier disciple de Boileau, la
sautillante inspiration d'Horace que le pas grave et lourd de Boileau
lui-mÍme; mais on voit que Voltaire ne craignait pas plus que nous de
confesser une sťrieuse estime pour les services littťraires de celui
qu'il nomme l'_oracle du goŻt_, dans un temps oý le gťnie franÁais ťtait
nť avec Corneille, et oý il allait pťrir, sans Boileau, dans les
mignardises italiennes ou dans les rodomontades espagnoles de l'hŰtel de
Rambouillet.
XII
Nous ne raconterons pas la vie de Boileau.
Boileau d'ailleurs n'eut point de vie, car il n'eut ni aventures ni
passions. La vie des poŽtes est dans leur coeur; celui-lŗ n'avait que de
l'esprit. Toute sa vie est dans son bon sens. Il l'avait reÁu de la
nature, innť, incorruptible, inflexible. Les ťtudes sťvŤres, seule
consolation des infirmitťs prťcoces qui attristŤrent son enfance et sa
jeunesse, avaient appliquť en lui ce bon sens au bon goŻt dans les
lettres. QuinziŤme enfant d'un pŤre greffier du parlement, privť de
bonne heure des soins et de l'affection de sa mŤre, opťrť de la pierre ŗ
douze ans, nourri dans les collťges, ce dur et froid noviciat des
enfants sevrťs de leurs familles, jetť ensuite contre son grť dans des
ťtudes de thťologie et de jurisprudence dont les arguties lui
rťpugnŤrent, possesseur d'une petite fortune suffisant ŗ la modestie de
ses dťsirs aprŤs la mort d'un pŤre laborieux; sans ambition, sans
intrigue, sans chaleur dans l'‚me, mais non sans amitiť; amateur de tout
ce qu'on appelle vertu par probitť naturelle d'esprit et par ce penchant
honnÍte qui est le bon goŻt de l'‚me, il prit contre son siŤcle la plume
de Caton le Censeur, et il ťcrivit des satires pour rťformer le mauvais
goŻt, comme, dans une autre fortune, il aurait pris la hache des
licteurs pour rťformer les mauvaises moeurs de sa patrie.
Il ne regarda de la vie que les livres; il s'attira de bonne heure la
haine des mauvais ťcrivains, l'amitiť des illustres. Il fut recherchť de
la cour sans s'y livrer; il honora dans Louis XIV l'autoritť souveraine
et la majestť du rŤgne sans flatter dans le roi d'autre faiblesse que
celle de la gloire. Il ne fut point courtisan comme Racine; il fut plus
immaculť de complaisance que Bossuet, plus pur de tout manťge que
Fťnelon, plus noblement dťsintťressť que Corneille, aussi dťgagť
d'orgueil et d'envie que MoliŤre, exemple accompli du parfait honnÍte
homme dans sa vie publique comme dans sa vie privťe.
Retirť souvent dans sa petite maison de campagne d'Auteuil, dont il
avait fait son _Lucretile_ ŗ l'exemple d'Horace, il y cultivait ŗ la
fois ses plantes et ses livres; il y recevait, pendant l'ťtť, ŗ sa table
frugale, mais dťcente, tout ce que la France possťdait d'hommes vťnťrťs
par la vertu, illustres par le gťnie. On ferait son histoire par ses
amitiťs; elles ťtaient toutes pures, grandes ou glorieuses. Il vieillit
ainsi jusqu'aux limites assignťes par la nature aux plus longues vies,
et mourut avec fermetť, comme il convient ŗ un homme qui a beaucoup
pensť au nťant pompeux des choses humaines et ŗ la grandeur des
espťrances au delŗ du tombeau.
Voilŗ Boileau comme homme; voyons Boileau comme ťcrivain.
XIII
Comme ťcrivain, selon nous, son plus grand mťrite fut d'avoir ťtť
l'homme nťcessaire au moment oý il apparut dans notre littťrature. Cette
littťrature courait ŗ sa perte en se dťnationalisant trop sur les pas
des imitateurs du style italien et du style espagnol. Il lui fallait un
vigoureux coup de fťrule sur les mains qui tenaient la plume depuis
Ronsard. Sans doute Ronsard ťtait mille fois plus poŽte que Boileau; il
y avait, dans ce gentilhomme de cour et d'ťpťe, du _Tasse_, du
_Pťtrarque_, de l'_Arioste_, presque du _Pindare_; il y avait aussi de
l'_Horace_. Il y avait de plus une certaine gr‚ce juvťnile et gauloise
qui charmait l'esprit sans doute, mais qui tendait trop ŗ faire tomber
la langue et la littťrature dans une seconde enfance. Cette seconde
enfance, qui n'a pas l'inexpťrience et la naÔvetť vraie de la premiŤre,
pouvait faire dťgťnťrer l'esprit franÁais en affťterie, en mignardise,
en jeu d'esprit, toutes choses indignes d'une grande langue et d'un
grand peuple.
XIV
ņ cŰtť de l'ťcole de Ronsard, qui triomphait ŗ l'hŰtel de Rambouillet,
et en opposition avec elle, il s'ťtait formť une ťcole pťdantesque,
pťnible, lourde, gauche, inhabilement imitatrice, mais trŤs-orgueilleuse
et trŤs-puissante, dont _Pradon_, _Chapelain_ et d'autres ťcrivains
estimables, mais sans gťnie, ťtaient les soleils, selon l'expression de
Boileau; ťcole littťraire qui s'ťtait emparťe par la prťtention, par _la
camaraderie_ et par la suffisance, de la cour, des salons, de ce qu'on
appelait alors _les ruelles_, et surtout des faveurs lucratives du
gouvernement.
Cette coterie littťraire, toute-puissante et comme inviolable dans
l'opinion, rappelait assez l'ťcole dogmatique qui a prťvalu depuis
trente ans parmi nous en politique et mÍme en littťrature, par une
volontť tenace et bien disciplinťe plus que par une vťritable
supťrioritť de gťnie. Les Pradon et les Chapelain obstruaient la voie
aux _Corneille_, aux _Racine_, aux _MoliŤre_, aux _Bossuet_, aux
_Fťnelon_, vťritables grandeurs de la nature, ťclipsťes ou ajournťes par
ces fausses grandeurs d'engouement. La littťrature franÁaise, entre
leurs mains, allait mourir d'ennui avant d'Ítre nťe.
C'est contre ces faux grands hommes que Boileau osa ouvrir une campagne
de critique ‚pre, mais courageuse, qui n'ťtait ni sans danger ni sans
gloire dans un jeune homme qui n'avait d'autre appui que sa passion pour
le vrai. Mais, en tacticien habile, ce jeune homme commenÁa, pour
assurer sa position, par dťsintťresser l'amour-propre du roi de cette
querelle entre les ťcrivains de son rŤgne, et par payer largement ŗ
Louis XIV le tribut de gloire ou de vanitť que ce prince levait avant
tout sur les gťnies de son siŤcle.
XV
C'est ťvidemment ŗ cette tactique, presque lťgitime dans un jeune poŽte
sans patrons, que l'on doit attribuer les ťloges rťitťrťs de Boileau au
maÓtre des lettres comme des armes; car on ne voit dans le reste de la
vie de cet homme austŤre aucune autre trace de bassesse et aucun
penchant innť ŗ la flatterie. S'il y en a dans ses ťpÓtres ŗ Louis XIV,
c'est que ce roi ťtait placť dans l'esprit de ses courtisans hors la loi
mortelle et par ses poŽtes hors de la vťritť. Le censeur de son siŤcle
dťbuta donc par une ťpÓtre au roi. Cette ťpÓtre ťtait dťjŗ une satire.
Les vers ŗ deux visages louaient le roi d'un cŰtť, mordaient de l'autre
les adulateurs ordinaires du prince.
Jeune et vaillant hťros, dont la haute sagesse
N'est point le fruit tardif d'une lente vieillesse,
Mais qui, seul, sans ministre, ŗ l'exemple des dieux,
Soutiens tout par toi-mÍme et vois tout par tes yeux,
Grand roi, si jusqu'ici, par un trait de prudence,
J'ai demeurť pour toi dans un humble silence,
Ce n'est pas que mon coeur vainement suspendu
Balance pour t'offrir un encens qui t'est dŻ;
Mais je sais peu louer. . . . . . . .
Je mesure mon vol ŗ mon faible gťnie,
Plus sage en mon respect que ces hardis mortels
Qui d'un indigne encens profanent tes autels,
Qui, dans ce champ d'honneur oý le gain les amŤne,
Osent chanter ton nom sans force et sans haleine,
Et qui vont tous les jours d'une importune voix
T'ennuyer du rťcit de tes propres exploits.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
C'est ŗ leurs doctes mains, si l'on veut les en croire,
Que Phťbus a commis tout le soin de ta gloire;
Et ton nom, du Midi jusqu'ŗ l'Ourse vantť,
Ne devra qu'ŗ leurs vers son immortalitť.
Ah! plutŰt, sans ce nom, dont la vive lumiŤre
Donne un lustre ťclatant ŗ leur veine grossiŤre,
Ils verraient leurs ťcrits, honte de l'univers,
Pourrir dans la poussiŤre ŗ la merci des vers!
Pour chanter un Auguste il faut Ítre un Virgile.
Toute la fin de cette ťpÓtre est ťcrite avec la vigueur du style
cornťlien, avec la limpiditť du style racinien, avec la propriťtť acťrťe
du style de MoliŤre. Boileau entremÍle si habilement et si
indissolublement les louanges du roi aux mťpris contre les mauvais
ťcrivains que l'enthousiasme emporte avec lui l'ťpigramme, et qu'il est
impossible de supprimer une invective contre les poŽtes de cour sans
supprimer dans le mÍme vers une magnifique apothťose du roi. Ce dťbut,
qui caressa dťlicieusement les oreilles de Louis XIV, valut du premier
coup ŗ Boileau l'amnistie de la cour sur tout ce qu'il pourrait ťcrire
contre les rimeurs en crťdit du temps. Il eut le privilťge de ses
satires. Louis XIV sentit qu'il fallait tout accorder ŗ un jeune poŽte
qui se montrait si supťrieur ŗ ses rivaux, et qui dispensait d'une main
si magistrale le dťdain au mauvais goŻt, la gloire au grand rŤgne.
Ajoutons que, dans cette mÍme ťpÓtre et toujours depuis, Boileau,
capable de mťpris, mais incapable d'envie, sťparait Corneille, Racine,
MoliŤre, de la tourbe des ťcrivains mercenaires, et s'honorait de son
admiration pour ces grands hommes comme de leur amitiť pour lui. C'est
lŗ ce qui distingue le satiriste du libelliste, l'homme de goŻt du vil
envieux.
XVI
Les qualitťs vťritablement antiques du style de Boileau, qualitťs neuves
ŗ force d'Ítre antiques, apparurent ainsi dŤs ses premiers vers. Vťritť,
clartť, propriťtť, sobriťtť saine, sens spirituel et juste dans une
image naturelle et proportionnťe au sens, harmonie des vers sans
mollesse, briŤvetť de la phrase poťtique qui ajoute ŗ sa vigueur, trait
inattendu qui frappe avant d'avoir averti, peu d'ťlan, mais une marche
vive et sŻre qui va droit au but et qui ne trťbuche jamais; en un mot
toutes les qualitťs, non d'un grand poŽte, mais d'un grand manieur de la
langue poťtique, voilŗ ce qui distingua ŗ l'instant ce jeune homme et
qui donna ŗ sa jeunesse l'autoritť d'un ‚ge avancť.
On crut que l'Horace latin de l'Art poťtique, des …pÓtres et des
Satires, s'ťtait incarnť de nouveau ŗ Paris pour ch‚tier les lettres et
pour amuser un autre Auguste: on se trompait. Le lyrisme et la gr‚ce, le
_molle et facetum_, manquaient ŗ la ressemblance, mais le goŻt, l'esprit
et la langue ťtaient ŗ l'unisson dans les deux poŽtes. Il y avait plus
d'analogie avec Juvťnal; mais, s'il tombait moins bas, le satiriste
franÁais s'ťlevait moins haut que le latin. Il avait de plus le mťrite
de ne jamais faire rougir ni la pudeur du front, ni la pudeur de
l'esprit, et de conserver toujours, mÍme dans ses dťbordements de verve
et de fiel, cette pudicitť des mots qui est la dťlicatesse du goŻt,
comme la dťcence des actes est la dťlicatesse du coeur. Il ne donnait
point au franÁais, comme son prťdťcesseur _Rťgnier_, l'effronterie du
latin. On sentait qu'il parlait dans une langue vÍtue et chaste, qui
s'offense des nuditťs du style comme d'une profanation des yeux.
XVII
La premiŤre de ses satires, qui suivit son _…pÓtre au Roi_, n'est qu'une
dťclamation un peu vague, calquťe d'Horace et de Juvťnal et appliquťe
aux moeurs gťnťrales du temps. Beaucoup de vers en sont devenus
proverbes; mais les proverbes, qui sont des images dans l'Orient, ne
sont que des maximes en Occident. On peut Ítre proverbial chez nous sans
Ítre poťtique. C'est le don de Boileau, de MoliŤre, de Voltaire, les
plus spirituels des ťcrivains en vers, mais les moins vťritablement
poŽtes. L'esprit suffit pour faire un proverbe; l'imagination et
l'enthousiasme sont nťcessaires pour ťcrire un vers de sentiment.
J'appelle un chat un chat et Rollet un fripon,
n'est qu'un mot cruel rťdigť en douze pieds. La malignitť de Boileau,
qui ne rougit pas dans cette satire d'attaquer les mauvais poŽtes
jusque dans leur mauvaise fortune, lui fera reprocher ťternellement
cette insulte ŗ l'indigence, restťe proverbiale aussi, mais proverbiale
contre son coeur:
Tandis que Colletet, crottť jusqu'ŗ l'ťchine,
S'en va chercher son pain de cuisine en cuisine.
Ce n'ťtait pas ainsi que Juvťnal, son maÓtre, parlait des indigences et
des labeurs de l'esprit; dans ses plus mordantes invectives contre les
fautes du talent, il laissait tomber une larme chaude sur les iniquitťs
de la fortune. ęIl est beau, il est lťgitime, s'ťcriait-il en deux vers
pieux, de gagner le salaire de son gťnie par le travail de
l'intelligence.Ľ Boileau, dans ses vers, ťtait d'autant plus inexcusable
que dťjŗ il recevait du roi une pension pour ses louanges prťcoces, et
que son aisance poťtique n'ťtait pas encore le prix du travail, mais le
salaire de la flatterie.
La seconde satire est adressťe ŗ MoliŤre:
Rare et fameux esprit, dont la fertile veine
Ignore en ťcrivant le travail et la peine,
Pour qui tient Apollon tous ses trťsors ouverts,
Et qui sait ŗ quel coin se frappent les bons vers!
Cette satire n'est qu'une charmante et piquante plaisanterie, pleine de
ce qu'on appelait alors le sel attique ou la sťve grecque, sur les
difficultťs de la rime dans le mŤtre franÁais. Il cite ŗ MoliŤre, pour
exemple de ces contradictions de la rime et du sens, une foule de
circonstances oý, cherchant ŗ trouver le nom d'un homme de gťnie, la
rime lui prťsente au bout du vers le nom d'un plat ou ridicule ťcrivain.
Cette litanie de la sottise est entremÍlťe cependant de vers plus
poťtiques qu'ťpigrammatiques, dans lesquels on aime ŗ retrouver quelques
aspirations nonchalantes d'Horace ŗ la paix et ŗ l'obscuritť des champs.
Nous les citons, car de tels vers sont trop rares dans Boileau. Ils
dťlassent de la mťchancetť par le charme, ils dťtendent l'esprit, comme
un air de flŻte au milieu d'un aigre concert d'instruments aigus.
Ah! maudit soit celui dont la verve insensťe
Dans les bornes d'un vers enferma la pensťe,
Et, donnant ŗ l'esprit une ťtroite prison,
Voulut avec la rime enchaÓner la raison!
Sans ce mťtier, fatal au repos de ma vie,
Mes jours pleins de loisirs couleraient sans envie;
Mon coeur, exempt de soins, libre de passion,
Sait donner une borne ŗ mon ambition.
…vitant des grandeurs la prťsence importune,
Je ne vais point au Louvre adorer la fortune.
La satire sur le repas, presque entiŤrement imitťe de Juvťnal, ne se
relŤve qu'ŗ la fin par une salve d'ťpigrammes ironiques qui jaillissent
comme la mousse d'un vin de dessert sur tous les noms des ennemis de
Boileau.
Plusieurs ne sont que des discours en vers sur des gťnťralitťs de
morale, heureusement rimťes, mais infiniment au-dessous des discours en
vers de Voltaire, un des chefs-d'oeuvre de cet esprit universel. Celle
sur la noblesse est une imprťcation contre les inťgalitťs de rang qui
prťludait de bien loin ŗ la rťvolution franÁaise et que Louis XIV
autorisait parce qu'il ne comprenait d'inťgalitť que pour le trŰne. ņ
peine imprimerait-on de telles maximes de dťmocratie aujourd'hui.
Boileau, MoliŤre et Fťnelon sapaient en pleine cour l'institution qui
peuple les cours.
Que maudit soit le jour oý cette vanitť
Vint ici de nos moeurs souiller la puretť!
Dans les temps bien heureux du monde en son enfance,
Chacun mettait sa gloire en sa seule innocence,
Chacun vivait content et sous d'ťgales lois;
Le mťrite y faisait la noblesse et les rois,
Et, sans chercher l'appui d'une naissance illustre,
Un hťros de soi-mÍme empruntait tout son lustre;
Mais enfin par le temps le mťrite avili
Vit l'honneur en roture et le vice ennobli,
Et l'orgueil, d'un faux titre appuyant sa faiblesse,
MaÓtrisa les humains sous le nom de noblesse.
La satire sur les embarras des rues de Paris n'est qu'une boutade sans
originalitť, sans gr‚ce et sans sel. Celle qui suit commence par de
trŤs-beaux vers sur le mťtier du satiriste:
Muse, changeons de style et quittons la satire;
C'est un mťchant mťtier que celui de mťdire;
ņ l'auteur qui l'embrasse il est toujours fatal:
Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal.
Le poŽte aveuglť d'une telle manie
En courant ŗ l'honneur trouve l'ignominie,
Et tel mot, pour avoir rťjoui le lecteur,
A coŻtť bien souvent des larmes ŗ l'auteur.
Celle sur l'avarice, ŗ travers des banalitťs mesquines, a des accents
de gťnie romain dans la bouche de Caton ou de SťnŤque. La morale y est
ťloquente comme le drame. Ces vers, traduits de _Perse_, ne le cŤdent
pas au latin le plus ferme.
Le sommeil sur mes yeux commence ŗ s'ťpancher.
Debout! dit l'Avarice, il est temps de marcher!
--Eh! laisse-moi!--Debout!--Un moment!--Tu rťpliques!
--ņ peine le soleil fait ouvrir les boutiques.
--N'importe, lŤve-toi!--Pourquoi faire, aprŤs tout?
--Pour courir l'Ocťan de l'un ŗ l'autre bout,
Chercher jusqu'au Japon la porcelaine et l'ambre,
Rapporter de _Goa_ le poivre et le gingembre.
--Mais j'ai des biens en foule et je puis m'en passer!
--On n'en peut trop avoir, et pour en amasser
Il ne faut ťpargner ni crime ni parjure,
Il faut souffrir la faim et coucher sur la dure,
Avoir plus de trťsors que n'en perdit Galet,
N'avoir dans sa maison ni meubles ni valet,
Parmi des tas de blť vivre de seigle et d'orge,
De peur de perdre un liard souffrir qu'on vous ťgorge.
--Et pourquoi cette ťpargne enfin?--L'ignores-tu?
Afin qu'un hťritier, bien nourri, bien vÍtu,
Profitant d'un trťsor en tes mains inutile,
De son train quelque jour embarrasse la ville!
--Que faire?--Il faut partir; les matelots sont prÍts!
Pour quiconque a reÁu le sens du style et du vers, ce dialogue ťgale
Boileau aux plus grands artisans de la langue. Ici mÍme ce n'est plus un
artisan de la langue, c'est un poŽte vťritable. La verve latine enivre
sa diction un peu froide.
Que faire?--Il faut partir; les matelots sont prÍts!...
est une image interrompue qui emporte l'avare et le lecteur jusqu'aux
extrťmitťs de l'Ocťan, ŗ la fortune ou ŗ la mort.
La satire qu'il adresse ironiquement ŗ son esprit, pour le gourmander
sur sa manie de mťdire, est l'apogťe de son talent de critique. Elle
ťtincelle comme le fer chaud sous le marteau de forge, et chaque
ťtincelle brŻle le nom d'un de ses ennemis; mais elle est sans pitiť et
souvent sans justice. Ces beautťs sont des crimes d'esprit qu'on ne peut
admirer qu'en les dťplorant, crimes brillants, mais inutiles, mÍme au
bon goŻt qu'ils prťtendent venger; car le temps suffit seul ŗ ťteindre
toutes ces fausses gloires. _Guarda e passa!_ Regarde et passe, est le
seul mot ŗ dire en passant ainsi en revue toutes les mťdiocritťs et
tous les engouements d'un siŤcle.
La dixiŤme, contre les femmes, est une dťclamation d'ťcolier qui ne
mťrite pas d'Ítre lue. Il n'appartenait pas ŗ un poŽte sans passion de
parler des femmes. Le seul juste jugement des femmes, c'est l'amour; qui
ne les adore pas ne les connaÓt pas. Il me semble entendre un buveur
d'eau parler de l'ivresse. Si on les juge par les vertus naturelles de
leur sexe, on les divinise; si on les juge par les vices d'un trŤs-petit
nombre d'entre elles, on les calomnie et on les profane. Les vrais
poŽtes, comme les vrais hťros, se reconnaissent ŗ l'adoration qu'ils ont
pour elles. HomŤre, Dante, Pťtrarque, Milton, Racine, Byron ont tous
donnť ŗ leurs poťsies des noms de femmes. Andromaque, Bťatrice, Laure,
l'ťpouse et les filles de l'HomŤre anglais, les hťroÔnes innomťes de
l'auteur de Lara, cťlŤbres sous les noms de _Mťdora_ ou de _Gulnare_,
sont toutes des dťifications de ce sexe outragť par Boileau. C'est une
page ŗ dťchirer de ce livre oý manquera ťternellement la page du coeur.
Ce crime contre l'amour porta malheur aux autres satires de Boileau.
Dťpourvu, dans celles sur l'_honneur_ et sur l'_ťquivoque_, de l'appui
des anciens, qui n'avaient pas pu toucher ŗ ces sujets tout modernes, il
se traÓna lourdement dans des banalitťs sans traces. Sa prose,
pťniblement rimťe, n'eut rien du vers que son uniformitť et sa
monotonie.
XVIII
De l'aveu de tous les critiques, il se releva dans ses ťpÓtres, non
jamais ŗ la gr‚ce, mais ŗ la perfection de sens et de versification de
son modŤle, Horace. L'ťpÓtre, sorte de lettre plus ou moins familiŤre en
vers, laisse bien plus de libertť et de souplesse au style. C'est un
instrument poťtique qui a toutes les notes graves ou douces du clavier.
On peut y Ítre familier sans Ítre vulgaire, on peut s'y montrer
ingťnieux sans Ítre mťchant.
ņ l'exception de celles de Voltaire, nous n'avons rien dans la langue
franÁaise d'aussi parfait dans le style tempťrť que les belles ťpÓtres
de Boileau; quelquefois mÍme elles s'ťlŤvent au sublime contemplatif ou
descriptif, comme dans l'ťpÓtre sur le passage du Rhin par l'armťe de
Louis XIV, ou comme dans l'ťpÓtre vengeresse adressťe ŗ Racine, mťconnu
par son siŤcle et attendu par la postťritť. Elles sont le fruit plus mŻr
de ses annťes. L'‚ge lui apportait, comme ŗ Voltaire, ce qu'il emporte
souvent aux esprits sans longťvitť, la flexibilitť assouplie et l'habile
nťgligence, ces gr‚ces du gťnie au repos.
La premiŤre, au Roi, a des accents dignes de Virgile parlant la
philosophie de SťnŤque:
. . . . . . En vain aux conquťrants
L'erreur parmi les rois donne les premiers rangs;
Entre les vrais hťros ce sont les plus vulgaires;
Chaque siŤcle est fťcond en heureux tťmťraires,
Chaque climat produit ces favoris de Mars:
La Seine a des Bourbons, le Tibre a des Cťsars!
Combien n'a-t-on pas vu des fanges Mťotides
Sortir ces conquťrants, Goths, Vandales, Gťpides?
Mais un roi vraiment roi, qui, juste en ses projets,
Sache en un calme heureux maintenir ses sujets,
Qui du bonheur public ait cimentť sa gloire,
Il faut pour le trouver courir toute l'histoire.
La terre compte peu de ces rois bienfaisants;
Le Ciel ŗ les former se prťpare longtemps.
Tel fut cet empereur sous qui Rome adorťe
Vit renaÓtre les jours de Saturne et de Rhťe,
Qui rendit de son joug l'univers amoureux,
Qu'on n'alla jamais voir sans revenir heureux;
Qui soupirait le soir si sa main fortunťe
N'avait par des bienfaits signalť sa journťe.
Le cours ne fut pas long d'un empire si doux!
Si on lisait ces vers admirables dans une scŤne de la tragťdie de
_Britannicus_, un des chefs-d'oeuvre de Racine, qui pourrait distinguer
entre le style poťtique de Boileau et le style de Racine? L'ťpÓtre ici
est ťgale ŗ la tragťdie, et les deux ťcrivains amis sont, dans des
ordres de poťsie diffťrents, au mÍme niveau de diction poťtique.
L'ťpÓtre badine ŗ M. de Guilleragues ťtincelle de beautťs d'un autre
genre. Boileau vieilli aspire au repos, donne et demande la paix ŗ ses
ennemis.
J'ťtais plus irritable et plus guerroyant, lui dit-il,
Quand mes cheveux plus noirs ombrageaient mon visage.
Maintenant que le temps a mŻri mes dťsirs,
Que mon ‚ge, amoureux de plus sages plaisirs,
S'en va bientŰt frapper ŗ son neuviŤme lustre,
J'aime mieux mon repos qu'une fatigue illustre.
Aujourd'hui, vieux lion, je suis doux et traitable;
Je n'arme plus contre eux mes ongles ťmoussťs:
Ainsi que mes beaux jours mes chagrins sont passťs.
Qu'ŗ son grť dťsormais la Fortune me joue;
On me verra dormir au branle de sa roue!
Y a-t-il dans La Fontaine des vers supťrieurs en philosophie
ťpicurienne? Y en a-t-il d'aussi riches en images appropriťes au sens,
et d'aussi vibrants d'harmonie? Ne sont-ce pas lŗ des mťdailles de style
poťtique qu'on ne trouverait, en aussi grande abondance, dans aucun
ťcrivain de tous nos siŤcles franÁais?
XIX
Boileau avait trouvť au petit village d'Auteuil, alors isolť de Paris,
l'abri que tout homme sensible ou las cherche au soir de sa vie.
Les simples paysages des collines de Paris et les dťlicieux loisirs des
champes, savourťs par un esprit nonchalant, sont retracťs, dans l'ťpÓtre
ŗ M. de Lamoignon, comme Horace retrace les collines de Tivoli et les
heures paresseuses de sa vie encaissťe dans son jardin ŗ _Lucretile_.
Du lieu qui me retient veux-tu voir le tableau?
C'est un petit village, ou plutŰt un hameau,
B‚ti sur le penchant d'un long rang de collines,
D'oý l'oeil s'ťgare au loin dans les plaines voisines;
La Seine, au pied des monts que son flot vient laver,
Voit du sein de ses eaux vingt Óles s'ťlever,
Qui, partageant son cours par leurs vertes barriŤres,
D'une riviŤre seule y forment vingt riviŤres.
Tous ses bords sont couverts de saules non plantťs,
Et de noyers souvent du passant insultťs.
La maison du Seigneur, seule un peu plus ornťe,
Se prťsente au dehors de murs environnťe.
Le soleil en naissant la regarde d'abord,
Et le mont la dťfend des outrages du nord.
C'est lŗ, cher Lamoignon, que mon esprit tranquille
Met ŗ profit les jours que la Parque me file.
Ici, dans ce vallon qui borne mes dťsirs,
J'achŤte ŗ peu de frais de solides plaisirs:
TantŰt, un livre en main, errant dans les prairies,
J'occupe ma raison d'utiles rÍveries;
TantŰt, cherchant la fin d'un vers que je construi,
Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait fui.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
‘ fortunť sťjour! Ű champs aimťs des cieux!
Que pour jamais, foulant vos prťs dťlicieux,
Ne puis-je ici fixer ma course vagabonde,
Et, connu de vous seuls, oublier tout le monde!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
N'est-ce pas, dans la mÍme langue et dans un autre esprit, la pathťtique
invocation de PhŤdre ŗ la fraÓcheur des forÍts, dans Racine:
Dieux! que ne suis-je assise ŗ l'ombre des forÍts?
N'est-ce pas le vers savoureux d'oubli du poŽte romain:
_Ducere sollicitś jucunda oblivia vitś?_
Peut-on soutenir qu'un tel homme ne fut que le pťdagogue des poŽtes? Oý
trouvera-t-on de pareilles dťlices d'oreille en franÁais? Et ces dťlices
ťtaient des prťmices, il ne faut pas l'oublier.
…coutez comme il continue dans le mÍme style:
Qu'heureux est le mortel qui, du monde ignorť,
Vit content de soi-mÍme ŗ l'ombre retirť!
Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommťe
N'a jamais enivrť d'une vaine fumťe!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Il n'a point ŗ subir d'affronts ni d'injustices,
Et du peuple inconstant il brave les caprices.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
On le presse de produire encore; il rťpond
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Cependant tout dťcroÓt, et moi-mÍme, ŗ qui l'‚ge
D'aucune ride encor n'a flťtri le visage,
Dťjŗ moins plein de feu, pour animer ma voix
J'ai besoin du silence et de l'ombre des bois.
Ma muse, qui se plaÓt dans leurs routes perdues,
Ne saurait plus marcher sur le pavť des rues!
Plus loin, seul contre tous, il prend courageusement corps ŗ corps
l'injustice du siŤcle envers Racine, son ami; il emprunte ŗ l'auteur
d'_Athalie_ son style pour terrasser l'envie qui rapetissait dťjŗ le
grand tragique. Il lui rappelle l'abandon dans lequel le siŤcle avait
laissť mourir quelques jours avant MoliŤre.
Avant qu'un peu de terre, obtenu par priŤre,
Pour jamais sous sa tombe eŻt enfermť MoliŤre...
on ravala sa gloire comme la tienne, lui dit-il;
Mais sitŰt que, d'un trait de ses fatales mains,
La Parque l'eut rayť du nombre des humains,
On reconnut le prix de sa muse ťclipsťe.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Je soulŤve pour toi l'ťquitable avenir.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
XX
Son poŽme de l'_Art poťtique_, froide et prosaÔque imitation d'Horace,
dont les pťdants routiniers de collťge prosaÔsent et affadissent la
mťmoire des enfants, est certainement le plus faible de ses ouvrages.
C'est le squelette de la poťsie, dťcharnť, dťcolorť, privť de vie et
d'‚me par un profane anatomiste de l'inspiration. C'ťtait dťjŗ une faute
que d'ťcrire un tel poŽme; les vers sont faits pour le chant,
quelquefois pour la pensťe, jamais pour la pťdagogie. C'est ce prosaÔsme
de l'_Art poťtique_ qui a le plus diminuť Boileau dans l'esprit de notre
siŤcle; on se venge de l'ennui qui respire dans ces prťceptes rimťs en
oubliant les vers admirables qui parsŤment les satires et les ťpÓtres.
Deux seules grandes qualitťs manquent ŗ Boileau dans ses ouvrages, la
longue haleine et l'ťlťvation. Il est court dans son vol, il rase la
terre et il badine au lieu de toucher. Aussi est-il par excellence le
poŽte des esprits ingťnieux, mais mťdiocres, qui n'ont pas d'ailes et
qui jouent terre ŗ terre ŗ la poťsie, au lieu de se laisser emporter par
elle dans son ciel; MUSA PEDESTRIS! poťsie pťdestre, qui ne bronche pas,
mais qui ne dťvore pas l'espace. Le manque de profondeur fut le dťfaut
capital de Boileau comme de sa race gauloise; ce dťfaut qui ťtait celui
de la littťrature franÁaise jusqu'ŗ Corneille, Racine, Bossuet, surtout
jusqu'ŗ J.-J. Rousseau, dťfaut qui a fait une partie du succŤs si
prodigieux et si mťritť de Voltaire, obligť de rire jusqu'ŗ l'indťcence
mÍme pour raisonner.
XXI
C'est ŗ ce badinage, selon nous, un peu profanateur de la poťsie, que
Boileau a dŻ sa plus grande popularitť et qu'il la conserve. Nous
voulons parler de son poŽme hťroÔ-comique du _Lutrin_. Jusqu'ŗ cette
oeuvre il avait ťtť critique et modŤle; critique toujours spirituel,
modŤle quelquefois accompli, mais lŗ il fut vťritablement poŽte,
toujours dans l'acception ingťnieuse et tempťrťe du mot.
Les poŽtes italiens jusqu'ŗ l'Arioste; Tassoni, aprŤs lui, dans la
_SŤcchia rapita_, plaisanterie assez lourde et peu digne de sa renommťe;
le poŽte anglais _Pope_, dans _la Boucle de cheveux enlevťe_, hochet
poťtique d'une incomparable dťlicatesse de travail, avaient ťtť les
modŤles de Boileau dans ce genre b‚tard et corrompu de composition.
Boileau lui-mÍme, en autorisant par son _Lutrin_ ce faux genre, devait
servir d'excuse ŗ La Fontaine dans ses Contes, puis servir d'exemple au
poŽme burlesque et licencieux de Voltaire, _la Pucelle d'Orlťans_; et
Voltaire, ŗ son tour, devait servir d'exemple ŗ lord Byron dans son
poŽme moqueur et satanique de _Don Juan_. Ainsi la profanation de la
poťsie par le _burlesque_ devait corrompre une longue sťrie de poŤtes et
amener, d'excŤs en excŤs, La Fontaine ŗ l'obscťnitť. Voltaire an
scandale, Gresset ŗ la puťrilitť, Byron au sacrilťge. On ne ravale pas
impunťment le plus beau don de Dieu, la poťsie, ŗ des trivialitťs
ridicules. On ne boit pas le vin de l'orgie dans le calice. La
corruption du genre entraÓne celle de l'esprit. Le burlesque est la
mascarade d'une divinitť.
XXII
Nous sommes loin nťanmoins d'appliquer ces sťvťritťs ŗ l'Arioste, le
_CervantŤs_ poťtique de la chevalerie errante. Il fit le _Don Quichotte_
italien, mais un Don Quichotte hťroÔque et amoureux, dont chaque
aventure est un dťlicieux poŽme. L'Arioste embellit tout, mais il ne
profane rien. Il l‚che la bride de son imagination pour qu'elle le
promŤne, comme les conteurs arabes, dans les espaces, jamais dans la
boue. Aussi la gr‚ce, l'amour, l'hťroÔsme, le pathťtique mÍme, qui
pleure en souriant, l'accompagnent toujours; il enivre d'imagination, il
n'attriste jamais de sacrilťge. Il lui faut une place ŗ part dans la
littťrature, entre ciel et terre. Quelle que soit notre estime pour
l'exťcution savante du poŽme hťroÔ-comique de Boileau, nous ne ferons
pas ŗ l'Arioste l'offense de lui comparer son imitateur franÁais.
On connaÓt le sujet du _Lutrin_. C'est un sujet de sacristie et de
collťge. Cela ne prÍte ŗ rien qu'ŗ de beaux vers malheureusement
dťplacťs. Boileau les a prodiguťs dans ce badinage. Jamais on ne parodia
en style plus nerveux et plus ťpique les beaux rťcits d'HomŤre et de
Virgile, mais c'est une parodie.
Parmi les doux plaisirs d'une paix fraternelle,
Paris voyait fleurir son antique chapelle;
Ses chanoines vermeils et brillants de santť
S'engraissaient d'une longue et sainte oisivetť.
Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Ces pieux fainťants faisaient chanter matines,
Veillaient ŗ bien dÓner et laissaient en leur lieu
ņ des chantres gagťs le soin de louer Dieu;
Quand la Discorde, encor toute noire de crimes,
Sortant des Cordeliers pour aller aux Minimes, etc.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Dans le rťduit obscur d'une alcŰve enfoncťe,
S'ťlŤve un lit de plume ŗ grands frais amassťe;
Quatre rideaux pompeux par un double contour
En dťfendent l'entrťe ŗ la clartť du jour.
Lŗ, parmi les douceurs d'un tranquille silence,
RŤgne sur le duvet une heureuse indolence;
C'est lŗ que le prťlat, muni d'un dťjeuner,
Dormant d'un lťger somme, attendait le dÓner.
La jeunesse en sa fleur brille sur son visage;
Son menton sur son sein descend ŗ double ťtage,
Et son corps, ramassť dans sa courte grosseur,
Fait gťmir les coussins sous sa molle ťpaisseur.
Si on ne reconnaÓt pas dans ce style le grand poŽte, il est impossible
de n'y pas reconnaÓtre le grand artiste en vers. Il y en a peu de plus
parfaits dans la langue, en admettant que le vers et le sens soient
deux choses sťparťes, et que la beautť sťrieuse de la pensťe ou du
sentiment ne soit pas nťcessaire ŗ la beautť de la poťsie. On peut en
dire autant de presque tous les vers du poŽme:
Lui-mÍme le premier, pour honorer la troupe,
D'un vin pur et vermeil il fait remplir sa coupe;
Il l'avale d'un trait, et, chacun l'imitant,
La cruche au large ventre est vide en un instant.
Nous passons les triviales et burlesques inventions du rťcit, quoique la
mÍme perfection fasse partout reconnaÓtre le grand artisan de langue.
Qui ne se rťcrierait ŗ cette caricature, devenue classique, de la
mollesse?
L'air, qui gťmit du cri de l'horrible dťesse,
Va jusque dans CÓteaux rťveiller la Mollesse;
C'est lŗ que d'un dortoir elle a fait son sťjour;
Les plaisirs nonchalants fol‚trent ŗ l'entour;
L'un pťtrit dans un coin l'embonpoint des chanoines,
L'autre broie en riant le vermillon des moines.
La voluptť la sert avec des yeux dťvots,
Et toujours le Sommeil lui verse ses pavots.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
ņ ce triste discours, qu'un long soupir achŤve,
La Mollesse en pleurant sur un bras se relŤve,
Ouvre un oeil languissant, et d'une faible voix
Laisse tomber ces mots, qu'elle interrompt vingt fois.
Elle regrette le temps
Oý les rois s'honoraient du nom de fainťants.
On reposait la nuit, on dormait tout le jour.
Seulement, au printemps, quand Flore dans les plaines
Faisait taire des vents les bruyantes haleines,
Quatre boeufs attelťs d'un pas tranquille et lent
Promenaient dans Paris le monarque indolent.
Puis enfin ces quatre vers aussi assoupis que le Sommeil lui-mÍme:
‘ nuit, ne permets pas!... La Mollesse oppressťe
Dans sa bouche ŗ ce mot sent sa langue glacťe,
Et, lasse de parler, succombant sous l'effort,
Soupire, ťtend les bras, ferme l'oeil et s'endort.
Aucune langue, mÍme la plus naturellement harmonieuse, n'est arrivťe
par la perfection du travail de ses plus habiles ouvriers (les poŽtes) ŗ
produire de pareils effets de musique et d'images. Il faut plaindre ceux
qui mťprisent un tel artiste de n'avoir ni des yeux ni des oreilles
capables de comprendre ce grand art de faire rendre ŗ des syllabes tout
ce que la nature fait ťprouver de plus inexprimable aux sens, mÍme le
silence et l'assoupissement des sensations!
Le poŽme tout entier est semť de perles de style semblables et sans
nombre, mais malheureusement attachťes ŗ une trop mince ťtoffe. Si
Boileau avait ťcrit avec cette perfection sur un sujet sťrieux,
religieux ou hťroÔque, il aurait fait une oeuvre immortelle au lieu
d'une fugitive plaisanterie; au lieu du sourire, il aurait arrachť
l'ťmotion au coeur humain. Mais c'ťtait une de ces inspirations qui
descendent et qui ne montent pas: le sourire vient de l'esprit,
l'ťmotion vient de l'‚me. Nous l'avons dit et nous le rťpťtons: ce
n'ťtait que l'homme d'esprit franÁais par excellence. La nature lui
avait refusť la source des larmes.
XXIII
Mais s'il avait les lťgŤretťs et les ťlťgances trop superficielles de
l'esprit gaulois, il en avait aussi les qualitťs. C'ťtait un esprit
probe et droit, c'ťtait de plus un coeur courageux et honnÍte. Sa
constance dans ses amitiťs pour MoliŤre persťcutť par les hypocrites de
son temps, pour Racine abandonnť par la faveur du roi, attestent en lui
une de ces ‚mes fermes qui ne se laissent plier ni par la versatilitť
des partis, ni par la disgr‚ce des rois. L'_aura popularis_, ce vent de
terre qui souffle dans la voile des grands hommes, tantŰt pour les
enfler, tantŰt pour les dťchirer dans leur course, n'existait pas pour
lui. Il reprťsentait ce qu'il y a de plus beau ŗ reprťsenter dans son
temps: la postťritť.
Son amitiť ťtait si fidŤle et son goŻt pour les hommes d'ťlite ťtait si
sŻr qu'il ne se trompa dans aucune de ses prophťties. Il promit la
gloire durable ŗ Corneille, ŗ Racine, ŗ MoliŤre, ŗ Bossuet. La postťritť
a tenu toutes les promesses qu'il avait faites d'avance en son nom ŗ
ses illustres amis. Il ne parle jamais en vers de La Fontaine, bien que
ce fabuliste nonchalant fŻt un hŰte assez assidu de son jardin d'Auteuil
et un convive voluptueux de sa table. Il le regardait, dit-on, comme un
enfant g‚tť du gťnie, mais comme un enfant nouť qui ne grandirait pas
au-dessus de la taille des enfants ŗ la stature des vrais grands hommes.
Les fanatiques sur parole de La Fontaine reprochent ŗ Boileau cet oubli
de l'auteur des Fables et des Contes; nous n'y voyons, nous, qu'une
preuve de plus de l'exquise justesse de son jugement. La Fontaine avait
des gr‚ces enfantines de langue et des hasards heureux de poťsie qui
devaient engouer longtemps la France; mais les gr‚ces enfantines
s'ťvaporent avec la jeunesse et ne survivent pas longtemps ŗ la maturitť
des peuples. La postťritť veut des hommes faits, des coeurs virils, des
‚mes fortes. Boileau ne s'est pas trompť. Il ne s'est trompť que sur le
Tasse et sur la littťrature italienne, dont les vices le choquaient avec
raison, mais dont il apprťciait trop peu les chefs-d'oeuvre. Dante, le
Tasse, Pťtrarque, Arioste ťtaient pour lui des livres fermťs; il ne
pouvait juger ces grands esprits dont il ignorait la langue.
XXIV
ņ l'exception de quelques ťpigrammes plus correctes qu'ťlťgantes, et de
deux ou trois malheureuses tentatives pour voler de ses propres ailes
jusqu'ŗ l'ode hťroÔque, voilŗ toute l'oeuvre littťraire de cette longue
vie.
On a dit, non sans raison, que le FranÁais n'avait pas la tÍte ťpique.
Quand on a lu _Ronsard_, _Malherbe_, les imitations bibliques de
_Jean-Baptiste Rousseau_, quelques strophes de _Pompignan_, quelques
stances inimitťes et inimitables de _Gilbert_, quelques odes vraiment
pindariques de _Lebrun_, enfin les odes d'_Hugo_ et de ses contemporains
de notre ‚ge, on ne peut plus dire que le FranÁais n'a pas l'‚me
lyrique. Mais il est vrai de dire que Boileau ne l'avait pas dans ses
odes; il chantait sans lyre, il brŻlait sans feu, il palpitait sans
souffle. Il est vťritablement curieux et presque ridicule de voir
comment il prenait avec un compas la mesure des ailes de Pindare pour
ajuster ses ailes factices ŗ lui sur ce modŤle, et pour fendre le ciel ŗ
l'aide de ce lourd mťcanisme d'enthousiasme classique qui le laissait
tomber ventre ŗ terre aux justes sifflets de ses admirateurs ťbahis.
Ce n'ťtait pas lŗ sa sphŤre: il n'excellait que dans le bon sens; le
gťnie ne se laisse aborder que par un sublime dťlire. Boileau ne
dťlirait jamais. Il le dit lui-mÍme dans une de ses lettres:
ęPhilosophiquement, les vers me paraissent une folie!Ľ Folie sainte,
folie plus inspirťe de divinitť que la sagesse vulgaire! Folie de la
lyre, dont les hommes de la trempe de Boileau ne seront jamais
coupables!
XXV
Sa correspondance, surtout celle qu'il entretenait avec Racine, son
collŤgue en historiographie du rŤgne, et avec Brossette, son ami et son
ťditeur, montre en lui l'homme tout ŗ fait conforme au poŽte. M. Berriat
Saint-Prix a recueilli de nos jours et a mis ŗ leur date et ŗ leur
vraie lumiŤre chaque syllabe de cette vie poťtique ou familiŤre. Il a
exhumť Boileau tout entier, prose et vers, avec une minutie d'ťrudition
qui est en mÍme temps la piťtť de la mťmoire. On n'aime pas beaucoup
plus Boileau aprŤs avoir lu ces quatre ťnormes volumes, mais on apprend
ŗ l'estimer plus haut: c'est le poŽte honnÍte homme.
Ses jugements confidentiels sur les oeuvres du temps sont sťvŤres et se
ressentent un peu de l'austťritť de Port-Royal.
ęJe vous remercie de m'avoir envoyť le _Tťlťmaque_ de M. de Fťnelon,Ľ
ťcrit-il ŗ Brossette; ęj'y trouve de l'agrťment. HomŤre est plus
instructif que lui. Mentor dit de fort bonnes choses, mais un peu
hardies. Enfin M. de Cambrai me paraÓt beaucoup meilleur poŽte que
thťologien; de sorte que, si, par son livre des _Maximes_, il me semble
trŤs-peu comparable ŗ saint Augustin, je le trouve, par son _roman_,
digne d'Ítre mis en parallŤle avec Hťliodore, l'auteur du roman grec de
_ThťagŤne et Chariclťe_. Je doute nťanmoins qu'il fŻt d'humeur, comme
Hťliodore, ŗ quitter sa mitre pour son roman. Mais vraisemblablement le
revenu de l'ťvÍchť d'Hťliodore n'approchait guŤre du revenu de l'ťvÍchť
de Cambrai.Ľ
On suit dans ces lettres, avec une certaine pitiť d'esprit, les
sollicitudes un peu puťriles d'une longue existence passťe ŗ aligner des
rimes, ŗ ťlucider une ťpigramme, ŗ justifier une ode, ŗ commenter un
sonnet. Puis on arrive aux derniŤres pages, oý on lit avec tristesse ce
refrain des petites vies comme des grandes:
ęJ'ai fait une chute sur mon escalier d'Auteuil. Je suis malade,
vraiment malade; la vieillesse m'accable de tous cŰtťs: l'ouÔe me
manque, ma vue s'ťteint, je n'ai plus de jambes, je ne saurais plus
monter ou descendre qu'appuyť sur le bras d'autrui; enfin je ne suis
plus rien de ce que j'ťtais, et, pour comble de misŤre, il me reste un
malheureux souvenir de ce que j'ai ťtť.Ľ
Racine mourant aussi, Racine, son ťlŤve autant que son ami, dťsira le
voir pendant sa derniŤre maladie; Boileau se traÓna au lit de mort du
poŽte d'_Athalie_. Racine, se ranimant ŗ sa prťsence, essaya de se
soulever sur son lit et de le serrer pour la derniŤre fois dans ses
bras. Boileau s'attendrit et veut consoler son ami de quelque
espťrance.--ęNon! non!Ľ lui dit Racine, ęne me plaignez pas! Je regarde
comme un bonheur de mourir le premier!Ľ L'homme qui inspirait de tels
sentiments au plus sensible des poŽtes de son ťpoque n'ťtait
certainement pas un coeur froid. Racine, au reste, ťtait son plus bel
ouvrage. Le disciple et le maÓtre doivent Ítre confondus dans la mťmoire
de la postťritť.
Peu de temps aprŤs cette plainte et cette mort, Boileau lui-mÍme n'ťtait
plus. Et comme si son tombeau avait dŻ Ítre encore aprŤs lui une pierre
d'achoppement et de division entre les ťcrivains et entre les ťcoles
littťraires, la dispute ťternelle sur l'utilitť ou sur le malheur de son
influence commenÁait sur cette tombe et se perpťtuait jusqu'ŗ nos jours.
Nous ne prťtendons pas la trancher, mais nous dirons courageusement
notre pensťe ŗ ses amis comme ŗ ses ennemis.
Boileau ne fut point un grand poŽte dans l'acception transcendante du
mot. On n'est pas tel pour avoir aiguisť malignement quelques lancettes
acťrťes d'ťpigrammes, ou pour avoir rimť heureusement quelques satires
spirituelles contre les mauvais ťcrivains de son temps. On n'est point
tel pour avoir admirablement poli quelques ťpÓtres courtes sur les
exploits de son prince, ou sur quelques maximes saines, mais banales, de
philosophie sans nouveautť. On n'est point tel pour avoir rimť en vers
mťdiocres la prose didactique d'Horace, de Longin ou de Quintilien sur
le mťcanisme du style. On n'est point tel pour avoir supťrieurement
maniť l'instrument encore inhabile de la langue poťtique franÁaise et
pour avoir remis aprŤs soi cette langue trŤs-perfectionnťe ŗ ses
successeurs. On n'est point tel mÍme pour avoir ťcrit dans un poŽme
hťroÔ-comique, comme _le Lutrin_, cinq ou six pages ťgales en
expression, sinon en invention, ŗ ce qu'il y a de plus parfait dans le
badinage d'Arioste et de Pope. On est, ŗ tous ces titres, un admirable
artisan de style, mais on n'est pas crťateur, c'est-ŗ-dire poŽte. On est
homme de sens, homme d'esprit, homme de talent, homme de goŻt, le
premier des critiques en action; on contribue ŗ faire les grands poŽtes,
comme Boileau fit Racine, mais on est dťpassť par ses disciples et on
reste ŗ jamais terre ŗ terre, tandis qu'ils prennent leur vol vers la
gloire avec les ailes que vous leur avez faÁonnťes. Tel fut Boileau
comme poŽte.
Comme critique, il eut deux influences diverses: l'une, selon nous,
trŤs-nuisible; l'autre trŤs-salutaire au gťnie spťcial de son pays. Par
la premiŤre il comprima, autant qu'il ťtait en lui, les originalitťs,
les tťmťritťs, les audaces, les enthousiasmes poťtiques de la France
littťraire, et il la condamna ŗ se calquer servilement sur l'antique,
c'est-ŗ-dire ŗ calquer le vif sur le mort. Il voulut refaire ce qui ne
se refait jamais, un vieux monde avec un nouveau. Par cela seul il fit
avorter l'avenir d'une grande poťsie nationale en France. Ce n'est que
juste un siŤcle aprŤs sa mort que la France conÁut de l'esprit nouveau
de nouveaux germes poťtiques, et qu'elle redevint capable d'enfanter ce
que nos neveux verront naÓtre et grandir, une poťsie ŗ grand foyer dans
l'‚me, ŗ grand souffle et ŗ grandes ailes, pour emporter aux siŤcles le
nom propre et non le nom latin de notre patrie. Boileau retarda de plus
de cent ans cette naissance. C'est son tort, ou plutŰt c'ťtait le tort
de sa nature. Il n'ťtait pas nť libre et fťcond, il ťtait nť servile et
copiste.
XXVI
Mais, cela dit, il serait souverainement injuste de mťconnaÓtre
l'influence rťgulatrice et directrice que cet excellent esprit devait
avoir sur l'esprit littťraire de sa patrie.
Nous ne voulons pas exagťrer ici la valeur de ce qu'on appelle la
critique. Ce n'est certes pas la premiŤre des qualitťs de l'esprit;
mais, si elle n'est pas la plus ťminente, elle est toutefois la plus
nťcessaire; ou, pour mieux dire, lŗ oý cette qualitť manque, il n'y en a
plus d'autre qui serve.
Si nous avions ŗ la dťfinir comme nous la comprenons, nous dirions: _la
critique est la logique des arts_, de l'art de penser et d'ťcrire comme
de tous les autres arts que l'esprit humain a inventťs pour exercer les
forces de son intelligence ou de ses sens ŗ la gloire de son Ítre. Sans
cette logique des arts, qui doit gouverner, ŗ son insu, mÍme le gťnie,
le gťnie ne serait qu'une sublime dťmence. Il ferait, dans le domaine de
l'esprit ou des sens, des choses prodigieuses dans quelques parties,
monstrueuses dans l'ensemble. Ses oeuvres, tombant ŗ chaque instant dans
le dťsordre ou dans l'excŤs, n'auraient ni proportions, ni convenance,
ni mesure. Ce seraient encore des prodiges, mais ce seraient des
prodiges de dťrŤglement. Ces monstruositťs n'offenseraient pas moins la
vťritť ťternelle que l'intelligence saine ou que les sens justes de
l'homme.
XXVII
La beautť dans la nature ou dans les arts, ces divines contre-ťpreuves
de la nature, la beautť n'est pas arbitraire, comme le prťtendent
quelques philosophes ŗ courte conception. La beautť est absolue en
elle-mÍme; elle rťsulte de quelques rapports mystťrieux entre la forme
et le fond dans toutes les choses morales ou matťrielles, rapports qui
ont ťtť ťtablis par Dieu lui-mÍme, suprÍme type, suprÍme rŤgle, suprÍme
proportion, suprÍme mesure, suprÍme convenance de tout ce qui ťmane de
lui. ę_Dieu fit l'homme ŗ son image._Ľ On pourrait dire encore: ę_Dieu
fit toute chose ŗ son image._Ľ Or Dieu est le grand logicien par
excellence. La critique ou la logique des arts n'est donc nullement un
caprice ou d'esprit ou du goŻt; elle est la logique absolue et divine
appliquťe par le sens commun, ce rťgulateur sans appel, aux oeuvres de
l'esprit, de la langue ou de la main de l'homme. En d'autres termes, la
critique est la recherche et la manifestation de cette rŤgle logique et
intime qui prťside et doit prťsider ŗ toute crťation de notre
intelligence; sorte de conscience de l'esprit qui, au lieu de nous dire:
Cela est bien, cela est mal, nous dit avec la mÍme autoritť: Cela est
beau, cela est laid; cela est proportionnť, cela est disproportionnť;
cela est dans la mesure, cela est dans l'excŤs; cela est dans la vťritť,
ou cela est dans la chimŤre.
Or, pendant que les hommes de crťation ou de gťnie produisent, soit dans
le domaine de la pensťe, soit dans le domaine des sens, des oeuvres
d'art que la fougue mÍme de leur imagination crťatrice peut faire
quelquefois dťborder avec beaucoup d'ťcume et d'irrťgularitť du moule,
comme le bronze en ťbullition dťborde du fourneau, il est bon que les
hommes de critique ou de logique des arts les surveillent, les modŤrent,
les gourmandent, et, leur prťsentant la rŤgle et la mesure ťternelles,
leur disent: ęVoilŗ le type! vous ne l'atteignez pas, ou vous le
dťpassez.Ľ
Et s'il arrive que ces hommes de critique, ces logiciens des arts, ces
logiciens de la langue, soient eux-mÍmes capables ŗ un certain degrť de
joindre l'exemple ŗ la leÁon et de produire des oeuvres de talent
irrťprochables, leur talent accroÓt leur autoritť, et les nations
reconnaissent longtemps leurs lois. Or Boileau fut prťcisťment et
opportunťment pour la France un de ces hommes. Il prouva sa mission par
ses oeuvres. Il fut un esprit critique, et il fut en mÍme temps, non un
poŽte d'‚me et de gťnie, mais un ťcrivain en vers trŤs-accompli, ce que
les musiciens appellent, non un compositeur sublime, mais un admirable
exťcutant.
XXVIII
La France ťtait jeune dans les lettres quand il parut; elle pouvait se
jeter dans les excŤs de jeunesse et de sťve, ťcarts antipathiques ŗ son
gťnie national, gťnie vrai, sensť, modťrť, logique, dťlicat, gťnie qui
avait besoin, comme la jeunesse, d'un instituteur sťvŤre et un peu
froid. Boileau fut pour sa littťrature naissante cet instituteur, qui
encouragea d'une main et qui ťmonda de l'autre sa sťve surabondante.
Peut-Ítre l'ťmonda-t-il trop, nous ne le nions pas; mais remarquez
cependant qu'il n'empÍcha de naÓtre et de grandir ni MoliŤre, ni
Corneille, ni Racine, ni Bossuet, ni Fťnelon, ni Pascal, ni surtout
Voltaire, qui naissait ŗ cŰtť de lui, sur sa trace, et qui, avec un
esprit mille fois plus original, plus indťpendant et plus ťtendu, fut
cependant, comme il l'avoue partout en s'en glorifiant lui-mÍme, son
disciple et son ouvrage dans le domaine de la langue, de la critique et
du bon sens dans l'art d'ťcrire.
De tels services ŗ la langue franÁaise, au bon sens et au bon goŻt,
rendus en beaux vers par un bon esprit, ne pourraient Ítre mťconnus sans
injustice ni oubliťs sans ingratitude par la nation du bon sens, du bon
esprit et du bon goŻt comme la France. Boileau a immensťment contribuť ŗ
lui conquťrir et ŗ lui maintenir incontestablement ces trois modestes
mais solides supťrioritťs sur les littťratures des nations
contemporaines.
La France n'avait pas, comme l'Italie, son _Dante_ gigantesque mais
tťnťbreux, son _Tasse_ ťpique mais ťnervť, son _Machiavel_ robuste mais
dťpravť, son _Arioste_ accompli mais futile; elle n'avait pas, comme le
Portugal, son _CamoŽns_ grandiose mais trop latin; elle n'avait pas,
comme l'Angleterre, son _Milton_ biblique mais monotone. Non, la France
avait, avec son inexpťrience, cette universelle aptitude qui allait lui
donner, homme ŗ homme, selon l'heure et selon le besoin, non pas la
supťrioritť, mais la direction de l'esprit de l'Europe. Or, cette
direction que la France allait donner dans les lettres, dans la
philosophie, dans la science, dans la politique, dans les arts, dans le
goŻt, ŗ l'Europe, aprŤs Louis XIV, ce fut Boileau qui la donna le
premier ŗ la France.
N'est-ce rien? Homme de rŤgle et de monarchie dans les lettres, Boileau
sentit le besoin d'un gouvernement des lettres: il fonda le gouvernement
du goŻt. C'est une des puissances de la France. Il ne faut donc pas
s'ťtonner si dans le culte de Boileau il y a un peu de patriotisme
franÁais. Il fut un des fondateurs de cette monarchie du goŻt, qui fut
d'abord franÁaise, et qui, gr‚ce ŗ l'unitť de l'esprit humain qui se
constitue de plus en plus en Europe, devient maintenant universelle.
LAMARTINE.
XVIIe ENTRETIEN.
5e de la deuxiŤme Annťe.
LITT…RATURE ITALIENNE.
DANTE.
I
De toutes les nations qui ont cultivť les lettres avant ou aprŤs le
christianisme, sans en excepter la GrŤce et Rome, l'Italie moderne est
certainement, selon nous, la nation qui a apportť le plus magnifique
contingent de gťnie ŗ la famille humaine. Dante, Pťtrarque, le Tasse,
l'Arioste, Machiavel, Michel-Ange, RaphaŽl, les Mťdicis et leur cour;
trois poŽmes ťpiques en trois siŤcles; une litanie de noms et d'oeuvres
secondaires, et cependant impťrissables, dignes d'Ítre gravťs sur la
colonne de bronze qu'on ťlŤverait ŗ la gloire intellectuelle de l'Europe
pensante, sont le tťmoignage de cette immortelle fťconditť de l'Italie.
_Alma parens!_ Le ciel, la mer, les montagnes, les fleuves, la race, la
langue, les religions, les grandeurs et les revers de la destinťe, le
passť presque fabuleux, le prťsent triste, l'avenir toujours prÍt ŗ
renaÓtre, et toujours trompeur, la jeunesse ťternelle de ce sang italien
qui roule toutes sortes de royautťs dťchues dans ses veines, une
noblesse de peuple-roi dans le dernier laboureur de ses plaines ou dans
le dernier pasteur de ses montagnes, une rivalitť de villes capitales,
telles que Naples, Rome, Florence, Sienne, Pise, Bologne, Ferrare,
Ravenne, Vťrone, GÍnes, Venise, Milan, Turin, ayant toutes et tour ŗ
tour concentrť en elles l'activitť, le gťnie, la poťsie, les arts de la
patrie commune, et pouvant toutes aspirer ŗ la royautť intellectuelle
d'une troisiŤme Italie, voilŗ les explications de cette aristocratie
indťlťbile de l'esprit humain au delŗ des Alpes.
Tous les peuples jeunes et nous-mÍmes nous sommes des parvenus auprŤs de
l'Italie, et nous respectons sa grandeur jusque dans sa dťcadence. Car
ce n'est pas la race qui est dťchue en elle, c'est le sort. L'antiquitť,
la dignitť survivent ŗ la dťgradation de sa fortune. C'est l'Italie
divisťe, dťcouronnťe, humiliťe, affligťe, garrottťe ici, corrompue lŗ,
dominťe partout; mais c'est l'Italie!
Il est curieux de voir ce que fut un tel peuple dans sa littťrature
virile, au moment oý il donna le premier au monde le signal de la
renaissance des lettres, aprŤs douze siŤcles de tťnŤbres et de stťrilitť
rťpandues en Orient et en Occident sur ce qu'on appelait l'univers
romain.
Nous nťgligerons les premiers commencements de ce que nous pourrions
nommer les balbutiements de cette renaissance, et nous ne la ferons
dater, comme toutes les grandes choses, que de son premier grand homme:
le Dante.
II
Quand une religion s'ťcroule dans la partie du monde qu'elle dominait,
tout s'ťcroule avec elle. Le plus enracinť des ťdifices humains dans le
sol, c'est un autel; il faut, pour le saper, un tremblement de terre qui
engloutit tout dans sa poussiŤre. Quand les dieux s'en vont, comme dit
Tertullien, tout s'en va.
Tel fut l'avťnement du christianisme dans l'empire romain. Les lettres
pťrirent pour mille ans dans le choc des deux religions. Les tťnŤbres se
rťpandirent sur l'intelligence pendant qu'une nouvelle morale et une
nouvelle thťologie s'emparaient des opinions et des coeurs. Constantin
prÍta la massue de l'empire aux chrťtiens pour pulvťriser le passť. Les
monuments, les temples, les oracles, les bibliothŤques, les livres
pťrirent dans les dťcombres. Rien ne survťcut ŗ cet accŤs de colŤre
sacrťe de l'esprit humain contre lui-mÍme. On sema le feu sur les
ťdifices, la cendre sur le sol, le sel sur la cendre, pour empÍcher les
vieilles superstitions et les vieilles philosophies de regermer jamais
de leurs racines. Ce furent les _VÍpres siciliennes_ du paganisme, le
1793 de sa littťrature. Ainsi est faite la misťrable humanitť; elle ne
s'arrÍte jamais dans le vrai et dans le juste, elle se prťcipite ŗ
l'excŤs, et elle ne se croit libre de l'oppression que quand elle
opprime ŗ son tour.
On nie en vain aujourd'hui cette rťaction exterminatrice contre tous les
monuments b‚tis ou ťcrits de l'antiquitť littťraire; elle ťclate
partout, non-seulement dans les ruines d'…phŤse, de Delphes, d'AthŤnes,
d'Alexandrie, dont la poussiŤre est faite de statues mutilťes ou de
cendres de bibliothŤques, mais dans les ťcrits des premiers chrťtiens et
dans les actes des conciles. Tiraboschi, dans sa savante _Histoire de la
Littťrature italienne_, cite le dťcret du concile de Carthage qui
interdit aux ťvÍques la lecture des auteurs antťrieurs au christianisme;
il cite ťgalement le passage de saint JťrŰme oý ce PŤre gourmande
amŤrement ceux qui, au lieu de lire la Bible et l'…vangile, lisent
Virgile. On sait le sort de la bibliothŤque d'Alexandrie, incendiťe dans
un feu de six mois par l'ordre du patriarche Thťophile, qui ne laissa
rien ŗ faire ŗ Omar. L'historien contemporain Orose dťcrit et dťplore
l'anťantissement de ces trťsors de la mťmoire. Le pape Lťon X lui-mÍme,
ce restaurateur si platonique et si tendre des vestiges de l'esprit
humain ťchappťs ŗ ce sac du monde, dit ęqu'il a recueilli dans son
enfance, de la bouche de Chalcondyle, homme trŤs-instruit dans tout ce
qui concerne la GrŤce, que les prÍtres avaient eu assez d'influence sur
les empereurs d'Orient pour les engager ŗ brŻler les ouvrages de
plusieurs anciens poŽtes grecs, et c'est ainsi qu'ont ťtť anťanties les
comťdies de Mťnandre, les poťsies lyriques de Sapho, de Corinne,
d'Alcťe.Ľ ęCes prÍtres, ajoute Lťon X, montrŤrent ainsi une honteuse
animadversion contre les anciens, mais ils rendirent tťmoignage de la
sincťritť et de l'intťgritť de leur foi.Ľ
ņ l'exception des ťtudes thťologiques et morales, ŗ l'exception de
l'ťloquence sacrťe, qui dťbattait les questions d'orthodoxie ou de
schisme entre les diffťrentes sectes nťes du christianisme, qui
s'emparaient peu ŗ peu d'une partie de l'Orient et de tout l'Occident,
l'intelligence humaine, pendant ces siŤcles de chaos et d'ťlaboration,
parut enfermťe dans l'enceinte des temples ou des monastŤres. Ce fut
l'‚ge monastique de l'univers. Exceptť en Arabie, ŗ Bagdad et en
Espagne, sous les califes, nul flambeau des lettres et des sciences
n'ťclaira le monde chrťtien jusqu'ŗ Charlemagne. Ce grand homme fit le
premier, pour l'Occident tout entier, ce que les Mťdicis firent plus
tard pour l'Italie; il ordonna les fouilles dans la cendre du passť,
recueillit les monuments ťpars, restitua les langues mortes, ťvoqua,
par les ťtudes encouragťes et rťmunťrťes, le gťnie de l'antiquitť pour
y rallumer le gťnie de l'avenir. Un crťpuscule ťclaira d'un jour
croissant cette longue nuit de la barbarie. Mais, exceptť dans la
jurisprudence, cette premiŤre nťcessitť des sociťtťs civiles qui se
fondent, aucune oeuvre remarquable ne sortit de cette seconde enfance
des lettres. Le gťnie humain couvait sourdement on ne sait quel fruit
inconnu. C'est en Italie qu'il devait naÓtre.
III
Les papes, les empereurs d'Allemagne, les tyrannies provinciales, les
rťpubliques et les anarchies municipales se disputaient cet hťritage
conquis et reconquis des Romains et des Barbares. Ces ondulations
politiques de l'Italie, du quatriŤme au quatorziŤme siŤcle, seraient
aussi confuses et aussi fastidieuses ŗ dťcrire que les roulis des vagues
dťchaÓnťes par les vents sur une mer d'ťquinoxe.
Ces divisions, aprŤs la mort de l'empereur Frťdťric, finirent par se
rťduire ŗ peu prŤs ŗ deux grands partis, les Guelfes et les Gibelins:
l'un favorisant de ses voeux et de ses armes la domination des papes;
l'autre, par haine de cette domination pontificale, se dťvouant aux
empereurs d'Allemagne, comme si le patriotisme se fŻt senti moins
humiliť et moins oppressť de s'asservir ŗ un dominateur ťtranger qu'ŗ un
dominateur sacrť qui ajoutait un droit divin au droit temporel!
Florence, capitale de l'ancienne …trurie, aujourd'hui la Toscane, ťtait
le foyer le plus animť des querelles de ces deux grands partis. Cette
rťpublique, fondťe sur l'industrie, et non sur les armes, prospťrait,
malgrť ses dissensions intestines, par la seule vertu de la libertť.
C'ťtait ťvidemment lŗ que l'Italie littťraire et poťtique devait ťclore,
car l'esprit humain cherche par instinct les terres libres pour dťrober,
comme l'aigle, ses oeufs ŗ la tyrannie. De plus, il y avait dans le sang
toscan, ťcoulement du vieux sang ťtrusque, une sťve non encore ťpuisťe
de gťnie littťraire et de gťnie artistique. Cette nation venait de toute
antiquitť de GrŤce ou d'…gypte. La civilisation ťlťgante et presque
fabuleuse de l'…trurie avait ťtť anťantie par la soldatesque des
premiers Romains, ces barbares de Romulus; mais cette civilisation, dont
on ne sait rien que par ses oeuvres, avait laissť dans ses vases, dans
ses dessins, dans ses monuments cyclopťens, des tťmoignages d'une
grande vigueur d'esprit et d'une grande perfection de main. Cette race,
dans la politique, dans le commerce, dans la guerre, avait des facultťs
innťes qui ťclataient souvent en individualitťs colossales. Les Dante,
les Machiavel, les Mťdicis, les Buonarotti, les Gondi, les Mirabeau, les
Bonaparte ťtaient des familles ťtrusques. Les deux hommes modernes qui
ont remuť le plus d'idťes par l'ťloquence et le plus d'hommes par la
guerre, Mirabeau et Napolťon, sont des Toscans transportťs sur la scŤne
de la France. Le cardinal de Retz, qui fut ŗ l'intrigue ce que Machiavel
fut ŗ la politique, ťtait un Toscan. Cette AthŤnes de la Toscane ťtait
donc assez naturellement prťdestinťe ŗ donner une langue et une
littťrature ŗ la confťdťration des villes italiennes qui cherchaient ŗ
reconstruire un esprit moderne sur cette terre antique.
IV
Pour cela il lui fallait deux choses: une langue et un homme.
La langue latine s'ťtait ťcroulťe avec l'empire. Il s'ťtait formť, de
ses dťbris mÍlťs aux dialectes vulgaires des provinces romaines et de la
Gaule mťridionale, une langue usuelle, imparfaite, flottante, diverse,
par laquelle on s'entendait tant bien que mal dans la conversation, mais
sans pouvoir y graver ses pensťes dans cette forme solide, convenue et
uniforme, seule langue avec laquelle on puisse construire des monuments
de style. Un latin corrompu ťtait restť la langue de l'…glise, de
l'histoire, de la lťgislation; l'italien ťtait la langue du peuple. Les
classes supťrieures de la sociťtť parlaient les deux langues; mais le
latin dťpťrissait chaque jour et la langue usuelle se perfectionnait. Il
ne lui manquait plus que d'Ítre adoptťe par un grand esprit et d'Ítre
ťcrite dans une grande oeuvre pour se substituer facilement et
triomphalement ŗ la latinitť posthume du monde romain maintenant
gouvernť par les papes.
Voilŗ pour la langue.
Quant ŗ un homme de gťnie, il n'y en avait eu qu'un, selon nous, capable
d'opťrer cette grande rťvolution de la renaissance des lettres en Italie
depuis Charlemagne. Cet homme ťtait saint Thomas d'Aquin. Nous l'avons
longtemps confondu, dans notre ignorance, avec ces orateurs et avec ces
ťcrivains ecclťsiastiques des siŤcles barbares, qu'on a, selon nous,
ťlevťs bien au-dessus de leur stature, dans ces derniers temps, en les
comparant aux poŽtes, aux orateurs, aux historiens, aux philosophes
d'AthŤnes et de Rome. Ces Tacite, ces DťmosthŤne, ces Cicťron, ces
HomŤre et ces Virgile du cloÓtre ťcrivaient ŗ une ťpoque obscure de
transition ŗ travers les tťnŤbres, entre les lettres classiques et les
lettres des siŤcles des Mťdicis et de Louis XIV. Ils n'appartiennent
guŤre qu'au sacerdoce et trŤs-peu aux lettres profanes.
Mais, depuis qu'une ťtude plus approfondie nous a permis de mesurer, au
moins par des fragments, les grandeurs de l'intelligence de saint Thomas
d'Aquin, nous sommes restť convaincu que, si ce gťnie universel avait pu
s'ťmanciper de la thťologie scolastique et de la mauvaise latinitť, il
aurait donnť, longtemps avant le Dante, un Dante, supťrieur encore, ŗ
l'Italie. Fontenelle l'ťgalait dans son estime ŗ Descartes. Quant ŗ
nous, nous n'hťsitons pas ŗ reconnaÓtre dans ce prťcurseur des
philosophes et des politiques modernes un esprit digne de converser
d'avance et de loin avec Machiavel, avec Bacon, avec Montesquieu, avec
Jean-Jacques Rousseau, esprit assez fťcond et assez vaste pour porter
de la mÍme gestation un monde divin et un monde humain dans ses flancs,
comme deux jumeaux de sa pensťe. Les idťes ont ainsi, comme la terre, de
ces germinations de plantes prťcoces et ťtranges qui fleurissent en
hiver. Saint Thomas fut un de ces phťnomŤnes de vťgťtation anticipťe.
C'ťtait un jeune gentilhomme de la noble maison de Landolfo d'Aquino. Il
vivait dans l'opulence fťodale au ch‚teau de Rocca Secca. La passion de
Dieu et de l'intelligence des choses divines, qui prťcipitait alors tant
d'‚mes dans la solitude, l'arracha, dans la fleur de son adolescence, au
monde. On raconte que cette passion ťtait si forte dans ce jeune homme
qu'elle brisa avec violence tous les piťges tendus par sa famille pour
le retenir, et qu'il poursuivit, un tison enflammť dans la main, une
jeune fille d'une merveilleuse beautť que ses frŤres lui avaient fait
apparaÓtre dans sa chambre pour sťduire ses yeux et son coeur. Entrť
dans l'ordre des Dominicains, il alla ťtudier ŗ Paris sous Albert le
Grand, thťologien cťlŤbre, alors que la thťologie ťtait la science
unique. Devenu lui-mÍme de disciple maÓtre, il professa avec ťclat ŗ
Paris, ŗ Rome, ŗ Naples. Le feu de l'ťtude le consuma avant l'‚ge, et
il expira sur la route en se rendant en 1274 au concile de Lyon. Il
n'avait encore que quarante-neuf ans. Les ouvrages laissťs par ce
philosophe, sans repos et sans limites, formŤrent les bibliothŤques des
monastŤres et des universitťs du temps. Quelques-uns sont dignes d'en
Ítre exhumťs, comme des monuments de force et de fťconditť dans la
pensťe humaine.
V
Neuf ans avant la mort de saint Thomas d'Aquin, en 1265, le Dante ťtait
ŗ Florence. Esprit du mÍme ordre, mais avec le don de plus qui ťlŤve la
pensťe jusqu'au ciel, la poťsie. Son nom ťtait _Alighieri_. Sa famille,
attachťe par tradition au parti guelfe, ťtait patricienne et consulaire
dans la rťpublique. Livrť de bonne heure aux leÁons de Brunetto Latini,
sorte de Quintilien toscan qui professait la grammaire et la rhťtorique
ŗ Florence et ŗ Bologne, l'enfant fut nourri du lait ‚pre de la
thťologie scolastique. Cette nourriture ne lui fÓt pas perdre totalement
le goŻt des lettres profanes. Il apprit le franÁais sous Brunetto
Latini, qui professait en cette langue; il apprit l'italien vulgaire
dans les sonnets et dans les _canzone_ de quelques poŽtes toscans qui
commenÁaient ŗ rťgulariser et ŗ polir cet idiome naissant comme pour le
prťparer ŗ un plus grand qu'eux. Tous chantaient exclusivement l'amour,
cette ťternelle inspiration du coeur. L'amour fut aussi le premier chant
de cet enfant, dans l'‚me duquel la passion idťale ťtait ťclose avant
l'‚ge des passions terrestres.
…levť dans la familiaritť de la noble famille des _Portinari_, amie de
la sienne, il couva, dŤs l'‚ge de onze ans, une sorte de pressentiment
amoureux pour une jeune fille de cette maison, nommťe Bťatrice. Cette
inclination fut mutuelle, quoique contrariťe par les circonstances de
famille. Elle remplit l'adolescence du Dante de songes, et son ‚ge mŻr
de larmes. Bťatrice mourut dans la fleur de sa beautť, ŗ vingt-cinq ans.
L'‚me de Dante quitta en quelque sorte la terre avec elle, et on ne peut
douter que ce ne fut pour suivre et pour retrouver l'‚me de Bťatrice
qu'il entreprit plus tard ce triple voyage ŗ travers les trois mondes
surnaturels, enfer, purgatoire, paradis, oý, sous le nom de thťologie,
il ne cherche et ne divinise au fond que son amante.
Ses vers, jusqu'ŗ l'‚ge de trente ans et au delŗ, n'annonÁaient pas le
poŽte souverain qui devait dans l'‚ge avancť se rťvťler en lui;
c'ťtaient des sonnets et des _canzone_ sans nerf, sans naturel et sans
grandeur, calquťs sur les poťsies amoureuses des poŽtes secondaires de
son temps. L'‚ge, la mťditation et le malheur n'avaient pas encore donnť
ŗ son ‚me cette sonoritť grave et surhumaine, timbre sťpulcral de sa
seconde voix.
Les traditions de son pŤre mort, la vocation de famille, les soins de sa
mŤre _Bella_, femme ťminente autant que tendre, enfin le courant des
affaires et des passions d'une rťpublique, qui entraÓne tous les
citoyens notables dans les fonctions de l'…tat, lancŤrent le jeune
Alighieri dans les emplois et dans les dissensions de sa patrie. Nous
n'ťcrivons pas ici sa vie, nous la rťservons pour une autre place; nous
ne faisons pas l'histoire, bien peu intťressante aujourd'hui, de ces
agitations municipales de la vallťe de l'Arno. Ces agitations ne sont
grandes que lorsqu'elles influent sur le sort du monde. Dante aurait ťtť
peut-Ítre un Gracque ou un Cicťron ŗ Rome, il ne fut qu'un Gibelin de
plus ŗ Florence.
VI
Qu'il nous suffise de savoir qu'Alighieri, qu'on nommait dťjŗ
familiŤrement Dante, servit dans la cavalerie florentine contre les
Guelfes de la petite ville toscane d'Arezzo, et qu'il se montra vaillant
soldat avant de se montrer politique et poŽte; bien diffťrent en cela
d'Horace, jetant son bouclier ŗ Philippes, et de Virgile, fuyant, un
chalumeau ŗ la main, sous les hÍtres, pendant que la guerre civile
dťchire sa patrie. Dante ťtait un citoyen, ceux-lŗ n'ťtaient que des
poŽtes.
…levť bientŰt aprŤs aux premiŤres magistratures de la rťpublique,
assailli d'un cŰtť par les _blancs_, de l'autre par les _noirs_,
dťnomination de deux partis dans Florence, il rťsiste aux uns, aux
autres, et les fait ťnergiquement exiler hors de la Toscane.
Nommť ambassadeur de la rťpublique auprŤs du pape, il y nťgociait la
paix et l'indťpendance pour son pays. Pendant cette mission, le peuple
de Florence, ingrat et aveugle comme tous les peuples, l'accuse de
trahison, de concussion, s'ameute contre son nom, court ŗ sa maison, la
ravage et la rase, comme _Clodius_ avait fait de celle de Cicťron, le
modťrateur de Rome. Ou confisque ses biens, on le bannit ŗ perpťtuitť de
sa patrie. On trouve la peine trop faible pour ses prťtendus crimes; un
second jugement populaire le condamne ŗ mourir par le feu!
Indignť contre le pape, son ennemi, qu'il suppose l'instigateur de ces
proscriptions, Dante quitte Rome, se rťfugie d'abord ŗ Sienne, puis ŗ
Arezzo, oý i! rejoint ses concitoyens ťmigrťs, proscrits pour la mÍme
cause. Il tente avec eux une attaque ŗ main armťe contre Florence. Il
succombe et s'ťloigne pour jamais de ces murs qui dťvorent leurs
citoyens.
Il erre, depuis ce jour, de retraite en retraite, dans la basse Italie,
tantŰt ŗ Padoue chez les _Malespina_, tantŰt ŗ Vťrone chez les
_Scaligieri_, tyrans de la ville, tantŰt chez les _Scala_, tyrans d'une
autre partie de l'Italie; aujourd'hui ŗ Udine, demain au ch‚teau de
Tolmino, ŗ la fin de ses jours ŗ Ravenne. De lŗ, plus refoulť que jamais
par la vengeance vers le parti de l'empereur, il ne cesse d'animer ce
prince contre sa patrie et de le pousser de la main ŗ l'oppression de
Florence. Triste sort des ťmigrťs, condamnťs ŗ avoir souvent pour amis
les ennemis de leur pays! Enfin, l'empereur ťtant mort avant d'avoir
vengť le poŽte, Dante vient ŗ Paris, retourne en Italie, et se fixe
enfin pour mourir ŗ Ravenne. L'hospitalitť du tyran de Ravenne, _Guido
Novello de Polenta_, lui en adoucit le sťjour. Ce site mťlancolique
convenait ŗ la mťlancolie de son ‚me. La forÍt de pins (_la pineta_) qui
s'ťtend entre la mer et Ravenne ťtait sa promenade habituelle. J'y ai lu
moi-mÍme ses plus beaux vers, peut-Ítre ťcrits sous les mÍmes arbres, au
bruit lointain des mÍmes brises de l'Adriatique. C'est lŗ, et non pas
dans le carrefour fangeux de Ravenne, que devrait s'ťlever son tombeau.
Il faut le vide autour des ombres et le silence autour des grandes
mťmoires; on entendrait mieux l'‚me gťmissante de l'exilť dans les
gťmissements des pins de la _pineta_ et des vagues sans repos sur la
grŤve.
VII
Mais, pendant que ce sombre proscrit, ŗ _la taille haute et courbťe, au
visage long et p‚le, ŗ l'oeil voilť par la rťflexion intťrieure_, comme
ses contemporains le dťcrivent, pendant que cet hŰte des ennemis de sa
patrie errait ainsi de ville en ville et de mers en forÍts, regrettant
sa maison rasťe par son peuple, il couvait deux choses immortelles dans
son front cave: sa gloire et sa vengeance. Ce n'ťtait plus le poŽte
affadi et ingťnieux de sa jeunesse; c'ťtait le poŤte thťologique,
politique et _nťmťsien_ de son ‚ge avancť. L'adversitť avait changť sa
muse dans son sein; elle n'y avait laissť que son premier amour.
Cet amour, cependant, n'avait pas ťtť le seul. Indťpendamment de son
mariage avec une fille d'une famille illustre de Florence, dont il avait
eu sept enfants, Boccace confesse, dans l'histoire de sa vie, ťcrite sur
les lieux et si peu d'annťes aprŤs la mort de Dante, que son hťros et
son poŽte avait eu la faiblesse des hťros et des poŤtes: un amour de la
beautť poussť quelquefois jusqu'ŗ la licence du coeur.
La nťgligence que Dante fit de sa femme aprŤs son exil, sa longue
sťparation sans retour et l'affectation avec laquelle il parle, dans ses
oeuvres en prose, des inconvťnients du mariage, appuient trop ŗ cet
ťgard les accusations de Boccace. Mais tout indique aussi que, si le
Dante avait ťtť plus que lťger dans l'amour des sens, il avait ťtť
fidŤle dans l'amour de l'‚me. Le souvenir toujours renaissant de sa
Bťatrice, premiŤre et derniŤre apparition de la beautť cťleste sous un
voile mortel, l'obsťda, tantŰt dťlicieusement, tantŰt douloureusement,
jusqu'au dernier jour. Cette image le transformait tellement, en se
prťsentant ŗ lui ŗ chaque pas de sa vie et ŗ chaque mouvement de sa
pensťe, que, quand il voulut se consacrer entiŤrement ŗ la philosophie
thťologique, muse sťvŤre de son ťpopťe, il ťprouva le besoin de donner ŗ
cette philosophie et ŗ cette thťologie personnifiťes le nom, la forme,
le regard, la voix, la beautť de sa Bťatrice. C'est ce qu'il avoue sans
cesse lui-mÍme dans ses sonnets et dans sa _Vita nuova_ (vie nouvelle),
sorte de commentaire mystique ťcrit par lui-mÍme de ses oeuvres et de sa
pensťe.
Mais sa grande inspiration ne soufflait pas encore en lui quand il
ťcrivait ces sonnets et ces oeuvres en prose; elle ne souffla que dans
l'exil, quand les ťvťnements, la guerre, la diplomatie, la politique et
les passions civiles eurent fait silence, le soir, dans son ‚me. Alors,
et alors seulement, il entendit toute la voix de son gťnie, ťtouffťe
jusque-lŗ par les bruits de la terre. Il dessina son grand poŤme et il
commenÁa ŗ l'ťcrire.
Ce poŽme, c'ťtait lui! Le poŽte n'est-il pas toujours le sujet le plus
vivant et le plus intťressant de tout poŽme? Quels que soient les
innombrables dťfauts de ce poŽme ťpique du Dante dans la fable, on ne
peut nier que ce ne fŻt, ŗ l'ťpoque oý il vivait, et encore ŗ la nŰtre,
le seul vťritable texte d'une vaste ťpopťe qui rest‚t ŗ chanter aux
hommes. Il y eut dans la conception autant de gťnie vrai que dans
l'exťcution. J'aime ŗ assister, par la pensťe, ŗ cette lente conception
dans l'esprit de l'exilť de Florence. Je comprends comment il fut amenť
par la force et par la justesse de son esprit ŗ chanter le monde
invisible.
En effet, puisque l'ťtendue de son intelligence, l'ťlťvation de son
coeur, la fťconditť de son imagination, la richesse des couleurs sur sa
palette poťtique portaient cet homme du treiziŤme siŤcle ŗ crťer pour
l'Italie et pour le monde un poŽme ťpique, oý pouvait-il trouver, dans
l'histoire du moyen ‚ge, depuis les empereurs romains jusqu'ŗ lui, un
sujet hťroÔque, national ou europťen, d'ťpopťe? Il n'y en avait plus sur
la terre. HomŤre avait fait l'ťpopťe des Grecs, Virgile avait fait celle
des Latins; les places ťtaient prises. Le ciel paÔen, les hťros
fabuleux, l'Olympe, la terre, la mer, la guerre, les naissances et les
chutes d'empires, la nature physique et la nature morale avaient ťtť
dťcrites et chantťes par les poŽtes prťdťcesseurs de l'ťpoque
chrťtienne. Exceptť les grandes invasions des Barbares, qui ťtaient
venues, comme un reflux du Nord, submerger l'Italie, il n'y avait, dans
l'histoire, aucune grande ťpopťe hťroÔque ŗ construire; mais cette
ťpopťe des Barbares, ruine et humiliation de l'Italie, il appartenait ŗ
des bardes du Nord, et non ŗ des citoyens de la patrie conquise, de la
chanter.--Nous la lirons bientŰt ensemble.
VIII
Dante ne trouvait donc rien d'ťpique autour de lui dans l'histoire
d'Italie qui pŻt servir de texte ŗ son imagination; mais le monde
thťologique ťtait plein de dogmes nouveaux, de foi savante ou de foi
populaire, de croyances surnaturelles, de vťritťs morales ou de fantŰmes
imaginaires, flottant pÍle-mÍle dans le vide de l'esprit humain, comme
les figures tronquťes des rÍves au moment d'un rťveil.
L'‚me humaine, que le christianisme avait dťtachťe, dans les monastŤres
surtout, des intťrÍts terrestres, s'ťtait absorbťe dans l'intťrÍt de son
salut ťternel. Des cieux, des enfers, des purgatoires sans cesse
dťcrits, peuplťs, vidťs par les moines prťdicateurs dans les chaires du
peuple, ťtaient devenus, par la puissance de la foi, par l'habitude des
pratiques, par la rťpťtition des cťrťmonies, des rťalitťs de la pensťe
aussi visibles et aussi palpables dans l'esprit des fidŤles que les
rťalitťs physiques. L'imagination habitait pour ainsi dire ces mondes
intellectuels des morts autant et plus que le monde des vivants. Les
temples ťtaient remplis de leurs symboles; les murailles mÍme des rues
ťtaient couvertes des reprťsentations par le pinceau de ces trois
sťjours de l'‚me, enfer, purgatoire, paradis. Dans les fÍtes sacrťes, ou
mÍme profanes, on donnait aux peuples de l'Italie, au lieu de courses
olympiques ou de combats du cirque, des drames de thťologie chrťtienne.
Lŗ les ‚mes, les dťmons, les anges, les vierges, les saints, les damnťs,
les trois personnes de la Divinitť elles-mÍmes, jouaient des rŰles
d'acteur dans le drame thťogonique de ces mondes surnaturels. Le ciel et
la terre se touchaient et se confondaient, dans cette atmosphŤre de la
thťologie monastique et populaire, comme deux horizons dans la brume.
Dante lui-mÍme ťtait ce qu'on ťtait dťjŗ ŗ Florence ŗ cette ťpoque, et
ce qu'on fut bien davantage, quelques annťes aprŤs, ŗ l'ťpoque des
Mťdicis et de Lťon X: croyant et platonicien tout ŗ la fois, associant
dans son esprit la foi moderne ŗ la philosophie grecque et romaine; les
pieds dans l'…glise, la tÍte dans l'Olympe, l'‚me dans les cieux, dans
les ťpreuves ou dans les abÓmes du monde chrťtien.
Il ťtait naturel que ce monde surnaturel, qui tenait plus de place dans
l'imagination des hommes de son temps que le monde des vivants, lui
parŻt le seul et vrai sujet d'ťpopťe poťtique et mystique pour son ‚ge
et pour la postťritť. Il regarda donc pendant longtemps et jusqu'au
vertige dans la profondeur de son ‚me, de sa foi, de ses amours, de ses
haines, de ses vengeances, et il se dit: ęJe ferai voir l'invisible, et
je le rendrai si visible, par la puissance de ma foi et par la vigueur
de mes pinceaux, que la terre et le ciel sembleront s'ouvrir aux yeux
des hommes, et que je jouirai d'abord en ce temps, puis, par
anticipation, dans l'ťternitť, de cette justice ťternelle qui sera ŗ la
fois ma fťlicitť et ma vengeance. Gloire ŗ ceux que j'aurai sauvťs!
Malheur ŗ ceux que j'aurai perdus! Et surtout gloire ŗ moi-mÍme! Je ne
serai pas seulement, aux yeux de l'Italie guelfe et gibeline, un poŽte,
je serai le prophŤte de la divine rťtribution!Ľ
Ainsi ťvidemment se parla ŗ lui-mÍme le Dante, brŻlant ŗ la fois de
conviction divine et de colŤre humaine, quand, regardant pour la
derniŤre fois l'inique Florence du haut de l'Apennin, il lui lanÁa sa
malťdiction de proscrit et sa prophťtie de poŽte.
IX
On le voit, cette conception de l'ťpopťe de _la Divine Comťdie_ (titre
de son poŽme) ťtait double: divine par le plan, humaine par la
personnalitť; de lŗ ses beautťs et ses vices, que nous allons faire
saillir, le livre ŗ la main, sous vos yeux.
Je comprends d'autant mieux le plan de cette ťpopťe que moi-mÍme, hťlas!
mille fois infťrieur en conception, en ťloquence et en poťsie, au grand
exilť de Florence, j'avais conÁu, dŤs ma jeunesse, une ťpopťe, le grand
rÍve de ma vie, la seule ťpopťe qui me paraisse aujourd'hui rťalisable,
sur un plan ŗ peu prŤs analogue au plan de _la Divine Comťdie_.
Je m'ťtais dit: Qu'y a-t-il de plus intťressant aujourd'hui dans
l'humanitť? Sont-ce des batailles, des conquÍtes, des ťlťvations et des
catastrophes d'empires? Non; le monde en a tant vu, et il connaÓt
tellement les misťrables ressorts par lesquels la fortune ťlŤve ou
abaisse les conquťrants d'ici-bas, qu'il ne s'ťtonne guŤre plus des
vicissitudes des empires que de l'amoncellement et de l'ťcroulement
d'une vague en ťcume sur le lit de l'Ocťan. Mais ce qui intťresse
vťritablement l'homme, c'est l'homme; et dans l'homme, c'est la partie
permanente de son Ítre, c'est l'‚me; et dans l'‚me, c'est la destinťe
passťe, prťsente, future, ťternelle, de ce principe immatťriel,
intelligent, aimant, jouissant, souffrant, consciencieux, vertueux ou
criminel, se punissant soi-mÍme par ses vices, se rťcompensant soi-mÍme
par ses vertus, s'ťloignant ou se rapprochant de Dieu selon qu'il vole
en haut ou en bas dans la sphŤre infinie de sa carriŤre ťternelle,
jusqu'au jour oý il s'unit enfin, par la foi croissante et par l'amour
identifiant, ŗ son Crťateur, le souverain tre, la souveraine vťritť,
le souverain beau, le souverain bien.
X
Je me plais ŗ me rappeler encore, en ce moment, le lieu, le jour,
l'heure oý je conÁus soudainement, dans ma pensťe, le plan de cette
ťpopťe de l'‚me, de l'‚me suivie par le poŽte dans ses pťrťgrinations
successives et infinies ŗ travers les ťchelons des mondes et ses
existences d'ťpreuves.
C'ťtait en Italie, ŗ la fin de ma jeunesse. Je venais de passer un hiver
ŗ Naples, dans de vagues souffrances de nerfs qui sont la croissance de
l'esprit et qui donnent ŗ l'‚me les mÍmes angoisses que la croissance
trop accťlťrťe du corps donne aux sens. Une anxiťtť sourde et continue
travaillait ma pensťe; je n'ťtais bien ŗ aucune place; ce ciel serein,
ce beau soleil, cette mer ťblouissante, ces collines ťlysťennes, le
bruit de vie et de joie perpťtuelle de ce peuple d'enfants, d'amoureux,
de musiciens, de poŽtes, fourmillant sur les plages de cette cŰte, aprŤs
m'avoir tant charmť autrefois, m'ťtaient devenus presque fastidieux
alors. Il y avait je ne sais quel contraste blessant entre la sťrťnitť
ťpanouie de cette race et la mťlancolie maladive de mon esprit. Ce grand
jour m'aveuglait en m'ťblouissant. Je regrettais les brumes d'automne et
les tťnŤbres humides des forÍts de mon pays. L'…cosse et Ossian me
seyaient mieux que _le Tasse_ et _Sorrente_. Je lisais alors prťcisťment
les documents les plus dťtaillťs de la vie du Tasse; la lecture de ces
documents, tout remplis de preuves de sa folie, obsťdait mon imagination
et m'imprimait je ne sais quelle terreur. J'avais cependant l'esprit
aussi juste que le corps sain; mais j'ťtais malade d'un poŽme que je
voulais enfanter sans avoir eu encore la force de conception nťcessaire
ŗ cet enfantement.
Pour me soulager de cette obsession d'un mal inconnu et pour retremper
mes nerfs irritťs dans un air moins imprťgnť de sel et de soufre que
l'air de la mer et du Vťsuve, je cťdai au conseil du vieux _Cottonio_,
l'Esculape presque sťculaire de Naples, et je partis pour Rome.
XI
ņ peine eus-je dťpassť Capoue, et franchi les premiŤres collines des
Abruzzes qui sťparent l'atmosphŤre des montagnes de l'atmosphŤre de la
mer, que je me sentis soudainement guťri, comme un homme asphyxiť ŗ qui
une fenÍtre ouverte vient de rendre l'air respirable. Le lendemain,
aprŤs une nuit de sommeil passťe dans la villa de Cicťron ŗ _Molo di
Gaete_, je poursuivis dťlicieusement ma course vers Rome. Je couchai ŗ
Terracine, ŗ l'issue des marais Pontins; puis je commenÁai ŗ gravir les
collines de _Velletri_, de _Genzano_ et d'_Albano_, ces monts
_Penthťlique_ et ces monts _Hymette_ de la plaine de Rome, plus
majestueux et plus gracieux que ceux d'AthŤnes.
J'ťtais montť sur le siťge de ma calŤche pour contempler de plus haut et
de plus prŤs une plus large part de ce magique horizon, dťlices de
Cicťron, de MťcŤne, de Virgile et d'Horace; ils y ont incorporť leurs
noms comme des illustrations ťternelles de l'homme sur ces pages de la
nature.
C'ťtait le soir; le soleil, roulant autour de son disque rouge quelques
brumes sanglantes comme les vapeurs de pourpre de ces champs de bataille
ťvaporťes dans ses rayons, se prťcipitait dans la mer ťtincelante. Les
rides roses de cette mer ondulaient doucement dans le lointain comme une
ťtoffe moirťe qu'on dťploie et qu'on replie pour en faire admirer les
chatoyements. Les collines sur lesquelles serpentait la route ťtaient
couvertes dans leurs vallťes et sur leurs flancs de forÍts d'amandiers
en fleurs. Ces fleurs innombrables rťpandaient leurs teintes lactťes et
rosťes sur toute la campagne; elles tombaient des branches ŗ chaque
lťgŤre bouffťe du vent tiŤde de la mer; elles semaient d'un vťritable
tapis de couleurs riantes l'intervalle d'un arbre ŗ l'autre; elles
remplissaient l'air soulevť par la brise d'une nuťe de papillons
inanimťs qui venaient tomber jusque sous les roues sur le chemin.
Au sommet de ces collines de vignes hautes et d'amandiers fleuris
pyramidaient quelques mťtairies romaines ŗ l'aspect sombre, caverneux,
monumental; plus haut encore des pins parasols ŗ larges cimes
dentelaient l'horizon de leurs dŰmes noirs. Ces coupoles sombres
contrastaient avec la riante lumiŤre des vallťes, comme les siŤcles
immuables contrastent avec les printemps d'une heure qui fleurissent et
qui s'effeuillent ŗ leurs pieds!
XII
Je me souviens aujourd'hui de tous les dťtails les plus fugitifs de ce
beau coucher de soleil, au mois de mars, dans la campagne de Rome; je
m'en souviens avec plus de prťsence des objets dans les yeux que je ne
la ressentais mÍme alors. Cette scŤne a dŻ m'impressionner cependant
avec une certaine force, puisqu'elle se retrouve si complŤte et si vive
aprŤs trente ans dans mon imagination; mais je ne la percevais que par
mes sens et par le seul instinct, car mon esprit ťtait absorbť par la
contemplation intťrieure d'une tout autre nature.
Il me sembla que le rideau du monde matťriel et du monde moral venait de
se dťchirer tout ŗ coup devant les yeux de mon intelligence; je sentis
mon esprit faire une sorte d'explosion soudaine en moi et s'ťlever
trŤs-haut dans un firmament moral, comme la vapeur d'un gaz plus lťger
que l'atmosphŤre, dont on vient de dťboucher le vase de cristal, et qui
s'ťlance avec une lťgŤre fumťe dans l'ťther. J'y planai, dans cet ťther,
pendant je ne sais combien de temps, avec les ailes libres de mon ‚me,
sans avoir le sentiment du monde d'en bas qui m'environnait, mais que je
ne voyais plus de si haut.
Les crťations infinies et de dates immťmoriales de Dieu dans les
profondeurs sans mesure de ces espaces qu'il remplit de lui seul par ses
oeuvres; les firmaments dťroulťs sous les firmaments; les ťtoiles,
soleils avancťs d'autres cieux, dont on n'aperÁoit que les bords, ces
caps d'autres continents cťlestes, ťclairťs par des phares entrevus ŗ
des distances ťnormes; cette poussiŤre de globes lumineux ou
crťpusculaires oý se reflťtaient de l'un ŗ l'autre les splendeurs
empruntťes ŗ des soleils; leurs ťvolutions dans des orbites tracťes par
le doigt divin; leur apparition ŗ l'oeil de l'astronomie, comme si le
ciel les avait enfantťs pendant la nuit et comme s'il y avait aussi lŗ
haut des fťconditťs de sexes entre les astres et des enfantements de
mondes; leur disparition aprŤs des siŤcles, comme si la mort atteignait
ťgalement lŗ haut; le vide que ces globes disparus comme une lettre de
l'alphabet laissent dans la page des cieux; la vie sous d'autres formes
que celles qui nous sont connues, et avec d'autres organes que les
nŰtres, animant vraisemblablement ces gťants de flamme; l'intelligence
et l'amour, apparemment proportionnťs ŗ leur masse et ŗ leur importance
dans l'espace, leur imprimant sans doute une destination morale en
harmonie avec leur nature; le monde intellectuel aussi intelligible ŗ
l'esprit que le monde de la matiŤre est visible aux yeux; la saintetť de
cette ‚me, parcelle dťtachťe de l'essence divine pour lui renvoyer
l'admiration et l'amour de chaque atome crťť; la hiťrarchie de ces ‚mes
traversant des rťgions tťnťbreuses d'abord, puis les demi-jours, puis
les splendeurs, puis les ťblouissements des vťritťs, ces soleils de
l'esprit; ces ‚mes montant et descendant d'ťchelons en ťchelons sans
base et sans fin, subissant avec mťrite ou avec dťchťance des milliers
d'ťpreuves morales dans des pťrťgrinations de siŤcles et dans des
transformations d'existences sans nombre, enfers, purgatoires, paradis
symbolique de _la Divine Comťdie_ des terres et des cieux;
Tout cela, dis-je, m'apparut, en une ou deux heures d'hallucination
contemplative, avec autant de clartť et de palpabilitť qu'il y en avait
sur les ťchelons flamboyants de l'ťchelle de Jacob dans son rÍve, ou
qu'il y en eut pour le Dante au jour et ŗ l'heure oý, sur un sommet de
l'Apennin, il ťcrivit le premier vers fameux de son oeuvre:
Nel mezzo del cammin di nostra vita,
et oý son esprit entra dans la forÍt obscure pour en ressortir par la
porte lumineuse.
XIII
ęC'en est fait!Ľ m'ťcriai-je en me rťveillant, ęj'ai trouvť mon poŽme!Ľ
Et ce n'ťtait pas seulement mon poŽme que j'avais cru trouver; c'ťtait
le jour ou plutŰt le crťpuscule de ce monde de vťritťs que la Providence
fait flotter toujours ŗ portťe, mais toujours un peu au-dessus de notre
intelligence, comme le pŤre fait flotter le fruit au-dessus de la taille
de son enfant pour lui faire lever ses petites mains jusqu'ŗ l'arbre, et
pour le faire grandir par l'effort jusqu'ŗ la branche.
Crťation, thťogonie, histoire, vie et mort, phases primitives,
successives et dťfinitives de l'esprit, destinťe de tous les Ítres
animťs, de l'‚me humaine d'abord, puis de celle de l'insecte, puis de
celle des soleils, puis de celle de ces myriades d'esprits invisibles,
mais ťvidents, qui comblent le vide entre Dieu et le nťant, qui
pullulent dans ses rayons, et qui sont, je n'en doute pas, aussi divers
et aussi multipliťs que les atomes flottants qui nous apparaissent dans
un rayonnement de soleil; je crus tout comprendre; et, en effet, je
compris tout ce que Dieu permet de comprendre ŗ une de ses plus infimes
intelligences.
Et une grande joie, une joie que je n'avais jamais goŻtťe avant, que je
n'ai jamais goŻtťe depuis, se rťpandit dans tout mon Ítre. Je croyais
m'Ítre approchť autant qu'il ťtait en moi du foyer de la vťritť; je n'en
entrevoyais pas seulement la lueur, qui m'ťblouissait, j'en sentais la
chaleur, qui me descendait de l'esprit au coeur, du coeur aux sens;
j'ťtais ivre d'intelligence, s'il est permis d'associer ces deux mots.
XIV
En un instant mon poŽme ťpique fut conÁu. Je me supposai assistant,
comme un barde de Dieu, ŗ la crťation des deux mondes matťriel et
moral. Je pris deux ‚mes ťmanťes le mÍme jour, comme deux lueurs, du
mÍme rayon de Dieu: l'une m‚le, l'autre femelle, comme si la loi
universelle de la gťnťration par l'amour, cette tendance passionnťe de
la dualitť ŗ l'unitť, ťtait une loi des essences immatťrielles de mÍme
qu'elle est la loi des Ítres matťriels animťs (et qui est-ce qui n'est
pas animť dans ce qui vit pour se reproduire?). Je lanÁai ces deux ‚mes
soeurs, mais devenues ťtrangŤres l'une ŗ l'autre, dans la carriŤre de
leur ťvolution ŗ travers les modes de leur vie renouvelťe. Je les suivis
d'un regard surnaturel et ťternel dans les principales transfigurations
angťliques ou humaines qu'elles avaient ŗ subir dans les mondes
supťrieurs et infťrieurs, se rencontrant quelquefois, sans se
reconnaÓtre jamais complťtement, de sphŤre en sphŤre, d'‚ge en ‚ge,
d'existence en existence, de vie en mort et de mort en renaissance, dans
le ciel et sur la terre. Puis, aprŤs ces douze ou vingt transfigurations
accomplies, qui tantŰt les rapprochaient de Dieu par leurs vertus,
tantŰt les en ťloignaient par leurs fautes, en mÍme temps que ces vertus
ou ces fautes les rapprochaient aussi ou les sťparaient davantage l'une
de l'autre, je les rťunissais enfin dans l'unitť de l'amour mutuel et
de l'amour divin, ŗ la source de vie, de saintetť et de fťlicitť d'oý
tout ťmane et oý tout remonte par sa gravitation naturelle vers le
souverain bien et le souverain beau, l' tre parfait, l' tre des Ítres,
Dieu.
Chaque scŤne de ce drame sacrť ťtait empruntťe ŗ la terre ou aux autres
planŤtes de l'espace, et les dťcorations poťtiques changeaient ainsi, au
grť du poŽte, comme l'ťpoque, les ťvťnements, les personnages. Le poŽme
s'ouvrait aux portes de l'…den et se terminait ŗ la fin de la terre par
l'explosion du globe, rendant toutes ses ‚mes purifiťes, divinisťes par
la misťricorde de Dieu, et lanÁant ses gerbes de feu dans le firmament
comme les flammŤches d'un bŻcher qui se consume lui-mÍme aprŤs
l'holocauste accompli.
On comprend quelle richesse, et quelle variťtť, et quel pathťtique, et
quel mystŤre un pareil texte d'ťpopťe fournissait au poŽte, s'il y avait
eu un poŽte, ou si j'avais ťtť moi-mÍme ce poŽte digne de concevoir et
de rendre en chants une pareille inspiration. Mais je n'ťtais qu'un
enfant essayant de souffler des ťtoiles au lieu de souffler ses bulles
de savon. Mon poŽme, aprŤs que je l'eus contemplť quelques annťes,
creva sur ma tÍte comme une de ces bulles de savon colorťes, en ne me
laissant que quelques gouttes d'eau sur les doigts, ou plutŰt quelques
gouttes d'encre, car la _Chute d'un Ange_, _Jocelyn_, le _PoŽme des
Pťcheurs_, que j'ai perdu dans mes voyages, et quelques autres ťbauches
ťpiques que j'ai avancťes, puis suspendues, sont de ces gouttes d'encre.
Ces poŽmes ťtaient autant de chants ťpars de mon ťpopťe de l'‚me. Je
possťdais dans ma pensťe le fil conducteur ŗ travers ces ťbauches, et je
comptais les relier ŗ la fin les unes aux autres par cette unitť des
deux mÍmes ‚mes, toujours ťgarťes, toujours retrouvťes, toujours suivies
de l'oeil et de l'intťrÍt, dans leur _Divine Comťdie_, ŗ travers la vie,
la mort, jusqu'ŗ l'ťternelle vie!
XV
Ce poŽme avait quelque analogie lointaine avec _la Divine Comťdie_ du
Dante. Il y a nťanmoins cette diffťrence: c'est que l'intťrÍt est
impossible dans le plan du Dante, attendu que son poŽme n'est qu'un
spectacle auquel il assiste sans y prendre part, une espŤce de revue
rapide des supplices de quelques ombres de ses ennemis. Les personnages
passent comme des fantŰmes sous le fouet des dťmons et sous l'oeil du
poŽte; l'intťrÍt, sans cesse morcelť et interrompu, passe avec eux et ne
laisse qu'un ťblouissement dans l'imagination; tandis que, dans l'ťpopťe
telle que je la concevais, l'intťrÍt attachť aux mÍmes ‚mes dans des
pťripťties diverses ne se rompait qu'ŗ leur rťunion dťfinitive et ŗ leur
bťatitude ťternelle. Il ne manquait, je le rťpŤte, ŗ mon ťpopťe qu'une
chose: le poŽte.
Le _Dante_ ou le _Tasse_, ou _Pťtrarque_ pouvaient, peut-Ítre, exťcuter
cette ťpopťe de l'‚me, seul sujet qui reste; mais il n'y avait en moi,
disciple trop dťgťnťrť de ces grands hommes, que la force de rÍver une
telle conception sans la puissance de l'enfanter.
XVI
Revenons au Dante.
En disant ce que devait Ítre une ťpopťe surnaturelle aprŤs les ťpopťes
hťroÔques ťpuisťes, nous avons dit ce qui, selon nous, manquait ŗ la
sienne: l'intťrÍt, l'universalitť, l'unitť.
C'est lŗ le sujet de la violente objurgation que nous adressent, depuis
quelques mois, les nombreux journaux littťraires de l'Italie. Nous avons
touchť ŗ l'arche, et la majestť du dieu nous frappe de mort. Voyons
cependant si nous y avons touchť sans le respect convenable. Voici le
fait.
Il y a quelques mois, nous fÓmes imprimer, selon notre habitude, dans le
journal _le SiŤcle_, quelques pages lťgŤres de notes intimes _sur nos
lectures_, pages dans lesquelles nous parlions, comme dans une
conversation au coin du feu, du _Dante_ et de son poŽme.
Voici textuellement ce que nous disions. On verra, dans la suite de
cette ťtude approfondie sur le _Dante_ et sur son poŽme, que ce que nous
pensons aujourd'hui ne diffŤre pas considťrablement de ce que nous
ťcrivions dans _le SiŤcle_. Nous dťfinissons le Dante: _Un homme plus
grand que son poŽme._
Voici le crime; lisez.
ęNous allons froisser bien des fanatismes. N'importe, disons ce que nous
pensons.
ęOn peut, selon nous, classer le poŽme du Dante, _l'Enfer, le Purgatoire
et le Paradis_, parmi ces poťsies locales, nationales, temporaires, qui
ťmanent du gťnie du lieu, de la nation, de l'ťpoque, et qui s'adressent
aux croyances, aux passions de la multitude. Quand le poŽte est aussi
mťdiocre que son pays, son peuple, son ťpoque, ces poťsies sont
entraÓnťes dans le courant ou dans l'ťgout des siŤcles avec la foule qui
les goŻte. Quand le poŽte est _un grand homme_ comme le Dante, le poŽte
survit ťternellement, et on essaye aussi de faire survivre le poŽme
(_tout entier_), mais on n'y parvient pas; l'oeuvre jadis intelligible
et populaire rťsiste comme le sphinx aux interrogations des ťrudits; il
n'en subsiste que des fragments plus semblables ŗ des ťnigmes qu'ŗ des
monuments. Pour comprendre le poŽme du Dante, il faudrait ressusciter
toute la plŤbe florentine de son ťpoque (qui l'exila, le brŻla en
effigie et rasa sa maison); car ce sont les croyances, les popularitťs
et les impopularitťs de cette plŤbe qu'il a chantťes.
ęIl est puni par oý il a pťchť: il a chantť pour le temps; la postťritť
ne le comprend pas.Ľ _Je vous remercie_, ťcrit Voltaire, _d'avoir eu le
courage d'ťcrire contre ce monstre d'obscuritť, etc._ Nous n'avons rien
dit de _si cru_, de si injuste; mais continuons la citation du
_SiŤcle_.
ęTout ce qu'on peut comprendre, c'est que le poŽme, exclusivement
toscan, du _Dante_ ťtait une espŤce de satire vengeresse du poŽte et de
l'homme d'…tat contre les partis auxquels il avait vouť sa haine. Cette
idťe ťtait mesquine et indigne du poŽte. Le gťnie n'est pas un jouet mis
au service de nos petites colŤres; c'est un don de Dieu qu'on profane en
le ravalant ŗ ces petitesses. _La lyre_, pour nous servir de
l'expression antique, n'est pas une tenaille pour torturer nos
adversaires, elle n'est pas une claie pour traÓner des cadavres aux
gťmonies; il faut laisser cela ŗ faire au licteur, ce n'est pas oeuvre
de poŽte. Le Dante eut ce tort; il crut que les siŤcles, infatuťs par la
beautť de ses vers, prendraient parti contre on ne sait quels ennemis
qui battaient alors le pavť de Florence. Ces amitiťs ou ces inimitiťs
d'hommes obscurs sont parfaitement indiffťrentes ŗ la postťritť; elle
aime mieux un beau vers, une belle image, un beau sentiment, que toute
cette chronique rimťe de la place du _Vieux-Palais_ ŗ Florence.
ęMais le style dans lequel le Dante a ťcrit cette gazette de l'autre
monde est impťrissable. Rťduisons donc ce poŽme bizarre ŗ sa vraie
valeur, le style. Nous savons bien que nous choquons, en parlant ainsi,
toute une ťcole littťraire rťcente (en France comme en Italie); cette
ťcole s'acharne sur le poŽme du Dante sans parvenir ŗ le comprendre,
comme les mangeurs d'opium, en Orient, s'acharnent ŗ regarder le
firmament pour y dťcouvrir Dieu. Mais nous avons vťcu de longues annťes
en Italie dans la sociťtť de ces ťrudits commentateurs et explicateurs
du Dante, qui se succŤdent de gťnťration en gťnťration comme les ombres
des hiťroglyphes sur les obťlisques de ThŤbes. La persťvťrance mÍme de
ces commentateurs est la meilleure preuve de l'impuissance du
commentaire ŗ ťlucider le texte. Un secret une fois trouvť ne se cherche
plus avec tant d'acharnement. De jeunes FranÁais s'ťvertuent maintenant
ŗ poursuivre ce sens cachť qui a lassť les Toscans eux-mÍmes. Que le
dieu du chaos leur soit propice!
ęQuant ŗ nous, comme Voltaire, nous n'avons trouvť, dans le Dante, qu'un
grand inventeur de style, un grand crťateur de langue ťgarť dans une
conception tťnťbreuse, un immense fragment de poŽte dans un petit nombre
de morceaux gravťs plutŰt qu'ťcrits avec le ciseau de ce _Michel-Ange de
la poťsie_, quelquefois une grossiŤre trivialitť qui se dťgrade
jusqu'au cynisme du mot (le papier franÁais n'en souffrirait pas ici la
reproduction et la preuve), une quintessence de thťologie scolastique
qui s'ťlŤve jusqu'ŗ la vaporisation de l'idťe; enfin, pour dire notre
sentiment d'un seul mot, _un grand homme_ et un mauvais poŽme!Ľ
XVII
On voit que la prťtendue injure n'est pas mortelle, et que si j'ai ťtť
accusť, peut-Ítre avec quelque fondement, par les Italiens, d'avoir
mťconnu la beautť architecturale du poŽme, je suis bien loin d'avoir
mťconnu la grandeur colossale et michel-angťlesque de l'homme.
Je poursuivais, dans cette note du _SiŤcle_, la mÍme pensťe; je citais
en entier l'ťpisode de Francesca, et voici comment j'en parlais: ęQuoi
de plus incendiaire que ces deux amants seuls avec ce livre complice qui
interprŤte malheureusement leur silence, que cet ťgarement qui les perd,
et enfin que ce supplice changť en fťlicitť amŤre par le souvenir de
leur sťparation sur la terre et par le sentiment de leur
indivisibilitť dans le ch‚timent? Si Dante avait beaucoup de pages comme
celle-lŗ, il surpasserait son maÓtre Virgile et son compatriote
Pťtrarque. Peu de pages de poťsie ťgalent en mťlancolique beautť et en
perfection ces quelques vers. Le tableau est ťtroit, la peinture est
sobre de couleurs; l'impression est ťternelle! C'est que l'ťmotion et la
beautť y sont complŤtes et pour ainsi dire infinies. Et je dis pourquoi.
C'est que la jeunesse, la beautť, la naÔve innocence des deux
personnages, qui ne se dťfient ni d'eux-mÍmes, ni des autres; leurs
fronts penchťs sur le mÍme livre, qui, semblable ŗ un miroir terni par
leur haleine, leur retrace et leur rťvŤle tout ŗ coup leur propre image,
et les prťcipite dans le mÍme dťlire et dans le mÍme enfer par la fatale
rťpercussion du livre contre le coeur et du coeur lui-mÍme contre un
autre coeur, sont lŗ des coups de pinceaux achevťs. C'est que le rťcit
est simple, court, candide comme la confession de deux enfants. Je
voudrais avoir,Ľ disais-je, ęje voudrais avoir pour plume le pinceau du
grand peintre de sentiment Scheffer, pour traduire ici le trop court
ťpisode de FranÁoise de Rimini, qui fait pleurer et rÍver, dans le poŽme
et dans le tableau de Scheffer, les imaginations amoureuses..... Il y a
lŗ une divine intelligence du coeur de la femme qui prouve que le Dante
avait aimť. Il sait le secret des coeurs tendres, qu'il ne faut pas dire
trop haut, mÍme aux enfers: c'est que l'amour dťfie tout, exceptť la
sťparation, le seul enfer de ceux qui aiment.
ę…coutons le poŽte. Il dťcrit d'abord en vers qui frissonnent de froid
l'ouragan glacť par lequel sont ťternellement fouettťs et roulťs dans un
ocťan de brume et de frimas les ombres de ceux dont les flammes de
l'amour coupable consumŤrent ici-bas les sens et les ‚mes.Ľ
Quand j'ai reproduit cette scŤne pathťtique, que je ne reproduis pas ici
en ce moment parce que je vous la reproduirai plus loin dans cet
entretien, je m'ťcrie:
ęSapho dans sa strophe de feu n'a rien de comparable. La nature du
supplice lui-mÍme, le vent glacial qui emporte dans un tourbillon de
frimas les deux coupables, mais qui les emporte ensemble, ťchangeant
l'amŤre et ťternelle confidence de leur repentir, buvant leurs larmes,
mais y retrouvant au fond quelque arriŤre-goutte de leur fťlicitť
perdue, quoi de plus dans un tel rťcit ťpique? L'ťmotion n'est-elle pas
produite ici par le Dante en quelques vers plus complťtement que par
tout un poŽme? Aussi c'est pour cela que le poŽme survit; le poŽme de la
thťologie est mort, celui de l'amour est immortel.Ľ
Et, aprŤs avoir reproduit un second ťpisode que je vous analyserai tout
ŗ l'heure, je m'ťcrie en finissant:
ęSi l'immense poŽte n'est pas lŗ, oý sera-t-il? Ni HomŤre, ni Virgile,
ni Shakspeare n'ont en si peu de notes de pareils accents. N'eŻt-il que
ces deux scŤnes, Dante mťriterait d'Ítre nommť ŗ cŰtť d'eux!Ľ (_SiŤcle_,
numťro du 20 dťcembre 1856.)
XVIII
Voilŗ, je le rťpŤte, les prťtendus sacrilťges dont je suis coupable
envers le grand Toscan! Voilŗ pour quels crimes imaginaires contre
l'inviolabilitť de leur poŽte vingt journaux littťraires ou politiques
de l'Italie, dont les rťdacteurs n'ont certainement pas lu ma note dans
son texte, me traÓnent sur la claie, aux ťgouts de l'Arno, me lapident
de diatribes oý la calomnie assaisonne l'injure, et m'ensevelissent
tout vivant et tout brŻlant de l'amour de l'Italie sous des monceaux de
papier patriotique noirci de leur colŤre. Cette colŤre va jusqu'ŗ la
tragťdie dans un de ces journaux qui m'a envoyť rťcemment ŗ son tour son
invective circulaire. ęPourquoi ma plume,Ľ s'ťcrie le rťdacteur en
finissant, ęn'est-elle pas une ťpťe, et pourquoi ne peut-elle te percer
le coeur du mÍme fer dont notre compatriote, le colonel _Pepe_, te perÁa
autrefois le bras?Ľ
Voltaire parlait des amťnitťs littťraires de son temps; qu'aurait-il dit
de celle-lŗ? Et quel fondement ŗ tant de fureur nationale? On vient de
le voir: j'ai appelť le Dante un grand homme, un Michel-Ange de la
poťsie, un rival d'HomŤre, de Virgile, de Shakspeare, quelquefois
supťrieur ŗ eux par fragments ťpiques; mais j'ai eu l'audace de dire que
son poŽme ťtait obscur, que les expressions se perdaient quelquefois
dans les nuages de la thťologie mystique, et descendaient souvent
jusqu'au scandale de l'image et jusqu'au cynisme du mot!
Je n'ai pas de rancune contre ces patriotes de l'hťmistiche et de la
rime, qui se sont crus outragťs parce qu'ils ne m'avaient pas lu, et
qui m'ont excommuniť sur parole. Le patriotisme est honorable partout;
le gťnie italique est aussi une patrie dont ils dťfendent ŗ coups de
plume les magnifiques frontiŤres. Seulement je les engage ŗ viser plus
juste, et ŗ ne pas tirer sur leurs meilleurs amis en croyant tirer sur
leurs ennemis. Que ne placent ils leur patriotisme de collťge sur les
Alpes et sur l'Apennin au lieu de le placer sur des rimes du Dante?
Reprenons le sujet.
XIX
Mais, avant de feuilleter avec vous page ŗ page, ces trois poŽmes en un,
_l'Enfer_, _le Purgatoire_, _le Paradis_, poŽmes pleins de tant de
splendeur de style et de tant de tťnŤbres d'idťes, disons un mot des
diffťrentes interprťtations que les traducteurs ou commentateurs
franÁais ont donnťes du sens mťtaphysique de _la Divine Comťdie_.
Il n'y a pas trŤs-longtemps que le poŽme du Dante a commencť ŗ retentir
an delŗ des Alpes. Boileau n'en parle pas dans son _Art poťtique_, ou,
s'il en parle, dans le passage oý il rťprouve le merveilleux chrťtien en
poťsie, c'est avec dťdain. Voltaire en parle dans quelques lettres ŗ
des savants italiens, mais il ne l'avait ťvidemment pas lu tout entier
(chose difficile), et on a vu plus haut qu'il en parle comme d'une
_monstruositť_ poťtique.
Les premiŤres traductions qu'on en donna en France, ŗ la fin du dernier
siŤcle, ne sont que des paraphrases enluminťes ou affadies; il est
impossible d'y trouver trace de l'original: ce sont des dentelles sur le
corps d'Hercule. La premiŤre traduction sťrieuse et les premiers
commentaires compťtents sont la traduction et les notes explicatives du
chevalier Artaud. M. Artaud ťtait un diplomate et un savant franÁais,
rťsidant tantŰt ŗ Florence, tantŰt ŗ Rome. Je l'ai beaucoup connu dans
ma jeunesse; j'ai ťtť son disciple en diplomatie italienne et en
intelligence des poŽtes de cette terre de toute poťsie. C'est lui qui
m'a fait ťpeler le Dante, c'est ŗ lui que je dois le droit de le
comprendre et d'en parler aujourd'hui. J'aime ŗ lui rendre ce tribut de
reconnaissance sur sa tombe; il y est descendu tard; il s'y repose d'une
vie honorable et laborieuse dans un champ des morts de Paris. Il ťtait
digne de dormir avec les illustres Toscans sur sa couche de gloire dans
le champ des morts (_Campo Santo_) de Pise, ou dans l'ťglise de _Santa
Croce_ ŗ Florence, ou bien ŗ Ravenne, ŗ l'ombre du sťpulcre du Dante!
Les Italiens devraient revendiquer sa dťpouille comme ils devraient
revendiquer un jour la mienne, si l'homme doit dormir en effet dans la
terre qu'il a le plus aimťe.
XX
La destinťe de M. Artaud ťtait bizarre. Entrť dans la diplomatie
franÁaise sous les derniers ministŤres de Louis XVI, il y ťtait restť
sous la Convention, sous le Directoire, sous le Consulat, sous l'Empire,
jusqu'au jour oý il n'y eut plus d'autre diplomate ŗ Rome que le gťnťral
_Miollis_, homme de mÍme moelle et de mÍmes os antiques que M. Artaud.
Il avait passť alors ŗ Florence de longues annťes dans la sociťtť
d'Alfieri et de la comtesse d'Albany. Puis il ťtait revenu ŗ Rome avec
l'…glise; il avait ťtť l'ami de Pie VI, le plus doux des papes, et du
cardinal Gonsalvi, le plus sťduisant des ministres. Il y avait ťtť ŗ lui
seul la tradition de la diplomatie franÁaise en permanence depuis le
cardinal de Bernis jusqu'au duc de Montmorency-Laval, en passant par le
gťnťral Duphot et par M. de Canclaux. Il ťtait ŗ Rome et ŗ Florence
inamovible comme la tradition, ŗ peu prŤs semblable ŗ ces premiers
drogmans que les puissances europťennes entretiennent dans les cours
d'Asie auprŤs de leurs ambassadeurs pour leur enseigner la langue du
pays et la politique de ces cours. Un tel homme est indispensable ŗ
Rome, oý il y a une politique permanente et traditionnelle ŗ cŰtť de
souverains ťlectifs et transitoires.
M. Artaud remplissait merveilleusement ce rŰle prŤs de la cour romaine.
Liť avec tous les membres distinguťs de cette aristocratie ťlective
qu'on appelle le _Sacrť Collťge_, il les avait vu arriver ŗ Rome, y
remplir successivement les divers degrťs des fonctions de l'…glise et de
l'administration au Vatican, puis s'ťlever de dignitťs en dignitťs
jusqu'ŗ ces ťpiscopats, ŗ ces cardinalats, ŗ ces principautťs, ŗ cette
papautť qui les rendaient arbitres de la politique sacrťe ou profane du
monde catholique. Les rapports qu'il avait eus avec eux dans leur
jeunesse, dans leurs revers, dans leurs lťgations, le rendaient
ťminemment propre ŗ traiter avec eux presque familiŤrement les grandes
affaires.
Ses liaisons avec le monde savant et lettrť de Rome n'ťtaient pas moins
intimes. Nulle part il n'existe en Europe une caste savante et lettrťe
comparable ŗ ces abbťs romains, vivant pour ainsi dire dans les
catacombes des bibliothŤques, et s'enivrant depuis l'enfance jusqu'ŗ la
mort de la poussiŤre des livres.
M. Artaud avait contractť auprŤs d'eux cette mÍme passion des antiquitťs
et des curiositťs bibliographiques de l'Italie. Le matin, c'ťtait un
diplomate habile et consommť, traitant avec une autoritť polie les
intťrÍts de la France ŗ Rome; le soir, c'ťtait un ťrudit presque
monastique, ťlucidant avec des religieux et des bibliothťcaires le texte
d'un vers du Dante ou le sens d'une allusion obscure de ce poŽte aux
hommes et aux ťvťnements de son temps. C'est pendant quarante ans d'une
pareille vie que la traduction et les notes de M. Artaud furent, pour
ainsi dire, filtrťes goutte d'encre ŗ goutte d'encre. Il avait transfusť
son sang dans l'ombre du poŽte toscan. La figure mÍme de M. Artaud avait
pris quelque chose de la physionomie anguleuse, plombťe, ascťtique, que
les peintres donnent au visage du Dante, allongť et amaigri sous son
laurier.
XXI
ņ mon premier voyage ŗ Rome j'avais des lettres de recommandation pour
ce savant diplomate. Il m'accueillit avec cette bontť un peu supťrieure
d'un homme fait envers un adolescent. Ma passion prťcoce pour l'Italie
poťtique l'intťressa ŗ moi; il m'ouvrit le sanctuaire du Dante; il
m'apprit ŗ ťpeler vers ŗ vers ce grand poŽme ou cette grande ťnigme dont
il ťtait le sphinx depuis tant d'annťes. Il m'initia en mÍme temps, par
une immense variťtť d'anecdotes dont il ťtait le recueil vivant, ŗ la
diplomatie consommťe de la vieille cour de Rome et ŗ l'histoire de cette
capitale ecclťsiastique depuis la rťvolution franÁaise jusqu'ŗ la
captivitť de Pie VI ŗ Savone.
Je goŻtais beaucoup ces entretiens avec un homme supťrieur en ‚ge, en
ťrudition et en politique. Je n'ai jamais perdu le souvenir de ces
heures agrťables passťes dans son cabinet de traducteur ou dans sa
chancellerie de diplomate. Ce souvenir m'a peut-Ítre rendu partial pour
sa traduction et pour ses commentaires; mais j'avoue que jusqu'ici je
n'ai pu lire avec une complŤte sťcuritť de sens le poŽme du Dante que
dans l'ťdition en deux langues de M. Artaud, et en contrŰlant ŗ chaque
instant le texte par le commentaire. M. Artaud n'ťtait pas poŽte, j'en
conviens; mais il ťtait savant. Dante ťtait assez poŽte pour deux; ce
qu'il lui fallait, c'ťtait un interprŤte. Il n'en pouvait pas avoir un,
selon moi, plus pťnťtrant, plus consciencieux et plus fidŤle que le
secrťtaire d'ambassade de France ŗ Rome et ŗ Florence. Depuis ce temps
ce livre ne m'a pas quittť.
XXII
Il y a une autre traduction en franÁais et en prose, qu'on dit
excellente et que je n'ai lue que par fragments; c'est celle d'un homme
de lettres italien. M. Fiorentino s'est naturalisť FranÁais par la
puretť de son style dans notre langue. C'est un lťgitime prťjugť en
faveur du sens de cette traduction que d'avoir ťtť ťcrite par un
compatriote du Dante. Le sens de _la Divine Comťdie_ coule, pour ainsi
dire, dans les veines des Italiens. _Barbarus hic ego sum_, devons-nous
dire ŗ M. Fiorentino, nous autres Barbares. Il vient de me lancer ŗ ce
titre une indulgente ťpigramme dans un article de journal; nous l'avons
acceptťe en toute humilitť. Un traducteur qui venge son poŽte est
respectable dans sa piťtť filiale. Le droit des traducteurs est de
confondre tellement leur personne avec la personne de leur modŤle que
les critiques adressťes ŗ l'un blessent l'autre, et que, si on ťvoque le
Dante, M. Fiorentino a le droit de rťpondre: ęMe voilŗ!Ľ
Nous admettons celte identitť sans doute trŤs-lťgitime entre le poŽte et
l'interprŤte: c'est l'identitť de la voix et de l'ťcho. M. Fiorentino a
ťtť un bel ťcho de l'Italie en France. Sa petite ťpigramme immťritťe
(car nous ne nous sommes jamais mis, comme poŽte, au niveau seulement
d'un vers du Dante) ne nous empÍchera pas de remercier cet ťcrivain de
son excellente interprťtation.
AprŤs lui M. Mongis, en vers, M. Brizeux, digne de lutter corps ŗ corps,
et plusieurs autres traducteurs sťrieux ont tentť l'oeuvre.
XXIII
M. de Lamennais, c'est-ŗ-dire un souverain ouvrier de style, a consacrť
ses derniŤres annťes ŗ une traduction littťrale et mot ŗ mot de _la
Divine Comťdie_. M. de Chateaubriand avait consacrť ainsi ses derniŤres
veilles d'ťcrivain ŗ une traduction de Milton.
Il est glorieux sans doute pour l'Italie comme pour l'Angleterre que les
deux plus grands prosateurs franÁais de ce siŤcle n'aient pas jugť
au-dessous de leur talent de copier ces deux modŤles ťtrangers et
d'ťcrire leurs noms sur les piťdestaux ťternels de Milton et de Dante;
mais le systŤme de traduction qu'ils ont adoptť l'un et l'autre est,
selon nous, un faux systŤme, un jeu de plume plutŰt qu'une fidťlitť de
traducteur. Ils ont voulu, par une copie servile plutŰt que fidŤle,
rendre le mot par le mot, la phrase par la phrase, la syllabe par la
syllabe. Erreur! ils ont montrť en cela qu'ils ne s'ťtaient pas rendu
compte du gťnie des langues.
Que vous demande, en effet, le lecteur? Ce ne sont pas des mots qu'il
demande, c'est du sens. Or deux langues diffťrentes n'expriment pas le
mÍme sens dans les mÍmes mots, ni mÍme dans le mÍme nombre de mots. Si
vous vous astreignez ŗ rendre puťrilement le vers par le vers, le mot
par le mot, le tercet par le tercet, l'octave par l'octave, que
faites-vous? Vous faussez par l'effort votre propre langue sans parvenir
ŗ lui faire rendre ni la forme ni le sens de la langue que vous
traduisez. L'instrument n'est pas le mÍme; vous ne le manierez pas avec
la mÍme mesure et avec le mÍme doigtť. Vous faites ce que voudrait
faire un musicien qui prťtendrait imiter le violon avec la cimbale ou la
flŻte avec le tambourin. Encore une fois, ce n'est pas l'expression
qu'il faut traduire, c'est le sentiment. Pour transvaser ce sentiment,
cette poťsie, cette harmonie, cette image, d'un dialecte dans un autre,
vous n'avez pas trop de toute la libertť, de toute la souplesse, de
toute la richesse de votre langue. Ne vous entravez donc pas vous-mÍme
en vous liant comme un boeuf servile au joug parallŤle du mot ŗ mot.
C'est ce qu'avait fait M. de Chateaubriand pour Milton, c'est ce qu'a
voulu faire M. de Lamennais pour le _Dante_; oeuvre estimable, mais
malheureuse, oý la servilitť dťtruit la fidťlitť.
XXIV
Un autre jeune traducteur de _la Divine Comťdie_ tente en ce moment une
oeuvre mille fois plus difficile, et, chose plus ťtonnante encore, il y
rťussit.
Nous voulons parler de la traduction de _la Divine Comťdie_ en vers
franÁais, par M. Louis Ratisbonne.
Malgrť le prodigieux effort de talent et de langue nťcessaire pour
traduire un poŽte en vers, M. Louis Ratisbonne n'a pas seulement rendu
le sens, il a rendu la forme, la couleur, l'accent, le son. Il a
communiquť au mŤtre franÁais la vibration du mŤtre toscan; il a
transformť, ŗ force d'art, la pťriode poťtique franÁaise en tercets du
Dante. Ce chef-d'oeuvre de vigueur et d'adresse dans le jeune ťcrivain
est tout ŗ la fois un chef-d'oeuvre d'intelligence de son modŤle. M.
Louis Ratisbonne rappelle la traduction, jusqu'ici inimitable, des
_Gťorgiques_ de Virgile par l'abbť Delille; mais le Dante, poŽte
abrupte, ťtrange, sauvage et mystique tout ensemble, est mille fois plus
inaccessible ŗ la traduction que Virgile. La lumiŤre se rťflťchit mieux
que les tťnŤbres dans le miroir de l'esprit humain comme dans le miroir
de l'Ocťan. Le vers de M. Ratisbonne roule, avec un bruit latin, dans la
langue franÁaise, les blocs, les rochers et jusqu'au limon de ce torrent
de l'Apennin toscan qu'on entend bruire dans les vers du Dante.
XXV
D'autres ťcrivains de notre ‚ge, parmi lesquels on doit citer M. de
Saint-Mauris, qui a consacrť dix annťes d'ťtude patiente et forte ŗ
cette reproduction de _la Divine Comťdie_; d'autres aussi, qu'on annonce
et qu'on nomme dťjŗ avec espťrance, ont vulgarisť ou vulgarisent de plus
en plus le Dante parmi nous. Il y a dans ce culte une rťvťlation de
l'esprit de ce siŤcle; c'est le symptŰme d'une renaissance de la poťsie
grave et philosophique chez une nation qui a trop longtemps confondu la
poťsie et la futilitť. Le fleuve poťtique remonte ŗ sa source pour y
retrouver ces eaux qui coulent des hauts lieux. Le Dante, malgrť ses
dťfauts, est certainement pour notre ťpoque un de ces glaciers
inabordables d'oý ces eaux fťcondes coulent sous les nuťes et sous les
tťnŤbres du moyen ‚ge. On n'a pas voulu le traduire seulement, on a
voulu le comprendre, et cet effort a produit le bel ouvrage de M.
_Ozanam_ intitulť: _Dante et la philosophie catholique du treiziŤme
siŤcle._
Hťlas! nous avons aimť comme ami et pleurť ce studieux et pieux jeune
homme. Il ressemblait, par la physionomie, par l'‚me, par la sťrťnitť du
regard, par le timbre mÍme monotone, affectueux et voilť de sa voix, ŗ
un brahme chrťtien venu des Indes en Europe pour y prÍcher l'…vangile
de la science calme de la contemplation mystique et de l'adoration
extatique ŗ notre monde de discorde et de contention.
Ozanam croyait, comme nous, que la vťritť ťtait ŗ plus grande dose dans
le coeur que dans l'esprit. Ses dogmes ruisselaient d'onction, comme les
soleils d'Orient ruissellent le matin et le soir de rosťe. Bien que ma
philosophie ne fŻt plus la sienne, dans tous les articles de ce grand
symbole qui unit les esprits ŗ la base et qui les sťpare quelquefois au
sommet, ces diffťrences ťgalement respectťes, parce qu'elles ťtaient
ťgalement sincŤres, n'ťtablissaient aucune divergence d'‚me et aucune
froideur de sentiment entre nous. Son orthodoxie parfaite pour lui-mÍme
ťtait une charitť d'esprit parfaite aussi pour les autres. Il y avait
autour de lui comme une atmosphŤre de tendresse pour les hommes. Cette
atmosphŤre cordiale adoucissait toutes les aspťritťs entre les idťes. Il
respirait et il aspirait je ne sais quel air balsamique qui avait
traversť le vieil …den. Chacune de ces respirations et de ces
aspirations vous prenait le coeur et vous donnait le sien. On pouvait
diffťrer, on ne pouvait pas disputer avec cet homme sans fiel. Sa
tolťrance n'ťtait pas une concession, c'ťtait un respect. Ozanam ťtait
le saint Jean de la philosophie platonicienne et monastique de la
Renaissance. Il s'endormait sur le sein de son maÓtre, Dante, et il y
faisait de divins songes.
Un de ces songes mÍlťs de nuages et de lumiŤre, de merveilleux et de
vťritť, est son livre intitulť _de Dante et de la Philosophie catholique
au treiziŤme siŤcle_.
L'italien avait ťtť la langue de son berceau, de graves ťtudes l'avaient
initiť depuis ŗ tous les arcanes du moyen ‚ge. Il avait pris ce
crťpuscule pour le grand jour. En cela nous ne partagions pas ses
illusions; c'est la raison qui fait le jour dans les siŤcles, ce n'est
pas la crťdulitť. Mais il faut respecter la lumiŤre jusque dans son
aurore. Le moyen ‚ge ťtait une aurore. Dante, semblable au Lucifer du
tableau du Guide, dťchirait les ombres et secouait le flambeau devant
ses pas.
Un mot, en passant, de ce livre d'Ozanam.
XXVI
On sait que le poŽme du Dante a, selon ses interprŤtes et selon le poŽte
lui-mÍme (dans sa _Vita nuova_), deux sens: un sens littťral et poťtique
pour les profanes, un sens mystique et symbolique pour les initiťs.
C'est ce sens mystique et symbolique des amours et de la poťsie de Dante
qu'_Ozanam_ s'efforce de dťcouvrir, et c'est dans ce sens mystique et
symbolique du poŽme qu'il s'efforce aussi de faire reconnaÓtre et
admirer la philosophie religieuse du moyen ‚ge chrťtien. Selon lui,
Dante serait une espŤce d'_Ovide_ supťrieur; ses poŽmes seraient des
espŤces de mťtamorphoses chrťtiennes, racontant, chantant, expliquant
tous les dogmes surnaturels de la religion nouvelle qui avait remplacť
le paganisme. Il y a dans ceci du vrai et du faux, mais le vrai domine.
…coutons dans quelques belles pages cette voix d'Ozanam si digne de
parler des choses de l'esprit.
ęC'est vers le milieu de cette pťriode, ŗ l'heure du chant du cygne de
la philosophie antique mourante, que la philosophie du moyen ‚ge devait
avoir son poŽte. La poťsie est, en effet, comme un corps glorieux sous
lequel la pensťe demeure incorruptible et ťternelle. Immortalitť et
popularitť, ce sont les deux dons divins dont les poŽtes ont ťtť faits
les dispensateurs. La philosophie grecque avait eu son HomŤre en la
personne de Platon.Ľ (Ne pourrait-on pas dire que la philosophie
spiritualiste avait commencť ŗ Platon?) ęLa philosophie scolastique,
celle du moyen ‚ge, menacťe d'une dťcadence plus rapide, ťprouvait le
besoin d'Ítre consolťe par un grand poŽte. Le poŽte qui allait venir
avait donc sa place marquťe dans le temps.Ľ
ę tre conÁu dans l'exil et y mourir,Ľ ajoute Ozanam, ęremplir de hautes
magistratures et subir les derniŤres infortunes, ce destin a ťtť celui
de beaucoup d'autres; mais d'autres circonstances avaient mťnagť ŗ Dante
une autre vie que la vie publique, une vie de coeur dont il faut, pour
le comprendre, pťnťtrer les mystŤres. En effet, selon les lois qui
rťgissent le monde spirituel, pour qu'une ‚me s'ťlŤve, elle a besoin de
l'attraction d'une autre ‚me. Cette attraction, c'est l'amour. Dante ne
devait pas ťchapper ŗ la loi commune. ņ neuf ans, ŗ un ‚ge dont
l'innocence ne laisse rien soupÁonner d'impur, il rencontra dans une
fÍte de famille Bťatrice, jeune enfant, pleine de noblesse et de gr‚ce.
Cette vue fit naÓtre en lui une affection qui n'a pas de nom sur la
terre et qu'il conserva plus tendre et plus chaste encore durant la
pťrilleuse saison de l'adolescence. C'ťtaient des rÍves oý Bťatrice se
montrait ŗ lui radieuse. Mais surtout quand Bťatrice quitta la terre
dans tout l'ťclat de la jeunesse, il la suivit par la pensťe dans ce
monde invisible dont elle ťtait devenue l'habitante, et il se plut ŗ la
parer de toutes les fleurs de l'immortalitť. Il l'entoura des choeurs
des anges, il la fit asseoir sur les degrťs les plus hauts du trŰne de
Dieu. Ainsi cette beautť se transforma pour lui en un type idťal qui
remplissait son imagination et qui devait la faire se dilater et
s'ťpancher au dehors. Il voulut dire ce qui se passait en lui; il
voulut, selon sa propre expression, noter les chants intťrieurs de
l'amour, et Dante fut poŽte.Ľ
ęMais comme il faut toujours,Ľ poursuit Ozanam, ęque la nature humaine
se trahisse par quelque cŰtť, les belles qualitťs de ce poŽte se
dťshonorŤrent quelquefois par leurs excŤs. Au milieu des luttes civiles,
la haine de l'iniquitť devint une colŤre aveugle qui ne sut jamais
pardonner. Alors il allait par les rues de Florence, jetant des pierres
aux femmes et aux enfants qui calomniaient son parti politique. Alors il
s'ťcriait, dans une discussion philosophique: ęCe n'est point par des
arguments, c'est par le couteau qu'il faut rťpondre ŗ ces stupiditťs!Ľ
Alors aussi, quoique protťgť par le souvenir de Bťatrice, sa sensibilitť
elle-mÍme rťsistait mal aux sťductions d'autres beautťs. Ses poťsies
lyriques, qui ont prťcťdť la composition de son poŽme, ont gardť les
traces de ses affections profanes et passagŤres, qu'il essaya en vain de
voiler ŗ demi sous des allusions symboliques.Ľ
ęLa poťsie ťpique,Ľ dit plus loin le jeune commentateur, ęapparaÓt, ŗ
son origine, revÍtue d'un caractŤre sacerdotal, se mÍlant ŗ la priŤre et
ŗ l'enseignement religieux; c'est pourquoi, dans les temps mÍme de
dťcadence, le merveilleux demeure un des prťceptes de l'art poťtique.
Aussi, dŤs le paganisme, les grandes compositions orientales, comme le
_Mahabarata_; les cycles grecs, comme ceux d'Hercule, de Thťsťe,
d'Orphťe, d'Ulysse, de Psychť; les ťpopťes latines de Virgile, de
Lucain, de Stace, de Silius Italicus; et enfin ces ouvrages qu'on peut
nommer des poŽmes philosophiques, la _Rťpublique_ de Platon et celle de
Cicťron, eurent leurs voyages aux cieux, leurs descentes aux enfers,
leurs nťcromancies, leurs morts ressuscitťs ou apparus pour raconter les
mystŤres de la vie future. Le christianisme dut favoriser encore
davantage l'intervention des choses surnaturelles dans la littťrature
qui se forma sous ses auspices. Les victimes qui remplissent l'Ancien et
le Nouveau Testament inspirŤrent les premiŤres lťgendes; les martyrs
furent visitťs dans leurs prisons par des visions prophťtiques; les
anachorŤtes de la ThťbaÔde et les moines du mont Athos avaient des
rťcits qui trouvŤrent des ťchos dans les monastŤres d'Irlande et dans
les cellules du mont Cassin. Rien n'ťtait plus cťlŤbre, au dix-huitiŤme
siŤcle, que les songes de sainte Perpťtue et de saint Cyprien, le
pŤlerinage de saint Macaire Romain au paradis terrestre, le ravissement
du jeune Albťric, le purgatoire de saint Patrick et les courses
miraculeuses de saint Brendan.--Ainsi de nombreux exemples et toutes les
habitudes littťraires contemporaines nous montrent les rťgions
ťternelles comme la patrie de l'‚me, comme le lien naturel de la pensťe.
Dante le comprit, et, franchissant les limites de l'espace et du temps
pour entrer dans le triple royaume dont la mort ouvre les portes, il
plaÁa de prime abord la scŤne de son poŽme dans l'infini.
ęLŗ il se trouvait au rendez-vous des gťnťrations, jouissant du mÍme
horizon qui sera celui du jugement universel, et qui embrassera toutes
les familles du genre humain. Il assistait ŗ la solution dťfinitive de
l'ťnigme des rťvolutions. Il jugeait les peuples et les chefs des
peuples; il ťtait ŗ la place de celui qui un jour cessera d'Ítre
patient, puisant ŗ son grť au trťsor des rťcompenses et des peines. Il
avait l'occasion de dťrouler, avec la magnificence de l'ťpopťe, ses
thťories politiques, et d'exercer, avec cette verge de la satire que les
prophŤtes n'ont pas dťdaignť de manier, ses impitoyables vengeances. Lŗ,
comme un voyageur attendu ŗ l'arrivťe, il rencontrait Bťatrice, qui
l'avait prťcťdť de quelques jours; il la voyait telle qu'il se l'ťtait
faite dans ses plus beaux rÍves; il la possťdait dans son triomphe. Ce
triomphe cťleste avait peut-Ítre ťtť l'idťe primitive et gťnťratrice de
_la Divine Comťdie_, conÁue comme une ťlťgie oý viendraient se rťflťchir
les mťlancolies et les consolations d'un pieux amour.Ľ
XXVII
M. Ozanam cite ici l'interprťtation philosophique et symbolique de _la
Divine Comťdie_ par le fils du Dante lui-mÍme, si peu de temps aprŤs la
mort de son pŤre, et ŗ un moment oý la tragťdie paternelle devait
retentir encore dans l'oreille du fils. Voici cette interprťtation
filiale; tout donne lieu de croire qu'elle est la vťritť sur cette
ťtrange composition.
ęL'oeuvre entiŤre se divise en trois parties, dont la premiŤre se nomme
Enfer, la seconde Purgatoire, la troisiŤme et derniŤre Paradis. J'en
expliquerai d'avance et d'une faÁon gťnťrale le caractŤre allťgorique en
disant que le dessein principal de l'auteur est dťmontrer, sous des
couleurs figuratives, les trois maniŤres d'Ítre de la race humaine.
ęDans la premiŤre partie il considŤre le vice, qu'il appelle Enfer, pour
faire comprendre que le vice est opposť ŗ la vertu comme son contraire,
de mÍme que le lieu dťterminť pour le ch‚timent se nomme Enfer ŗ cause
de sa profondeur, opposťe ŗ la hauteur du ciel. La deuxiŤme partie a
pour sujet le passage du vice ŗ la vertu, qu'il nomme Purgatoire, pour
montrer la transmutation de l'‚me qui se purge de ses fautes dans le
temps, car le temps est le milieu dans lequel toute transmutation
s'opŤre. La troisiŤme et derniŤre partie est celle oý il envisage les
hommes parfaits; et il l'appelle Paradis, pour exprimer la hauteur de
leurs vertus et la grandeur de leur fťlicitť, deux conditions hors
desquelles on ne saurait reconnaÓtre le souverain bien. C'est ainsi que
l'auteur procŤde dans les trois parties du poŽme, marchant toujours, ŗ
travers les figures dont il s'environne, vers la fin qu'il s'est
proposťe.Ľ
XXVIII
D'aprŤs cet indice fourni par le fils du Dante sur les intentions
philosophiques et poťtiques de son pŤre, M. Ozanam, comme la plupart des
commentateurs italiens, voit dans la fable du Dante une philosophie tout
entiŤre; il appelle cette doctrine la philosophie catholique du moyen
‚ge. On l'appellerait plus justement, selon nous, la philosophie
spiritualiste de tous les ‚ges, incorporťe dans quelques dogmes et dans
quelques formes de l'imagination christianisťe du temps.
Le christianisme alors, en Italie, ŗ Florence surtout, se dťgageait mal
de la philosophie platonique, avec laquelle il sembla un moment prÍt ŗ
se confondre sous les Mťdicis. Le mťlange, souvent grotesque, des
personnages de la Fable et de la Bible, de Virgile et des prophŤtes, des
Muses et de Bťatrice, du Ciel et de l'…lysťe, dans le poŽme, est une
contre-ťpreuve de ce qui se passait ŗ cet ťgard dans l'imagination du
peuple et du poŽte. Dante ťtait, pour ainsi dire, un paÔen ŗ peine
converti, traÓnant encore dans l'…glise les thťories de son vieux culte
et les lambeaux de son premier costume.
Ici M. Ozanam, dans un long et savant volume, suit pas ŗ pas le Dante
dans sa thťologie, dans son astronomie, dans sa science scolastique, et
montre partout la concordance allťgorique de la foi du Dante, de la
science du temps et de l'invention surnaturelle du poŽte. Ceci devient
sous la main d'Ozanam un vaste traitť de scolastique moderne dans lequel
nous ne le suivrons pas. Il nous suffit d'avoir donnť au lecteur, qui
voudra lire les trois poŽmes tout entiers, la clef de ces
interprťtations retrouvťes et prťsentťes par un judicieux et savant
esprit.
Ce commentaire rend, en passant, ŗ chacun ce qui lui appartient dans le
trťsor philosophique et poťtique du Dante. Il rapporte avec justice
l'idťe gťnťrale du poŽme ŗ cet incomparable fragment de la philosophie,
de la raison et de l'ťloquence antique dans Cicťron, intitulť _le Songe
de Scipion_. Ce fragment, que nous avons reproduit nous-mÍme dans la vie
de Cicťron, est, selon nous, la plus belle profession de foi
rationnelle qui ait ťtť ťcrite par une main d'homme au-dessus des
fictions et des crťdulitťs d'imagination de l'antiquitť.
ęParmi les rťminiscences qui ont inspirť _la Divine Comťdie_, celles de
Cicťron me frappent d'abord. Lorsque Dante parcourt les cercles du
paradis, ťcoutant le bruit harmonieux des astres et cherchant des yeux
au fond de l'espace la terre imperceptible; lorsqu'il apprend de son
bisaÔeul, Caccia-Guida, sa mission pťrilleuse et son exil, on reconnaÓt
le rťcit du _Songe de Scipion_. Au moment de commencer sa carriŤre de
gloire, le hťros est ravi en songe en un lieu ťlevť du ciel, oý son
aÔeul l'Africain, lui dťcouvrant les honneurs, les pťrils et les devoirs
qui l'attendent, le prťpare ŗ cette destinťe par le spectacle de
l'ťconomie divine qui soutient l'univers, police les sociťtťs et dispose
souverainement des hommes. Du haut du temple cťleste, au milieu des ‚mes
justes qui vont et viennent par la voie lactťe, Scipion ťcoute les sept
notes de cette musique ťternelle que forment les astres; il contemple
les espaces oý ils roulent, et, quand enfin il aperÁoit la terre si
petite, et sur la terre le point obscur qui est l'empire romain, il a
honte d'une puissance qui trouve si tŰt ses limites, il aspire ŗ une
fťlicitť que rien ne circonscrive. Son aÔeul lui en dťcouvre le secret,
et dans ce cadre admirable Cicťron rassemblait ses plus fortes doctrines
sur Dieu, la nature, l'humanitť. Il en avait fait le dernier livre de
son traitť _de Republica_, cherchant ainsi, dans l'ťternitť, la sanction
des lois destinťes ŗ contenir les peuples dans le temps.
ęC'est la gloire du Dante,Ľ dit Ozanam en finissant, ęd'avoir imprimť sa
marque, la marque de l'unitť, sur un sujet immense dont les ťlťments
mobiles roulaient depuis bientŰt six mille ans dans la pensťe des
hommes.
ęLe gťnie ne peut rien de plus. Il n'a pas mission, quoi qu'on ait dit,
de crťer, d'introduire des idťes dans le monde; il y trouve tout ce
qu'il faut de lumiŤre pour les yeux; mais il les trouve flottantes,
nuageuses, en tourbillon et en dťsordre. La hardiesse est d'arrÍter chez
soi, au passage, ces pensťes fugitives; de percer leur nuage, de saisir
au vif les beautťs qu'elles recŤlent; de les fixer, enfin, en les
enchaÓnant, en y mettant l'ordre, en les forÁant de se produire par les
oeuvres. Je crois voir l'originalitť souveraine dans cette force d'un
grand esprit qui soumet ses idťes, les fait obťir, et en obtient tout
ce qu'elles peuvent, en sorte que le dernier secret du gťnie comme de la
vertu serait encore de se rendre maÓtre de soi. Si l'homme, d'aprŤs les
philosophes, est un abrťgť de l'univers, il ne se montre jamais si
puissant que lorsqu'il maÓtrise cet univers intťrieur, ce tumulte
orageux de sentiments et de pensťes qu'il porte en lui. Dieu s'est
rťservť le pouvoir de crťer; mais il a communiquť aux grands hommes ce
second trait de sa toute-puissance, de mettre l'unitť dans le nombre et
l'harmonie dans la confusion.Ľ
XXIX
Je ne peux quitter ce beau travail d'un esprit aussi philosophique que
tolťrant sans dťplorer la mort prťcoce qui brisa la plume dans la main
de ce jeune disciple du Dante. Ozanam fut enlevť au paradis de son poŽte
favori en laissant sur la terre la _Bťatrice_ de ses inspirations et de
son amour. Un esprit tel que le sien eŻt ťtť bien nťcessaire ŗ ce temps
de contention pťnible oý la philosophie, redevenue religieuse, et oý
l'orthodoxie, redevenue platonicienne, si elles ne peuvent pas se
confondre, cherchent nťanmoins ŗ s'avancer dans une concorde divine sur
la double voie que la raison et le coeur cherchent vers le mÍme but: la
science est le service de Dieu. Homme de paix et non de dispute, si
Ozanam n'avait pas conquis les esprits ŗ ses doctrines, que de coeurs
n'aurait-il pas conquis ŗ la paix! Or la dispute est-elle plus favorable
que la paix aux progrŤs de la vťritť dans les deux ordres d'esprits qui
s'occupent des choses surnaturelles? C'est encore un vers du Dante qui
rťpond:
...... Esser conviene
Amor sementa in voi d'ogni virtute.
(CHANT 17e _du Purgatoire_.)
ęQue l'amour soit en vous la semence de toute vertu.Ľ
La plus belle des oeuvres d'Ozanam, la sociťtť fondťe pour l'assistance
des misŤres du peuple, sous les auspices du saint de la charitť moderne,
Vincent de Paul, ne fut-elle pas une oeuvre d'amour impartial qu'on
s'efforcerait vainement de mťconnaÓtre ou de rťtrťcir aujourd'hui?
Toujours attachť ŗ la grande figure symbolique du Dante, Ozanam
mťditait, dans ses derniers jours, une histoire complŤte de la
littťrature, depuis le cinquiŤme siŤcle jusqu'au treiziŤme. On ne peut
lire sans attendrissement le prologue inachevť de son oeuvre.
ęNous sommes tous des serviteurs inutiles,Ľ ťcrit-il en sentant dťjŗ
dťfaillir sa vie, ęmais nous servons un maÓtre souverainement ťconome et
qui ne laisse rien perdre, pas plus une goutte de nos sueurs qu'une
goutte de ses rosťes. Je ne sais quel sort attend ce livre, ni s'il
s'achŤvera, ni si j'atteindrai la fin de cette page qui fuit sous ma
plume; mais j'en sais assez pour y mettre le reste, quel qu'il soit, de
mon ardeur et de mes jours. Je le commence dans une heure solennelle. Le
vendredi saint du grand jubilť de 1300, Dante, arrivť, comme il le dit,
au milieu du chemin de sa vie, dťsabusť de ses passions et de ses
erreurs, commenÁa son pŤlerinage en enfer, en purgatoire et en paradis.
Au seuil de la carriŤre, le coeur un moment lui manqua; mais trois
femmes bťnies veillaient sur lui dans la cour du ciel. Virgile
conduisait ses pas, et, sur la foi de ce guide, il s'enfonÁa
courageusement dans ce chemin tťnťbreux. Comme lui je veux faire le
pŤlerinage des trois mondes.... Mais, tandis que Virgile abandonne son
disciple avant la fin de sa course, Dante, lui, m'accompagnera
jusqu'aux derniŤres hauteurs du moyen ‚ge, oý il a marquť sa place, et
celle qui est pour moi Bťatrice m'a ťtť laissťe sur cette terre pour me
soutenir d'un sourire et d'un regard, pour m'arracher ŗ nos
dťcouragements, et pour me montrer sous sa plus touchante image la
puissance de l'amour chrťtien dont je vais raconter les oeuvres...Ľ
XXX
BientŰt aprŤs, chassť par la langueur croissante de la maladie de place
en place pour retremper sa vie dans un rayon de soleil, Ozanam ťcrivait
de _Pise_ cette page en marbre, ces lignes du 23 avril 1853, vťritable
psaume d'agonie chantť sur les tombes du _Campo santo_.
ęJ'ai dit au milieu de mes jours: J'irai aux portes de la mort.
ęMa vie est repliťe derriŤre moi comme la tente des pasteurs.
ęLe fil qui s'ourdissait encore est coupť comme sous le ciseau du
tisserand. Entre le matin et le soir vous m'avez conduit ŗ ma fin.
ęMes yeux se sont fatiguťs ŗ force de s'ťlever au ciel.
ęJ'accomplis aujourd'hui ma quarantiŤme annťe, plus que la moitiť du
chemin ordinaire de la vie. Je sais que j'ai une femme jeune et bien
aimťe, une charmante enfant, d'excellents frŤres, une seconde mŤre,
beaucoup d'amis, une carriŤre honorable, des travaux conduits
prťcisťment au point oý ils pouvaient servir de fondement ŗ un ouvrage
longtemps rÍvť. Laquelle faut-il que je vous immole de mes affections
mondaines? Si je vendais mes livres pour en donner le prix aux pauvres;
si je consacrais le reste de ma vie ŗ visiter les indigents; seriez-vous
satisfait, Seigneur, et me laisseriez-vous la douceur de vieillir auprŤs
de ma femme et d'ťlever mon enfant? Peut-Ítre n'accepterez-vous point
cet holocauste? C'est moi que vous voulez! Me voici, Seigneur, je viens!
ęJe viens! Si vous m'appelez, je n'ai pas le droit de me plaindre. Vous
avez donnť quarante ans de vie ŗ une crťature qui est arrivťe sur la
terre maladive, frÍle, destinťe ŗ mourir dix fois sans les tendresses
d'un pŤre et d'une mŤre qui l'avaient seuls sauvťe. Mais peut-Ítre,
Seigneur, exaucerez-vous ma priŤre d'une autre maniŤre? Vous me donnerez
le courage de la rťsignation, vous me ferez trouver dans la maladie une
source de mťrites et de bťnťdictions, et ces bťnťdictions vous les
ferez retomber sur ma femme, sur mon enfant.Ľ
XXXI
Ozanam allait, ŗ la fin de l'automne, s'embarquer pour la France. En
quittant la maison qu'il avait habitťe au bord de la mer, dans ces
tiŤdes maremmes de Toscane oý l'on respire une atmosphŤre d'…lysťe
antique, dit M. Lacordaire, son ami, dans un rťcit vťritablement
virgilien de sa mort, il Űta son chapeau pour saluer le soleil et le
firmament. Sa femme, son enfant, ses frŤres ťtaient lŗ. Il ťleva ses
mains au ciel et dit ŗ haute voix: ęJe vous remercie, mon Dieu, des
souffrances et des afflictions que vous m'avez envoyťes dans cette
demeure que je quitte. Acceptez-les en rťmission de mes faiblesses.Ľ
Puis, se tournant vers sa femme: ęJe veux, ajouta-t-il, qu'avec moi tu
bťnisses Dieu de mes douleurs.Ľ Et en l'embrassant: ęJe le bťnis aussi
des consolations qu'il m'a donnťes!Ľ en rťvťlant ŗ cette Bťatrice, par
un regard et par un triste sourire, que ces bonheurs et ces consolations
avaient ťtť pour lui personnifiťs en elle. Il expira en touchant le
rivage de la France.
Voilŗ le traducteur qu'il fallait au poŽte mystique de la philosophie
des trois mondes. M. de Lamennais, ťcrivain plus consommť dans le
maniement de la langue, avait dans l'esprit l'ťnergique ‚pretť du Dante,
Ozanam en avait l'onction: le rocher est imposant, mais il n'est beau
que quand il ruisselle pour dťsaltťrer un peuple; sous la main d'Ozanam
il aurait ruisselť des larmes ťpiques des abondances du coeur.
Quant aux commentaires sur le sens obscur de l'histoire de la
philosophie du poŽme, Ozanam n'aurait pas mieux rťussi que M. de
Lamennais ŗ rťpandre une complŤte lumiŤre sur ce chaos. Tous ces
commentaires ne sont au fond que de la nuit dťlayťe avec des tťnŤbres.
C'est la poťsie qu'il faut chercher dans ce livre; ce ne sont pas des
opinions posthumes ou des allusions mortes.
Nous allons, le livre ŗ la main, vous conduire, autre VIRGILE, dans ces
trois mondes, pour y glaner Áŗ et lŗ des vers sublimes, et pour y
recueillir, dans l'ariditť des siŤcles en poudre, quelques-unes de ces
gouttes de rosťe qu'on trouve ŗ la fin d'une longue nuit sur l'herbe des
tombes.
LAMARTINE.
XVIIIe ENTRETIEN.
6e de la deuxiŤme Annťe.
LITT…RATURE L…G»RE.
ALFRED DE MUSSET.
I
Vive la jeunesse!... mais ŗ condition de ne pas durer toute la vie!...
Cette exclamation nous est inspirťe par la mťmoire d'un homme qui vient
de chanter et de mourir comme un rossignol au printemps, ivre de
mťlodie, de rayons et de gouttes de rosťe. Le rossignol, c'est Alfred de
Musset. Alfred de Musset est la personnification de la jeunesse.
La jeunesse est la vie en sťve; c'est aussi le gťnie en fleur. Si nous
ťtions encore poŽte, nous dirions:
ęIl y a dans la famille des vťgťtaux, des plantes, des arbres, des
arbustes ŗ doubles fleurs dont la sťve ne se noue jamais en fruits,
prťcisťment parce que la fleur double ťpuise l'arbuste; plantes dont la
seule destination est de peindre la terre d'un arc-en-ciel de riantes
couleurs ťtendues sur les pelouses, les parterres, les forÍts, et
d'embaumer le printemps en livrant au vent d'ťtť leurs corolles
stťriles. La plupart de ces dťbris tombent ŗ terre sans que personne les
ramasse.
ęNeige odorante du printemps! comme dit Hugo.
ęLes plus parfumťes et les plus salubres sont ramassťes soigneusement au
pied de l'arbuste qui les a portťes par les jeunes filles des bords du
Bosphore ou de Fontenay-aux-Roses; elles en remplissent leurs tabliers
et leurs corbeilles. Elles les distillent, elles en fixent l'odeur
volatile, elles en remplissent, sous forme d'une goutte de liqueur ou
d'huile suave, des flacons que respirent avec dťlices les odalisques,
les voluptueux et les amants.
ęEh bien! de mÍme il y a dans la famille humaine des _hommes
printaniers_, si l'on peut se servir de cette expression, ‚mes ŗ doubles
fleurs et sans fruits, qui accomplissent toute leur destinťe en
fleurissant, en coloriant, en embaumant leur vie et celle de leurs
contemporains, mais dont on fixe cependant l'ťclat et le parfum dans la
mťmoire en volumes de vers ou de prose immortels, oeuvres qu'on ne
compulse pas, mais qu'on respire, qui ne nourrissent pas, mais qui
enivrent! Ce sont les oeuvres et les hommes de la littťrature lťgŤre.Ľ
De ces hommes et de ces livres il y en a eu dans tous les siŤcles et
dans tous les pays, depuis _Salomon_ en Judťe, _Anacrťon_ en GrŤce,
_Horace_ ŗ Rome, _Hafiz_ en Perse, _Saint-…vremond_, _Chaulieu_,
_Voltaire_ en France, _Byron_ et _Moore_ en Angleterre, _Heine_, plus
amer que suave en Allemagne, jusqu'ŗ Alfred de Musset, fleur sans ťpine,
abeille sans dard, dont nous remuons avec dťlicatesse la cendre toute
tiŤde encore aujourd'hui! Ces hommes sont l'ťternelle jeunesse de la
littťrature.
II
Nous avons dit tout ŗ l'heure: ęVIVE LA JEUNESSE, ņ CONDITION QU'ELLE NE
DURE PAS TOUTE LA VIE!Ľ Expliquons cette exclamation involontaire, mais
qui a cependant un sens profond quand la rťflexion l'analyse.
La jeunesse de tout est la gr‚ce de l'Ítre. Tout le monde l'aime, tout
le monde lui pardonne, tout le monde lui sourit. Mais pourquoi
l'aime-t-on? pourquoi lui sourit-on? C'est que la jeunesse est une
gr‚ce, c'est qu'elle est une espťrance, disons plus, c'est qu'elle est
une promesse. Si la jeunesse reste ťternellement gr‚ce, elle ne sera
jamais force; si elle reste ťternellement espťrance, elle ne sera jamais
rťalitť; si elle reste ťternellement promesse, elle ne sera jamais
fructification. Il faut que la nature mÍme la plus fťconde tienne enfin
un jour ce qu'elle a promis.
Sans doute il est beau d'Ítre jeune, de n'avoir que des songes gais du
matin dans le coeur, des ťblouissements de rťveil dans les yeux, des
ťclats de rire ou des tendresses de sourire sur les lŤvres; il est beau,
comme le charmant gťnie du matin, dans le tableau de l'_Aurore_, de
s'ťlancer sans toucher terre devant le char du jour, la torche de
l'amour dans une main, des roses dans l'autre, dont on sŤme, pour ne pas
voir les tombeaux, le sentier de la vie.
Mais s'il est beau de fleurir, il est plus beau de mŻrir, il est plus
beau de transformer sa m‚le adolescence en forte virilitť; il est plus
beau de dťcouvrir des horizons plus sťvŤres, plus tristes, mais plus
vrais, sans p‚lir et sans se dťtourner en arriŤre ŗ mesure qu'on avance
dans la route; il est plus beau de voir, sans reculer et sans pleurer,
les roses de l'aurore p‚lir et sťcher aux feux, et ŗ la sueur du milieu
du jour; il est plus beau d'avancer toujours courageusement en teignant
du sang de ses pieds les rudes aspťritťs du chemin. S'il est beau d'Ítre
enfant, il est beau d'Ítre homme, fils, ťpoux, pŤre penchť gravement sur
les devoirs pťnibles de l'existence, artiste sťrieux, citoyen utile,
philosophe pensif, soldat de la patrie, martyr au besoin d'une raison
dťveloppťe par la rťflexion et par le temps. Quand les anciens, nos
maÓtres en tout, parce qu'ils ont marchť les premiers, voulurent
exprimer dans une seule figure la suprÍme beautť physique de l'homme,
ils ne sculptŤrent pas un enfant, ils sculptŤrent Apollon, le dieu de la
beautť ŗ trente ans; ils sculptŤrent Hercule, le dieu de la force ŗ
quarante. Et quand ils voulurent exprimer dans une seule figure la
suprÍme beautť intellectuelle et morale, ils sculptŤrent la figure d'un
vieillard, le vieil HomŤre, visage presque sťpulcral sur lequel la
cťcitť mÍme, infirmitť des sens, ajoute ŗ la beautť intellectuelle,
morale et recueillie en dedans du vieillard; car s'il est beau d'Ítre
jeune, s'il est beau d'Ítre mŻr, il est peut-Ítre plus beau encore de
vieillir avec les fruits amers, mais sains de la vie dans l'esprit, dans
le coeur et dans la main.
Que de beautť, en effet, dans le vieillard digne de porter le poids et
l'honneur des longues annťes qu'il a plu ŗ la Providence d'accumuler sur
ses ťpaules courbťes?
Les sens usťs au service d'une intelligence immortelle, qui tombent
comme l'ťcorce vermoulue de l'arbre, pour laisser cette intelligence,
dťgagťe de la matiŤre, prendre plus librement les larges proportions de
son immatťrialitť; les cheveux blancs, ce symbole d'hiver aprŤs tant
d'ťtťs traversťs sans regret sous les cheveux bruns; les rides, sillons
des annťes, pleines de mystŤres, de souvenirs, d'expťrience, sentiers
creusťs sur le front par les innombrables impressions qui ont labourť le
visage humain; le front ťlargi qui contient en science tout ce que les
fronts plus jeunes contiennent en illusions; les tempes creusťes par la
tension forte de l'organe de la pensťe sous les doigts du temps; les
yeux caves, les paupiŤres lourdes qui se referment sur un monde de
souvenirs; les lŤvres plissťes par la longue habitude de dťdaigner ce
qui passionne le monde, ou de plaindre avec indulgence ce qui le trompe;
le rire ŗ jamais envolť avec les lťgŤretťs et les malignitťs de la vie
qui l'excitent sur les bouches neuves; les sourires de mťlancolie, de
bontť ou de tendre pitiť qui le remplacent; le fond de tristesse
sereine, mais inconsolťe, que les hommes qui ont perdu beaucoup de
compagnons sur la longue route rapportent de tant de sťpultures et de
tant de deuils; la rťsignation, cette priŤre dťsintťressťe qui ne porte
au ciel ni espťrance, ni dťsirs, ni voeux, mais qui glorifie dans la
douleur une volontť supťrieure ŗ notre volontť subalterne, sang de la
victime qui monte en fumťe et qui plaÓt au ciel; la mort prochaine qui
jette dťjŗ la gravitť et la saintetť de son ombre sur l'espťrance
immortelle, cette seconde espťrance qui se lŤve dťjŗ derriŤre les
sommets tťnťbreux de la vie sur tant de jours ťteints, comme une pleine
lune sur la montagne au commencement d'une claire nuit; enfin, la
seconde vie dont cette premiŤre existence accomplie est le gage et qu'on
croit voir dťjŗ transpercer ŗ travers la p‚leur morbide d'un visage qui
n'est plus ťclairť que par en haut: voilŗ la beautť de vieillir, voilŗ
les beautťs des trois ‚ges de l'homme! On voit que ces beautťs sont
diverses, mais non infťrieures les unes aux autres; on voit que le
Crťateur, qui n'a rien fait que de beau, quand on considŤre ses ouvrages
de ce point de vue supťrieur et gťnťral oý la raison se place pour tout
adorer et tout comprendre, a distribuť par doses au moins ťgales leur
beautť propre ŗ toutes les annťes de l'existence humaine. Soyez donc
heureux de votre jeunesse, mais n'en soyez pas si tiers, et ne vous
obstinez pas ŗ rester verts quand vous aurez dŻ devenir mŻrs, ni ŗ
rester ťtourdis quand vous devez Ítre sťrieux. Le faux rire est la plus
lugubre des tristesses.
III
Que rťsulte-t-il littťrairement de ce coup d'oeil sur la jeunesse, sur
la maturitť, sur la vieillesse de l'homme? Il en rťsulte qu'il y a et
qu'il doit y avoir eu toujours des ťcrivains correspondants ŗ ces trois
phases de la vie humaine. La littťrature lťgŤre dont nous nous occupons
en ce moment, ŗ propos d'Alfred de Musset, appartient particuliŤrement ŗ
la jeunesse: rire, sourire, badiner, aimer, dťlirer, chanter, fol‚trer
avec les primeurs de la vie qui ne vivent qu'un jour, sont choses jeunes
de leur nature. Il y a une strophe d'un poŽte persan adressťe aux
sources de _Chiraz_ qui m'a frappť dŤs mon enfance, en la lisant dans
une traduction anglaise. Je ne me rappelle pas littťralement les
paroles, mais voici le sens:
ęCharmant ruisseau dont le gazouillement m'assoupit pendant la chaleur
du jour et oý je fais rafraÓchir le vin de Chiraz, tu ne murmureras plus
ainsi, quand l'hiver sera venu et qu'il aura congelť et solidifiť tes
ondes babillardes.--Oui, me rťpondait la petite onde fugitive, mais
Allah m'ťtendra et me polira dans mon bassin en miroir de cristal, et
j'y reflťterai son soleil et les ťtoiles du ciel!Ľ
Image aussi naÔve et aussi philosophique, selon moi, qu'aucune image
d'Horace pour assigner leur rŰle diffťrent au printemps et ŗ l'hiver des
poŽtes!
IV
Mais indťpendamment de cette littťrature badine de la jeunesse et de
cette littťrature sťrieuse de l'‚ge mŻr ou de l'‚ge avancť, il y a une
sorte de littťrature mixte participant des deux autres et inventťe par
les Italiens, ces inventeurs de tout ce qui amuse ou charme en Europe.
Ils appellent ce genre de littťrature, le genre _semi-sťrieux_, genre
ťminemment propre aussi au gťnie franÁais qui aime ŗ faire badiner mÍme
la raison, et qui ne flotte ni trop haut ni trop bas entre le ciel et la
terre. Voici ce que nous ťcrivions l'annťe derniŤre sur ce genre si fin
et si indťfinissable de littťrature, ŗ propos de l'aimable vieillard
Xavier de Maistre, l'auteur du _Voyage autour de ma chambre_.
ęLe caractŤre de Xavier de Maistre se lit dans son style, dŤs la
premiŤre page de son livre. C'ťtait un caractŤre _semi-sťrieux_; c'est
ainsi que les Italiens dťsignent cette espŤce d'oeuvre et cette espŤce
d'homme dont le _divin Arioste_ est dans leur langue le type le plus
original et le plus achevť, comme _Sterne_ l'est pour l'Angleterre.
ęL'ťcrivain semi-sťrieux est un homme chez lequel la sensibilitť douce
et l'enjouement tendre sont, par le don d'une nature modťrťe, dans un si
parfait ťquilibre, qu'en ťtant sensible, l'ťcrivain ne cesse jamais
d'Ítre enjouť, et qu'en ťtant enjouť il ne cesse jamais d'Ítre sensible;
en sorte qu'en le lisant ou en l'ťcoutant on passe ŗ son grť, du sourire
aux larmes, et des larmes au sourire sans jamais arriver ni jusqu'au
sanglot qui dťchire le coeur, ni jusqu'ŗ l'ťclat de rire, cette
grossiŤretť de la joie. PhťnomŤne rare et admirable d'une nature
parfaitement pondťrťe qui semble toujours prÍte ŗ glisser ou dans la
mťlancolie ou dans le cynisme, mais qui n'y glisse en rťalitť jamais, et
qui, par la merveilleuse ťlasticitť de son ressort, se relŤve toujours
de la douleur ou de la plaisanterie dans la sťrieuse sťrťnitť d'une
philosophie supťrieure ŗ ses propres impressions.Ľ
V
La raison d'Ítre de cette littťrature est dans la nature mÍme du coeur
humain. Il y a, en effet, une littťrature qui n'a pour objet que le
beau, l'utile, le grand, le vrai, le saint. C'est la littťrature de la
raison, du sentiment, de l'ťmotion par l'art, de la vťritť, de la vertu,
la littťrature de l'‚me. Il y a une autre littťrature qui a surtout pour
objet l'agrťment, le dťlassement, le plaisir, la littťrature de l'esprit
et, faut-il tout dire? la littťrature des sens.
Ces deux littťratures sont trŤs-diffťrentes l'une de l'autre, et
cependant elles sont ťgalement fondťes sur la nature de notre Ítre.
Le plaisir est, en effet, aussi une des fonctions de l'homme; par une
divine indulgence de la Providence, la vie de tous les Ítres a ťtť
partagťe en travail et en repos, en veille et en sommeil, en effort et
en dťtente du corps et de l'esprit. C'est cette dťtente agrťable du
corps et de l'esprit qu'on appelle le plaisir. Dieu a traitť ainsi
paternellement l'homme en enfant ŗ qui on accorde un dťlassement aprŤs
le travail. Sans cette alternative de la peine et du plaisir dans notre
existence, l'homme succomberait comme le trappiste ŗ l'obsession et ŗ la
fixitť d'une seule pensťe, toujours en haut, jamais en bas; la dťmence
ou la mort puniraient bientŰt le contre-sens aux lois intermittentes de
notre nature.
La vie est lourde, il faut la soulever quelquefois avec des ailes,
fŻt-ce avec des ailes de papillon; le temps si court dans sa durťe est
souvent bien long dans son passage, bien lent dans le cours inťgal des
heures; il faut l'aider ŗ passer plus vite et plus agrťablement d'un
lever du jour ŗ un coucher de soleil. L'esprit se lasse aisťment, il
faut le dťtendre, le distraire, l'amuser pour lui rendre, aprŤs ces
courbatures de la vie, l'ťlasticitť, la souplesse et mÍme la _gaietť_ de
son ressort. C'est le plaisir en tout genre (et puisque nous ne parlons
ici que de littťrature), c'est le plaisir littťraire qui est chargť de
rendre ŗ l'esprit cette ťlasticitť, cette _gaietť_ de notre ressort
moral, nťcessaire ŗ l'homme de toute condition pour faire, comme disait
Mirabeau, son _mťtier gaiement_.
L'oisivetť rÍveuse, l'amitiť ťpanchťe, l'amour heureux, la causerie
familiŤre avec des esprits inattendus et ťtincelants de verve, la
plaisanterie douce, l'ironie lťgŤre, le badinage dťcent, la chanson
rieuse, le vin mÍme versť ŗ petites coupes dans les festins sont les
muses sans ceintures (_discinctś_, comme disent les Latins), quelquefois
mÍme un peu dťbraillťes de cette littťrature du plaisir ou du
passe-temps. Le vin aussi est chanteur de sa nature. Il y a une poťsie
comprimťe sous le liťge qui bouche la bouteille au long col du vin de
Champagne, comme sous la feuille de figuier qui ferme la jarre au large
ventre des vins de Chypre ou de Samos. C'est de cette poťsie dont
_Horace_, le poŽte sobre de la treille, disait:
_Nardi parvus onyx eliciet cadum._
VI
Rien n'est donc de plus lťgitime quand on est jeune, spirituel, oisif,
amoureux, libre de soucis et de deuils, dťlicatement voluptueux,
lťgŤrement grisť de la sťve du coeur ou de la sťve du raisin; rien n'est
si naturel du moins que de chanter nonchalamment couchť ŗ l'ombre du pin
qui chante sur votre tÍte, au bord du ruisseau qui court et qui chante ŗ
vos pieds, au coucher du soleil, au lever de la lune, heure oý chante le
rossignol, sur l'herbe oý chante la cigale, tenant ŗ la main la coupe oý
chante d'avance dans la mousse qui pťtille la demi-ivresse du buveur
insoucieux; cette poťsie du passe-temps et du plaisir, quelque futile
qu'elle soit, a eu des ťchos tellement conformes ŗ notre nature et
tellement sympathiques aux lťgŤretťs de notre pauvre coeur humain, que
ces ťchos se sont prolongťs depuis Anacrťon jusqu'ŗ Bťranger, et
depuis Hafiz jusqu'ŗ Alfred de Musset, cet Hafiz de nos jours.
La France a ťtť la terre de prťdilection de cette littťrature du plaisir
et du passe-temps. La France, ou, selon l'expression du _Tasse_, qui
venait de visiter la Touraine:
... _La terra dolce e ieve
Simile a se gli habitator produce!_
ęLa France oý un sol lťger et superficiel produit des habitants du mÍme
caractŤre que son sol!Ľ
VII
Nous ne parlons pas ici de RABELAIS, le gťnie ordurier du cynisme, le
scandale de l'oreille, de l'esprit, du coeur et du goŻt, le champignon
vťnťneux et fťtide, nť du fumier du cloÓtre du moyen ‚ge, le pourceau
grognant de la Gaule, non le pourceau du troupeau d'…picure comme dit
Horace:
... _Epicuri de grege porcum!_
mais le pourceau des moines dťfroquťs, se dťlectant dans sa bauge
immonde et faisant rejaillir avec dťlices les ťclaboussures de sa lie
sur le visage, sur les moeurs et sur la langue de son siŤcle. Rabelais,
selon nous, ne reprťsente pas le plaisir, mais l'ordure; il enivre, mais
en infectant. La jeune ťcole littťraire du rťalisme qui s'ťvertue
aujourd'hui ŗ le rťhabiliter, ne parviendra qu'ŗ se salir l'imagination
sans parvenir ŗ le laver. Toute l'eau de rose du Bosphore ou de
Fontenay-aux-Roses ne suffirait pas ŗ parfumer ce lťviathan de la
crapule. Rabelais a quelquefois une folle ivresse qui fait qu'on se
rťcrie d'admiration sur la sordide fťconditť de la langue, j'en
conviens, mais c'est un ivrogne de verve.--Aux ťgouts le festin!
Deux ťcrivains du XVIIe siŤcle ont laissť ŗ la France, en l'amusant, la
dťlicatesse de ses plaisirs et de son goŻt. Ces deux ťcrivains sont:
Hamilton, l'auteur des _Mťmoires du comte de Grammont_, et
Saint-…vremond, le premier importateur du vťritable sel attique en
France.
Saint-…vremond est le patriarche de cette tribu des voluptueux et des
rieurs en prose et en vers. Il enfanta dans sa vieillesse Mme de
Sťvignť, puis Chaulieu, Lafare, l'abbť Courtin, l'ťcole des gracieux
dťbauchťs du _temple_, puis le Voltaire des poťsies lťgŤres, des
facťties, de la correspondance, puis Beaumarchais, puis Alfred de
Musset, le dernier des petits-fils de Saint-…vremond, non pas plus
voluptueux, mais mille fois plus poŽte que cet aÔeul de ses vers.
Il y a un air de famille incontestable entre Hamilton, Saint-…vremond et
Alfred de Musset; coeurs de mÍme gr‚ce, esprits de mÍme sťve,
philosophes de mÍme insouciance, si on peut appliquer ŗ l'insouciance le
nom de philosophie. C'est du moins la philosophie de l'agrťment.
VIII
Nous venons de relire, pour les comparer aux oeuvres d'Alfred de Musset,
les _Mťmoires du comte de Grammont_. Nous ne connaissons dans aucune
langue une si charmante dťbauche d'esprit, de dťraison et de style.
Pourquoi? C'est que le comte de Grammont ne songeait pas le moins du
monde, en ťcrivant ou en dictant son livre, ŗ faire de l'esprit, de la
folie ou du style; il ne songeait qu'ŗ se raconter lui-mÍme, et, comme
la nature avait fait de lui, en le crťant, le plus fin et le plus
spirituel badinage vivant qui soit jamais sorti des sources de
l'hťroÔque et facťtieuse Garonne, en se racontant lui-mÍme, il faisait
un chef-d'oeuvre de bonne plaisanterie. Son livre n'est pas un livre,
c'est un homme, et cet homme n'est pas un homme, c'est un esprit follet.
On ne sait pas bien au juste dans quelle proportion exacte le comte de
Grammont, son beau-frŤre l'anglais Hamilton, et Saint-…vremond, l'ami
des deux et vivant ŗ Londres avec eux, concourent ŗ cet inimitable
livre. Il y a vingt romans de moeurs, trente comťdies et cinquante
mariages de Figaro dans cet opuscule. ņ coup sŻr, Voltaire le savait par
coeur et Beaumarchais l'avait beaucoup lu. Le comte de Grammont fut
l'original de ces esprits fins, lťgers, futiles, inconsistants, mais
cependant justes, sensťs, exquis, dont notre littťrature de passe-temps
a eu depuis cette ťpoque tant de copies. Mais ces esprits-lŗ ne se
copient pas, ils jaillissent du caractŤre et de la verve de
l'ťcrivain; il faut que le livre naisse avec l'homme.
IX
Saint-…vremond, l'ami du comte de Grammont et d'Hamilton, ťtait un de
ces hommes qui ne se font pas avec de la volontť, du travail et du
talent, mais qui naissent tout faits des mains capricieuses de la
nature. Son histoire ressemble elle-mÍme ŗ un caprice du hasard.
…levť dans les lettres pour le parlement, emportť par l'ardeur du sang
et de la jeunesse vers la guerre, il entra dans les camps et dans les
cours ŗ une de ces ťpoques toujours fertiles en talents neufs, oý les
esprits secouťs par de longues guerres civiles se dťtendent et se
reposent dans le loisir de la paix. La sociťtť comme la terre, n'est
jamais plus fťconde que quand elle a ťtť bien remuťe par le soc des
rťvolutions: elle produit alors des plantes inattendues. L'ťpoque de la
_Fronde_, oý les partis, dťjŗ ŗ demi-dťsarmťs se combattaient avec la
plume autant qu'avec l'ťpťe, fournit ŗ l'esprit aiguisť plus que malin
de Saint-…vremond l'occasion de railler spirituellement et gracieusement
ses adversaires. Son bon sens l'avait rangť de bonne heure dans le parti
du jeune roi Louis XIV, de la reine-mŤre et de l'habile ministre
Mazarin. Il ne voyait, avec raison, dans les partis opposťs que des
queues de factions, d'intrigues et d'ambitions sans tÍte, propres ŗ
perpťtuer les dťsastres de la France, mais nullement ŗ y constituer la
libertť pratique et morale. Mazarin, aussi spirituel que lui, se
dťlectait jusque sur son lit de mort ŗ entendre la lecture de ses
facťtieuses ripostes au parti des princes et du parlement. Le jeune roi
l'aimait comme il aima plus tard MoliŤre et Boileau. Mais un badinage
ťpistolaire un peu trop hardi contre le cardinal, ŗ propos de la paix
des Pyrťnťes, fut envenimť aux yeux du roi par Colbert, infiniment moins
spirituel et par consťquent infiniment moins tolťrant que le cardinal
italien; ce badinage fut travesti en crime d'…tat. Menacť de la Bastille
aprŤs l'emprisonnement de Fouquet, son ami, Saint-…vremond se rťfugia
d'abord en Hollande; il y connut Spinosa dont la frťquentation ajouta
une teinte de philosophie sceptique, mais non athťe, ŗ la voluptueuse
licence de sa vie.
De lŗ il passa en Angleterre. C'ťtait le rŤgne de l'esprit, de la
dťbauche, de la beautť, sous le spirituel et voluptueux Charles II.
Charles II ťtait une sorte de Louis XV anglais, avec plus de gaietť,
plus de libertť et plus d'ťlťgance dans ses scandales de cour.
Saint-…vremond se lia d'une amitiť passionnťe, quoique mŻre, avec la
belle duchesse de Mazarin, niŤce du cardinal, errante comme lui de cour
en cour, et fixťe enfin en Angleterre. Il se fit de cette Clťop‚tre
italienne, digne d'Ítre adorťe dans tous les pays, une divinitť
terrestre. Il attira autour d'elle, dans un centre de sociťtť
cosmopolite, le comte de Grammont, l'abbť de Saint-Rťal, historien
superficiel, mais entraÓnant, prťcurseur de Voltaire dans l'art de
donner de la couleur et du mouvement au rťcit, Hamilton, le
Saint-…vremond anglais, Waller enfin, l'Anacrťon de la Grande-Bretagne.
L'amitiť solide, l'amour respectueux, la libertť d'esprit, la gr‚ce de
l'entretien, l'oisivetť d'habitude, le travail par amusement, la
plaisanterie sans malice, la poťsie sans prťtention, la recherche du
plaisir dťcent comme but d'une vie oý rien n'est certain que la mort, le
doute nonchalant sur les vťritťs morales, la philosophie des sens en un
mot assaisonnťe seulement des dťlicatesses du bon goŻt, prolongŤrent
jusqu'ŗ quatre-vingt-dix ans les annťes toujours saines et l'esprit
toujours productif du philosophe franÁais.
La mort de la duchesse de Mazarin, son amie, attrista sans le briser le
coeur de Saint-…vremond. Elle emportait en mourant tout son bonheur et
toute sa fortune qu'il lui avait gťnťreusement prÍtťe. Il refusa de
rentrer en France, voulant mourir oý il avait aimť.
La mťdiocritť de ses ressources n'altťra ni son dťsintťressement ni sa
paix: ęJe me contente de mon indolence, ťcrit-il ŗ ses amis. J'avais
encore cinq ou six ans ŗ aimer le thť‚tre, la musique, la table; il faut
vivre de privations et d'ťconomies; je saurai me passer de ce que je ne
puis avoir sans m'enchaÓner, je suis un philosophe ťgalement ťloignť de
la superstition et de l'impiťtť, un voluptueux qui n'a pas moins
d'aversion pour la dťbauche que de goŻt pour le plaisir. J'ai mis mon
bonheur dans moi-mÍme pour qu'il ne dťpendÓt que de ma raison: jeune,
j'ai ťvitť la dissipation, persuadť qu'un peu de bien ťtait nťcessaire
aux commoditťs d'une vie avancťe; vieux, j'ai cessť d'Ítre ťconome,
pensant que la nťcessitť est peu ŗ craindre quand on a peu de temps ŗ en
souffrir. Je me loue de la nature et ne me plains point de la fortune.
J'aime le commerce des belles personnes autant que jamais, mais je les
trouve aimables sans le dessein de m'en faire aimer. Je ne compte que
sur mes propres sentiments, et ce que je cherche avec elles, c'est moins
la tendresse de leur coeur que celle du mien.Ľ
X
Quinze jours avant sa fin, il ťcrivit encore des vers pleins des
souvenirs de son amoureuse jeunesse. Il la faisait revivre cette
jeunesse entre la mort et lui pour se retenir encore ŗ la vie par les
perspectives en arriŤre du bonheur passť.
Saint-…vremond avait naturalisť la lťgŤretť et la gr‚ce franÁaises en
Angleterre. Il lui avait appris ŗ badiner et ŗ sourire; la littťrature
anglaise lui doit quelque chose de cette qualitť de style qu'on appelle
en anglais _humour_; cette qualitť du style ou de la conversation, qui
n'a pas de nom en franÁais, pourrait s'appeler l'ťtonnement. C'est
quelque chose de neuf dans l'idťe, de contrastant dans l'esprit,
d'heureux dans l'expression, d'inespťrť dans le mot, qui tient au
caractŤre plus encore qu'au gťnie de l'ťcrivain. Ce don de l'esprit
appartient plus gťnťralement aux amateurs de littťrature qu'aux auteurs
de profession, parce qu'il est insťparable d'une certaine lťgŤretť; les
hommes du monde possŤdent plus souvent cette lťgŤretť que les hommes
d'ťtudes, parce que la conversation rend la phrase lťgŤre et que la
plume rend quelquefois la main lourde.
L'Angleterre reconnaissante du plaisir qu'elle avait eu de la
conversation de Saint-…vremond, rťclama sa cendre et l'ensevelit avec
honneur parmi ses rois, ses orateurs, ses hommes illustres, dans
l'abbaye de Westminster. Quoiqu'il eŻt vťcu presque autant qu'un siŤcle,
il n'y avait eu rien de sťrieux dans sa longue vie, que son honneur et
son amour pour la belle Hortense Mancini, duchesse de Mazarin.
XI
Saint-…vremond n'avait jamais ni imprimť, ni recueilli, ni vendu ses
lťgers ouvrages; il ne travaillait pas, il s'amusait; il s'en rapportait
au vent pour dissťminer Áŗ et lŗ ou pour laisser tomber ŗ terre ses
feuilles ťparses, simples badinages, la destinťe de son talent n'ťtant,
selon lui, que de faire sourire ses amis.
Mais aussitŰt qu'il fut mort, l'Angleterre et la France recueillirent
avec un engouement passionnť ses moindres reliques en vers et en prose.
ęDonnez-nous du Saint-…vremond, disaient les ťditeurs aux auteurs, nous
vous payerons ces gr‚ces sans poids au poids de l'or.Ľ
Cinq volumes multipliťs par d'innombrables ťditions suffirent ŗ peine ŗ
l'empressement de son siŤcle. Ils sont rares et nťgligťs aujourd'hui
dans les bibliothŤques; c'est un malheur pour l'esprit franÁais. Les
gr‚ces indťfinissables de ce style sont ensevelies dans ces pages, mais
elles n'y sont pas ťvaporťes. Mes mains tombŤrent par hasard sur ces
cinq volumes poudreux de Saint-…vremond, dans une vieille bibliothŤque
de famille, chez un de mes oncles, curieux de reliques d'esprit. Je les
feuilletai avec complaisance et avec assiduitť dans ma premiŤre
jeunesse. J'en ai conservť la saveur que laissent aux doigts des roses
sťchťes retrouvťes sur la pierre d'un vieux sťpulcre: vers, prose,
correspondance, ťpanchement du coeur, enjouement d'esprit, fines
railleries, plaisanteries d'autant plus rieuses qu'elles sont plus
inoffensives, voilŗ le patrimoine hťrťditaire de cet ancÍtre de Voltaire
et d'Alfred de Musset.
Il y a surtout dans ces volumes une conversation rťelle ou imaginaire
sur les plus graves sujets de la philosophie traduits en comique et
assaisonnťs du rire inextinguible d'HomŤre. Elle est intitulťe
_Conversation du pŤre Canaye avec le marťchal d'Hocquincourt_. C'est
certainement le chef-d'oeuvre sans rival de l'enjouement et de la fine
ironie. MoliŤre n'a pas plus de verve dans ses bouffonneries grotesques,
Voltaire n'a pas plus d'ťclat de fou-rire dans ses facťties.
Saint-…vremond a ťtť ťvidemment leur modŤle. C'est un Rabelais de cour
et de bon goŻt qui n'a du franÁais que la sťve, mais qui a du grec
l'atticisme. Il y soulŤve les idťes mťtaphysiques avec la gr‚ce d'un
enfant d'AthŤnes jouant sous les portiques aux osselets, pendant que
Platon y pťrore ou qu'Alcibiade y promŤne ses gr‚ces pour sťduire les
Athťniens.
En recherchant bien dans la littťrature franÁaise le type original et
l'ancÍtre direct d'Alfred de Musset, nous ne trouvons pour cette
gťnťalogie lointaine que Saint-…vremond qui soit digne de cette parentť.
Nous allons, en feuilletant avec vous ses oeuvres et en faisant glisser
sous le pouce bien des pages, lui trouver des ancÍtres moins purs et
plus rapprochťs de nous.
Mais d'abord un mot de l'homme lui-mÍme. Dans ces ťcrivains sans marque
dont l'inspiration est le caprice et dont la nonchalance est la seule
muse, l'homme et le livre se confondent tellement, que si vous n'aviez
pas le caractŤre, vous n'auriez pas le livre. Car la gr‚ce est un don
gratuit de la nature. Les poŽtes de cette ťcole sont des favoris de
talent; ils se sont seulement donnť, comme on dit, la peine de naÓtre.
Ils n'ont rien acquis, ils ont tout reÁu. Ne leur demandez pas compte
de leurs efforts, mais de leur bonheur. Ce sont des prťdestinťs.
XII
Alfred de Musset appartenait ŗ une ancienne famille noble de la
Touraine. Son pŤre, administrateur par ťtat, ťtait homme de lettres par
goŻt; il avait profondťment ťtudiť J.-J. Rousseau. Un excellent livre de
lui, intitulť _Vie et ouvrage de J.-J. Rousseau_, atteste ŗ la fois son
enthousiasme et sa saine critique. C'est un supplťment des
_Confessions_. Sa conduite, dans toutes les circonstances difficiles de
ces temps de contrastes et de revirements de fortune, fut aussi noble
que ses sentiments. La mŤre d'Alfred de Musset survit, hťlas! ŗ son
fils, mais consolťe et honorťe au moins par un autre fils, aussi lettrť,
aussi aimable, aussi ťminent, mais plus sťrieux. Elle est fille d'un
membre du Conseil des Anciens, nommť Des Herbiers. Des Herbiers ťtait
ami de Cabanis, qui reÁut le dernier soupir de Mirabeau. Cet aÔeul
d'Alfred de Musset cultivait la poťsie. Il imprimait dťjŗ ŗ ses vers ce
tour spirituel, original, capricieux, caractŤre des drames lťgers de son
petit-fils. Il est rare qu'on soit sans aÔeux dans le gťnie comme dans
la fortune. En remontant avec attention le cours des gťnťrations dans
les plus humbles familles, on retrouve presque toujours dans la premiŤre
goutte du sang la source de la derniŤre. Il y a une rťvťlation dans la
gťnťalogie; on ne doit pas trop s'ťtonner que les hommes de tous les
siŤcles y aient attachť, sinon une gloire, du moins une signification.
Ceci ne contredit point la dťmocratie, cela peut l'honorer au contraire,
car il y a une noblesse de sentiments et de moeurs dans toutes les
conditions, et toutes les familles ont des ancÍtres sous le chaume comme
dans le palais.
XIII
Alfred de Musset fut le premier couronnť dans toutes ses ťtudes.
L'enfance est ainsi bien souvent la promesse de la vie. En 1827, il
remporta le grand prix de philosophie au concours gťnťral de l'ťlite des
ťtudiants de Paris; il n'avait que dix-sept ans. On voit que si la
philosophie manqua plus tard ŗ sa vie, ce ne fut pas par ignorance, mais
par cette indolence qui n'est une gr‚ce que parce qu'elle plie.
Ce succŤs ťclatant ŗ la fin de ses ťtudes l'introduisit presque encore
enfant chez Nodier, dans cette sociťtť de l'Arsenal dont la gloire ťtait
Hugo, dont l'agrťment ťtait Charles Nodier. Il apprit de l'un l'art des
vers; il apprit trop peut-Ítre de l'autre l'art de dťpenser sa jeunesse
en loisirs infructueux, en nonchalances d'imagination, en voluptťs
paresseuses d'esprit. Nodier ťtait le plus dťlicieux des causeurs et le
plus dangereux des modŤles. Il aurait dŻ naÓtre curť de village, vicaire
de Wakefield, uniquement occupť ŗ sarcler les herbes de son jardin
l'ťtť, ŗ regarder l'hiver les pieds sur ses chenets, la bŻche jaillir en
ťtincelles sous les coups distraits, de ses pincettes, et ŗ prolonger le
souper avec quelques voisins sans affaires jusqu'ŗ l'aurore dans les
entretiens sans suite et intarissables de son foyer. Nous l'avons
beaucoup connu et beaucoup aimť nous-mÍme. Nous ne l'avons jamais vu
remplacť; c'ťtait une de ces gr‚ces dont on ne peut se passer, une de
ces inutilitťs nťcessaires au coeur et qui manquent au bonheur comme
elles manquent au temps. Cette molle incurie de l'‚me et du talent qui
faisait la faiblesse de son caractŤre, faisait le charme de son esprit.
_Molle atque facetum!_
XIV
Cette faiblesse, cette gr‚ce, cette adolescence perpťtuelle de caractŤre
ťtaient empreintes ŗ l'oeil sur les traits d'Alfred de Musset comme sur
son style. Nous l'aperÁŻmes ŗ cette ťpoque une ou deux fois
nonchalamment ťtendu dans l'ombre, le coude sur un coussin, la tÍte
supportťe par sa main sur un divan du salon obscur de Nodier. C'ťtait un
beau jeune homme aux cheveux huilťs et flottants sur le cou, le visage
rťguliŤrement encadrť dans un ovale un peu allongť et dťjŗ aussi un peu
p‚li par les insomnies de la muse. Un front distrait plutŰt que pensif,
des yeux rÍveurs plutŰt qu'ťclatants (deux ťtoiles plutŰt que deux
flammes), une bouche trŤs-fine, indťcise entre le sourire et la
tristesse, une taille ťlevťe et souple, qui semblait porter, eu
flťchissant dťjŗ le poids encore si lťger de sa jeunesse; un silence
modeste et habituel au milieu du tumulte confus d'une sociťtť jaseuse de
femmes et de poŽtes complťtaient sa figure.
Il n'ťtait point cťlŤbre encore. Je n'habitais Paris qu'en passant; Hugo
et Nodier me le firent seulement remarquer comme une ombre qui aurait un
jour un nom d'homme.
Plus tard je me trouvai une ou deux fois assis ŗ cŰtť de lui aux sťances
d'ťlection de l'Acadťmie franÁaise; je reconnus la mÍme figure, mais
allanguie par la souffrance et un peu assombrie par les annťes; elles
comptent doubles pour les hommes de plaisir.
Le trait marquant de cette physionomie alors ťtait la bontť: on se
sentait portť ŗ l'aimer involontairement. S'il avait eu quelques
dťfaillances de nerfs et non de coeur, elles n'avaient jamais fait tort
qu'ŗ lui-mÍme. Il ťtait innocent de tout ce qui diffame une vie; il
n'avait pas besoin de pardon; il n'avait besoin que d'amitiť; on aurait
ťtť heureux de la lui offrir. Voilŗ le sentiment que sa physionomie
inspirait.
Nous n'ťchange‚mes que quelques-unes de ces questions et de ces
rťponses insignifiantes que s'adressent deux inconnus quand le hasard
les rapproche dans une assemblťe publique. Il me prenait pour un
rigoriste qui n'aurait pas daignť s'humaniser avec un enfant du siŤcle;
il se trompait bien. C'est alors qu'il ťcrivait dans son dernier sonnet
ce vers ťquivoque oý l'on ne devine pas bien s'il me reproche mon ‚ge ou
s'il s'accuse du sien:
Lamartine vieilli qui me traite en enfant.
Hťlas! nous avons tous ťtť jeunes! et je voudrais bien qu'Alfred de
Musset eŻt reÁu du ciel ce complťment de la journťe humaine qu'on
appelle le soir. J'aurais ťtť heureux de rajeunir d'esprit et de coeur
avec un poŽte qui prenait, comme lui, des annťes sans vieillir.
XV
C'ťtait un temps trŤs-indťcis que 1829 et 1830, une halte au milieu d'un
siŤcle, semblable ŗ un plateau de montagne ŗ deux versants; on s'y
arrÍte un moment pour dťlibťrer si l'on doit monter encore ou
redescendre. On y embrasse d'un coup d'oeil mille horizons et mille
sentiers sans savoir lequel il faut prendre. Alfred de Musset, bien
qu'entraÓnť par une puissante impulsion de nature, dut ťprouver un
moment cette hťsitation. Bien des places ťtaient prises en poťsie ŗ
cette ťpoque; l'instinct de son gťnie naissant, comme aussi l'instinct
de son doux caractŤre, lui dirent qu'il ne fallait dťplacer personne,
mais qu'il fallait se faire ŗ lui-mÍme, ŗ cŰtť et au niveau de tout le
monde, une place neuve qui n'eŻt pas encore ťtť occupťe, et qui, par
cela mÍme, n'excit‚t ni colŤre ni envie parmi ses rivaux.
Le badinage poťtique ťtait vacant, il prit le badinage comme autrefois
Hamilton, Saint-…vremond, Chaulieu, Voltaire, l'avaient pris en
commenÁant. Il se dit: je suis jeune, je suis nonchalant, je suis
enjouť, je ne crois qu'ŗ mon plaisir, je serai le poŽte de la jeunesse.
La jeunesse s'ennuie, elle m'accueillera comme son image.
Soit raisonnement, soit instinct, il y avait, en 1829 et en 1830, un
vťritable gťnie des circonstances dans ce parti pris.
De 1789 ŗ 1800 il y avait eu une solution complŤte de continuitť dans
la littťrature franÁaise. La littťrature spirituelle et lťgŤre, celle
qu'on peut appeler la littťrature de paix, avait disparu pour faire
place ŗ la littťrature de guerre. Il ne s'agissait plus de loisir et de
plaisir, mais d'opinions et de combats dans les ouvrages d'esprit. Un
interrŤgne tragique de rťvolution, d'ťchafaud, de patrie en danger,
d'ťloquence tribunitienne, avait occupť l'espace entre 1789 et 1800.
AprŤs cette ťpoque et pendant le Consulat et l'Empire, il y avait eu une
lourde et froide littťrature de collťge qui semblait vouloir faire de
nouveau ťpeler ŗ un peuple adulte l'alphabet classique de sa premiŤre
enfance. ņ l'exception de Mme de StaŽl et de M. de Chateaubriand qui,
malgrť leur gťnie, avaient bien conservť dans leur style quelques
oripeaux, clinquant de la dťclamation et de la rhťtorique natale, tout
ťtait imitation servile de l'antique dans les poŽtes laurťats de la
guerre, de la gloire, de la caserne, de l'acadťmie et du palais.
De 1815 ŗ 1830 la libertť de tribune, la libertť de penser et la libertť
d'ťcrire avaient relevť la nation de ces champs de bataille oý elle
avait trťbuchť ŗ son tour et oý elle gisait toute mutilťe dans sa
gloire et dans son sang. La respiration des ‚mes, suspendue par les
proscriptions de 1793, par la guerre et par le gouvernement militaire,
avait ťtť rendue ŗ la France, on peut mÍme dire ŗ l'Europe: une nouvelle
gťnťration d'esprits ťlevťs dans le silence et dans l'ombre ťtait
apparue sur toutes les scŤnes littťraires, ŗ la fois monarchique avec M.
de Chateaubriand, libťrale avec Mme de StaŽl, thťocratique avec M. de
Bonald, fťodale avec M. de Montlosier, sacerdotale avec M. de Maistre,
classique avec Casimir Delavigne et Soumet, historique avec M. Thiers,
ťpique avec M. Philippe de Sťgur, attique avec Bťranger, platonique avec
M. Cousin, acadťmique avec M. Villemain, pindarique sur les ailes neuves
et dans les rťgions inexplorťes avec Victor Hugo, ťlťgiaque avec moi,
oratoire avec Royer-Collard, de Serre, Foy, Lainť, Berryer naissant, et
leurs ťmules de tribune, nťo-grecque avec Vigny, romanesque avec Balzac,
humoristique avec Charles Nodier, satirique avec Mťry, Barthťlemy,
Barbier, intime avec Sainte-Beuve, guerroyante et universelle avec cette
lťgion de journalistes survivants au jour, avant-postes des idťes ou
des passions libres de leurs partis qui, de Genoude ŗ Carrel, de
Lourdoueix ŗ Marrast, de Girardin ŗ Thiers, combattaient aux
applaudissements de la foule entre les dix camps de l'opinion lettrťe.
Si on met les noms propres, tous ťclatants au moins de jeunesse, sur
chacune de ces innombrables catťgories d'esprits alors en sťve ou en
fleur, si on y ajoute, dans l'ordre des sciences exactes (oý le gťnie
consiste ŗ se passer d'imagination,) La Place, qui sondait le firmament
avec le calcul; Cuvier, qui sondait le noyau de la terre et qui lui
demandait son ‚ge par ses ossements; Arago, qui rťdigeait en langue
vulgaire les annales occultes de la science; Humboldt, qui dťcrivait
dťjŗ l'architecture cosmogonique de l'univers, et tant d'autres leurs
rivaux, leurs ťgaux peut-Ítre, qui nťgligŤrent d'inscrire leurs noms sur
leurs dťcouvertes; si on rend ŗ tout cela le souffle, la vie, le
mouvement, le tourbillonnement de la grande mÍlťe religieuse, politique,
philosophique, littťraire, classique, romantique de la restauration, on
aura une faible idťe de cette renaissance, de cet accŤs de seconde
jeunesse, de cette ťnergie de sťve et de fťconditť de l'esprit
franÁais ŗ cette date. Cette renaissance de 1815 ŗ 1830 et au delŗ, ne
sera peut-Ítre pas regardťe un jour comme trop inťgale ŗ la renaissance
des lettres sous les Mťdicis et sous Louis XIV. J'en parlerais avec plus
d'orgueil si moi-mÍme je n'en avais pas ťtť, quoique bien loin des
autres, une faible partie:
_Et quorum pars parva fui._
Et si on y ajoute enfin les grands esprits littťraires de l'Angleterre
qui semblaient avoir fleuri de la mÍme floraison sous les rayons de la
paix europťenne, esprits qui subissaient le contre-coup intellectuel de
la France, et dont la France ŗ son tour subissait l'influence; si on y
ajoute les Canning, les Byron, les Walter Scott, les Moore, les
Wordsworth, les Coledridge, les poŽtes des lacs, ces thťbaÔdes anglaises
de la poťsie de l'‚me, on aura une idťe approximative vraie de la
situation de la littťrature au moment oý Alfred de Musset naissait aux
vers.
XVI
Ses premiers vers publiťs datent de 1828, ce sont les fantaisies
intitulťes: _Don Paez_, _Madrid_, _Portia_, _Mardoche_, _les Marrons du
feu_, la _Ballade ŗ la lune_, tout un volume enfin dont le plus grand
mťrite ťtait de ne ressembler ŗ rien dans la langue franÁaise.
Si ce jeune poŽte n'eŻt pas ťtť douť par la nature d'une originalitť
forte et inventive, il aurait certainement commencť comme tout le monde
par l'imitation des modŤles morts ou vivants qu'il avait ŗ cŰtť de lui.
Sa nature le lui dťfendit, et peut-Ítre aussi un calcul habile.
Bernardin de Saint-Pierre, Mme de StaŽl, M. de Chateaubriand, Andrť
Chťnier, Hugo, Vigny, Sainte-Beuve, moi-mÍme nous avions touchť trop
fort et trop longtemps la note grave, solennelle, religieuse,
mťlancolique, quelquefois larmoyante, quelquefois trop ťthťrťe, du coeur
humain. Ainsi le voulait le temps qui sortait, le front couvert de
cendres, des dťcombres d'une sociťtť; ainsi le voulaient nos propres
coeurs, que nos mŤres avaient allaitťs de tristesse ou que l'amour
malheureux avait enivrťs de son dernier charme, la mťlancolie des
regrets.
Mais la mÍme note, touchťe par tant de mains pendant dix annťes, avait
fatiguť la France. La France a l'oreille nerveuse et dťlicate, prompte ŗ
saisir, prompte ŗ dťlaisser mÍme ce qui l'a charmťe un moment. Il ne lui
faut pas longtemps le mÍme diapason. Elle ťtait lasse de rÍver, de
prier, de pleurer, de chanter, elle voulait se dťtendre. Alfred de
Musset, soit qu'il ťprouv‚t lui-mÍme cette _fastidiositť_ du sublime et
du sťrieux, soit qu'il comprÓt que la France demandait une autre musique
de l'‚me ou des sens ŗ ses jeunes poŽtes, ne songea pas un seul instant
ŗ nous imiter. Il toucha du premier coup sur son instrument des cordes
de jeunesse, de sensibilitť d'esprit, d'ironie de coeur, qui se
moquaient hardiment de nous et du monde. Ces vers faisaient, dans le
concert poťtique de 1828, le mÍme effet que l'oiseau moqueur fait ŗ la
complainte du rossignol dans les forÍts vierges d'Amťrique, ou que les
_castagnettes_ font ŗ l'orgue dans une cathťdrale vibrante des soupirs
pieux d'une multitude agenouillťe devant des autels.
Ce fut d'abord un grand scandale, puis ce fut un grand ťclat de rire;
puis, quand on se rendit compte du talent prodigieux de cette parodie du
sublime, ce fut, dans la jeunesse surtout, un grand engouement. Tout le
monde demanda du _Musset_ comme tout le monde avait demandť autrefois du
Saint-…vremond. Puis enfin ce fut une grande estime pour l'artiste, mÍme
parmi les hommes sťrieux, quand ils eurent le sang-froid et
l'impartialitť nťcessaires pour reconnaÓtre l'admirable doigtť de cet
instrumentiste, de ce guitariste si l'on veut, sur les touches neuves et
capricieuses de son fragile instrument.
XVII
Soyons justes dans nos indulgences cependant: il n'est pas exact de dire
que tout fut neuf dans l'‚me de l'artiste, dans la musique et dans
l'instrument. Hťlas! malheureusement non: tout n'ťtait pas original dans
cette poťsie charmante et bouffonne du nouveau poŽte. Il ne nous imitait
pas, cela est vrai, mais la nature humaine, dans la premiŤre jeunesse,
est tellement imitatrice qu'ŗ son insu Alfred de Musset en imitait
d'autres que nous. Si nous avions fondť l'ťcole des larmes, deux
ťcrivains d'un immense gťnie, mais d'une dťpravation de coeur aussi
prodigieuse que leur gťnie, avaient fondť l'ťcole du rire. Mais de quel
rire? du faux rire! Car rire du sťrieux, rire du triste, rire des
sentiments les plus dťlicats et les plus saints du coeur de l'homme,
rire de soi-mÍme, rire du bien, rire du beau, rire de l'amour, rire de
la femme, rire de Dieu, ce n'est plus rire: c'est grimacer le blasphŤme,
c'est grincer des dents en profťrant le sacrilťge, c'est profaner la
poťsie, c'est se griser ŗ l'autel dans le calice de l'enthousiasme et
des larmes.
Ces deux hommes ťtaient alors lord Byron en Angleterre, Henri _Heine_ en
Allemagne, et ensuite ŗ Paris.
Lord Byron, aprŤs avoir ťcrit les plus pathťtiques et les plus
orientales poťsies qui aient jamais attendri ou enchantť l'Occident,
ťcrivait maintenant son poŽme burlesque de _Don Juan_, apostasie
quelquefois ravissante, quelquefois grossiŤre et plate de son ‚me et de
son gťnie. _Don Juan_, prťcisťment parce que c'ťtait un scandale, avait
un succŤs immense et trŤs-disproportionnť ŗ son mťrite. On passait sur
des chants interminables de divagations, d'obscťnitťs et de platitudes,
pour s'extasier avec raison sur des chants inouÔs de passion naÔve, de
jeunesse, d'innocence et de fťlicitť, tels que les amours de Don Juan et
d'HaÔdť, cette Chloť et ce Daphnis de l'Archipel. Tout le monde se
croyait capable d'ťcrire des _HaÔdť_, parce qu'on se sentait
trŤs-capable de rimer en franÁais les prosaÔques obscťnitťs et les
grossiŤres plaisanteries de cette longue et mauvaise rapsodie du poŽte
anglais.
Le sujet de _Don Juan_ a ťtť et sera mille fois encore l'ťternelle
tentation des imaginations poťtiques. _Don Juan_ est Espagnol d'origine,
puis Allemand de conception, puis Anglais d'exťcution; il sera
certainement FranÁais tŰt ou tard d'imitation, quand le poŽte sera nť
assez enthousiaste pour s'ťlever au sublime, assez corrompu pour se
moquer de son enthousiasme, assez souple pour se prťcipiter de l'empirťe
dans l'ťgout sans se casser les reins dans ce tour de force. Dieu
prťserve le plus longtemps possible la littťrature franÁaise de ce
casse-cou! Voltaire l'a essayť dans un poŽme plus ordurier que
plaisant; oý Voltaire a ťchouť qui osera se flatter de rťussir?
XVIII
Le type vťritablement original de _Don Juan_ est nť le jour oý la
chevalerie est morte en Europe. La chevalerie ťtait la noble folie de la
vertu; les don Juan sont la folie du vice. C'est _Don Quichotte_ qui est
le vťritable pŤre de _Don Juan_; le jour oý l'on a commencť ŗ railler
l'hťroÔsme et l'amour, on a ouvert la carriŤre aux hťros du scepticisme
et du libertinage. _Don Juan_, fils de _Don Quichotte_, aprŤs avoir
amusť sous diffťrentes incarnations l'amoureuse Espagne, a fait son
apparition dans la fantastique Allemagne sous le nom de _Faust_. Les
vieux poŽtes allemands s'en sont emparťs et lui ont donnť un degrť de
dťpravation de plus. Ils ont ajoutť l'impiťtť ŗ la dťbauche dans ce
caractŤre. Ils en ont fait un _Lucifer_ dťguisť en amant pour sťduire et
pour dťlaisser les jeunes filles ťblouies ŗ sa lueur infernale. Goethe
l'a rajeuni dans son _Faust_, tragťdie ťpique et merveilleuse, oý
l'innocente coupable Marguerite attendrit Dieu lui-mÍme aprŤs avoir
attendri Satan.
Don Juan, dans lord Byron comme dans les poŽtes espagnols, n'est plus
Satan, mais c'est un jeune homme satanique, une personnification de la
jeunesse corrompue dans sa fleur, corrompant tout autour d'elle, mais
ayant conservť, dans sa corruption prťcoce et malfaisante, quelque chose
de la gr‚ce et du parfum de sou innocence. Don Juan, en un mot, c'est
l'ťtourdi blasť de l'univers, c'est le mauvais sujet de l'espŤce
humaine, c'est le vice sťduit et sťduisant, ťprouvant quelquefois la
passion, la jouant plus souvent par caprice et la finissant toujours par
un ťclat de rire.
Voilŗ le modŤle que _Don Quichotte_ de CervantŤs, le _Faust_ de Goethe
et le _Don Juan_ de Byron offraient ŗ Alfred de Musset.
_Henri Heine_, pour qui on commenÁait ŗ s'engouer en France, lui en
offrait un bien plus dťpravť.
Nous avons beaucoup lu _Henri Heine_ dans ses vers et dans sa prose. Ce
Voltaire de Hambourg, ce Camille Desmoulins de la mer Baltique, ce
Figaro d'outre-Rhin, ťtait le fils d'une honorable et opulente maison
de banquiers d'Allemagne. Proscrit de son pays pour quelques peccadilles
de satiriste, il ťtait venu ŗ Paris; il s'y ťtait fait le Coriolan de
plume de sa patrie.
Son prodigieux talent comme pamphlťtaire, bien supťrieur, selon nous, ŗ
son trŤs-mťdiocre talent comme poŽte, l'avait bien vite naturalisť
FranÁais. Nous lui rendons justice sous ce rapport: ni Aristophane, ni
Arioste, ni Voltaire, ni Beaumarchais, ni Camille Desmoulins, ces dieux
rieurs de la facťtie, n'ont surpassť ce jeune Allemand dans cet art
mťchant d'assaisonner le sťrieux de ridicule et de mÍler une poťsie
vťritable ŗ la plus cynique raillerie des choses sacrťes. Du reste, il
ne fallait lui demander aucune raison d'aimer ou de haÔr ce qu'il
exaltait ou ce qu'il brisait avec la mÍme verve d'esprit.
_Heine_ n'avait pour raison que son caprice. Tour ŗ tour libťral,
monarchiste, allemand, franÁais, radical, napolťoniste, orlťaniste,
rťpublicain, communiste, blasphťmant la sociťtť quand elle rŤgne, sapant
le trŰne quand il est debout, imprťquant la rťpublique quand elle sort
pour un jour de ses propres voeux, cynique d'impiťtť quand il s'amuse,
dťvot quand il souffre, ambigu quand il meurt, indťchiffrable partout,
ce n'est pas un homme, c'est une plume, ou plutŰt c'est une griffe, mais
c'est la griffe d'un aigle de tťnŤbres, d'un singe de l'enfer amuseur
des mauvais esprits: cette griffe ťgratigne jusqu'au sang tout ce
qu'elle touche et elle brŻle tout ce qu'elle a ťgratignť. En conscience
nous ne croyons pas que la nature humaine ait jamais rťuni dans un seul
homme, tant de talent, tant de lťgŤretť, tant de poťsie, tant de gr‚ce ŗ
tant d'innocente perversitť. Nous disons innocente, car un enfant n'est
jamais coupable, et sous les premiers cheveux blancs Henri Heine est
mort enfant!
Tel ťtait le second modŤle que l'esprit tentateur offrait ŗ
l'adolescence inexpťrimentťe d'Alfred de Musset quand il entra dans le
monde. Mais s'il fut malheureux dans ses premiers modŤles, il fut
ťgalement malheureux dans ses premiŤres tendresses de coeur.
Un jeune ťcrivain aussi dťlicat de touche qu'il est accompli
d'intelligence et qu'il est viril de caractŤre, M. Laurent Pichat, poŽte
et politique de la mÍme main, fait aujourd'hui mÍme dans la _Revue de
Paris_, une allusion par rťticence ŗ cette infortune de coeur d'Alfred
de Musset, hťlas! et peut-Ítre la plus irrťmťdiable de ses
infortunes!--ęLes biographesĽ ťcrit M. Laurent Pichat, ęchercheront ŗ
rendre publique l'anecdote de cette douleur qui le fÓt pleurer comme un
enfant: dťjŗ mÍme les indiscrťtions personnelles en ont trop dit
peut-Ítre. Ne nous arrÍtons pas ŗ ces lťgendes du sentiment. Quand nous
dťvorions ses plaintes, et quand des voix vagues voulaient nous rťvťler
cette mystťrieuse histoire, nous nous refusions ŗ entendre, et
aujourd'hui mÍme nous ne voulons rien savoir et rien rťpťter de ce qu'on
a murmurť. Lisons les vers et respectons les secrets de l'‚me.Ľ
Nous ne dťchirerons pas le voile, et cela avec d'autant plus de raison,
que nous n'avons recueilli, comme M. Laurent Pichat, que les commťrages
ŗ demi-mot de l'ignorance et de la malveillance contre deux natures de
gťnie. Il paraÓt rťsulter de ces balbutiements de vagues sur les lagunes
de Venise, que le premier amour de ce jeune homme ne fut pas heureux, et
que nť d'un caprice, il fut abrťgť et puni par un abandon. De lŗ ces
gouttes de larmes amŤres qui tombŤrent pendant toute la vie de Musset
sur ces feuilles de rose de ses vers, et qui en sont peut-Ítre les
perles les plus prťcieuses, comme dans un tableau de fleurs _de
Saint-Jean_ les gouttes de rosťe que transperce un rayon de soleil. Mais
de lŗ aussi une incrťdulitť impie ŗ l'amour vertueux, une ironie
habituelle contre l'amour fidŤle, une moquerie de l'amour de l'‚me, un
culte ŗ l'amour des yeux, et enfin un abandon sans rťsistance ŗ l'amour
capricieux et volage de l'instinct qui est ŗ la fois la profanation et
la vengeance de ce qu'il y a de plus divin dans le calice oý l'homme
boit ses dťlices et ses larmes.
Ce fut un grand malheur que cette rencontre au printemps de leur vie,
entre deux grandes imaginations et entre deux belles jeunesses qui
n'ťtaient pas nťes pour se reflťter l'une ŗ l'autre des clartťs, mais
des ombres. Elles se ternirent ainsi au lieu de s'illuminer
mutuellement. Il y eut ťclipse dans leur ciel, elles en souffrirent, et
tout le monde en souffrit avec elles.
Il y a deux ťducations pour tout homme jeune qui entre bien douť des
dons de Dieu dans la vie: l'ťducation de sa mŤre et l'ťducation de la
premiŤre femme qu'il aime aprŤs sa mŤre. Heureux celui qui aime plus
haut que lui ŗ son premier soupir de tendresse! Malheureux celui qui
n'aime pas ŗ son niveau! L'un ne cessera pas de monter, l'autre ne
cessera pas de descendre. La Destinťe est femme.
Ce n'ťtait pas un caprice de jeunesse qu'il fallait ŗ Musset, c'ťtait
une religion du coeur, notre premier maÓtre de philosophie, c'est un
chaste amour. C'est Bťatrice qui fÓt Dante, c'est Laure qui fÓt
Pťtrarque, c'est Lťonore qui fÓt le Tasse, c'est Vittoria Colonna qui
fit Michel-Ange, aussi poŽte de coeur qu'il fut artiste du ciseau; dans
la GrŤce, c'est Sapho qui fÓt Alcťe; les femmes olympiques de la GrŤce
ne firent que des Anacrťons, les belles _Dťlies_ de Rome ne firent que
des Tibulles, les _…lťonores_ de Paris ne firent que des Parnys. L'amour
est un holocauste dans les coeurs purs, mais c'est ŗ condition de ne
brŻler que des parfums.
XIX
Cependant Alfred de Musset paraÓt avoir rencontrť plus tard (hťlas, trop
tard!) une de ces crťatures au-dessus de tout pinceau, fŻt-ce celui de
RaphaŽl pour la Fornarina; elle semblait digne d'exhausser le gťnie d'un
jeune poŽte jusqu'ŗ la hauteur idťale et sereine oý l'amour des
_Bťatrice_, des _Laure_ et des _Lťonore_ avait transfigurť le Tasse, le
Dante et Pťtrarque.
Cette femme aurait suffi pour les transfigurer tous les trois. C'ťtait
la musique, ou plutŰt c'ťtait la poťsie sous figure de femme. On
l'appelait sur la terre la _Malibran_; on l'appelle sans doute au ciel
la sainte Cťcile du dix-neuviŤme siŤcle.
Quelques vers tristes, et pour ainsi dire rťtrospectifs, d'Alfred de
Musset, ťcrits sur le tombeau de cette incarnation de la mťlodie quinze
jours aprŤs sa mort, semblent rťvťler dans le poŽte un regret qui recŤle
presque un amour. ęQue reste-t-il de toi aujourd'hui, dit le poŽte, de
toi morte hier, de toi, pauvre Marie! Au fond d'une chapelle il nous
reste une croix!Ľ
Une croix et l'oubli, la nuit et le silence!
…coutez! c'est le vent, c'est l'ocťan immense,
C'est un pÍcheur qui chante au bord du grand chemin,
Et de tant de beautť, de gloire, d'espťrance,
De tant d'accords si doux, d'un instrument divin,
Pas un faible soupir, pas un ťcho lointain!
N'ťtait-ce pas hier, qu'ŗ la fleur de ton ‚ge,
Tu traversais l'Europe, une lyre ŗ la main,
Dans la mer, en riant, te jetant ŗ la nage,
Chantant la tarentelle au ciel napolitain,
Coeur d'ange et de lion, libre oiseau de passage,
NaÔve enfant ce soir, sainte artiste demain?
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Hťlas! Marietta, tu nous restais encore;
Lorsque sur le sillon l'oiseau chante l'aurore,
Le laboureur s'arrÍte, et, le front en sueur,
Aspire dans l'air pur un souffle de bonheur:
Ainsi nous consolait ta voix fraÓche et sonore,
Et tes chants dans les airs emportaient la douleur!
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Meurs donc: la mort est douce et ta t‚che est remplie!
Ce que l'homme ici-bas appelle le gťnie,
C'est le besoin d'aimer, hors de lŗ tout est vain.
Et puisque tŰt ou tard l'amour humain s'oublie,
Il est d'une grande ‚me et d'un heureux destin
D'expirer comme toi pour un amour divin!
XX
Ces vers nous ramŤnent malgrť nous ŗ un amer souvenir.
Nous l'avons connue et admirťe aussi, cette apparition transparente du
gťnie dans la beautť. Nous avons entrevu dans tous les climats bien des
femmes dont les traits ťblouissaient les yeux, dont le timbre de l'‚me
dans la voix ťbranlait le coeur, dont les regards rťpandaient plus de
lueurs qu'il n'y en a dans l'aube et dans les ťtoiles d'un ciel
d'Orient; mais nous n'avons jamais vu et nous craignons qu'on ne revoie
jamais (car la nature s'ťgale mais ne se rťpŤte pas) une crťature
innomťe comparable ŗ cette bayadŤre du ciel ici-bas. Nous disons
bayadŤre dans le sens pur et pieux du mot, une cariatide vivante des
temples de la divinitť dans les Indes, l'ivresse de l'oreille et des
yeux dťvoilťe aux hommes pour enlever l'‚me au ciel par les regards et
par la voix!
Un mystŤre qu'elle nous a ŗ demi rťvťlť un jour ŗ nous-mÍme planait sur
sa vie comme un nuage sur la source d'un fleuve. Ce nuage assombrissait
sa beautť. Il rťpandait sur ses traits ťclatants de jeunesse et
d'inspiration une arriŤre-pensťe de tristesse. Cette mťlancolie
s'ťclairait, mais ne se dissipait jamais entiŤrement. Elle avait trop
souffert pour que le sourire ne conserv‚t pas une certaine langueur et
une certaine amertume irrťflťchie sur ses lŤvres.
Cette beautť de madame Malibran existait par elle-mÍme sans avoir besoin
de formes, de contours, de couleurs pour se rťvťler. C'ťtait la beautť
mťtaphysique n'empruntant ŗ la matiŤre que juste assez de forme pour
Ítre perceptible aux yeux d'ici-bas. Son corps charmant ne la parait
pas, il la voilait ŗ peine. Cependant cette beautť, qui transperÁait ŗ
travers ce frÍle tissu comme la lueur ŗ travers l'alb‚tre, fascinait
tous les sens autant qu'elle divinisait l'‚me. On se sentait en prťsence
d'un Ítre dont le feu sacrť de l'art avait dťvorť le tissu. Ce feu de
l'enthousiasme ťtait si ardent et si pur en elle, qu'ŗ chaque instant on
croyait voir cette enveloppe consumťe tomber en une pincťe de cendre et
tenir dans une urne ou dans la main. On connaÓt les prodigieux
engouements qu'elle excitait d'un bout de l'Europe ŗ l'autre par son
chant. Mais ce n'ťtait ni son chant, ni son geste, ni son drame que
j'admirais le plus en elle, c'ťtait sa personne. Elle n'avait pas besoin
de baguette pour ses enchantements, le charme ťtait dans son ‚me. Ce
charme ne tombait pas avec ses parures ou ses couronnes de thť‚tre, il
s'endormait et se rťveillait avec elle.
Un hasard nous rapprocha; elle me tendit la main comme ŗ un frŤre. Toute
son ‚me ťtait dans ce geste. Je la vis assidŻment pendant un court
printemps, le dernier de ses beaux printemps; c'ťtait tantŰt dans des
nuits musicales sous les arbres illuminťs des jardins de Paris, oý elle
faisait taire et mourir de mťlodie les rossignols; tantŰt dans son salon
familier de la rue de Provence, oý les instruments de musique et les
guitares de la veille jonchaient les meubles et les tapis. La
conversation y prenait bien plus souvent le ton mťlancolique de
l'enthousiasme qui est le mal du pays des grandes ‚mes, que le ton de
l'enjouement qui n'ťtait chez elle que l'ivresse d'une soirťe.
Elle me traitait en ami supťrieur en ‚ge ŗ qui l'on se plaÓt ŗ se
confier, parce qu'on sent l'affection dťsintťressťe dans le conseil. Il
dťpendit plusieurs fois de moi d'avoir une influence heureuse sur sa
destinťe. Cependant je ne la dťtournai pas assez du chemin de la mort.
Elle partit. Elle ťpousa un homme supťrieur dans l'art qu'elle aimait.
Elle fut heureuse quelques jours, puis elle mourut dans le bonheur et
dans le triomphe. Ses bienfaits incalculables l'avaient devancťe dans le
ciel et l'attendaient sur le seuil des misťricordes. Je venais de
recevoir d'elle peu de jours avant sa mort une lettre badine de trente
pages, qui dort encore quelque part parmi mes papiers. ęJe voudrais, m'y
disait-elle, avoir sous la main une feuille de papier longue et large
comme le firmament pour la remplir de mon bavardage et de mes
ťpanchements avec vous.Ľ Jeunesse, beautť, bontť, gťnie, ‚me de
prťdilection parmi les ‚mes expressives, la petite croix dont parle
Alfred de Musset couvrit tout.
Voilŗ la vision ŗ la fois charmante et surnaturelle que le hasard aurait
dŻ placer ŗ temps sur la route du poŽte dont nous parlons! voilŗ le
_Sursum corda_ qu'il fallait ŗ ce jeune homme pour l'empÍcher de
regarder jamais ailleurs. Ils ťtaient jeunes, ils ťtaient libres, ils
ťtaient beaux, ils ťtaient poŽtes au moins autant l'un que l'autre, ils
pouvaient s'attacher saintement dans la vie l'un ŗ l'autre aussi
indissolublement que la musique s'attache aux paroles dans une mťlodie
de Cimarosa!
Il ne devait pas en Ítre ainsi, nous dit M. de Sainte-Beuve dans un
tendre reproche ŗ la destinťe de cet ami mort. ęLa passion vint,
ajoute-t-il; elle ťclaira un instant ce gťnie si bien fait pour elle;
mais elle le ravagea. On connaÓt trop bien cette histoire pour que ce
soit une indiscrťtion de la rappeler.Ľ
M. de Sainte-Beuve a raison; du jour, en effet, oý ce jeune poŽte cessa
de croire ŗ la saintetť de l'amour et ŗ la durťe de l'enthousiasme, il
fit plus que de tomber dans l'incrťdulitť, il tomba dans la dťrision de
l'amour, il devint un sceptique du sentiment, un athťe de
l'enthousiasme, un blasphťmateur du feu sacrť; de lŗ au cynisme il n'y a
qu'un pas; sa nature ťlťgante et attique lui dťfendait de s'y livrer,
mais il glissa trop souvent dans des libertinages de style qui ne se
dťgradent pas jusqu'ŗ l'Arťtin, mais qui rappellent Boccace, le Musset
immortel d'Italie.
XXI
Trois conditions, selon nous, sont nťcessaires pour former un grand
poŽte sťrieux dans tous les siŤcles. Ces trois conditions sont: un
amour, une foi, un caractŤre.
Nous venons de voir que la premiŤre de ces conditions, un saint amour,
un amour de _Bťatrice_ ou de Laure, avait malheureusement manquť ŗ M. de
Musset.
Ses oeuvres, ŗ dater de ce jour, nous prouvent assez qu'une foi
quelconque, soit religieuse, soit philosophique, soit mÍme politique,
lui manqua aussi; nous n'en voudrions d'autre preuve que ses vers. Ils
badinent presque sans cesse avec les choses sťrieuses, ils font de la
poťsie la flamme bleue d'un bol de punch, au lieu d'en faire la flamme
inextinguible d'un autel. Musset fait plus que de badiner avec les
grands sentiments, il les raille, soit que ces grands sentiments
s'appellent amour, soit qu'ils s'appellent religion, soit qu'ils
s'appellent patriotisme: lisez, sur les matiŤres religieuses et
politiques, sa profession ironique adressťe ŗ un ami.
ęVous me demandez si j'aime ma patrie?
Oui, j'aime fort aussi l'Espagne et la Turquie.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
ęVous me demandez si je suis catholique?
Oui, j'aime fort aussi les dieux....
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
ęVous me demandez si j'aime la sagesse?
Oui, j'aime fort aussi le tabac ŗ fumer.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
ęJ'estime le Bordeaux, surtout dans sa vieillesse.
J'aime tous les vins francs parce qu'ils font aimer!Ľ
Lisez, dans les vers sur la naissance d'un prince, l'apostrophe ŗ la
nation pour la dťsintťresser de tout ce qui n'est pas jouissance
matťrielle.
ęAs-tu vendu ton blť, ton bťtail et ton vin?Ľ
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.††.
Enfin lisez dans la derniŤre page dont il a scellť ses oeuvres, son
sonnet d'adieu ŗ ce bas monde:
Jusqu'ŗ prťsent, lecteur, suivant l'antique usage,
Je te disais bonjour ŗ la premiŤre page.
Mon livre cette fois se ferme moins gaiement;
En vťritť, ce siŤcle est un mauvais moment.
Tout s'en va, les plaisirs et les moeurs d'un autre ‚ge.
Les rois, les dieux vaincus, le hasard triomphant,
Rosalinde et Suzon qui me trouvent trop sage,
Lamartine vieilli qui me traite en enfant.
La politique, hťlas! voilŗ notre misŤre.
Mes meilleurs ennemis me conseillent d'en faire.
tre rouge ce soir, blanc demain, ma foi, non.
Je veux, quand on m'a lu, qu'on puisse me relire.
Si deux noms, par hasard, s'embrouillent sur ma lyre,
Ce ne sera jamais que Ninette ou Ninon.
Charmante plaisanterie, triste symbole d'une foi absente qui ne donne
aucune unitť, aucune spiritualitť, aucun but grandiose, aucune tendance
mÍme perceptible au gťnie; ces moeurs dťlicieuses, mais toujours
lťgŤres, sont des osselets avec lesquels un enfant joue sur les deux
seuils de la vie. Une philosophie manque donc ŗ ce poŽte pour Ítre un
homme fait de la littťrature.
La troisiŤme condition, un caractŤre, ne lui a pas moins manquť. Si l'on
entend par ce mot une nature saine, bonne, honnÍte, tendre mÍme et
capable de tous les excellents sentiments du coeur et de l'esprit dans
la vie privťe; non, ce caractŤre-lŗ n'a pas manquť au poŽte, c'est pour
cela mÍme qu'il fut aimť, et qu'il sera pleurť: sa physionomie seule
rťvťlait un homme de bien. Mais si l'on entend par caractŤre cette
soliditť de membres, cet aplomb de stature, cette ťnergie de pose qui
font qu'un homme se tient debout contre les vents de la vie et qu'il
marche droit ŗ pas rťguliers dans les sentiers difficiles, vers un but
humain ou divin placť au bout de notre courte carriŤre humaine; non,
Alfred de Musset ne reÁut pas de la nature et ne conquit pas par
l'ťducation ce caractŤre, seul lest qui empÍche le navire de chavirer
dans le roulis des vagues. Son ‚me, qui n'ťtait que gr‚ce, flexibilitť
et souplesse comme son talent, s'inclinait ŗ tout vent de l'imagination.
Il n'y avait en lui de solide que ce qu'on entend par l'honnÍte homme:
tout le reste ťtait d'un enfant; ses fautes mÍme dont on a trop parlť
n'ťtaient que des enfantillages. C'ťtaient des fautes de tempťrament, ce
ne furent jamais des vices de coeur.
Mais enfin pour Ítre vrai il faut reconnaÓtre que l'absence de ces
trois conditions qui font seules la grande poťsie: l'amour, la foi, le
caractŤre, lui manquent comme elles manquŤrent ŗ un homme du
dix-septiŤme siŤcle avec lequel il a une lointaine ressemblance, la
Fontaine. Il faut reconnaÓtre de plus que l'absence de ces trois
conditions qui n'ont pas empÍchť la Fontaine d'Ítre ce qu'on appelle
immortel, mais qui l'ont empÍchť d'Ítre moral, il faut reconnaÓtre,
disons-nous, que l'absence totale de ces trois conditions de l'homme a
portť un prťjudice immense au poŽte; il faut reconnaÓtre que l'absence
de ces trois qualitťs donne ŗ l'ensemble des oeuvres de Musset quelque
chose de vide, de creux, de lťger dans la main, d'incohťrent, de
sardonique, d'ťternellement jeune, et par consťquent de souvent puťril
et de quelquefois licencieux qui ne satisfait pas la raison, qui ne
vivifie pas le coeur autant que ses oeuvres sťduisent et caressent
l'esprit.
Enfin il faut reconnaÓtre qu'il y a dans ces ťternels enjouements, dans
cette folle ironie des choses graves: amour, beautť, religion, chastetť
des moeurs, dťvouement ŗ ses opinions, quelque chose qui fait une
impression pťnible mÍme ŗ l'imagination. Cette impression est tout ŗ
fait semblable ŗ celle que fait, dans un bain d'Orient, le baigneur qui
vous verse une pluie d'eau froide sur la poitrine, aprŤs vous avoir
plongť dans l'eau tiŤde et parfumťe du bassin de marbre. On a froid et
chaud tout ensemble, on ne sait si l'on doit s'ťpanouir ou frissonner.
Pour moi j'avoue (mais c'est sans doute un tort de ma nature un peu trop
sensible aux impressions de l'air ambiant), j'avoue que c'est surtout
cette ironie moqueuse, cette caresse ŗ rebrousse-poil, ce chaud et froid
de ses vers, cette profanation du sentiment qui m'ont rendu moins
sensible que je ne devais l'Ítre au mťrite incomparable des ouvrages
lťgers de cet ťmule en poťsie.
Dirai-je ici toute ma pensťe? Il m'est arrivť souvent, en fermant avec
humeur le volume de _Don Juan_ de Byron, les facťties presque toujours
sacrilťges de _Heine_, et quelquefois les poťsies trop juvťniles et trop
rabelaisiennes de Musset, il m'est arrivť, dis-je, de comparer
l'impression que j'avais reÁue dans ces volumes lťthifŤres ŗ une Morgue
de la pensťe oý l'on va, pour les reconnaÓtre, contempler avec
rťpugnance et dťgoŻt les choses mortes et dťcomposťes du coeur humain!
Il me semblait que j'entendais la voix ricaneuse de don Juan, ou la voix
plus grinÁante de _Heine_ le _poŽte rťprouvť_ de cette ťcole, nous dire,
en se faisant une joie de notre horreur: Tenez, regardez votre idťal:
Ici la jeunesse, ici la beautť, ici l'innocence, ici l'amour, ici la
pudeur, ici la vertu, ici la piťtť, ici la poťsie, cette fleur de l'‚me!
ici l'hťroÔsme trompť par la fortune! Les voilŗ, mais les voilŗ tuťs!
les voilŗ trouvťs dans la rue aprŤs une nuit de carnaval! les voilŗ tout
salis de boue et de lie! les voilŗ honteux, mÍme aprŤs leur mort, de
leur nuditť! Et, pour que le spectacle soit plus funŤbre et que l'ironie
des poŽtes soit plus sanglante: Regardez! voilŗ, sous le vestibule de
cette Morgue de l'‚me, une statue du rire qui grimace la voluptť en face
de la mort et qui vous encourage du doigt ŗ vous moquer des plus belles
et des plus tristes choses de la vie!
Pardon de cette image, mais il ne s'en prťsente pas d'autre sous ma main
pour peindre cet attrait mÍlť de rťpulsion qui me saisit en lisant ces
poťsies renversťes qui placent l'idťal en bas au lieu de le laisser oý
Dieu l'a placť, dans les hauteurs de l'‚me et dans les horizons du
ciel. Est-ce lŗ ce qu'on ťprouve en lisant l'Arioste? Non! le franc rire
n'est pas le ricanement.
XXII
Alfred de Musset ne devait pas persister toujours dans ce faux genre. La
tristesse venait avec les annťes, et avec la tristesse venait la
vťritable poťsie, celle de son second volume, celle surtout de ses
_Nuits_ que nous vous ferons admirer tout ŗ l'heure sans rťserve. Depuis
quinze ans il s'ťtait retirť de tout, du monde, de l'amour, de la poťsie
mÍme, de tout exceptť de la famille et des amitiťs qui lui ťtaient
restťes pieusement fidŤles.
La maladie du dťsenchantement, vengeance de ceux qui n'ont pas placť
leur perspective et leur espťrance assez haut, explique les silences et
les dťfaillances qu'on a reprochťs ŗ ses derniŤres annťes. La
philosophie du plaisir ne laisse dans la bouche que cendre amŤre, elle
ne survit pas ŗ la jeunesse: il faut mourir quand les feuilles tombent,
ŗ l'approche de l'hiver, de l'arbre de vie. Musset dťsirait mourir; il
disait ŗ son excellent frŤre, homme d'une gr‚ce aussi tendre, mais d'une
raison plus saine que lui: ęJe suis le poŽte de la jeunesse, je dois
m'en aller jeune avec le printemps. Je ne voudrais pas passer l'‚ge de
RaphaŽl, de Mozart, de Weber, de la divine Malibran!Ľ
Une maladie de coeur l'avertissait depuis longtemps que ses voeux
seraient exaucťs. Le premier mai de cette annťe il s'alita comme pour
une indisposition lťgŤre; rien de funeste en apparence n'alarmait sa
mŤre, son frŤre, ses amis, la gouvernante dťvouťe qui le servait depuis
vingt ans avec une affection maternelle. Lui cependant avait les vagues
pressentiments d'un adieu prochain, il s'entretenait souvent avec une
tendre sollicitude de la douleur des siens, du sort de la pauvre femme
qui le veillait, providence domestique de son foyer.
Une lťgŤre crise les alarma un instant dans la soirťe; elle fut suivie
d'un bien-Ítre et d'un calme perfides; il tťmoigna le dťsir de dormir;
il s'endormit et ne se rťveilla pas. Il avait passť sans secousse d'un
monde ŗ l'autre; son dernier souffle n'avait pas ťtť entendu. Mort
douce et nonchalante, dťsirťe de ceux qui ne craignent ici-bas que la
douleur! De sourds sanglots ťclatŤrent autour de sa couche, et des
priŤres suivirent son ‚me lťgŤre et repentante au sťjour des bons et des
misťricordieux; il avait ťtť l'un et l'autre. Dante l'aurait placť dans
les limbes, comme les enfants dont ses faiblesses mÍmes avaient
l'innocence.
XXIII
Et maintenant on recueille ses vers. Mais quelle influence ce poŽte de
la jeunesse a-t-il eue sur cette jeunesse de la France, qui s'est
enivrťe pendant vingt-cinq ans ŗ cette coupe? Une influence maladive et
funeste, nous le disons hautement. Cette poťsie est _un perpťtuel
lendemain de fÍte_, aprŤs lequel on ťprouve cette lourdeur de tÍte et
cet allanguissement de vie qu'on ťprouve le matin ŗ son rťveil aprŤs une
nuit de festin, de danse et d'ťtourdissement des liqueurs malsaines
qu'on a savourťes. Poťsie de la paresse qui ne laisse, en retombant
comme une couronne de convive, que des feuilles de roses sťchťes et
foulťes aux pieds. Philosophie du plaisir qui n'a pour moralitť que le
dťboire et le dťgoŻt.
Pendant vingt-cinq ans, cette jeunesse ťpicurienne de ses disciples ne
s'est nourrie malheureusement que de cette fumťe des vers qui s'exhalait
avec une sťduction, enivrante des poťsies de son favori. Musset a fait
une ťcole, l'ťcole de ceux qui ne croient ŗ rien qu'aux beaux vers et
aux belles ivresses.
‘ Jeunesse d'aujourd'hui! Jeunesse dorťe de Musset, toi qui le pleures,
mais qui ne t'es pas mÍme donnť la fatigue d'aller jeter une feuille de
rose sur son cercueil ou de l'accompagner jusqu'au seuil creux de
l'ťternitť, de peur de dťranger une de tes paresses ou d'attrister une
de tes joies! ‘ Jeunesse d'aujourd'hui! Jeunesse qu'il a faite, il est
mort, ton poŽte! Mais toi, interroge-toi bien: est-ce que tu vis?
Est-ce que tu vis par l'intelligence? Est-ce que tu vis par le coeur?
Est-ce que tu vis mÍme par aucune de ces illusions gťnťreuses et
juvťniles qui poussent l'homme en avant sur les routes de l'idťal, de la
passion, de l'activitť, de l'ťtude, et qui sont les mirages de la
libertť et de la vertu? Non! tu ne vis, comme le vieillard blasť, que
de la vie sťnile des sens. Le ricanement de l'indiffťrence sur les
lŤvres, du plaisir pour de l'or et de l'or pour le plaisir dans la main:
voilŗ ta poťsie!
Tu as ťtť ťlevťe sous ce rŤgne terre ŗ terre oý la France de 1830,
antichevaleresque et antilibťrale tout ŗ la fois, s'ťtait fondu un trŰne
ŗ son image avec des rognures d'ťcus entassťes dans ses coffres-forts,
et oý le matťrialisme de la jouissance ne prÍchait pour toute morale aux
enfants de tels pŤres que le mťpris de toute noble intellectualitť! Le
_savoir-faire_ dans une petite faction gouvernante et le _savoir-vivre_
dans les fils de cette oligarchie dorťe, ťtaient les seuls mťrites
apprťciťs dans les gymnases de cette ťpoque en possession du sceptre et
du comptoir. _Enrichis-toi et jouis_ ťtait le catťchisme du temps.
Tu sortais de ces gymnases dťjŗ toute corrompue par cette prťtendue
sagesse de la vie sans rÍves. Il te fallait un poŽte ŗ l'image de ta
politique; car enfin les poŽtes sortent de terre comme en France sortent
les soldats, quel que soit le parti qui frappe du pied cette terre
fťconde. Alfred de Musset naquit; il volait plus haut que toi, car il
avait des ailes pour s'ťlancer, quand il ťtait dťgoŻtť, au-dessus de son
siŤcle; il avait un gťnie pour mťpriser mÍme sa propre trivialitť. Il
badinait avec le vice, et ton vice ŗ toi ťtait sincŤre. Il t'a chantť ce
que tu demandais qu'on te chant‚t, les seules choses que tu voulais
entendre: la beautť de chair et de sang, le plaisir sans choix, le vin
sans mesure,
Qu'importe le flacon, pourvu qu'il ait l'ivresse!
les sťrťnades espagnoles, les aventures risquťes, les strophes
titubantes, le dťdain de Platon, les assouvissements d'…picure, le
mťpris de la politique, le rire de la saintetť, le doute sur les
immortels lendemains de cette courte vie! Tu l'as applaudi, et vous vous
Ítes pervertis l'un et l'autre. Il est remontť de cette perversion par
le ressort vainement comprimť de son gťnie. Mais toi, Jeunesse, tu y es
restťe et tu t'y complais, et tu rťpŤtes ses vers, aprŤs tes orgies,
pour te justifier ŗ toi-mÍme ta mollesse par un ťlťgant exemple!
Aussi regarde: qu'es-tu devenue depuis que cette moralitť du plaisir a
ťtť aspirťe par toi dans ces vers ivres de verve, mais malsains de
substance. Ton trŰne de 1830 est tombť, et tu n'as pas levť un bras
seulement pour le dťfendre. La rťpublique a surgi sous tes pieds, et tu
n'as pas fait un geste pour la modťrer et pour l'asseoir sur ta propre
souverainetť, comme si tu t'ťtais sentie indigne de ce rŤgne de la
raison et de l'ťnergie civiles que le hasard t'offrait pour te relever ŗ
tes propres yeux et aux yeux du monde. Souverain fatiguť avant le
travail, tu as abdiquť avec insouciance, comme un roi de la race des
Sardanapale, une dignitť qui t'aurait coŻtť une heure de ton sommeil ou
une coupe de tes festins! Mille tribunes se sont ťlevťes, et tu n'es
montťe ŗ aucune pour dťfendre ou rťfuter des opinions. Des opinions? Ton
poŽte t'avait bien recommandť de ne pas te compromettre ŗ en avoir une.
Qui? moi? noir ou blanc? Ma foi non!
La dictature est venue et tu as regardť passer, les bras croisťs, la
fortune comme un spectacle! Que t'importe ŗ toi ce qui passe dans la
rue, pourvu que l'or roule, que le verre ťcume, que la courtisane
chante, et que la baÔonnette ťtincelle au soleil? car, il faut te rendre
justice, la bravoure est la seule incorruptibilitť de ta race!
En littťrature tu n'as pas cessť de railler depuis dix ans toutes ces
vieilleries de religiositťs, de philosophie, de spiritualisme,
d'ťloquence, de lyrisme, de philanthropie, de politique, bulles de savon
colorťes, selon toi, tantŰt des rayons de nos vaines imaginations,
tantŰt du sang de nos veines! Tu n'as pas cessť de relťguer dans le pays
des songes creux et des chimŤres tous ces poŽtes, tous ces publicistes,
tous ces historiens, tous ces orateurs qui avaient le malheur de dater
de plus haut que toi dans la vie, d'Ítre nťs ŗ des ťpoques oý l'‚me se
rattachait ŗ l'antiquitť par l'ťtude des grands exemples, et oý l'on
croyait bÍtement ŗ autre chose qu'ŗ _Ninette_ ou _Ninon_! Tu te vautrais
dans ton prosaÔsme, tu te p‚mais d'aise pour ton _Rabelais_, tu te
ch‚trais le coeur avec ton _Don Juan_, tu te pervertissais l'esprit avec
ton _Heine_! Tu ne reconnaissais pour philosophe que _Stendal_ et pour
maÓtre que Musset, et tu te targuais d'avance tous les matins des
oeuvres inouÔes que tu couvais sur ton oreiller inspirateur entre une
nuit d'orgie et une aurore de paresse!
Moi-mÍme, je l'avoue, ťtonnť de tes forfanteries de coeur et d'esprit,
j'attendais, avec une admiration toute prÍte ŗ t'applaudir, ces
chefs-d'oeuvre de nouveautť, promis par tes prťsomptueux pressentiments.
Nous avons attendu dix ans, et qu'avons-nous vu sortir de ces ťcoles de
Byron, de Heine, de Musset? Une foule d'imitateurs grimaÁant des gr‚ces,
naturelles chez ces grands artistes, affectťes chez vous! la platitude
systťmatique ou innťe se masquant pompeusement sous le nom prťtentieux
de _rťalisme_! la poťsie se dťgradant au tour de force comme une
danseuse de corde! les poŽtes oubliant le sens pour ne s'occuper que des
mŤtres ou des rimes de leurs compositions, et finissant par se glorifier
eux-mÍmes du nom de _funambules_ de la poŽsie! un jeu, en un mot, au
lieu d'un talent! un effort, au lieu d'une gr‚ce! un caprice, au lieu
d'une ‚me! une profanation, au lieu d'un culte! un sacrilťge, au lieu
d'une adoration du bien et du beau dans l'art? Y a-t-il lŗ de quoi tant
se vanter de sa jeunesse, et de quoi tant mťpriser ses pŤres?
Royer-Collard s'ťcriait que ce qui manquait ŗ la jeunesse de son temps,
c'ťtait le respect des supťrioritťs: ne pourrait-on pas vous dire ŗ
vous que ce qui vous manque aujourd'hui, c'est le respect de vous-mÍmes?
Et nous qui vieillissons aujourd'hui, sommes-nous fondťs ŗ vieillir du
moins avec espťrance?
Et comment bien espťrer encore de ce rťveil de ton ‚me, Ű Jeunesse dorťe
de Musset, Jeunesse ŗ qui tes poŽtes eux-mÍmes, tes poŽtes ťpicuriens,
chantres jadis des nobles passions, baladins de paroles aujourd'hui,
prÍchent l'indiffťrence, le boudoir et la coupe pour toute vťritť?
Comment bien espťrer de ton ‚me, quand la lťgislation de ton
enseignement national dťcrŤte elle-mÍme la suppression facultative de
l'ťtude des lettres humaines qui font l'homme moral, au profit exclusif
de l'enseignement mathťmatique qui fait l'homme machine? Crois-tu fonder
ainsi une civilisation pensante sur le chiffre qui ne pense pas? Ne
sens-tu pas qu'un pareil systŤme n'est propre qu'ŗ dťgrader d'autant la
pensťe dans le monde? Ne sais-tu pas ce que c'est que l'‚me d'un peuple?
L'‚me d'un peuple n'est pas ce chiffre muet et mort ŗ l'aide duquel il
compte des quantitťs et mesure des ťtendues; un calcul n'est pas une
idťe: la toise et le compas en font autant! L'‚me d'un peuple, c'est sa
littťrature sous toutes ses formes: religion, philosophie, langue,
morale, lťgislation, histoire, sentiment, poťsie! Si tu laisses diminuer
dans ton enseignement la part immense et principale qui doit appartenir
ŗ la pensťe dans l'homme, c'est ton ‚me elle-mÍme que tu diminues pour
toi et pour les gťnťrations qui naÓtront de toi; et quand on aura
diminuť ainsi l'‚me de cette grande nation intellectuelle, c'est sa
place dans le monde et dans les siŤcles que vous aurez faite plus petite
avec votre propre compas! Ce n'est pas en chiffres morts, c'est en
lettres vivantes et immortelles que le nom franÁais a ťtť ťcrit sur la
face du globe!
Voilŗ pourtant ŗ quoi tu applaudis, Jeunesse atteinte jusque dans ta
moelle! Voilŗ de quoi tu te rends complice: tu dťsertes les lettres pour
les chiffres, tu affectes, ŗ l'exemple de tes corrupteurs en prose et en
vers, le dťdain du beau, l'estime exclusive de l'utile, l'insouciance
des institutions qui font l'avenir, le mťpris pour ces noms littťraires
et politiques qui te restent encore comme des reproches vivants de ta
mollesse, ťcrivains, orateurs, philosophes, poŽtes, qui n'ont de vieux
que leurs services, leur expťrience et leurs gloires! Ces gloires
t'offusquent, tu aimes mieux les insulter que les atteindre! Prends
garde! cela porte malheur de dťshonorer ses pŤres!
Il en fut exactement ainsi ŗ Rome du temps de Cťsar. Tu pourrais le lire
dans Cicťron, si tu n'aimais mieux lire la ballade _ŗ la Lune_ ou les
facťties de tes pamphlťtaires que _le Songe de Scipion_; toute la
jeunesse romaine, aprŤs les longues guerres civiles, sťduite par l'ťclat
des armes et par les robes flottantes de Cťsar, d'Antoine, de Dolabella,
fut prise d'un ťpicurťisme insolent, d'une insouciance pour les lettres,
et d'un mťpris pour les choses cultivťes et honorťes jusque-lŗ, qui
devaient prťcipiter vite la ruine morale de l'Italie; il ne resta du
parti des patriciens de la vieille libertť et de la vieille austťritť
romaines, que des tÍtes chauves abandonnťes par les idol‚tres de la
gloire militaire et raillťes par les poŽtes lascifs du plaisir et de la
jeunesse, tels que le l‚che Horace qui avait jetť son bouclier. Mais ces
tÍtes chauves ťtaient les _Scipion_, les _Caton_, les _Cicťron_, les
noms par qui Rome vivait et vivra dans les lettres, dans le coeur et
dans la mťmoire des hommes de bien de tous les ‚ges futurs.
Prends garde, encore une fois, Ű prťsomptueuse et folle Jeunesse de
l'ťcole des sens, qu'il n'en soit ainsi de toi-mÍme! Prends garde que
les tÍtes mŻres, sur lesquelles tu jettes la poussiŤre de tes mťpris, ne
dominent encore de toute la hauteur d'un autre temps les cheveux
couronnťs de roses; ce serait lŗ le symptŰme fatal de l'abaissement du
niveau de l'intelligence nationale et de la diminution des proportions
de l'‚me parmi nous; car ce qu'il y a de plus dťplorable et de plus
irrťmťdiable dans un peuple, c'est quand la jeunesse du coeur se rťfugie
sous les cheveux blancs!
LAMARTINE.
_P. S._ Lis avec moi maintenant ces pages de ton poŽte favori, pour
apprendre de lui comment on _dťlire avec gr‚ce_, et dťchires-en ensuite
plus de la moitiť, pour apprendre qu'on ne doit chanter que ce qui est
digne d'Ítre pensť, et que la littťrature de l'‚me est plus impťrissable
que la littťrature des sens.
Paris.--Typographie de Firmin Didot frŤres, fils et Cie, 56, rue Jacob.
End of the Project Gutenberg EBook of Cours Familier de Littťrature (Volume
3), by Alphonse de Lamartine
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COURS FAMILIER ***
***** This file should be named 25276-8.txt or 25276-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/2/5/2/7/25276/
Produced by Mireille Harmelin, Christine P. Travers and
the Online Distributed Proofreading Team at
http://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the BibliothŤque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected]. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
[email protected]
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

Cours familier de Littérature - Volume 03
Subjects:
Download Formats:
Excerpt
The Project Gutenberg EBook of Cours Familier de Littťrature (Volume 3), by
Alphonse de Lamartine
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Cours Familier de Littťrature (Volume 3)
Un Entretien par Mois
Read the Full Text
— End of Cours familier de Littérature - Volume 03 —
Book Information
- Title
- Cours familier de Littérature - Volume 03
- Author(s)
- Lamartine, Alphonse de
- Language
- French
- Type
- Text
- Release Date
- May 1, 2008
- Word Count
- 91,306 words
- Library of Congress Classification
- PN
- Bookshelves
- France, FR Littérature, Browsing: History - General, Browsing: Literature, Browsing: Politics
- Rights
- Public domain in the USA.
Related Books
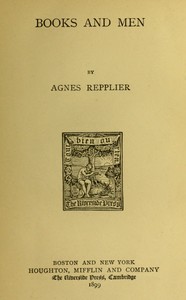
Books and men
by Repplier, Agnes
English
718h 50m read
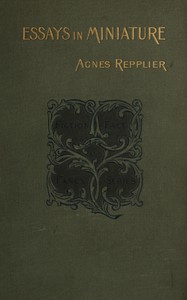
Essays in miniature
by Repplier, Agnes
English
654h 6m read
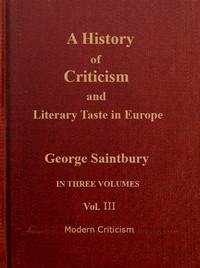
A history of criticism and literary taste in Europe, from the earliest texts to the present day. Volume 3 (of 3), Modern criticism
by Saintsbury, George
English
4284h 37m read

Literary values, and other papers
by Burroughs, John
English
1145h 7m read
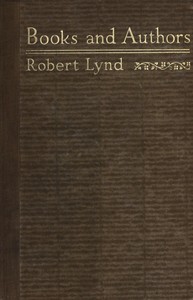
Books and authors
by Lynd, Robert
English
1092h 25m read
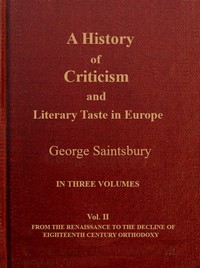
A history of criticism and literary taste in Europe from the earliest texts to the present day. Volume 2 (of 3), From the Renaissance to the decline of eighteenth century orthodoxy
by Saintsbury, George
English
3898h 3m read